Le Nerf grand hypoglosse (XII)
Le Nerf grand hypoglosse (XII)
I. Introduction
- La douzième paire des nerfs crâniens.
- Nerf exclusivement moteur.
- Innerve tous les muscles de la langue, tous les muscles du groupe sous-hyoïdien (sterno-thyroïdien, thyro-hyoïdien, sterno-cléido-hyoïdien, omo-hyoïdien) et le muscle génio-hyoïdien du groupe sus-hyoïdien.
- Rôle important dans la mastication, la succion, la parole et la déglutition.
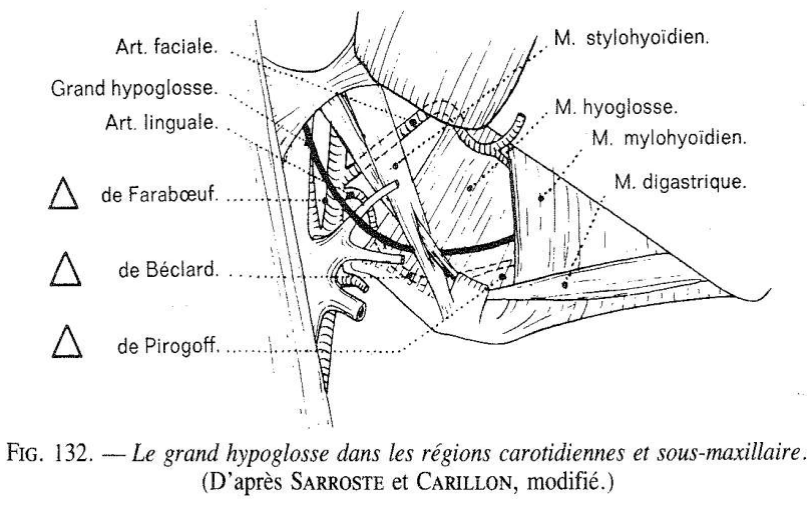
II. Anatomie descriptive
1. Origine réelle
- Noyau principal (noyau lingual):
- Colonne de substance grise s’étendant sur les 2/3 de la hauteur du bulbe.
- Fibres se portent en avant et en dehors, passant entre :
- En dedans: Bandelette longitudinale postérieure, ruban de REIL médian, faisceau pyramidal.
- En dehors: Noyau ambigu, olive bulbaire.
- Sortie par le sillon pré-olivaire du bulbe.
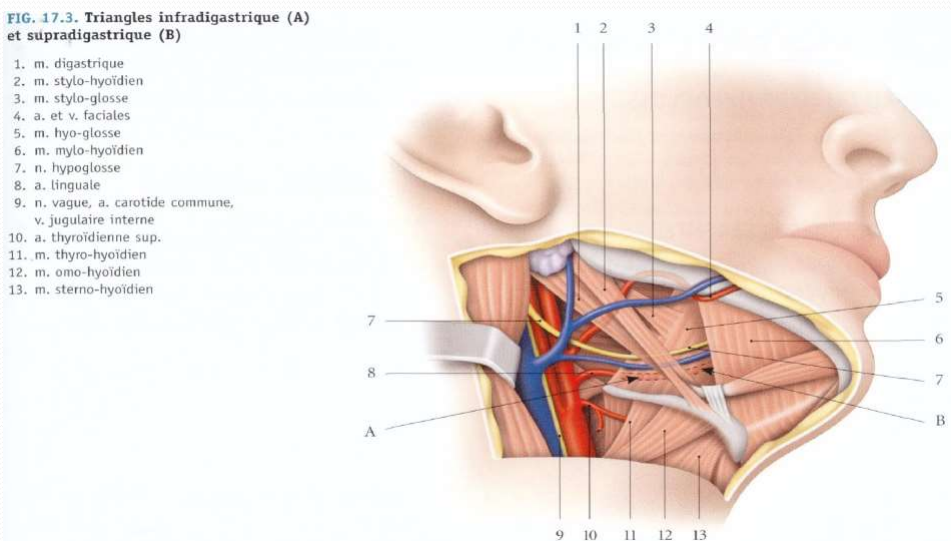
2. Origine apparente
- Émerge du sillon collatéral antérieur du bulbe (sillon pré-olivaire).
- Formé par 10 à 12 racines convergentes :
- Racine inférieure proche de la racine antérieure du 1er nerf cervical.
- Racine supérieure distante de 4 mm de la protubérance.
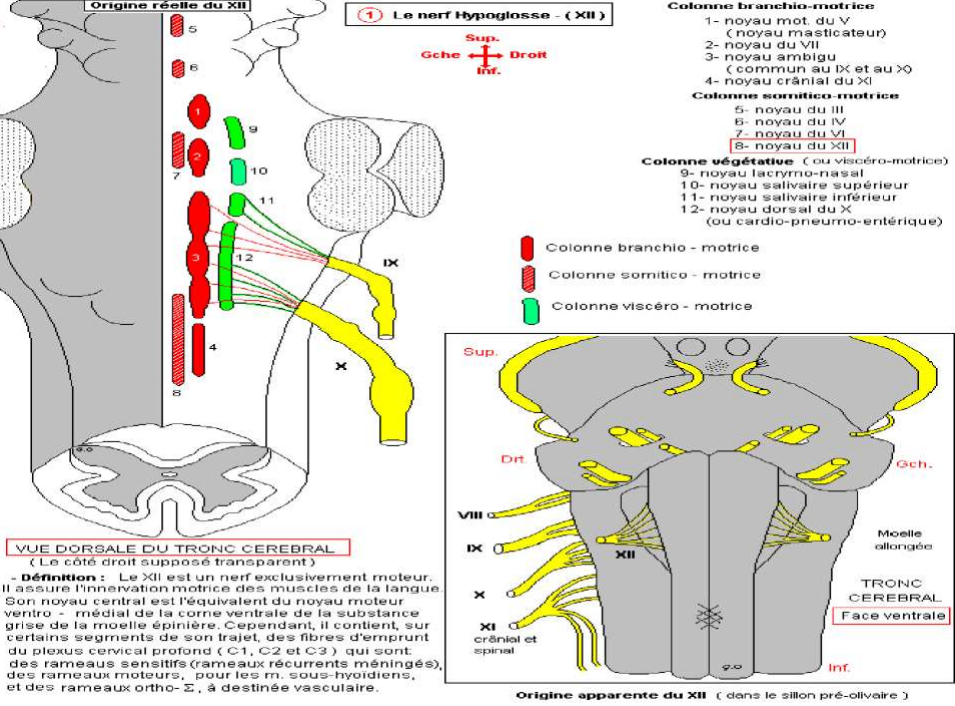
3. Trajet
Comprend six segments :
- Segment intracrânien dans l’étage postérieur du crâne.
- Traversée du canal condylien antérieur.
- Espace rétrostylien.
- Région carotidienne.
- Région submandibulaire.
- Région sublinguale.
- Décrit une courbe à concavité antérosupérieure.
4. Terminaison
- Se termine sur la face latérale de la langue par épanouissement en filets multiples.
III. Rapports
1. Dans l’étage postérieur de la base du crâne
- Filets radiculaires convergent vers le canal condylien antérieur.
- Rapports :
- En arrière: Face antérieure du bulbe, olive, origine des IX, X et XI.
- En avant: Masses latérales de l’occipital.
- En haut: Pédicule acoustico-facial.
- En bas: Artère vertébrale.
2. Dans le canal condylien antérieur
- Contient le XII, rameau récurrent méningé, méningée postérieure et plexus veineux condylien antérieur.
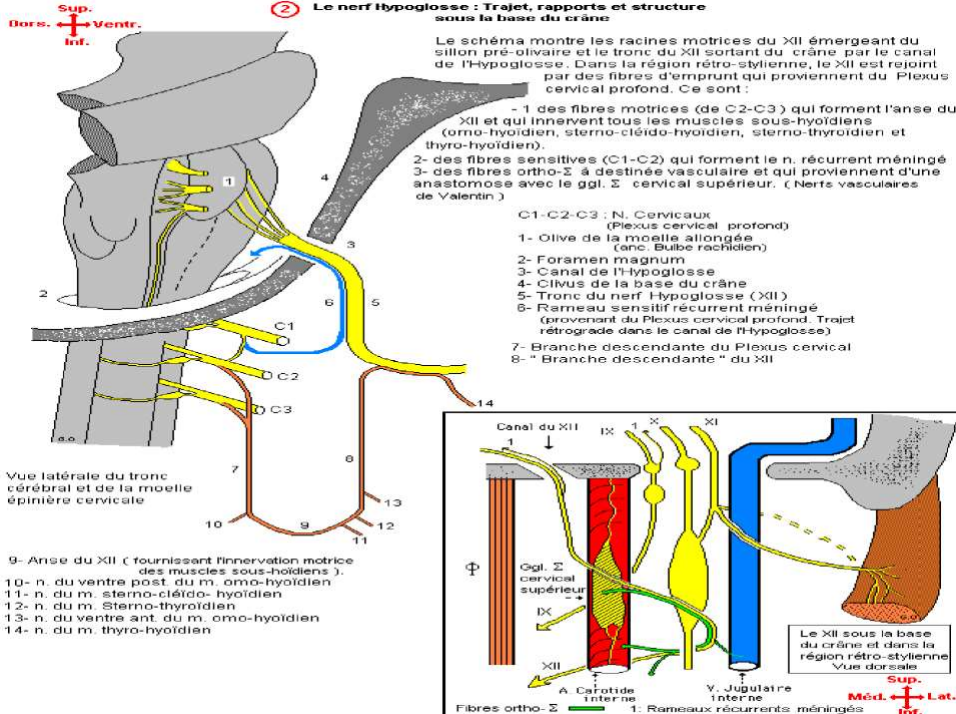
3. Dans l’espace rétrostylien
- Élément le plus interne et postérieur.
- Rapports :
- Paquet vasculaire (carotide interne, jugulaire interne).
- Nerfs mixtes (IX, X, XI).
- Ganglion sympathique cervical supérieur.
4. Dans la région carotidienne
- En dehors : chaîne ganglionnaire jugulaire interne.
- En dedans : surcroise les carotides interne et externe.
5. Dans la région submandibulaire
- Élément le plus profond.
- Rapports :
- En dehors : veine linguale superficielle, glande submandibulaire.
- Au-dessus : nerf lingual.
- En dedans : artère linguale et veines linguales profondes.
6. Dans la région sublinguale
- Pénètre entre l’hyoglosse (dedans) et le mylo-hyoïdien (dehors).
- Accompagné par le canal de Wharton et la glande submandibulaire.
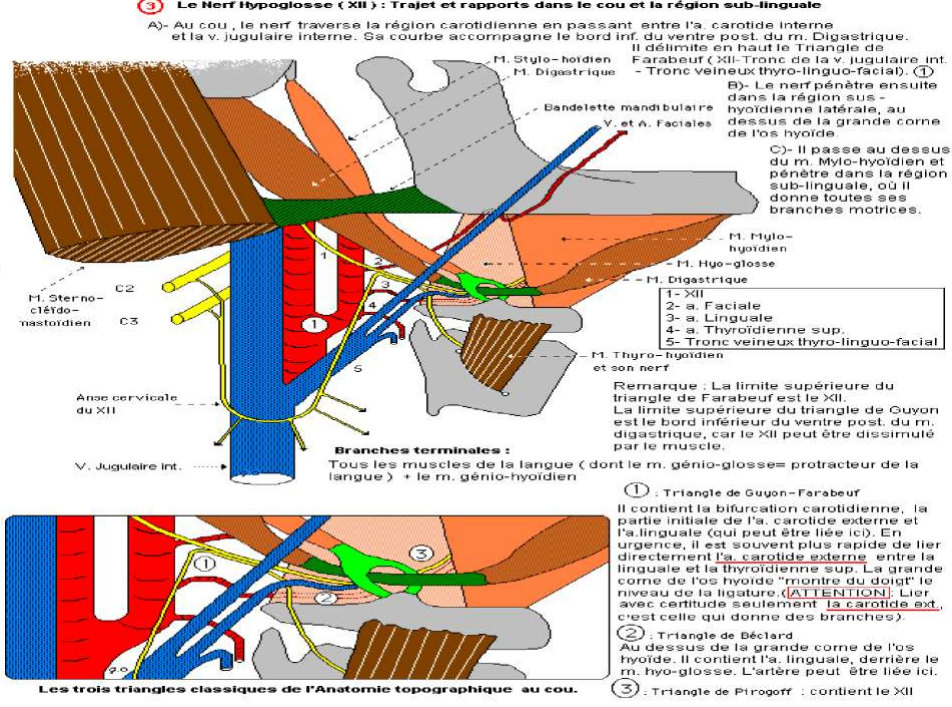
IV. Distribution
1. Branches collatérales
- Rameau méningé: Innerve la dure-mère de la fosse postérieure.
- Racine supérieure de l’anse cervicale:
- Donne des rameaux pour les muscles sterno-hyoïdien, omo-hyoïdien et sterno-thyroïdien.
- Nerfs du muscle thyro-hyoïdien.
2. Branches terminales
- Se divisent au niveau de l’hyoglosse, innervant tous les muscles de la langue.
3. Anastomoses
- Avec le tronc sympathique cervical, nerf vague, nerf lingual, nerf cervical C1 et nerf phrénique.
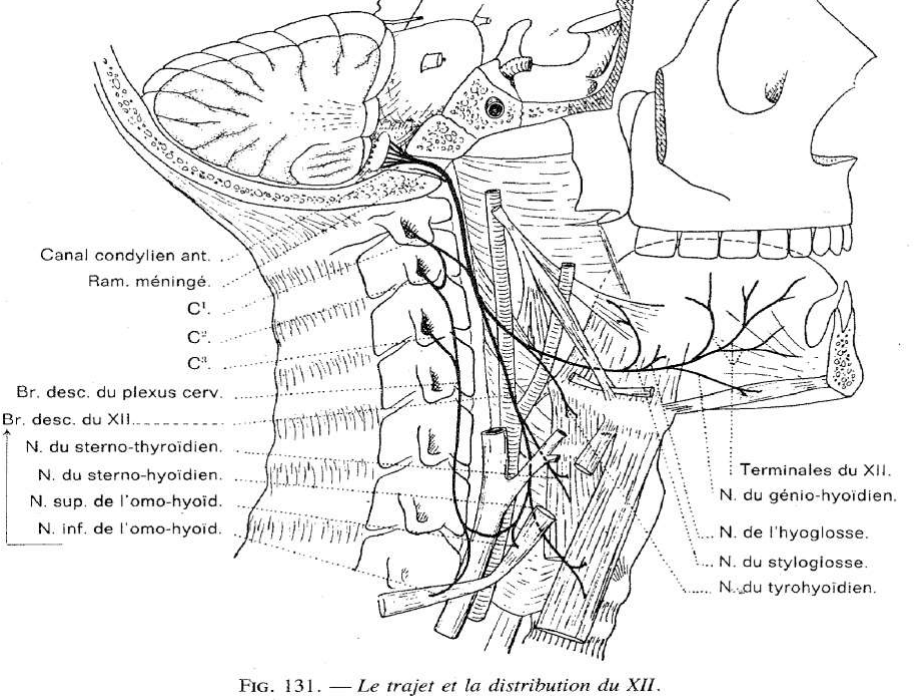
V. Systématisation
- Connexions centrales:
- Écorce de la partie inférieure de la circonvolution frontale ascendante.
- Centre de motricité linguale en avant du centre masticateur.
- Noyau principal: Colonne de 2 cm, située dans le plancher du IVème ventricule.
- Fibres radiculaires: Courbe à concavité externe, passant entre olive bulbaire et ruban de Reil.
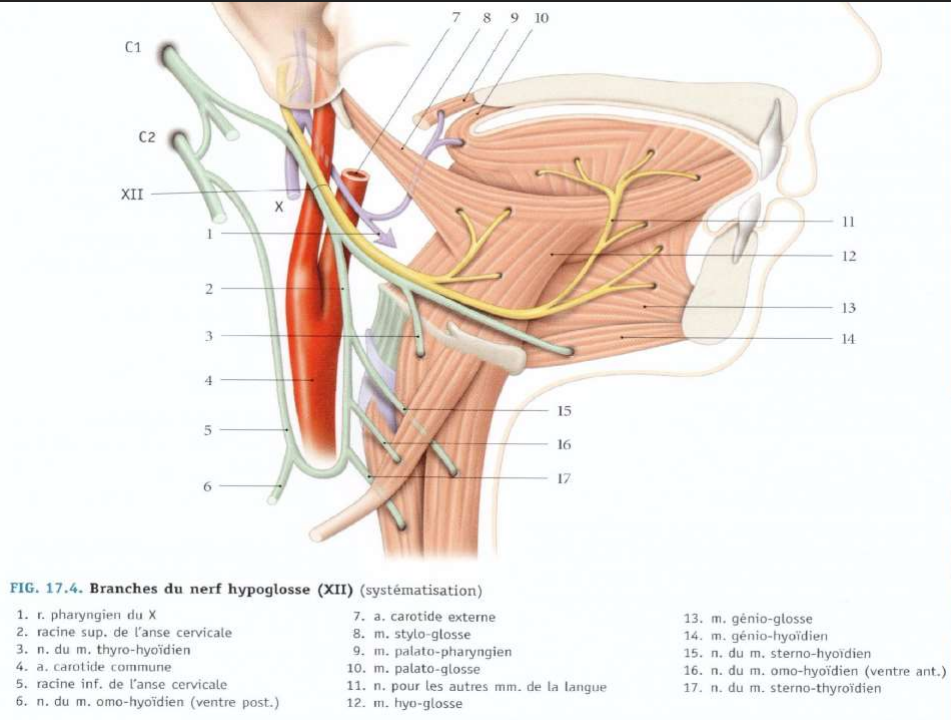
VI. Conclusion
- Lésion centrale supranucléaire:
- Paralysie linguale controlatérale.
- Déviation de la langue du côté opposé à la lésion lors de la protraction.
- Lésion nucléaire ou périphérique:
- Paralysie linguale ipsilatérale.
- Déviation de la langue du même côté que la lésion.
- Paralysie bilatérale:
- Langue immobile, déglutition impossible, phonation très troublée.
Exploration
- Radiographie de la base du crâne: Projection du canal condylien.
- TDM et IRM: Pour visualiser les lésions.
Le Nerf grand hypoglosse (XII)
Voici une sélection de livres:
Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché
Concepts cliniques en odontologie conservatrice
L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement
Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve


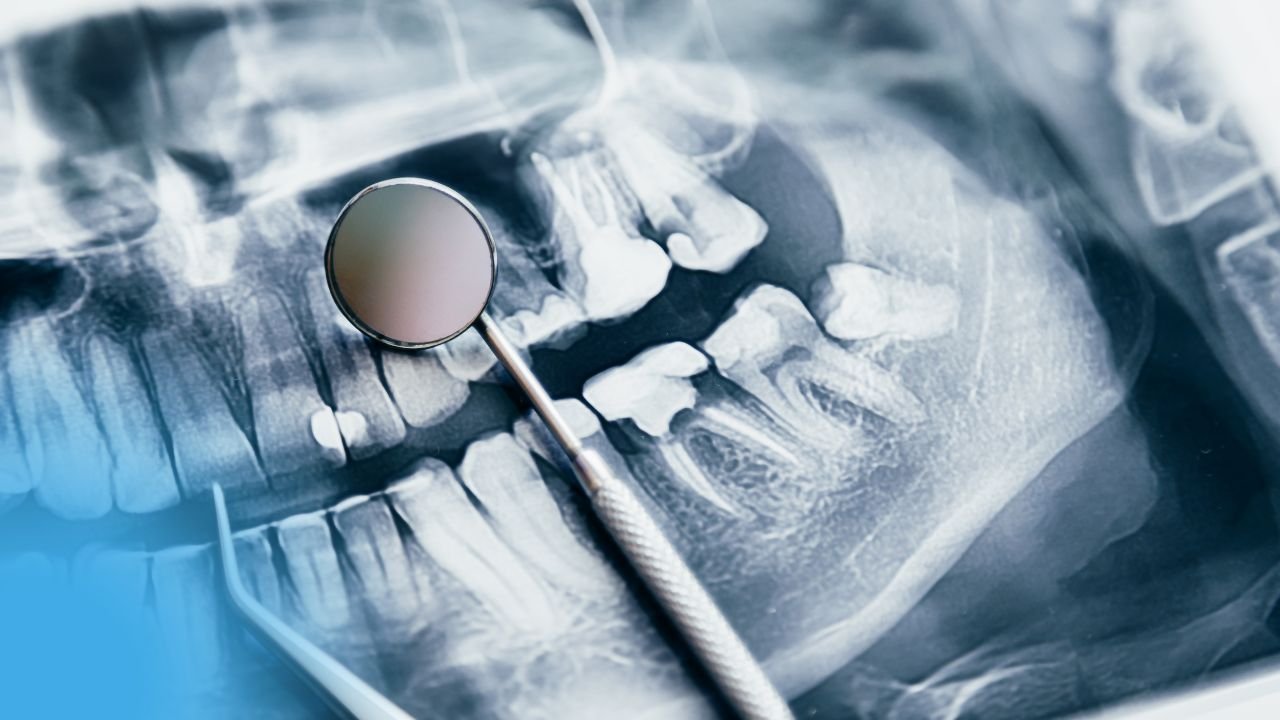

Leave a Reply