L’examen Clinique (Parodontologie)
L’examen Clinique (Parodontologie)
I- Introduction
La maladie parodontale est une affection compliquée de par son étiologie multifactorielle d’un côté et de la diversité et la richesse de son tableau clinique de l’autre côté. Ceci requiert un examen clinique méticuleux et détaillé faute de quoi le praticien mal averti peut omettre des éléments à caractère capital pour poser un diagnostic correct permettant l’élaboration du plan de traitement convenable.
L’examen clinique se défini comme étant l’ensemble des investigations et gestes cliniques effectués en présence du patient et menant à la fin à la pose d’un diagnostic correct. L’examen clinique peut être confirmé en cas de besoin par des examens complémentaires, qui ne remplaceront en aucun cas l’examen clinique.
II- Anamnèse
Un questionnaire est effectué afin :
- d’établir un bon contact avec le patient,
- déceler d’éventuels antécédents généraux ou stomatologiques ayant une relation quelconque avec la maladie parodontale,
- définir le motif de consultation et tracer l’histoire de la maladie.
III- Examen Exo-Buccal
À pour but d’examiner l’état général du patient, sa posture et examiner l’état de l’appareil manducateur. Il comprend deux étapes :
1- L’Inspection
- Symétrie faciale
- Coloration des téguments
- Les lèvres
2- La Palpation
- Des muscles
- Des ATM (Articulations Temporo-Mandibulaires)
- Des chaînes ganglionnaires
IV- Examen Endo-Buccal
1- L’Ouverture Buccale
Évaluée à 3 travées du doigt du patient, elle peut être :
- Insuffisante : dans le cas de trismus qui est le risque de la présence d’un foyer inflammatoire tel qu’une péricoronarite, cellulite, ostéite ou le SADAM ainsi qu’une lésion traumatique.
- Exagérée : signe d’une luxation mandibulaire.
2- L’Hygiène Bucco-Dentaire
Elle peut être bonne, moyenne ou mauvaise. Il faut noter la présence de :
- PB (plaque bactérienne),
- débris alimentaire,
- la materia alba,
- tartre,
- pigmentation superficielle des dents.
On doit rechercher la corrélation entre ces facteurs locaux et la sévérité de l’inflammation existante. La mise en évidence de la PB se fait :
a- Cliniquement
Par l’utilisation :
- Révélateurs de plaque
- Les indices : ils permettent de chiffrer l’état d’hygiène bucco-dentaire et parmi ces indices :
- L’indice d’OHIS (de GREEN et VERMILLON 1964) : Après coloration avec un révélateur de plaque, on examine les faces vestibulaires des 16-11-21-26 et face linguale des 36-46. On note :
- Dépôts mous :
- 0 : pas de dépôt ni coloration
- 1 : dépôt ne recouvrant pas plus de 1/3 de la couronne clinique
- 2 : dépôt compris entre 1/3 et 2/3 de la couronne clinique
- 3 : dépôt couvrant plus de 2/3 de la couronne clinique
- Dépôts durs :
- 0 : pas de tartre
- 1 : tartre sus-gingival < 1/3 de la couronne clinique
- 2 : tartre sus-gingival < 2/3 de la couronne clinique avec présence de tartre sous-gingival
- 3 : tartre supra-gingival recouvrant > 2/3 de la couronne clinique et une bande continue de tartre sous-gingival
- Dépôts mous :
- Plaque Index de LOE et SILNESS :
- 0 : pas de PB
- 1 : la plaque ne se voit qu’après assèchement du SGD (sillon gingivo-dentaire)
- 2 : accumulation modérée de plaque visible après raclage de la surface dentaire avec la sonde
- 3 : accumulation importante de plaque
- L’indice d’OHIS (de GREEN et VERMILLON 1964) : Après coloration avec un révélateur de plaque, on examine les faces vestibulaires des 16-11-21-26 et face linguale des 36-46. On note :
b- Au Laboratoire
- Étude microscopique,
- cultures,
- test immunologique,
- test enzymatique,
- sonde ADN,
- microsonde d’ADN.
3- L’Écoulement Salivaire
L’examen de la salive doit porter sur l’étude du flux salivaire et du pH salivaire. La qualité et le débit salivaire jouent un rôle très important dans l’équilibre du milieu buccal.
4- L’État des Muqueuses
On doit noter toute modification dans l’état de la muqueuse buccale à la recherche d’un foyer infectieux ou tumoral. On doit examiner systématiquement :
- la muqueuse labiale,
- jugale,
- palatine,
- du plancher lingual,
- péri-pharyngienne.
V- L’Examen Parodontal
a- Examen Gingival
Évaluer la présence de l’inflammation gingivale et sa sévérité en recherchant les modifications de :
- la couleur,
- du contour,
- du volume,
- de l’aspect,
- la consistance,
- ainsi qu’une tendance accrue au saignement au niveau de la gencive.
Des systèmes d’indice ont été mis au point pour chiffrer le degré d’inflammation, parmi les indices les plus utilisés :
- Gingival Index GI (de LOE et SILNESS 1963) : On procède à un examen visuel des tissus gingivaux et on détermine la présence de saignement à l’aide d’une sonde parodontale :
- 0 : la gencive est saine
- 1 : légère inflammation, léger changement de forme et de couleur, pas de saignement au sondage
- 2 : inflammation modérée, rougeur, œdème, saignement au sondage et à la pression
- 3 : inflammation sévère, rougeur, œdème, tendance au saignement spontané éventuellement ulcération.
- Indice PMA (de SCHOUR et MASSLER 1947) :
- 0 : pas d’inflammation
- 1 : inflammation au niveau de la gencive papillaire
- 2 : inflammation au niveau de la gencive papillaire et marginale
- 3 : inflammation au niveau de la gencive papillaire, marginale et attachée
- Papillery Bleeding Index PBI (de SAXER et MUHLEMANN 1975) : Une sonde parodontale parcourt le sillon de la base de la papille jusqu’au sommet du côté mésial et distal suivant l’intensité du saignement observée après 30 sec :
- 0 : pas de saignement
- 1 : un seul point de saignement apparaît
- 2 : un liseré de saignement qui emplit le sulcus
- 3 : saignement abondant débordant le sulcus
- Sulcular Bleeding Index SBI (de MUHLMANN et SON) : Se fait en déplaçant la sonde dans le sulcus :
- 0 : gencive saine, pas de saignement
- 1 : saignement au sondage, pas de changement de couleur ou de contour
- 2 : saignement au sondage avec érythème
- 3 : saignement au sondage avec érythème et œdème moyen
- 4 : saignement au sondage avec érythème et œdème important
- 5 : saignement au sondage et spontané avec œdème important avec ou sans ulcération
La Hauteur de la gencive attachée :
Elle peut atteindre jusqu’à 9 mm et elle varie d’une zone à une autre. La limite entre la gencive kératinisée et la muqueuse alvéolaire est souvent visible, c’est la jonction mucco-gingival. L’absence de gencive attachée est synonyme d’une gencive libre vulnérable aux irritants et à l’inflammation.
b- Le Sondage du Sillon Gingivo-Dentaire
Chaque dent est sondée en 6 points (mésio-vestibulaire, vestibulaire, disto-vestibulaire, lingual, mésio-lingual, disto-lingual) à la recherche :
- de la présence et distribution des poches parodontales,
- type de la poche,
- la profondeur de la poche,
- les pertes d’attache,
- noter la récession.
- Fausse poche : la sonde ne pénètre pas plus apicalement que la Jonction Émail-Cément, donc c’est une augmentation du volume de la gencive libre sans migration de l’attache épithéliale.
- Vraie poche ou poche parodontale : augmentation de la profondeur du sillon gingivo-dentaire avec migration de l’attache épithéliale.
- Récession : c’est une migration apicale du rebord marginal de la gencive provoquant une dénudation radiculaire. On doit donner la forme de la récession et la hauteur en mm :
- Récession visible : la distance JEC – bord marginal de la gencive
- Récession cachée : c’est la profondeur de la poche
- Récession absolue ou réelle : c’est l’addition des mesures de la récession visible et cachée.
Parmi les classifications des récessions :
- Classification de BENQUER et col : Récession en I, en U et en V.
- Classification de MILLER 1985 :
- Cl I : la récession n’atteint pas la ligne muco-gingivale, il n’y a pas de perte tissulaire interdentaire
- Cl II : la récession atteint ou dépasse la ligne muco-gingivale, il n’y a pas de perte tissulaire interdentaire
- Cl III : la récession atteint ou dépasse la ligne muco-gingivale, il y a perte d’os interdentaire et le tissu gingival proximal est apical à la jonction amélo-cémentaire, tout en restant coronaire à la base de la récession ou bien il existe une malposition
- Cl IV : la récession atteint ou dépasse la ligne muco-gingivale, les tissus proximaux se situent au niveau de la base de la récession et celle-ci intéresse plus d’une face de la dent.
Suppuration :
Le pus est le résultat d’une destruction tissulaire importante. Le sondage est à proscrire en cas d’écoulement ou collection purulente, il sera réalisé ultérieurement sous couverture antibiotique.
c- Les Atteintes de Furcations
C’est une perte de substance située entre les racines d’une pluri-radiculaire. Lorsque la perte osseuse se produit au niveau des dents multiradiculées, la lyse peut mettre à nu les bifurcations ou trifurcations. L’exploration des furcations s’effectue à l’aide :
- d’une sonde à extrémité mousse type NABERS n°1 ou 2,
- ou bien à l’aide d’une sonde exploratrice n°23 courbe n°17.
Plusieurs classifications ont été proposées par les auteurs :
- Classification de GLICKMAN 1975 :
- Cl I : lésion débutante ; atteinte du ligament parodontal au niveau de la furcation sans évidence clinique ou radiologique de lyse osseuse
- Cl II : lésion partielle ; l’os est détruit au niveau d’une ou plusieurs faces de la furcation mais une partie de l’os alvéolaire et du ligament sont intacts, ce qui permet le passage partiel de la sonde
- Cl III : lésion totale ; la furcation peut être obturée par la gencive mais l’os a été détruit à un degré assez important pour permettre le passage total de la sonde dans le sens VL (vestibulo-lingual)
- Cl IV : passage de part en part de la sonde.
VI- Examen Dentaire
- La formule dentaire
- Lésion dentaire : on doit rechercher toutes les atteintes dentaires telles que fracture, fêlure, caries, dysplasie de l’émail, dystrophie et on doit tester la vitalité pulpaire.
- Les dents traitées et les restaurations iatrogènes
- L’hypersensibilité : ressentie par le patient au cours des modifications physique, chimique et thermique sur les faces radiculaires dénudées.
- L’abrasion : rencontrée dans les cas de surcharges occlusales, ces abrasions sont évaluées à l’aide d’indice :
- Indice d’abrasion selon AGUEL :
- 0 : pas d’abrasion
- 1 : abrasion au niveau de l’émail
- 2 : abrasion au niveau de l’émail avec apparition d’îlots de dentine
- 3 : abrasion au niveau de l’émail avec apparition d’une surface de dentine
- 4 : abrasion importante où la pulpe est vue par transparence
- 5 : mise à nu de la pulpe
- Indice d’abrasion selon AGUEL :
- La mobilité dentaire : à l’aide d’une précelle, on applique des pressions alternées sur les faces vestibulaire et linguale de chaque dent. Cette mobilité est évaluée avec un indice :
- Indice de mobilité selon ARPA :
- 0 : mobilité physiologique
- 1 : mobilité perceptible au doigt et non visible à l’œil
- 2 : mobilité perceptible au doigt et visible à l’œil inférieure à 1 mm
- 3 : mobilité perceptible au doigt et visible à l’œil supérieure à 1 mm dans le sens vestibulo-lingual
- 4 : mobilité dans tout le sens axial et transversal
- Indice de mobilité selon ARPA :
- Migration dentaire pathologique ou secondaire : le déplacement dentaire secondaire issu de la lyse osseuse ou d’une extraction dentaire est fréquemment observé dans le sens horizontal (diastème) et dans le sens axial (égression).
VII- L’Examen de l’Occlusion
On recherche les prématurités et interférences qui peuvent participer de façon indirecte dans le développement de la maladie parodontale.
VIII- L’Examen des Fonctions
On recherche tout dysfonctionnement pouvant atteindre :
- la déglutition,
- la mastication,
- la phonation,
- la respiration.
Sans omettre de noter l’existence d’éventuelles parafonctions.
IX- Les Examens Complémentaires
Sont multiples : radiologiques, biologiques, les photos, l’analyse des moulages, etc. Ils sont demandés en cas de besoin pour confirmer les résultats de l’examen clinique mais ne le remplacent pas.
Conclusion
Le traitement d’une maladie parodontale ne peut être réalisé sans avoir collecté l’information et les données nécessaires durant l’examen clinique. Si, au cas où cet examen n’a pas été exécuté au complet, le praticien encourt le risque de faire un choix erroné en ce qui concerne le diagnostic et sera induit en erreur en entamant un traitement peu efficace ou carrément inefficace.
L’examen Clinique (Parodontologie)
Voici une sélection de livres:
Parodontologie Relié – 1 novembre 2005
Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011
Parodontologie Broché – 19 septembre 1996
MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE
Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient
Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé
Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1
Endodontie, prothese et parodontologie
La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

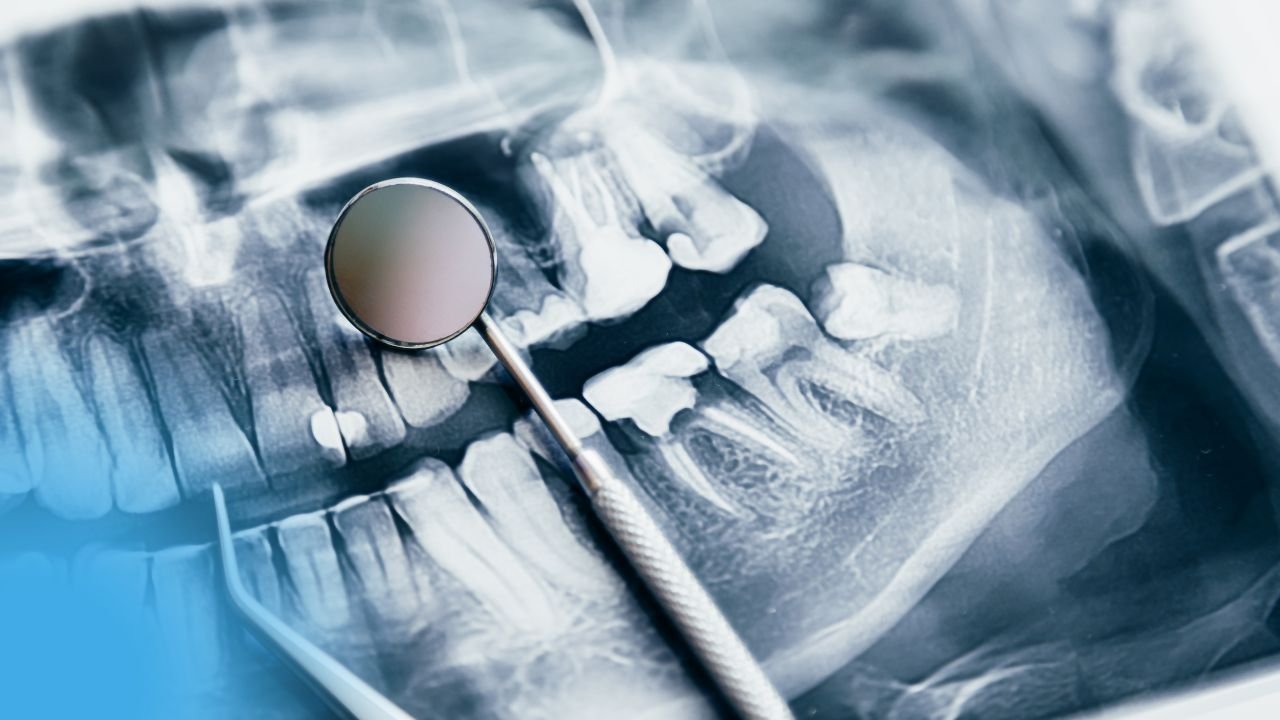


Leave a Reply