Thérapeutiques restauratricesadhésives : principes et techniques
Thérapeutiques restauratrices adhésives : principes et techniques
Thérapeutiques restauratrices adhésives : principes et techniques
Introduction
Les apports considérables de la dentisterie adhésive, en termes d’économie tissulaire, de biocompatibilité et d’esthétique, font partie de l’évidence clinique.
Définitions
Dentisterie adhésive
(ou micro-dentisterie, dentisterie a minima) : Spécificité de la dentisterie basée sur les capacités de collage des résines composites de telle façon à n’éliminer que la dentine infectée et ainsi remplacer les tissus dentaires détruits, y compris à un stade avancé, tout en conservant le maximum de tissu sain. A partir du moment où un matériau de restauration est collé aux structures dentaires, on peut être conservateur et on doit l’être autant que possible.
Restauration adhésive
Pièce prothétique ou obturation plastique conservatrice qui reconstitue la forme, la fonction et l’esthétique de la dent en faisant appel à des agents de couplage liant chimiquement et mécaniquement le matériau aux tissus dentaires.
Principe d’économie tissulaire
La conservation maximale des parties saines de la dent a permis l’évolution des interventions actuelles car elles sont le substrat même des techniques de collage et d’adhésion. La démarche devient alors plus biologique et moins mécaniste et assure ainsi la longévité de la dent restaurée.
Le maintien de la vitalité pulpaire
Est assuré par la conservation d’une cavité para-pulpaire garante de la protection pulpaire contre les agressions opératoires tout en permettant une fonction normale de la dent.
L’accès à la lésion carieuse
Doit permettre une économie tissulaire tant sur le plan quantitatif que qualitatif des structures poutres de la dent en ménageant l’émail périphérique. Les techniques actuelles ciblent donc la préparation des cavités sur le respect des tissus dentaires et non plus sur le matériau d’obturation.
L’adhésion
Les protocoles de collage permettent de nos jours de réaliser des adhésions assez puissantes sur l’émail et la dentine pour qu’elles soient durables dans le milieu buccal. Les progrès effectués en matière d’adhésion cherchent à réduire les infiltrations au niveau des interfaces.
Collage aux tissus dentaires
Les deux tissus constituant la dent, l’émail et la dentine, sont assez différents quant à leur composition chimique et leurs propriétés physiques. L’émail est un tissu dur et cassant, alors que la dentine est souple et plus tendre.
Spécificité de l’émail
Constitution
L’émail est le tissu le plus minéralisé du corps humain. Il est constitué de 96 % de matière minérale, 4 % d’eau et un peu de matière organique. La matière minérale s’organise en longs cristaux d’hydroxyapatite. Ces cristaux sont regroupés en faisceaux de prismes. Au sein des prismes, les cristaux d’hydroxyapatite sont orientés parallèlement au grand axe du faisceau, et selon une orientation différente au sein de la substance inter-prismatique. Cette substance inter-prismatique permet la cohésion des prismes entre eux. Les prismes prennent leur origine à la jonction amélo-dentinaire et rejoignent la surface de la couronne. La matrice organique est constituée de glycoprotéines et de polysaccharides.
Mode d’adhésion
C’est le Dr Michael Buonocore qui, le premier, mit en évidence qu’un acide pouvait altérer la surface de l’émail dentaire et permettre un collage par une résine. La dissolution plus importante du cœur des prismes va en effet créer un microrelief à la surface de l’émail. Une résine peut ensuite s’infiltrer dans ces anfractuosités créées et assurer une adhésion par clavetage mécanique.
Spécificité de la dentine
Constitution
La dentine est une matrice extracellulaire sécrétée par les odontoblastes qui se calcifie par l’accumulation d’hydroxyapatite. Elle est au final moins minéralisée que l’émail. Elle est parcourue par de fins tubules (50 000/mm²). Ces canalicules sont perpendiculaires à la jonction pulpo-dentinaire et contiennent de fins prolongements cytoplasmiques des odontoblastes. Ces prolongements cellulaires sont à l’origine de la sensibilité de la dentine aux stimuli (chaud, froid, contact).
Mode d’adhésion
Beaucoup moins minéralisée que l’émail et différemment organisée, la dentine ne permet pas de créer un relief à sa surface par une attaque acide (Figure 1). De plus, la présence d’eau, notamment dans les prolongements cellulaires, n’est pas favorable à un bon contact entre la résine et la dentine. La clef de l’adhésion dentinaire réside dans la possibilité de pénétrer les tubuli dentinaires par l’adhésif. Ces prolongements intratubulaires (Figure 2) (tags) vont ancrer mécaniquement la résine à la dentine. Une autre part importante de la rétention est obtenue par infiltration par l’adhésif des fibres de collagène de la surface préparée de la dentine. Il se crée ce que l’on nomme la couche hybride. Quand les tubuli se font rares, l’adhésion est principalement assurée par la couche hybride.


Mise en œuvre
Si l’adhésion à l’émail est un phénomène maîtrisé depuis fort longtemps, il en est autrement du traitement adhésif de la dentine. Il est tentant d’exploiter au mieux la présence naturelle d’un réseau de tubuli afin d’ancrer la résine dans la dentine. Cet ancrage mécanique est cependant rendu aléatoire par deux facteurs :
- Le premier est l’exsudation par les tubuli d’un fluide plasmatique sous l’effet de la préparation tissulaire. Il est concrètement impossible de sécher la surface dentinaire.
- Le second élément est que ces canalicules vont être en partie obturés par l’accumulation de résidu de préparation : la « boue dentinaire ».
La boue dentinaire
La boue dentinaire est une pellicule constituée d’une matrice, formée à partir d’un mélange de collagène dénaturé et d’eau d’origine dentinaire, dans laquelle seraient incorporés des cristaux d’hydroxyapatite arrachés lors du fraisage. D’autres éléments d’origine exogène sont également présents tels que la salive, du sang et des micro-organismes. L’épaisseur de cette couche varie de 0,5 à 1,5 μm. Cet enduit recouvre la dentine et obture les tubuli dentinaires. Il pénètre plus ou moins profondément dans ceux-ci et crée des bouchons canaliculaires.
On a longtemps pensé que l’on devait conserver cette boue dentinaire qui, en obturant les tubuli, permettait un collage sur une surface sèche. Cependant, la boue dentinaire n’est que faiblement adhérente à la dentine (5 MPa) et limite l’ancrage à cette valeur. De plus, la conservation de la boue dentinaire limite la profondeur d’infiltration de la résine dans les tubuli dentinaires. La présence de bactéries est inévitable dans cette boue dentinaire, et peut être à l’origine d’agression pulpaire.
Au niveau de la dentine, l’acide de mordançage a un double rôle de déminéralisation de surface et d’élimination par dissolution de la boue dentinaire obstruant les tubuli, permettant un ancrage profond (brides résineuses) de l’adhésif au niveau des canalicules.
Traitement de la dentine
Il faut ensuite traiter la surface de la dentine avec un liquide de conditionnement appelé « primer » afin d’assurer une pénétration de résine dans les tubuli. La composition du primer est en général la suivante :
- Un acide faible (citrique, maléique, phosphorique, nitrique, succinique ou éthylène diamine tétra-acétate [EDTA]), qui dissout les boues dentinaires de façon à dégager la dentine sous-jacente.
- De l’hydroxyéthyle de méthacrylate (HEMA) ou du dimétacrylate hydrophile : l’HEMA possède une fonction hydroxyle hydrophile, capable de se lier au collagène, et une extrémité méthacrylate pouvant se polymériser avec les monomères hydrophobes contenus dans l’adhésif (Figure 3).
- Un solvant qui augmente la mouillabilité de surface.

Le primer est un agent promoteur d’adhésion, ayant pour rôle de permettre une bonne pénétration des monomères adhésifs au sein de la matrice collagénique et des tubuli en remplaçant le milieu aqueux hydrophile par un milieu hydrophobe propice à la diffusion de la résine. Sa petite taille ainsi que son caractère partiellement hydrophile lui permettent une bonne diffusion au niveau des tubuli.
Il est ensuite nécessaire de traiter la dentine avec un adhésif qui va alors induire un changement structural de celle-ci. L’agent de couplage ou « bonding » est utilisé. Il s’agit d’une molécule organique ou organo-minérale avec deux sites actifs :
- Un site pouvant réagir avec la surface dentinaire.
- Un autre pour interagir avec le composite de collage.
Ainsi, nous obtenons une adhésion intime entre les différents matériaux en présence.
Classification des adhésifs
La notion de génération d’adhésifs n’a plus de sens aujourd’hui et la classification qui s’y référait est abandonnée car elle ne prenait pas en compte le mode d’action ni l’efficacité de ces produits.
On distingue deux grandes classes d’adhésifs :
- M&R (Mordançage et Rinçage) : Ceux qui sont appliqués après mordançage à l’acide orthophosphorique puis rinçage des surfaces dentaires.
- SAM (Systèmes Auto-Mordançants) : Ceux qui ne requièrent pas de mordançage, ils possèdent un caractère acide intrinsèque qui leur permet d’attaquer et de pénétrer simultanément les tissus dentaires.
Types d’adhésifs
On peut distinguer dans chaque classe 2 types d’adhésifs en fonction du nombre de séquences de mise en œuvre :
- M&R :
- M&R3 : Mordançage-rinçage, puis application du « primer », puis de la résine adhésive « bonding ».
- M&R2 : Regroupent le conditionnement « primer » et l’adhésif, simplifiant la procédure.
- SAM :
- SAM2 : Implique le dépôt en premier d’un « primer » qui contient des monomères acides et de l’eau qui va conditionner les surfaces dentaires, cette première couche est simplement séchée, sans rinçage, suivie par l’application du « bonding ».
- SAM1 : Contiennent des mélanges de primer acide et de « bonding », ils ne requièrent qu’une seule séquence d’application.
Avantages et inconvénients des M&R et des SAM
Les systèmes M&R
- Avantages : L’emploi préalable d’acide orthophosphorique leur confère un bon potentiel d’adhésion à l’émail.
- Inconvénients :
- La mise en œuvre est assez longue, avec les séquences préalables du mordançage à l’acide orthophosphorique et du rinçage. La multiplicité des étapes est une source d’erreur potentielle.
- Le rinçage peut occasionner un saignement inopiné d’une gencive inflammatoire au voisinage d’une préparation pas toujours bien isolée, d’où contamination des surfaces préparées.
- Ils peuvent entraîner des sensibilités post-opératoires. Leur application doit se faire sur une dentine un peu humide mais pas trop, ce qui n’est pas facile à maîtriser.
Les SAM
- Avantages :
- Plus simples et plus souvent plus rapides de mise en œuvre grâce à la suppression de la séquence de rinçage.
- L’absence de rinçage réduit la probabilité de contamination sanguine des préparations et diminue considérablement le risque de sensibilités post-opératoires, puisque la boue dentinaire n’est pas éliminée mais consolidée et étanchéifiée. Les bouchons qu’elle forme au niveau des orifices tubulaires sont assez hermétiques pour éviter les mouvements de fluides dentinaires générateurs de sensibilité.
- Inconvénients :
- Les SAM contiennent nécessairement de l’eau, nécessaire à l’ionisation de ses composants acides. La présence de l’eau dans leur composition peut entraîner une dégradation de certains de leurs constituants par hydrolyse, ayant pour conséquence une perte d’efficacité.
- La persistance d’eau résiduelle après séchage dans le joint adhésif peut nuire à la qualité de sa polymérisation, donc à sa résistance.
- Les SAM ont un caractère moins acide que l’acide phosphorique. Leur capacité de mordançage sur l’émail est plus faible que celle des M&R, donc leur adhérence aussi. Il est toutefois possible d’optimiser leur adhésion à l’émail en effectuant un mordançage à l’acide phosphorique préalable des marges d’émail, mais uniquement des marges d’émail, ce qui complique la procédure.
Globalement, les M&R et les SAM sont assez complémentaires puisque les inconvénients des uns correspondent aux avantages des autres. Ainsi, le praticien devrait disposer d’un système adhésif de chaque classe pour pouvoir répondre aux particularités de chaque situation clinique.
Adhésifs universels
Au fil des années, les fabricants ont cherché à rendre les systèmes adhésifs plus simples et plus fiables, tout en gardant les mêmes propriétés. Des adhésifs universels ont donc été proposés et montrent un réel intérêt dans leur polyvalence à être utilisés comme M&R, SAM ou de façon combinée.
- Première définition : Ces adhésifs sont efficaces avec ou sans mordançage préalable des structures dentaires (utilisation avec mordançage comme un système M&R, ou sans mordançage comme un système SAM).
- Seconde définition : Ces adhésifs universels sont applicables sur les structures dentaires mais aussi sur les intrados prothétiques.
En technique indirecte, ils ne présentent pas tous le même champ d’application, certains étant adaptés à de plus nombreux matériaux (composite, céramique, alliage, métaux précieux et non précieux), d’autres étant adaptés pour la réparation de prothèses fixées en bouche. Pour un adhésif universel, les fabricants indiquent que nous pouvons travailler avec un mordançage sélectif, total ou sans mordançage (auto-mordançant), et que nous pouvons traiter différents substrats, dentaires ou prothétiques. Ainsi, le système universel est présenté comme peu sensible à la manipulation de l’opérateur.
La différence entre le SAM1 et l’universel tient au fait que l’universel contient du MDP (Dihydrogénophosphate de méthacryloyloxydécyl) et non pas du MHP (Phosphoric acid ester monomer secret fabricant), et qu’il contient en plus du silane. Le reste de la composition est globalement la même que celle du M&R2.
Protocole opératoire
Sélectionner un produit adapté à la situation clinique
- Pour les restaurations adhésives des dents antérieures en techniques directe ou indirecte, le choix se portera généralement sur un système M&R. Une bonne isolation par un champ opératoire y est facile, donc les risques de contamination sont faibles. L’efficacité du pré-mordançage phosphorique de l’émail chanfreiné permet de limiter la dégradation des marges, surtout leur dyschromie, et donc de maintenir l’esthétique sur le moyen et long terme.
- Dans les situations où la mise en place du champ opératoire reste difficile à maîtriser, l’emploi des SAM est préférable, notamment pour les lésions cervicales proches de l’attache épithéliale et des cavités profondes du secteur postérieur.
Stockage et manipulation
- Stocker son produit au frais.
- Agiter son flacon avant emploi ou choisir des unidoses : mettre au réfrigérateur tous les soirs pour éviter les phénomènes d’hydrolyse accélérée par la température.
- Lire les modes d’emploi et suivre rigoureusement les procédures, notamment les temps d’application.
Mordançage
- Pour les M&R : Mordancer d’abord l’émail 15 à 30 secondes, puis la dentine mais pas plus de 15 secondes. La fourchette d’application d’un gel d’acide orthophosphorique sur l’émail est assez large pour un mordançage efficace, elle s’étend de 15 secondes à une minute. Par contre, le contact de cet acide avec la dentine doit être limité à 15 secondes maximum pour permettre une infiltration complète de la résine sur la totalité de la zone déminéralisée.
- Il est bien établi aujourd’hui que ce n’est pas l’épaisseur de la couche hybride qui paramètre la qualité de l’adhésion et de l’étanchéité, mais la qualité de son imprégnation par les monomères. Une zone déminéralisée incomplètement infiltrée de résine est source de sensibilités post-opératoires.
Application sur la dentine
- Pour les M&R2 : La dentine doit être un peu humide avant l’application. Sécher sans dessécher pour éviter l’évaporation de l’eau qui maintient le réseau de collagène ouvert pour permettre l’infiltration de la résine.
- Utiliser une boulette de coton mouillé et préalablement essorée ou des mini-brossettes au niveau des petites cavités.
- Certains auteurs préconisent de ne pas sécher à l’air comprimé la surface après rinçage mais préfèrent l’utilisation de l’embout d’une aspiration salivaire pour évaporer l’eau résiduelle. Aucune trace d’eau ne doit être visible après cette opération.
Application de l’adhésif
- Appliquer l’adhésif en frottant fermement les parois cavitaires : appliquer avec pression pour favoriser l’infiltration de l’adhésif (utilisation de mini-brossettes plus efficace que les pinceaux, le temps minimum d’application doit être respecté).
Séchage de l’adhésif
- Attention au séchage de l’adhésif, c’est la séquence la plus critique. Le séchage de la couche adhésive déposée s’impose avant la polymérisation pour évaporer les solvants contenus dans les produits et assurer une bonne étanchéité du joint, cette étape est surtout cruciale pour les SAM compte tenu de l’eau dans leur composition.
Contrôle de la couche d’adhésif
- Juste avant de procéder à la polymérisation, le praticien doit contrôler l’aspect de la couche d’adhésif qu’il a appliqué. Cette couche doit être uniformément brillante.
Polymérisation
- S’assurer d’une bonne polymérisation de l’adhésif : c’est la prise de l’adhésif par photopolymérisation. La qualité de cette opération conférera au joint collé l’essentiel de ses performances immédiates et à terme.
Principes de préparations pour matériaux collés
Dans tous les cas où le collage est possible, la rétention, la stabilité et la sustentation sont assurées par ce collage. Les techniques d’obturation par collage sont donc les techniques de choix qui permettent de répondre au mieux aux critères de conservation tissulaire.
Préparation cavitaire
- La préparation va se limiter au curetage de tous les tissus dentinaires pathologiques.
- La préparation amélaire se limite à l’élimination de l’émail présentant des fêlures. Une finition des bords d’émail sera réalisée de manière à assurer la meilleure adhésion et étanchéité possible sur l’émail.
Types de biseaux
- Biseau droit : Présente la meilleure esthétique. Généralement, la longueur du biseau est limitée à environ 1 mm (ce qui correspond à une angulation d’environ 45°), de manière à ne pas avoir une limite en trop fine épaisseur du composite.
- Biseau concave (ou congé) : Permet, du fait de sa plus grande épaisseur, une meilleure résistance à l’abrasion, mais au détriment de l’esthétique. L’anisotropie des deux milieux est perçue à la lumière, exactement comme deux fragments d’un miroir brisé et recollés. Le biseau concave est donc réservé aux faces palatines du secteur antérieur et aux faces occlusales molaires du fait de sa meilleure résistance occlusale. Un biseau droit peut être associé à un congé pour améliorer l’esthétique.
Évolution des concepts
Si jusqu’à ces dernières années la réalisation d’un biseau semblait indispensable pour assurer l’étanchéité et la stabilité de l’obturation, l’apparition des adhésifs amélo-dentinaires depuis la 4ème génération remet en cause cette notion. En effet, avec l’adhésion sur toute la surface dentinaire, le biseau n’est pas nécessaire pour assurer la stabilité, et l’étanchéité s’en trouve grandement améliorée. De plus, la dégradation des composites – sous l’effet des forces de cisaillement combinées à l’hydrolyse progressive des liaisons silaniques et de la matrice – commence dans les zones de faible épaisseur, c’est-à-dire au niveau du biseau. Ainsi, en l’absence de nécessité esthétique, on ne réalise plus de biseau dans les zones supportant des contacts occlusaux. Plus particulièrement, un trajet occlusal ne doit pas passer sur un biseau.
Classification Si-Sta
La classification de Black ne peut plus s’adapter à des formes de cavités si différentes des préparations pour amalgame. Mount et Hume, en 1997, ont proposé une classification qui est – sous une forme très légèrement modifiée – utilisée aujourd’hui pour les préparations cavitaires pour composites.
Sites d’apparition des caries
- Site 1 : Lésions des puits, sillons et défauts coronaires.
- Site 2 : Lésions des zones de contacts.
- Site 3 : Lésions cervicales coronaires et/ou radiculaires.
Stades d’évolution
Cinq stades (Sta) d’évolution sont distingués pour chaque site carieux, partant du stade 1 représentant une perte de substance de 1/5e de la partie coronaire, le stade 2 représentant une perte des 2/5e de la partie coronaire, etc., jusqu’au stade 5 représentant la perte de la totalité de la couronne dentaire. Le stade 5 relève bien évidemment d’une restauration prothétique après traitement endodontique.
Préparations de stade 1
- Ce sont des délabrements de très faible volume, particulièrement propices à la conservation des éléments anatomiques importants, en particulier les crêtes marginales.
- Les cavités par accès vestibulaire ou lingual sont réalisables à plusieurs conditions :
- Résistance suffisante du plafond de la cavité.
- Accessibilité parfaite aux instruments de préparation, aux adhésifs et aux matériaux composites.
- Il faut prendre garde à ne pas réaliser de préparation sous-gingivale.
- La préparation cavitaire sous digue est un facteur important du succès de la préparation, la digue permettant la compression et le refoulement gingival.
- Les cavités de type tunnel sont réalisables selon les mêmes conditions, elles sont préférées en cas de faible hauteur coronaire, ou de surface de contact très importante ou encore en cas de recouvrement gingival.
- Si la mise en œuvre de l’adhésif est délicate, l’utilisation d’un verre ionomère en technique sandwich peut s’avérer judicieuse. La technique sandwich consiste à obturer la cavité en deux parties : une obturation profonde reconstituant la dentine est réalisée avec un ciment verre ionomère conventionnel (CVI) ou hybride qui permet une adhésion spontanée à la dentine relativement faible mais fiable ; l’obturation de surface remplace l’émail par du composite résistant correctement à l’usure occlusale. Dans le cas des cavités tunnels, le CVI est injecté dans la partie profonde (proximale) du tunnel, et l’émail proximal n’est pas alors remplacé par du composite. On parle de tunnel ouvert lorsque l’émail proximal est éliminé, mais à chaque fois que cela est possible, on le conserve et il s’agit alors d’un tunnel fermé.
Préparations de stade 2
- Sont plus mutilantes et entraînent une perte ou une fragilisation irréversible de la crête marginale, permettant un accès plus conventionnel à la carie.
Préparations de stade 3
- Présentent une perte conséquente du volume de la dent, elles entraînent une fragilisation nette d’au moins une cuspide de la dent. Des pans dentaires ou amélaires fragiles ou non soutenus subsistent.
- Nous cherchons alors à améliorer la cohésion biomécanique de la dent reconstituée : pour minimiser le risque de fracture, aucun angle vif n’est réalisé, les pans résiduels trop faibles ou formant saillie sont également réduits. Un biseau périphérique englobe les pans d’émail dans la masse de la restauration.
- Souvent, ces cavités sont obturées en technique directe bien que le volume important de composite par rapport aux tissus résiduels soit un facteur défavorable. Il est donc plus indiqué d’obturer ces cavités par des techniques indirectes ou semi-directes.
Préparations de stade 4
- Présentent une perte du volume encore plus importante, elles entraînent une perte cuspidienne. Ces préparations ne sont pas compatibles avec la mise en œuvre in situ de matériaux de restauration et leur traitement relève des techniques indirectes ou semi-directes, sauf pour les caries de site 3.
- La surface d’adhésion sur l’émail et la dentine est faible par rapport au délabrement et à la surface « occlusante ». Nous cherchons alors à assurer une forme de cavité améliorant la stabilisation et la résistance dent-matériau : les pans résiduels trop faibles ou formant saillie sont réduits. Les pans d’émail non soutenus sont éliminés, la finition des bords sera proche de 90°.
- Le fond de la cavité est, au besoin, légèrement aplani, par étages de manière à conserver un maximum de tissus sains. Une mise en contre-dépouille parfaite n’est pas nécessairement recherchée. Deux possibilités se présentent :
- Soit la contre-dépouille est légère et alors elle est comblée par le composite de collage.
- Soit la contre-dépouille est nette, et il est tout à fait possible de réaliser une obturation partielle de la cavité, soit avec un composite collé, soit avec un CVI afin de combler cette contre-dépouille. L’empreinte et le collage de la reconstitution indirecte sont alors réalisés sur cette cavité partiellement obturée.
Si-Sta 3.4
- Concernent en général quatre faces cervicales de la dent et ne permettent donc pas l’insertion d’une obturation réalisée en technique indirecte. Elles sont donc obturées en technique directe.
- Il convient cependant de noter qu’avant l’apparition des adhésifs dentinaires de quatrième génération, ces Si-Sta 3.4 relevaient très rarement de traitements conservateurs et orientaient nos choix thérapeutiques vers la prothèse.
Les composites utilisés pour les restaurations adhésives
Les composites sont les matériaux de référence pour les restaurations directes. Grâce à l’utilisation d’un adhésif, ils sont collés à la dent et permettent ainsi la conservation des structures dentaires. De plus, leurs propriétés optiques et mécaniques les rendent incontournables dans une grande variété d’indications thérapeutiques.
Catégories de composites
Trois catégories de composites peuvent être utilisées :
- Les résines composites hybrides.
- Les composites condensables.
- Les composites fluides.
Tableau récapitulatif des indications cliniques des composites
| Type de composite | Propriétés | Indications cliniques |
|---|---|---|
| Composites hybrides (Hybrides, Microhybrides, Microhybrides nanochargés) | – Un large choix de couleur, de degré d’opacité, de translucidité et de fluorescence. – Une haute capacité à mimer les structures dentaires et une excellente habilité au polissage. – Une abrasion et une usure similaire à celle des structures dentaires. – Une résistance mécanique encore perfectible. – Un taux de rétraction de prise et une absorption d’eau relativement contrôlés mais encore existants. | Une utilisation indifférenciée entre les secteurs antérieurs et postérieurs. |
| Composites condensables | – Ils ont été proposés afin de se substituer à l’amalgame sans changer les habitudes de manipulation des praticiens. – Cependant, au vu de leur absence de supériorité mécanique (par rapport aux hybrides) et de leur rendu esthétique décevant d’une part, et d’autre part de l’apparition de petits consommables simples d’emploi permettant d’assurer un bon point de contact même avec des hybrides, ils semblent disparaître progressivement du marché. | Ils sont réservés au secteur postérieur. |
| Composites fluides | – Ils présentent l’avantage d’avoir : – Une haute capacité de mouillabilité des surfaces dentaires, quelles que soient leurs irrégularités, favorisant la préservation tissulaire et évitant l’inclusion de bulles d’air à l’interface. – Une haute flexibilité (module d’élasticité plus faible) lui permettant d’absorber les contraintes. – Cependant, leurs principaux inconvénients sont d’avoir : – Un retrait de polymérisation élevé. – Une résistance à l’usure et une dureté faible. | – Utilisés soit en fine couche comme joint viscoélastique (fond de cavité ou étanchéification de marges cervicales) sous un composite plus chargé (préférentiellement les composites compactables), soit pour des restaurations soumises à de faibles contraintes (petites pertes de substances ou lésions cervicales, par exemple). – La récente évolution des composites dits « Bulk Fill » promet un gain de temps non négligeable sur la réalisation des composites postérieurs. Ces composites particuliers nécessitent une instrumentation particulière. Ils présentent la capacité d’être photopolymérisés en masse (jusqu’à une hauteur de 4 mm en un seul temps) avec un degré de conversion qui serait adéquat même en profondeur. |
Conclusion
La dentisterie moderne a pour objectif la conservation maximale des structures résiduelles afin d’optimiser la pérennité de la dent sur l’arcade grâce à l’évolution des principes en dentisterie adhésive.
Voici une sélection de livres:
- Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché
- Concepts cliniques en odontologie conservatrice
- L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement
- Guide clinique d’odontologie
- Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve
- La photographie en odontologie: Des bases fondamentales à la clinique : objectifs, matériel et conseils pratique
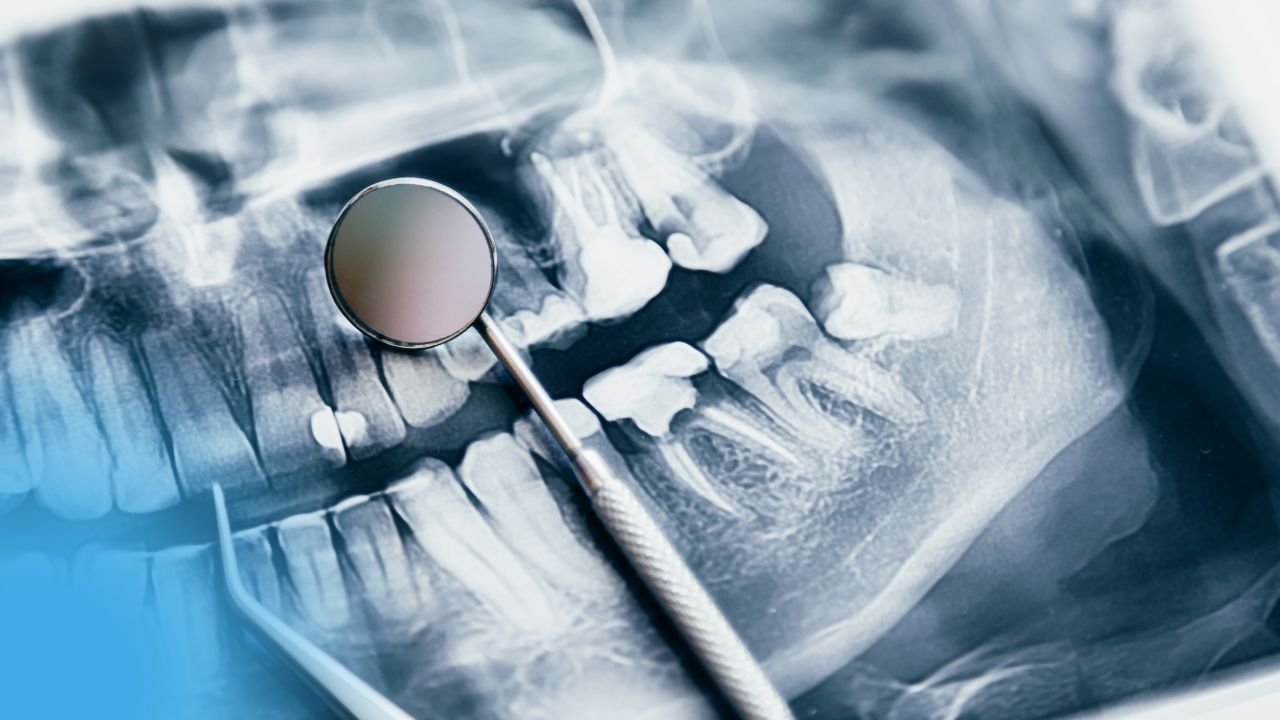



Leave a Reply