Prise en charge des patients sous chimiothérapie anti-cancéreuse
- Introduction :
La chimiothérapie est un moyen thérapeutique médicamenteux introduit dans l’éventail thérapeutique cancérologique depuis des années, elle a fait l’objet de développements très importants et rapides au cours des deux dernières décennies, mais malheureusement elle s’accompagne souvent d’effets secondaires parfois handicapants au niveau bucco-dentaire.
Actuellement, l’augmentation du nombre de nouveaux cas de cancers, amène de plus en plus les médecins dentistes à prendre en charge des patients sous ces traitements anticancéreux.
- Définition :
La chimiothérapie est un traitement médical prescrit sous deux types de formes galéniques : orale ou le plus souvent injectable. Elle est administrée périodiquement, généralement tous les 21 jours par des cycles ou cures de 1 à 6 jours en fonction des médicaments utilisés et de leurs associations.
Elle utilise des substances qui vont empêcher la croissance et le développement des cellules cancéreuses et/ou les détruire. Elle agit tant sur les cellules cancéreuses que sur certaines cellules saines particulièrement les cellules à division rapide (cellules hématopoïétiques, des cheveux, de la peau et des muqueuses).
- Les indications de la chimiothérapie :
La chimiothérapie est utilisée essentiellement dans trois situations cliniques :
- En traitement néo-adjuvant (primaire) : dite chimiothérapie d’induction ou inductive, elle est administrée avant le traitement locorégional de la tumeur dans le traitement des maladies à fort potentiel évolutif avec risque métastasique important, elle a pour but de diminuer la taille de la tumeur et de faciliter le traitement local.
- En traitement adjuvant : elle est délivrée après un traitement local à visée curative (chirurgie ou radiothérapie), son but est de détruire les micro- métastases.
- En traitement palliatif : elle s’adresse à des patients dont la maladie est considérée incontrôlable, elle a pour objectif de faire régresser ou au moins ralentir l’évolution des formes avancées récurrentes ou métastasiques.
- Les complications orales liées à la chimiothérapie :
La chimiothérapie est à l’origine de nombreuses manifestations orales qui sont de deux types :
- les unes résultent de l’effet direct cytotpxique, sur la sphère buccale, des agents utilisés (mucite, xérostomie, dysgueusie) ;
- les autres indirectes, qui sont les conséquences, au niveau de la cavité buccale, d’une toxicité générale (infections secondaires à la leucopénie et à l’immunodépression, saignements buccaux secondaires à la thrombocytopénie, neurotoxicité).
- Les manifestations directes :
- La mucite :
- Définition :
- La mucite :
C’est une inflammation des muqueuses de la cavité buccale pouvant conduire notamment à
la survenue d’aphtes, d’ulcérations responsables de douleurs et d’une dysphagie. Elle peut également s’étendre à tout le système digestif, à la muqueuse génitale et à l’œil.
L’action cytotoxique des médicaments de la chimiothérapie est dirigée contre les cellules à division rapide sans distinction entre les cellules cancéreuses et les cellules épithéliales saines
recouvrant les parois de la cavité buccale. Le renouvellement cellulaire est donc modifié, ce qui conduit à une altération de l’intégrité des muqueuses de la bouche allant de l’atteinte superficielle à des ulcérations pouvant être douloureuses et gêner l’alimentation. Parallèlement, les médicaments entraînent une inflammation au niveau des muqueuses accentuant la survenue des lésions.
- Signes cliniques : Généralement, les lésions apparaissent au cours de la première semaine de traitement et se résorbent progressivement durant la semaine suivante avec toujours un risque
de survenue possible ou d’aggravation lors d’un nouveau cycle de chimiothérapie
L’aspect clinique de la mucite est peu spécifique, il est fonction de son importance. Au départ, la muqueuse est érythémateuse puis elle s’atrophie, devient fine, fragile et luisante. Par endroits, des érosions ou des ulcérations se développent : celles-ci peuvent être minimes, superficielles, peu étendues et peu sensibles ou bien étendues, profondes et très douloureuses.
La mucite chimio-induite est le plus souvent observée au niveau de la muqueuse mobile non kératinisée : les lèvres, la muqueuse buccale, le palais mou, le plancher buccal et la face ventrale de la langue. Elle affecte rarement le dos de la langue, le palais ou les gencives (la muqueuse non kératinisée).
- Les facteurs de risque : Le risque de développer une mucite buccale dépend de facteurs à la fois liés aux traitements cytotoxiques et liés aux patients.
Facteurs liés aux traitements cytotoxiques :
-La dose administrée : chimiothérapie à fortes doses.
-La durée du traitement : l’administration prolongée ou répétée à petites doses d’agents cytotoxiques est associée à un risque supérieur de développer une mucite.
-La nature de la molécule utilisée : la plupart des traitements sont potentiellement toxiques pour la muqueuse buccale. Certains agents chimiothérapeutiques tels que le Méthotrexate et l’Etoposide peuvent également être sécrétés dans la salive, ce qui conduit à un risque accru de mucite directe.
Les facteurs de risque liés au patient sont :
- L’âge jeune ou au contraire avancé ;
- Un état nutritionnel dégradé ;
- L’état dentaire (prothèses abimées, maladie parodontale, …) et une mauvaise hygiène bucco- dentaire ;
- Les soins bucco-dentaires au cours du traitement ;
- Le nombre de neutrophiles bas avant traitement ;
-Les médicaments associés anti cholinergiques favorisant la xérostomie (opiacés, antihistaminiques, antidépresseurs tricycliques, …).
- Conséquences de la mucite buccale : La mucite buccale, dont la douleur est le principal symptôme, peut avoir un impact sur la qualité de vie et être à l’origine de nombreuses complications :
- La mucite peut conduire à de véritables insomnies et asthénies rendant le patient apathique, source de grande détresse psychologique et de dépression.
- Des dysphagies, des dysphonies, des dysarthries, des odynophagies (douleurs et sensations de brûlures à la déglutition), à l’origine d’une importante perte de poids et/ou dénutrition.
- Des brèches dans la muqueuse buccale peuvent favoriser le passage de microorganismes (bactéries, champignons, virus) et entrainer des infections pouvant même conduire à une septicémie, particulièrement en cas de réduction des défenses immunitaires ou d’aplasie.
- La xérostomie :
- Définition
La xérostomie définit un état de sécheresse de la cavité buccale et des lèvres ressenti de façon
subjective par le patient, traduisant une atteinte directe ou indirecte des glandes salivaires et se manifestant soit par une diminution du flux salivaire ou hyposialie, soit par une sécrétion salivaire nulle ou asialie.
La présence de manifestations cliniques objectives est obligatoire pour poser ce diagnostic. Elle se manifeste par une salive épaisse et collante, une muqueuse buccale brillante adhérente au miroir, atrophique et desséchée.
- Etiopathogénie :
Selon certains auteurs, les agents de chimiothérapie donneraient lieu à une dilatation canalaire,
à une dégénérescence des cellules acineuses, à la formation de kystes et à une inflammation dans le tissu glandulaire engendrant une réduction de la sécrétion salivaire. Après le traitement, le flux salivaire revient à la normale. La xérostomie post-chimiothérapie est réversible après 2 à 6 semaines. Parfois, l’hyposialie persiste mais n’entraîne pas de sensation importante de sécheresse buccale
- Conséquences de la xérostomie :
Les patients deviennent plus susceptibles aux infections orales, aux caries dentaires et maladies
parodontales par absence de nettoyage mécanique de la cavité buccale par la salive associée à la perturbation de la flore microbienne locale.
L’absence de salive retentit sur les multiples fonctions assurées par la cavité buccale provoquant troubles de la mastication, dysphagie, dysphonie, dysgueusie/agueusie. La sécheresse buccale et ses conséquences retentissent profondément sur l’état physique du patient (dénutrition, perte de poids) et sur son état psychique (humeur, comportement social) avec un impact significatif sur sa qualité de vie.
- Dysgueusies : Les médicaments anti-cancéreux induisent des lésions de l’épithélium lingual en perturbant le renouvellement des cellules épithéliales. Ils peuvent également endommager les cellules neuronales, modifiant ainsi les voies gustatives afférentes.
Les troubles du goût peuvent être de nature quantitative (hypogueusie, hypergueusie, agueusie) et/ou qualitative (aliagueusie, phantogueusie) affecter l’ensemble des saveurs (amer, acide, salé, sucré) ou être sélectifs.
- Les manifestations indirectes :
- Les infections : La myélosuppréssion liée à la chimiothérapie rend le patient très vulnérable aux infections: bactériennes, fongiques et/ou virales.
- Les infections fongiques : La candidose est une mycose superficielle due à des champignons levuriformes, du genre Candida dont l’espèce Albicans, saprophytes buccaux qui deviennent
- Les infections : La myélosuppréssion liée à la chimiothérapie rend le patient très vulnérable aux infections: bactériennes, fongiques et/ou virales.
pathogènes.
Elle est caractérisée par le dépôt de plaques blanches crémeuses, molles sur le dos de la langue, de la muqueuse jugale et quelques fois sur le palais, les gencives et le plancher de la bouche.
Les signes clinique sont divers : des douleurs, une gêne gingivale, des difficultés d’alimentation, une altération du goût, des brûlures, une sécheresse de la bouche, une sensation de soif ou une bouche pâteuse.
Les formes de candidose chimio-induites les plus répandues sont la présentation
pseudomembraneuse, suivie de la candidose érythémateuse et de la cheilite angulaire.
- Les infections virales : dues à Herpès simplex virus (HSV). Elles surviennent souvent chez les patients présentant des leucémies ou des lymphomes sous chimiothérapie à la suite d’une réactivation du virus.
Cliniquement : vésicules bombées et translucides, en bouquet qui éclatent et laissent sur la peau ou la muqueuse une petite ulcération qui guérit spontanément en 8 jours en formant une croûte. L’ulcération herpétique peut siéger sur la gencive, la langue, la joue, le voile du palais, mais, le plus souvent, elle se situe au niveau de la lèvre.
- Les infections bactériennes : Les bactéries impliquées dans ces infections sont variées : les bactéries à Gram positif comme le streptocoque et /ou à Gram négatif comme le Pseudomonas. Les infections les plus fréquentes sont les infections bactériennes à Spirochètes.
Les manifestations les plus souvent rencontrées sont la gingivite et la parodontite ulcéronécrotique. L’apparition de celles-ci dépend de la neutropénie et de l’état bucco-dentaire préalable du patient.
- Chimiocaries :
Les caries chimio-induites se présentent sous forme de décalcification au niveau des collets dentaires avec une altération de la dureté dentinaire. Les caries chimio- induites sont une conséquence directe de la xérostomie.
- L’hémorragie buccale:
La toxicité hématologique est la toxicité la plus fréquente des médicaments cytotoxiques, c’est le principal élément qui limite la chimiothérapie ce qui explique la nécessité d’une surveillance régulière et fréquente par des numérations de formules sanguines répétées.
Cette toxicité dont l’atteinte plaquettaire est d’une fréquence non négligeable induit une augmentation du risque hémorragique.
Il est admis que les saignements spontanés sont rares à partir d’un taux supérieur à 50 000/mm³. Dès lors qu’on passe à un taux inférieur à 20 000/mm³, on observe des saignements spontanés chez 50% des patients (gingivorragies, purpura, pétechies…)
- Prise en charge odontologique des patients traités par chimiothérapie :
Durant la chimiothérapie anticancéreuse, les infections bucco-dentaires ont une morbidité importante et peuvent parfois même entraîner le décès du patient. Les patients présentent en effet un risque majoré d’infection, soit par l’apparition de nouvelles infections buccodentaires, soit par l’exacerbation de lésions chroniques susceptibles de mettre en danger le pronostic vital du patient.
Dans ces conditions, le médecin dentiste a un rôle spécifique avant, pendant et après les cures de chimiothérapie afin de prévenir les complications infectieuses d’origine buccodentaire ou d’en juguler les effets.
- Avant la chimiothérapie : un bilan bucco-dentaire est systématiquement réalisé. Il doit impérativement comprendre un examen clinique complet (interrogatoire, sondage parodontal,
tests de vitalité, percussion, palpation des chaînes ganglionnaires…) ainsi qu’un examen radiographique panoramique, qui doit être complété au besoin (clichés rétro-alvéolaires..).
La mise en état de la cavité buccale est d’autant plus indispensable que la chimiothérapie prévue sera intensive et aplasiante.
Dans le cadre de cette mise en état de la cavité buccale, le médecin dentiste doit :
-Supprimer les foyers infectieux par extraction ou soin conservateur lorsqu’ils sont possibles, dans les délais disponibles et de manière optimale ;
-Avulsion des dents de sagesse enclavées avec foyer péri coronaire ;
-Détartrage sus et sous gingivale systématique ;
-L’enseignement de techniques de brossage efficaces et adaptées est indispensable; -Vérification et désinfection des prothèses amovibles excellent réservoir à Candida. -Polissage ou remplacement des obturations traumatisantes ;
-Dépose des appareils orthodontiques ;
-Extraction des dents lactéales mobiles, si elles sont présentes.
Le médecin dentiste informe le patient sur les effets secondaires buccaux de la chimiothérapie et le motive aux soins d’hygiène quotidiens.
- Pendant la chimiothérapie :
Un brossage rigoureux à l’aide d’une brosse à dents « ultra-souple », ainsi que la réalisation de bains de bouche à base de chlorhexidine ou de bicarbonate de sodium 14‰, sont indispensables durant tout le traitement.
Si des gingivorragies spontanées se manifestent ou si le taux de plaquettes est inférieur à 20 000/mm3, le brossage est à proscrire et il doit être remplacé par un nettoyage délicat avec une compresse imbibée d’une solution antiseptique ou d’eau oxygénée.
Précautions à prendre lors des soins bucco-dentaires : deux risques majeurs doivent guider la conduite à tenir en matière de soins dentaires : le risque hémorragique lié à la thrombopénie et le risque infectieux lié à la leucopénie et neutropénie.
Les soins dentaires invasifs peuvent être réalisés seulement lorsque les valeurs hématologiques s’améliorent (NFS= WBC>2000/mm3 PLT>80000/mm3), en intercure (correspondant à la semaine précédant une nouvelle cure) La restauration hématologique, se fait en général après 10 à 15 jours de la cure précédente ce qui nous permet d’intervenir.
Les gestes sanglants se font donc avec: NFS obligatoire ; ATB à commencer la veille est poursuivi jusqu’à cicatrisation, avec application des mesures d’hémostases locales (sutures ,éponges…)
Durant l’aplasie médullaire l’état hématologique du patient rend tout soin dentaire dangereux, car susceptible de provoquer une grave hémorragie ou bactériémie.
Aucun soin dentaire ne doit donc être réalisé durant cette phase d’aplasie.
En principe, la mise en état bucco-dentaire avant chimiothérapie évite toute complication. Toutefois, si un patient consulte présentant une des répercussions buccales liées à la chimiothérapie Le médecin dentiste doit faire face à ces répercussions, à savoir :
- En cas de mucites :
-Instauration d’une hygiène buccale rigoureuse ;
-Application des antiseptiques locaux : bains de bouche au bicarbonate de sodium 14‰ 4 à 6 fois par jour ;
-Application topique de vitamine E (Tocophérol®) : efficace pour les lésions déjà établies ;
-Traitement de la douleur : à l’aide de gels à base d’anesthésiques, comme la Xylocaïne visqueuse, antalgiques par voie générale (palier 2 voire 3).
- En cas de surinfection locale = mise en place d’un traitement antibiotique.
- En cas de candidose : traitement anti-fongique. Les traitements topiques, à privilégier, sont :
- Miconazole , Daktarin® gel buccal 2% : une application 4 fois par jour. La durée habituelle du traitement est de 7 à 15 jours.
- Amphotéricine B (Fungizone®) : suspension buvable utilisée sous forme de bains de bouche, 3 à 4 fois par jour. Le bain de bouche peut être avalé car la candidose n’est pas strictement limitée à la sphère oropharyngée.
Les traitements systémiques : exemple : Fluconazole (Triflucan®) en suspension buvable ou en gélules.
- En cas d’une infection virale : mise en route d’un traitement anti-viral : Aciclovir (Zovirax) : 200 mg per os, 5 fois par jour, pendant 5 à 10 jours.
- En cas de xérostomie : La stimulation salivaire par des substances qui agissent sur les récepteurs proprioceptifs comme l’acide ascorbique (citron, jus de fruit, et légumes frais), l’acide malique (pommes, poires, et jus de raisin), l’acide citrique, le sucre…
La prescription de sialogogues : la teinture de jaborandi : (10 gouttes 3 fois /jour avant le repas) ou sous forme de traitement généraux (Bromhexine (BISOLVON® :6 comprimés/jour), Anétholtrithione (SULFARLEM S25 ® :3 comprimés/jour, Eseridine (GENSERINE® : 3à 6 comprimés
/jour).
Les substituts salivaires sont prescrits lorsqu’il n’est pas possible de stimuler la sécrétion salivaire :
-Sous forme de spray (ARTISIAL R, SYALINE spray )
-Sous forme de gel (ORALBALANCE R®)
- Après la chimiothérapie :
Après chimiothérapie, toutes les valeurs hématologiques sont à nouveau normales, il n’y a donc plus aucune contre-indication aux soins dentaires, ni précautions particulières à prendre hormis les précautions générales. Le médecin dentiste traitant assurera à son patient un suivi bucco-dentaire régulier dont la fréquence varie de 6 à 12 mois, à adapter en fonction du contexte clinique.
- Conclusion : La méconnaissance de la conduite à tenir face à un patient irradié, sous BPS ou sous chimiothérapie conduit à des attitudes de prudence excessive ou de dangereuse désinvolture. Le médecin dentiste joue un rôle primordial dans la prévention et/ou le traitement des séquelles bucco-dentaires secondaires aux thérapeutiques anti-néoplasiques, il a également un rôle déterminant dans la diminution de la morbidité de cette pathologie.
Prise en charge des patients sous chimiothérapie anti-cancéreuse
Voici une sélection de livres:
Parodontologie Relié – 1 novembre 2005
Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011
Parodontologie Broché – 19 septembre 1996
MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE
Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient
Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé
Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1
Endodontie, prothese et parodontologie
La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020
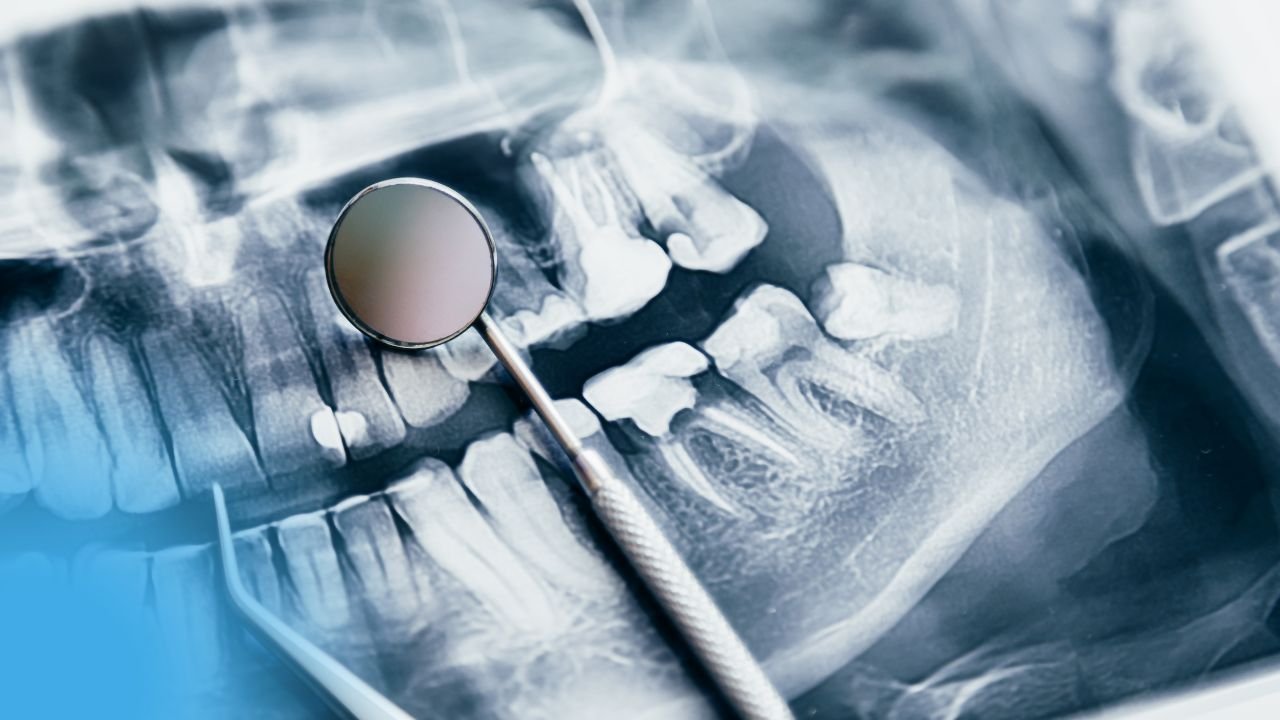



Leave a Reply