PRINCIPES ET TECHNIQUES DE MISE EN FORME CANALAIRE
PRINCIPES ET TECHNIQUES DE MISE EN FORME CANALAIRE
Définition
Le traitement endodontique (TE) est une procédure clinique qui s’applique de l’extrémité coronaire à l’extrémité apicale d’un réseau canalaire d’une dent ou racine et qui consiste, après diagnostic étiologique, positif et différentiel, à :
- Éliminer et neutraliser toutes substances organiques contenues dans le réseau canalaire (débridement, parage).
- Élargir le canal principal.
- Obturer le réseau canalaire.
Objectifs
Objectifs biologiques
Parage
- Élimination de tout le tissu pulpaire vivant ou mortifié.
Respect du périapex
- Pas d’irritation toxique (ne pas propulser de débris nécrotiques au-delà du foramen).
- Pas d’irritation mécanique.
- Pas d’irritation chimique.
Objectifs mécaniques
Conicité
La conicité permet :
- Le contrôle des instruments dans la région apicale.
- L’irrigation, par une meilleure pénétration de l’aiguille de la seringue à l’intérieur du canal.
- L’obturation tridimensionnelle.
- La pénétration des instruments de compactage jusque dans la région apicale.
Calque
La forme du canal préparé doit se calquer, en plus large, sur son anatomie originelle.
Position du foramen
Le foramen apical doit être maintenu dans sa position spatiale d’origine sur la surface radiculaire et rester le plus petit possible.
Temps opératoires de la préparation canalaire
Anesthésie
Elle est indispensable si la pulpe est vivante, elle permet un confort opératoire.
Champ opératoire
La meilleure façon de le réaliser est par digue.
Cavité d’accès
Elle est spécifique à chaque type de dent et doit permettre :
- Une pénétration aisée des instruments endodontiques.
- Une élimination facile des débris canalaires.
- Assurer un réservoir pour la solution d’irrigation.
Cathétérisme (pénétration initiale)
Choix de type et du numéro du premier instrument de pénétration
Weine recommande de réserver une lime K de n° 08 aux canaux calcifiés et d’utiliser le n° 15, voire le n° 20 comme premier instrument, selon le cas.
Précourbure des instruments
Deux types de précourbures peuvent être réalisées à l’aide de l’instrument de Maillefer :
- Une précourbure apicale (obligatoire) « serrée de 30 à 40° ».
- Et/ou une précourbure régulière « progressive » de toute la lame.
Techniques d’exploration canalaire initiale
Techniques manuelles
Une lime K est introduite dans le canal jusqu’au blocage. Un mouvement de 1/8 de tour est imprimé à l’instrument avec une légère poussée apicale, puis un autre mouvement d’1/8 de tour dans le sens inverse est donné pour faciliter son retrait. La manœuvre est répétée jusqu’à atteindre la limite apicale. Un chélateur peut être utilisé.
Techniques mixtes
Elles visent à éliminer les obstacles au niveau des 2/3 coronaire du canal à l’aide d’un instrument rotatif (Gates-Glidden, Orifices Openers) et à explorer le 1/3 apical à l’aide d’une lime K manuelle.
Détermination de la longueur de travail
Définition de la longueur de travail
C’est la distance qui joint un point précis d’une couronne ou d’un bord libre d’une dent à la limite apicale de la préparation. Il est important de marquer la longueur opératoire sur l’instrument avant de l’introduire dans le canal, à l’aide d’un stop par rapport à un point de référence coronaire, de préférence sain, plat et non susceptible d’être mis en péril pendant le traitement.
Techniques de mensuration
Méthodes empiriques
Basées sur le sens tactile de l’opérateur, son expérience ou la sensation douloureuse du patient lorsqu’on dépasse la limite apicale.
Méthodes radiographiques
Bissection et règle de trois
La longueur de la dent sera déterminée par la formule suivante :
L = [(A × C) / B] – D
Où :
- D = 0,5 à 2 mm, en fonction de l’âge du patient (longueur du foramen apical).
- A = Longueur radiologique de la dent.
- B = Longueur radiologique de l’instrument jusqu’au stop.
- C = Longueur de l’instrument jusqu’au stop.
Techniques parallèle et mesure
Puisque cette technique présente des dimensions réelles de l’image radiologique, la longueur de travail sera prise directement sur le cliché.
Technique de Beveridge
- 1ère étape : Examiner le cliché préopératoire et mesurer la longueur canalaire.
- 2ème étape : Reporter la longueur de présomption sur l’instrument et prendre une radiographie avec la lime en place.
Plusieurs situations peuvent se présenter :
- La lime semble avoir atteint la limite fixée (0,5 mm ou 1 mm) de l’extrémité apicale radiographique.
- La lime est en deçà de la limite choisie : l’instrument est alors poussé sur la longueur manquante.
- La lime est au-delà de la limite choisie : elle est immédiatement retirée de sa longueur en excès par rapport à la limite apicale choisie.
Mesure par logiciel (RVG)
Grâce à la radiovisiographie (RVG), il est possible de mesurer la longueur de travail à l’aide d’un logiciel spécifique en se basant sur des données numériques.
Détermination électronique de la longueur de travail
Définition
Un localisateur d’apex est un ohmmètre relié à deux électrodes :
- Une électrode buccale, en contact avec la peau, mesurant la résistance du ligament parodontal.
- Une électrode fixée sur l’instrument endodontique de cathétérisme, mesurant la résistance intracanalaire.
Les électrodes sont reliées à un boîtier permettant de lire, via un cadran à aiguille, un voyant lumineux, un signal sonore ou un écran digital, l’atteinte de la longueur canalaire.
Avantages
- Déterminent avec fiabilité et précision la position du foramen apical.
- Déduisent la position de la constriction apicale (jonction cémento-dentinaire).
- Protègent contre les dépassements apicaux.
- Diminuent l’exposition aux radiations pour le patient.
- Réduisent le temps d’opération.
Inconvénients
- Coût élevé.
- Certains modèles fonctionnent mal avec des dents ayant un apex très ouvert ou des canaux très larges.
- Besoin de preuves pour les dossiers au moyen de clichés radiographiques.
Choix des limites de travail
- Dent vivante : Longueur de travail à l’apex physiologique, en épargnant le foramen de toute instrumentation, car il renferme le desmodonte, élément clé de la cicatrisation.
- Dent nécrosée : Longueur de travail à l’apex radiologique.
Techniques de mise en forme canalaire
Concepts de préparation canalaire
Concept de Schilder (préparation en flamme)
Il s’agit d’aléser le canal en éliminant toutes les irrégularités, au détriment de la structure dentinaire radiculaire. Cette préparation est caractérisée par la réalisation d’un « cône d’arrêt » au niveau du rétrécissement apical, pour éviter tout risque de dépassement de matériau d’obturation. Originellement conçue pour permettre la condensation de la gutta chaude.
Concept de Weine : préparation en marche d’escalier (Step-back, 1977)
Il s’agit de préparer le canal en commençant par la portion apicale, depuis le cathétérisme jusqu’à la lime n° 25 (lime apicale maîtresse). À partir de ce numéro, chaque lime successive doit être utilisée à une longueur de travail réduite de 1 mm.
Concept de Marshall et Pappin : préparation corono-apicale (Crown-Down, 1980)
La technique « crown-down » met en œuvre un nettoyage et une mise en forme canalaire du tiers coronaire vers le tiers apical.
Techniques de préparation canalaire
Technique manuelle (technique sérielle)
Définition de la lime apicale maîtresse
C’est la lime de plus gros diamètre qui atteint la longueur de travail sans contrainte.
Définition de la lime de perméabilité
C’est la lime de diamètre inférieur qui assure la perméabilité canalaire au cours de la préparation.
Principe
Il s’agit de réaliser la préparation du canal, depuis le cathétérisme jusqu’à la mise en forme définitive, à l’aide d’instruments manuels de diamètre croissant, sans jamais sauter de numéros, sous irrigation abondante. Le passage à l’instrument de diamètre supérieur ne se fait que si l’instrument précédent est libre dans le canal, à la longueur de travail, jusqu’au 25/100 minimum, avec au besoin un retour à un instrument de diamètre inférieur.
Séquence instrumentale
| Instrument | Numéro | Longueur |
|---|---|---|
| Broche ou lime K | 15, 20, 25 | À LT |
| Broche ou lime K | 30 | LT – 1 mm |
| Broche ou lime K | 30 | LT – 2 mm |
| Lime H | 15, 20, 25 | À LT |
| Lime H | 30 | LT – 1 mm |
| Lime H | 35 | LT – 2 mm |
Technique mixte
Elle se déroule en deux étapes :
Phase de préparation des 2/3 coronaire du canal
Elle vise à éliminer tout obstacle et les irrégularités coronaires du canal afin de faciliter le passage des instruments manuels jusqu’à l’extrémité apicale. Elle peut se faire :
- En passant une séquence de forets Gates-Glidden (n° 1, 2, 3 et 4).
- En utilisant des instruments en NiTi (conicité 08 %, 06 %, puis 4 %).
- En passant des inserts endodontiques ultrasoniques.
Phase de préparation du 1/3 apical du canal
Elle se fait en passant une séquence d’instruments manuels, en respectant les mêmes règles que la technique sérielle. La préparation doit se terminer à la lime n° 30.
Techniques mécanisées
Elles utilisent des instruments en NiTi montés sur un contre-angle relié à un moteur, offrant une vitesse de rotation et un torque réglables, adaptés à chaque système instrumental, ainsi qu’un système de débrayage.
Préparation canalaire répondant au concept du Crown-Down
Système à conicité variable : ProTaper®
Le ProTaper® est le seul instrument présentant une conicité variable. C’est un instrument coupant, permettant une mise en forme canalaire efficace et rapide des canaux fins et courbés, sans transport de la trajectoire canalaire. La conicité variable assure une flexibilité adaptée aux différents instruments du système.
Séquence instrumentale
- Utilisation de limes K manuelles en acier (diamètre 10 et 15), enduites de Glyde File Prep®, pour la négociation initiale et la préparation de la portion accessible du canal, sans atteindre l’apex.
- Utilisation de l’instrument S1 sans dépasser la profondeur de pénétration de la lime K 15, pour élargir et mettre en forme la portion perméabilisée.
- Utilisation du Shaping File SX sans pression, par un mouvement de va-et-vient et de brossage sur la paroi opposée, pour redresser l’accès coronaire.
- Pousser des limes manuelles 10 ou 15 précourbées vers le 1/3 apical pour déterminer la longueur de travail, puis élargir cette portion.
- Avancer le S1 jusqu’à la longueur de travail, par un mouvement de brossage et va-et-vient, en appui au retrait contre les parois canalaires.
- Avancer le S2 à la longueur de travail, de la même manière que le S1.
- Avancer le F1 (Finishing File) à la longueur de travail, par des mouvements de va-et-vient uniquement.
Système à conicité constante : FKG®
Les instruments sont numérotés comme suit :
- R1 : conicité 6 %, diamètre 15/100.
- R2 : conicité 4 %, diamètre 25/100.
- R3 : conicité 4 %, diamètre 30/100.
Séquence instrumentale
- Ramener le R1 sur la portion accessible du canal.
- Ramener le R2 à la longueur de travail.
- Ramener le R3 à la longueur de travail.
Nouveaux concepts de préparation canalaire
Réciprocité
Le mouvement de réciprocité anime les limes de conicité élevée par un mouvement horaire/antihoraire d’amplitude variable. Le mouvement de vissage est plus important en amplitude que le mouvement de dévissage, évitant de repousser des débris en direction apicale. Exemples : WaveOne®, Reciproc®.
Protocole opératoire (WaveOne®)
La préparation est mono-instrumentale :
- Après réalisation de la cavité d’accès et repérage de l’entrée canalaire, explorer le canal à l’aide d’une lime manuelle K 10, puis pré-élargir manuellement.
- Mettre en forme la portion accessible du canal avec l’instrument réciproque (WaveOne primaire pour les canaux fins, WaveOne secondaire pour les canaux larges).
- Explorer la portion apicale du canal avec une lime K 10 et pré-élargir.
- Mettre en forme le 1/3 apical avec l’instrument WaveOne.
Système Self Adjusting File® (SAF)
L’instrument SAF® est un tube creux compressible, de 1,5 ou 2 mm de diamètre, composé d’un treillis en nickel-titane. Cet instrument « mou » s’adapte à la forme du canal. Il est couplé à un système d’irrigation.
Protocole opératoire
- Mettre en forme le canal jusqu’au diamètre 20 au minimum, avec des instruments manuels.
- Insérer doucement le SAF® en mode vibratoire actif dans le canal jusqu’à la longueur de travail, puis l’animer d’un mouvement de va-et-vient vertical sous irrigation continue.
Voici une sélection de livres:
- Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché
- Concepts cliniques en odontologie conservatrice
- L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement
- Guide clinique d’odontologie
- Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve
- La photographie en odontologie: Des bases fondamentales à la clinique : objectifs, matériel et conseils pratique


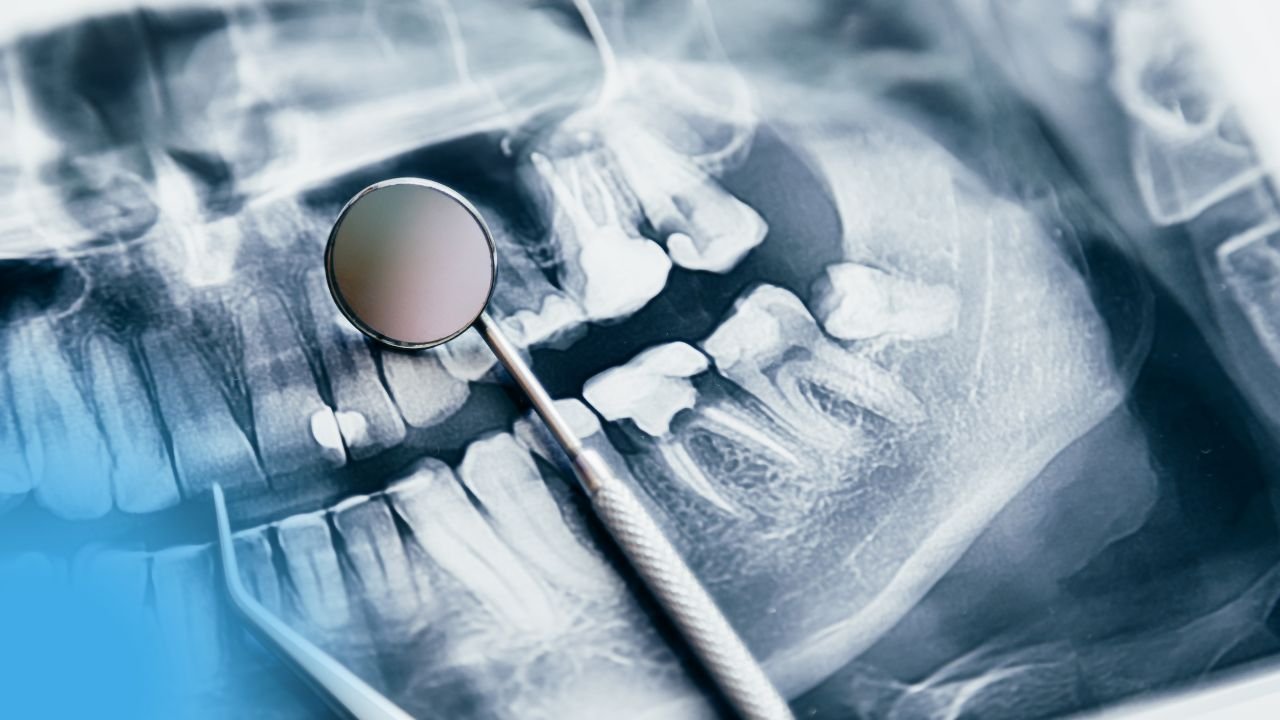

Leave a Reply