PREPARATION ENDOCANALAIRE LA CAVITÉ D’ACCÈS ENDODONTIQUE
PREPARATION ENDOCANALAIRE LA CAVITÉ D’ACCÈS ENDODONTIQUE
Introduction :
L’objectif du traitement endodontique des dents atteintes de pathologie pulpaire ou pathologie périapicale, est de prévenir ou d’éliminer l’infection, par l’éradication des bactéries et de leurs toxines du système canalaire, ainsi que de tous les débris susceptibles de servir de support et de nutriments à la prolifération bactérienne.
ère
C’est la 1 phase de la préparation canalaire. Elle consiste à réaliser une voie d’accès intra
coronaire de forme, de dimensions et de position bien déterminées qui permet une pénétration aisée et sans contraintes du système canalaire en direction apicale.
La réalisation correcte de cette phase coronaire facilite la pénétration instrumentale et donc l’élargissement canalaire. Le succès du traitement endodontique est donc directement lié à la qualité de cette voie d’accès qui est une étape capitale de la préparation canalaire.
Définition :
Souvent appelée injustement cavité de trépanation.
ère
C’est la 1 phase de la préparation canalaire.
Elle consiste à réaliser une voie d’accès intra coronaire de forme, de dimensions et de position bien déterminées qui doit permettre :
🞑 Un passage direct à l’orifice des canaux
🞑 Une pénétration aisée et sans contraintes du système canalaire en direction apicale.
Instrumentation nécessaire à la réalisation des cavités d’accès :
🞑 Fraises turbines type 170L et fraise sur taillée pour la réalisation de la cavité de délinéation dans l’émail.
🞑 Fraises boules longues (14mm ou 28) pour la trépanation proprement dite
🞑 Fraises de BATT pour la mise en dépouille de la chambre pulpaire
🞑 Fraises « ZEKRYA ENDO » pour l’extension des parois camérales.
Objectifs de la cavité d’accès endodontique :
La réalisation de la cavité d’accès doit être conduite selon les 3 objectifs suivants :
- Tous les tissus dentaires, et éventuellement les matériaux d’obturation composant le plafond pulpaire, doivent être supprimés. La cavité doit néanmoins être réalisée à minima et ne pas être trop délabrante.
- La cavité doit être à 4 parois afin d’assurer un réservoir constant de solution d’irrigation et une bonne assise du pansement provisoire entre les séances. La dent sera donc systématiquement reconstituée avant tout traitement.
- Les entrées canalaires doivent être visibles directement, et l’accès des instruments dans les canaux doit pouvoir se faire sans interférence dentinaire et/ou amélaire.
- La cavité d’accès doit être suffisamment ouverte
(Une mise de dépouille paroi): pour éviter tout surplomb au niveau de la chambre pulpaire, pour permettre le retrait des débris organiques, le repérage des variations anatomiques ainsi que la préparation et l’obturation de l’ensemble du système canalaire. Mais cette cavité ne doit pas mutiler inutilement la dent.
aura toujours une morphologie correcte, adaptée à celle de la dent
- En effet, la préparation de la CAE est indissociable de l’anatomie pulpaire de la dent. Il est obligatoire de posséder une image anatomique complète de l’organe dentaire : ” chaque dent présente des racines et des canaux dont le nombre et la configuration sont principalement typiques “.
- En outre, il faut connaître aussi l’anatomie particulière des dents du patient, et tenir compte d’autres facteurs comme : l’âge du patient, la position de la dent sur l’arcade, l’ouverture buccale du patient, le passé médical de la dent.
- Un ou plusieurs clichés radiographiques (incidences excentrées pour permettre la dissociation des racines), sont indispensables pour connaître l’anatomie particulière de la dent. Ces clichés préopératoires seront, bien entendu, minutieusement étudiés avant de réaliser la préparation de la cavité d’accès.
- Enfin, l’examen clinique direct de la dent, donnera des renseignements sur l’état de la couronne et éventuellement sur les étapes préliminaires à réaliser.
- Ce n’est que muni de tous ces éléments que l’on pourra déterminer la localisation, la taille et la forme de la CAE.
L’approfondissement de la cavité occlusale doit impérativement se faire en direction de la chambre pulpaire.
Il est donc important de bien analyser les radiographies préopératoires afin de matérialiser la position du toit de la chambre et définir l’orientation qui doit être donnée à la fraise. Un certain nombre de facteurs sont à prendre en compte :
Le grand axe de la dent :
Peut changer au cours du temps pour différentes raisons (version mésiale consécutive à l’absence de dent adjacente, égression, déplacement orthodontique, etc.) l’examen clinique et les radiographies préopératoires permettent de mettre en évidence ces modifications, et d’adapter en conséquence l’axe de la cavité.
Cette molaire mandibulaire a subi une version mésiale. L’axe de l’approfondissement de la cavité (axe vert), différent du grand axe de la dent (en rouge) a conduit à la perforation mésiale de la dent. Les facteurs morphologiques : La couronne de la dent peut présenter un axe différent de celui de la racine. Pour les prémolaires et molaires mandibulaires, cet axe est orienté en direction occluso- linguale, et pour les dents maxillaires, cet axe est occluso-vestibulaire.
La diminution du volume pulpaire. Le remplacement physiologique ou pathologique du tissu pulpaire par de la dentine implique une modification de l’axe de la cavité d’accès sur les dents antérieures.
Pour toutes les dents, les étapes de la cavité d’accès restent les mêmes ; seuls les repères anatomiques et la forme générale de la cavité varient en fonction de la dent concernée et de son anatomie :
C’est le 1 temps de la cavité d’accès qui consiste à la création d’une cavité de quelques mm de
profondeur qui correspond à une projection sur la surface externe de l’anatomie interne de la dent. On procède à cette étape en utilisant une fraise 170L ou surtaillée montée sur turbine et orientée selon l’axe longitudinal de la dent.
À un point d’élection, propre à chaque type de dent, la trépanation proprement dite est réalisée, à l’aide d’une fraise boule longue n° 2 ou 3, montée sur, contre-angle afin de conserver toute sensation tactile.
En général, il ne reste environ qu’un mm de tissu dentinaire. Cette étape est réalisée à l’aide d’une fraise boule long col de diamètre 012 ou 014 sans spray, montée sur un contre-angle bleu et sous contrôle visuel. La fraise est placée sous le toit de la cavité, et est utilisée exclusivement en retrait, (jamais en poussant afin d’éviter une perforation). Cette étape peut également être réalisée avec une fraise dont la pointe est mousse (Endo Z)
- À l’aide d’une sonde n° 17, il est nécessaire de contrôler la suppression complète de ce toit pulpaire. La sonde doit pouvoir glisser sur les parois de la cavité sans rencontrer de contre- dépouille
- Une fois tout le toit supprimé, la cavité est mise de dépouille et les parois sont régularisées.
Mise de dépouille de la cavité :
- Une occluso-divergence de 2 à 3 degrés des parois de la cavité d’accès améliore l’assise et l’étanchéité du pansement soumis aux forces de la mastication.
- À l’aide d’une sonde n° 17, il est nécessaire de contrôler la suppression complète de ce toit pulpaire. La sonde doit pouvoir glisser sur les parois de la cavité sans rencontrer de contre- dépouille.
- Une fois tout le toit supprimé, la cavité est mise de dépouille et les parois sont régularisées.
Finition de la cavité d’accès
La cavité terminée doit :
- Avoir été réalisée a minima avec un souci d’économie de tissu dentaire.
- Permettre à l’opérateur de voir toutes les entrées canalaires sans avoir à bouger le miroir.
- Présenter des parois lisses.
- Fournir des repères fiables pour le positionnement des stops en silicone des instruments de mise en forme. Si tel n’est pas le cas, la ou les pointes cuspidiennes de la dent devront être réduites d’environ 1 mm afin d’avoir des points de référence coronaire plats.
Techniques opératoires
- La technique opératoire et le respect des différentes étapes doivent être aussi rigoureux que lors de la préparation d’une cavité de dentisterie restauratrice.
- Anesthésie si elle est nécessaire pour réaliser le traitement endodontique,
o
- Curetage soigneux de la cavité de carie, à la fraise boule n 6 ou 8, montée sur contre-angle à vitesse lente.
- Elimination des parois d’émail fragiles risquant de se fracturer sous la pression du crampon à digue.
- Si la dent est trop délabrée : réaliser une restauration provisoire. C’est le seul cas où l’ouverture de la chambre pulpaire se fera avant la pose de la digue pour deux raisons :
- Ne pas risquer d’obstruer les entrées canalaires avec un ciment provisoire
- Et éventuellement vérifier que la dent est effectivement conservable et traitable (carie du plancher pulpaire, perforation, etc.).
Dans ce cas, si la chambre pulpaire n’est pas ouverte par la carie, l’ouvrir en direction d’une corne
o
pulpaire (la plus volumineuse) à l’aide d’une fraise boule acier n 2, et dès que l’on sent la
cavité, prendre la fraise Zekrya endo, qui nous guidera sur le plancher pulpaire.
Ne pas oublier de placer une boulette de coton dans la chambre pulpaire, voire des morceaux de cône de gutta-percha dans les orifices canalaires, avant de faire la restauration provisoire.
- Si la dent est porteuse d’une obturation défectueuse ou d’une coiffe défectueuse, il faut les déposer à ce moment, afin de réévaluer le cas
- Dans le cas où la dent est saine ou peu délabrée, cas idéal, l’émail sera éliminé sur 2,5 à 3 mm d’épaisseur à l’aide d’une fraise cylindro-conique diamantée montée sur turbine, en donnant déjà à la cavité une forme s’approchant de la forme idéale.
o
- Puis, à l’aide d’une fraise boule, n 1 ou 2, montée sur contre-angle, la dentine sera fraisée en direction d’une corne pulpaire.
- Dès que la dépression de chambre pulpaire est ressentie, on travaille de l’intérieur vers l’extérieur, pour élargir l’orifice de trépanation, et permettre le passage de la fraise Zekrya endo à pointe mousse.
Création de la cavité d’accès
- L’utilisation de la fraise Zekrya endo a grandement facilité et assuré la création de la cavité d’accès : cette fraise permet de travailler à la turbine en toute sécurité, en prenant appui sur
le plancher pulpaire, sans risquer de perforation ou de mauvaise route. La fraise étant longue, elle permettra, en même temps, de donner leur forme définitive aux parois de la CAE. On tendra donc à donner à la CAE sa forme idéale en fonction de la dent que l’on traite.
Elimination du contenu de la chambre pulpaire
- Le plus souvent le travail de la fraise ZEKRYA sous spray suffira à éliminer le contenu de la chambre pulpaire.
- Sur une pulpe vivante, il peut être utile d’employer un gros excavateur pour compléter ce nettoyage.
- Dans les cas de gangrène pulpaire ou de pulpe ouverte, il est intéressant d’utiliser les ultrasons qui nettoieront parfaitement la chambre pulpaire, éliminant même les copeaux dentinaires dus au fraisage.
- Visuel : la création de la cavité d’accès doit permettre de repérer visuellement les entrées canalaires dans la plupart des cas.
o
- A la sonde n 17, vérifier qu’on n’a pas laissé de contre-dépouilles au niveau du plafond
pulpaire, où du tissu pulpaire pourrait rester accroché et compromettre ainsi le succès du traitement endodontique, faire les rectifications nécessaires.
- Avec une sonde de Rhein, vérifier l’accessibilité des canaux et l’orientation, là aussi, afin de rectifier si nécessaire.
® ® o
- On introduit un instrument de type Lime K ou MMC n 8, 10 ou 15, en fonction du diamètre
du canal afin de vérifier l’axe du canal, et de voir s’il n’y a pas d‘interférences avec les parois de la CAE. On rectifie si nécessaire, et la suite du traitement endodontique pourra être entreprise.
■
- Monoradiculées, l’incisive centrale et la canine maxillaire sont rectilignes dans la majorité des cas.
- L’incisive latérale présente de façon quasi constante une courbure apicale en distopalatin qui passe inaperçue à la radiographie.
- Dans le sens mésio-distal, la chambre pulpaire est plus large au niveau incisif ; dans le sens vestibulo-lingual, elle s’élargit dans la région cervicale et présente une constriction à la transition entre la chambre pulpaire et le canal radiculaire : le triangle dentinaire palatin. Ce triangle sera supprimé lors de la réalisation de la cavité d’accès.
- Le canal unique a une section triangulaire qui a tendance à devenir circulaire dans la région apicale.
- Dessin de la cavité idéale
- La cavité d’accès est effectuée sur la face palatine de la dent.
- Sa forme générale est triangulaire ; le sommet du triangle est situé au niveau de la partie haute du cingulum. La base du triangle est parallèle et à distance du bord incisif de la dent.
- La forme générale de la cavité suit la forme de contour de la dent. La CA au niveau de la canine est de forme ovalaire.
- Approfondissement de la cavité
- Contrairement aux dents cuspidées, l’approfondissement ne se fait pas selon l’axe de la couronne de la dent.
- L’opérateur doit orienter la cavité vers le toit de la chambre pulpaire, l’approfondissement se fait jusqu’à l’effraction pulpaire.
- En cas de rétraction de la pulpe, la chambre a tendance à se rétracter en direction apicale. L’axe de la cavité est donc modifié. La lecture de la radiographie per-opératoire est par conséquent très importante,
- Suppression du plafond pulpaire et du triangle dentinaire palatin
- Le toit de la chambre est alors supprimé à l’aide d’une fraise boule long col, en travaillant en retrait.
- A la fin de cette intervention, la cavité obtenue génère la présence de deux triangles qui créent une contrainte pour le passage des instruments.
- Il est donc indispensable de les supprimer :
- Le triangle vestibulaire est éliminé avec la fraise boule montée sur turbine dans un mouvement de retrait arciforme.
- Le triangle palatin est supprimé avec la fraise boule LN qui est insérée à l’arrêt sous ce dernier, puis utilisée en retrait avec l’instrument en rotation pour rejoindre la ligne de contour palatine de la cavité d’accès.
- Finition de la cavité d’accès
Une fois terminée, la cavité est mise en dépouille et les différentes aspérités sont supprimées, soit à l’aide d’un instrument rotatif, soit avec les inserts sonores.
- Spécificités de la cavité en fonction de la dent
- Le principe de réalisation de la cavité d’accès est absolument le même pour les incisives centrales et latérales, et la canine maxillaire. Néanmoins, une attention particulière sera portée sur l’inclinaison de la dent (dans le plan frontal et sagittal).
- Les erreurs à ne pas commettre
- Forme générale de la cavité :
🞑 La cavité doit rester entièrement palatine ; elle ne doit toucher à aucun moment le bord incisif de la dent en traitement,
🞑 La cavité doit être économe de tissu dentaire.
- Accès au système canalaire :
🞑 Les erreurs d’axe lors de l’approfondissement sont les plus fréquentes. Si l’axe choisi est erroné, la perforation de la face vestibulaire est inévitable.
🞑 Les instruments endodontiques doivent accéder directement au canal, notamment sur l’incisive centrale et la canine dont le canal est souvent rectiligne. Si des interférences persistent, la suppression du triangle dentinaire palatin doit être réévaluée.
Groupe des prémolaires maxillaires :
🞑 La chambre pulpaire des prémolaires maxillaire est ovalaire et possède deux cornes pulpaires.
🞑 Très souvent la première prémolaire est bifide, la racine présente deux canaux (un par racine). Ces canaux peuvent parfois se rejoindre dans la région apicale, notamment quand la dent est monoradiculée.
🞑 La seconde prémolaire maxillaire est majoritairement monoradiculée mais présente quand même deux canaux.
2-dessin de la cavité d’accès :
- La face occlusale semble être divisée en deux parties égales par le sillon principal. La partie vestibulaire de la table occlusale est plus grande que la palatine ; le centre de la dent se trouve donc à l’intersection :
- De la droite séparant la table occlusale en deux parties égales,
- Et de l’axe joignant les deux sommets cuspidiens.
- Les canaux vestibulaire et palatin se trouvent de part et d’autre de ce milieu sur l’axe intercuspidien.
- Le canal palatin est à proximité du sillon central, et le canal vestibulaire est éloigné de ce sillon.
- La cavité idéale est aplatie, a grand axe vestibulo-palatin, étroite dans le sens mésio-distal; elle englobe les entrées canalaires.
. Approfondissement de la cavité ;
Comme pour toutes les dents cuspidées, l’approfondissement de la cavité occlusale se fait selon le grand axe de la couronne qui, au niveau des prémolaires maxillaires, est confondu avec celui de la dent.
La cavité est approfondie, jusqu’à la mise en évidence d’une corne pulpaire. Enfin, a l’aide d’une
fraise boule long col utilisée en travaillant en retrait, le reste du plafond pulpaire est éliminé.
- Finition
- La mise de dépouille des parois.
. Rappel anatomique :
La molaire maxillaire est certainement la dent dont l’anatomie du système canalaire est la plus complexe, ll est actuellement acquis que la molaire maxillaire (surtout la première) présente très fréquemment 4 canaux :
- Un canal palatin (P)
- Un canal disto-vestibulaire (DV)
- Deux canaux mésio-vestibulaires (MV 1 et MV2).
- La cavité est trapézoïdale, son dessin est guidé par la forme de contour de la dent. Elle englobe l’ensemble des projections des cornes pulpaires sur la face occlusale.
- La cavité est située en mésial de la face occlusale, et ne dépasse pas en général le pont d’émail. Au moment de la finition et de la relocalisation des entrées canalaires, cette cavité peut éventuellement être modifiée.
Le canal palatin est en général plus large que les autres. La cavité présente donc une paroi vraie au niveau de ce canal, ce qui explique sa forme trapézoïdale et non triangulaire.
La corne pulpaire palatine (P) est placée à :
- L’intersection du sillon intercuspidien vestibulaire et du sillon principal, légèrement en palatin.
- La corne pulpaire mésio-vestibulaire (MV) est située immédiatement sous la pointe cuspidienne du même nom.
- Tracer une droite passant par la corne MV et parallèle à la face vestibulaire de la dent.
- Tracer une droite passant par la corne P et parallèle à la face mésiale.
- Tracer une droite joignant les deux cornes pulpaires MV et P
—> Un triangle se dessine.
- Tracer la hauteur du triangle perpendiculaire à la droite (MV-P).
Les trois cornes pulpaires étant localisées, la cavité d’accès est dessinée en les englobant. Noter que
‘
cette cavité est en mésial du pont d émail.
La cavité est approfondie dans l’axe de la couronne qui est sensiblement celui de la dent.
Une fois l’effraction pulpaire obtenue, la cavité est mise de dépouille, les parois régularisées, et les pointes cuspidiennes légèrement diminuées si nécessaire.
La cavité d’accès idéale est
‘
Dessinée et approfondie jusqu à obtenir une effraction pulpaire.
Le plafond retiré, les 3 canaux principaux (MV, P et DV) sont mis en évidence
e
5-Mise en évidence du 4 canal :
e
C’est uniquement à ce stade que le 4 canal est recherché. Il est également possible de différer cette
étape après avoir fait la mise en forme des 3 canaux précédents
La cavité d’accès terminée est légèrement trapézoïdale de dépouille, et permet un accès aux 4 canaux sans interférence.
A-Comment localiser le MV2 ?
- Observation clinique préopératoire
Un moyen clinique simple pour apprécier la largeur de cette racine est procuré par le sondage parodontal.
Cette opération consiste à évaluer à l’aide d’une sonde parodontale la position plus ou moins palatine de la furcations entre la racine palatine et la racine mésio-vestibulaire.
Même si la furcations n’est bien sûr pas toujours accessible, une légère concavité plus coronaire en regard de cette dernière peut être perceptible à la sonde ; sa situation plus ou moins palatine renseigne sur la largeur de la racine mésiale.
- Analyse de la radiographie préopératoire
- Les clichés radiographiques au niveau des molaires maxillaires doivent être le plus souvent réalisés en incidence disto-excentrée (incidence de Walton) afin d’éviter la superposition du Malaire sur les structures dento-parodontales et sinusiennes.
- L’observation attentive des contours de la racine MV et la position plus ou moins centrale du MV1. Sur un cliché radiographique, la position excentrée d’une lime endodontique dans la racine mésio-vestibulaire Laisse présager la présence d’un MV2.
- Une parodontite apicale en regard de la racine mésio-vestibulaire (et en particulier localisée vers la paroi distale) doit attirer l’attention sur la nécessité d’une recherche de ce canal. Ceci est encore plus vrai lorsqu’il s’agit d’un échec de traitement initial.
Prolonger la hauteur du triangle
décrit ci-dessus en mésial.Le canal MV2 se trouve en mésial deaxe P-MV et dans un triangle dont le 3″ sommet est sur la hauteur
C-Astuce pour localiser du MV2
Lorsqu’il est difficile de mettre en évidence ce canal, les procédures suivantes peuvent être utilisées.
- Après avoir fait la mise en forme et la désinfection des 3 canaux, remplir la cavité d’accès d’hypochlorite de sodium. En dissolvant les matières organiques, l’hypochlorite de sodium génère des bulles.
- Étant donnés que les 3 autres canaux ne présentent plus de tissu pulpaire, il suffit de regarder d’où viennent les bulles pour localiser l’entrée du MV2.
- Il est également possible d’utiliser le bleu de méthylène. Une boulette de coton imbibée du colorant est placée pendant une minute dans la cavité d’accès. Après rinçage et séchage, seules les zones contenant des matières organiques et a fortiori le tissu pulpaire du canal recherché restent colorées en bleu.
D. Deuxième et troisième molaires maxillaires
- La description de la cavité d’accès de la 1ere molaire reste la même pour les 2eme et 3eme molaires maxillaires.
e
- Cependant, l’anatomie varie, et la présence du 4
canal diminue statistiquement de façon
importante pour la deuxième puis la troisième molaire maxillaire.
- D’autre part, plus la dent est distale, plus la corne pulpaire disto-vestibulaire a tendance à se rapprocher de l’axe reliant le canal MV et le canal P ; le triangle tend donc à s’aplatir. II n’est pas rare d’ailleurs de noter un alignement des 3 canaux sur une deuxième ou troisième molaire maxillaire.
- Maxillaire inferieur :
🞑 A. Groupe incisivo-canin :
- 1. Rappels anatomiques :
◻ Ce sont les dents les plus petites de la cavité buccale de l’adulte
- Les racines sont fines et aplaties dans le sens mésio-distal. Les incisives mandibulaires présentent deux canaux dans la moitié des cas. Lorsqu’elles ne présentent qu’un seul canal, celui-ci peut être rétréci en son milieu et avoir la forme d’un huit.
- La canine mandibulaire est rarement bifide et ne possède en général qu’un seul canal ; celui- ci est ovalaire et présente très fréquemment une courbure apicale distale.
- Forme idéale de la cavité
- La cavité d’accès est réalisée au centre de la face linguale de la dent. Elle a la forme d’un triangle dont le sommet arrondi est situé au niveau du cingulum, et dont la base est parallèle au bord incisif de la dent
- Le dessin général de la cavité est guidé par la forme de contour de la dent. Incisives et canines mandibulaires.
En divisant la face linguale de l’incisive mandibulaire en trois tiers horizontaux et trois tiers verticaux, nous pouvons matérialiser le centre de la dent. La cavité d’accès idéale est un triangle centré
sur la face linguale. Le sommet du triangle se situe au niveau du cingulum et la base est parallèle au bord incisif, tout en restant à distance de celui-ci.
- De la même façon que pour l’incisive maxillaire, le choix de l’axe d’approfondissement se fait en fonction de la situation de la chambre pulpaire. Plus la rétraction pulpaire est importante, plus l’axe est vertical. II faut garder à l’esprit que la dent est versée en direction vestibulaire, et n’est pas verticale. L’instrument rotatif doit donc être incliné en lingual.
‘
- Une erreur dans le choix de l’axe d approfondissement conduit inévitablement à la perforation de la dent. Cette perforation est en général vestibulaire. Elle peut également être proximale car la dent est aplatie et étroite dans le sens mésio-distal
- La cavité est approfondie jusqu’à l’effraction pulpaire. Le reste du plafond est supprimé à
er
l’aide de la fraise LN en travaillant en retrait. Si le 1 canal (en général vestibulaire) est facile
à trouver, le canal lingual est beaucoup plus difficile à mettre en évidence, et ne peut l’être que si le triangle dentinaire lingual a été complètement éliminé.
◻ L’élimination des deux triangles dentinaires vestibulaire et lingual permet de mettre en évidence le ou les canaux, et supprime les interférences pour les manoeuvres instrumentales.
Noter que les cavités terminées sont localisées exclusivement sur la face linguale de la dent, et que leur forme est ovalaire afin de reproduire la forme de la racine et du canal.
◻ Les perforations iatrogènes sont souvent rencontrées en vestibulaire, en mésial ou en distal, mais rarement en lingual. Elles sont dues à une mauvaise appréciation de l’axe des dents.
- La cavité doit se situer exclusivement sur la face linguale, le bord incisif ne doit jamais être touché.
- Le triangle lingual doit être entièrement supprimé pour permettre aux instruments d’accéder au canal, avec le moins de contraintes possibles.
C. Première prémolaire mandibulaire
- Rappels anatomiques
◻ La 1 prémolaire mandibulaire présente dans la majorité des cas un seul canal, mais il n’est pas rare d’en découvrir deux voire trois.
- Lorsque le canal est unique, il peut se diviser à plusieurs niveaux radiculaires, et l’anatomie du système canalaire devient très complexe.
- Au niveau de la morphologie coronaire, cette dent ressemble à une canine mandibulaire dont la cuspide linguale est un cingulum proéminent. La partie vestibulaire représente environ les 2/3 de la face occlusale de la couronne
- Forme idéale de la cavité
- La chambre pulpaire étant au milieu de la dent, la cavité d’accès ovalaire est faite aux dépens de la cuspide vestibulaire.
La surface développée par la cuspide vestibulaire est beaucoup plus importante que par la cuspide linguale. En traçant un axe intercuspidien (axe bleu) et un axe passant à la jonction 1/3-2/3 de la cuspide vestibulaire (axe vert), on obtient le milieu de la dent. La cavité est ovalaire et centrée sur la face occlusale. La forme générale suit le contour externe de la dent. Plus le diamètre mésio-distal est petit, plus la cavité est étroite.
- L’approfondissement se fait selon l’axe de la couronne qui est différent de celui de la dent. La cavité est agrandie jusqu’à l’effraction pulpaire Le reste du plafond est supprimé à l’aide de la fraise long col travaillant en retrait, ou à l’aide de la fraise Endo Z
4. Finition
◻ La forme de la cavité est allongée dans le sens vestibulo-lingual afin de mettre en évidence le deuxième canal.
C. Deuxième prémolaire mandibulaire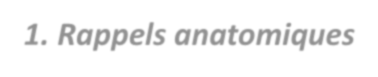
- Rappels anatomiques
◻ La deuxième prémolaire mandibulaire présente une cuspide vestibulaire et deux cuspides linguales. Sa face occlusale est plus développée que la précédente et son sillon principal divise la face occlusale en deux parties presque égales.
- Forme de la cavité
◻ La cavité, centrée sur la face occlusale de la dent, est ovalaire, allongée dans le sens vestibulo-lingual. Le canal de cette dent est pratiquement toujours ovalaire et exceptionnellement circulaire ; la forme finale de la cavité d’accès est adaptée â la forme générale du canal d’une part et à la forme de contour de la couronne d’autre part.
◻ Doit être conduite comme pour la 1ere PM. Avant de passer à la finition, toujours vérifier que la dent ne présente pas de canal supplémentaire
D. 1ere molaire mandibulaire
1-Rappels anatomiques
◻ La molaire mandibulaire présente en général 3 canaux (deux mésiaux et un distal). Néanmoins, il n’est pas rare de trouver 2 canaux distaux qui peuvent se fusionner dans la partie apicale. Le canal distal petit également prendre la forme d’un huit.
- La racine mésiale présente une courbure distale. On trouve en général un canal vestibulaire et un canal lingual. Cependant, il est important de bien explorer la région entre ces deux canaux qui renferme parfois un troisième canal mésial.
La dent présente 3 cuspides vestibulaires et 2 linguales ; ceci implique que les sillons intercuspidiens vestibulaires et lingual ne sont pas l’un en face de l’autre, le premier étant plus mésial.
La zone délimitée par ces deux sillons est appelée « zone neutre ». La corne pulpaire distale est située dans cette zone.
- La corne pulpaire distale est placée à l’intersection de l’axe matérialisant le milieu de la dent et la zone neutre.
- La corne pulpaire mésio-linguale (ML) est située à proximité de la fossette marginale mésiale.
- Tracer un axe passant par la corne pulpaire ML et parallèle à la face mésiale de la dent.
- La corne MV est placée sur cet axe, sous la pointe cuspidienne du même nom.
- Les cornes pulpaires étant localisées, la forme de contour de la cavité d’accès se dessine naturellement.
- La cavité d’accès est toujours située sur la partie mésiale de la dent et s’étend rarement au- delà du sillon intercuspidien lingual. Une forme trapézoïdale, le contour de cette cavité est dicté par la forme générale de la dent.
- L’approfondissement de la cavité doit se faire en direction du plafond de la chambre pulpaire. Deux orientations sont à prendre en considération :
- L’axe en vue mésio-distale ;
- L’axe en vue vestibulo-linguale, où l’inclinaison linguale de la couronne ne doit pas être négligée.
- Une mauvaise orientation de la fraise lors de l‘approfondissement de la cavité entraîne inévitablement une erreur qui peut conduire à la perforation.
- Il est important de bien évaluer l‘axe de la dent (en vert) avant la pose du champ opératoire.
La cavité devra être approfondie selon cet axe.
- En vue proximale, l’axe de la couronne est différent de celui des racines. Lors de l’approfondissement, l’inclinaison linguale de la couronne doit également être prise en compte afin d’éviter une perforation linguale de la dent
- Une fois l’effraction pulpaire obtenue, les tissus résiduels du plafond sont supprimés à l’aide de la fraise long col ou d’une fraise Endo Z, et la finition de la cavité est faite de façon conventionnelle. Lorsque l’inclinaison du canal distal est importante, on ne cherche pas forcément à obtenir la mise de dépouille de cette paroi. Il faut cependant veiller à ce que tout le plafond de la chambre soit bien supprimé.
- Un canal ou deux canaux dans la racine distale ?
Le canal distal est en général allongé dans le sens vestibulo-lingual. Lors du cathétérisme initial, la lime de petit diamètre donne une sensation de flottement dans le canal. Si tel n’est pas le cas, et que l’on a l’impression qu’il s’agit d’un canal étroit et excentré en vestibulaire ou lingual, il y a toutes les chances pour que cette dent présente deux canaux distaux.
la couronne est plus petite que celle de la première molaire et la table occlusale présente quatre cuspides. Les repères sont les mêmes que pour la première molaire. Cependant, plus la dent est distale, plus les canaux mésiaux ont tendance à se rapprocher l’un de l’autre, voire parfois même à fusionner. Au moment du dessin de la cavité idéale, on tendra alors à minimiser la forme trapézoïdale et à la rendre rectangulaire.
Il est fréquent de rencontrer des calcifications intra-pulpaires (pulpolithes vrais ou faux), tendant à réduire le volume de la chambre pulpaire jusqu’à oblitération totale chez certains sujets âgés.
🞑 Dans ces cas, il faut être très prudent. Le premier geste, si l’on trouve un orifice est d’utiliser un appareil à ultrasons avec un insert de détartrage, afin d’essayer de désolidariser le pulpolithes des parois.
🞑 Si cette opération n’est pas efficace, il faudra alors fraiser cette calcification en
®
direction des orifices canalaires avec une fraise LN de Maillefer, fraise boule à long
col, montée sur contre-angle, en prenant fréquemment des clichés radiographiques de façon à vérifier la progression de la fraise. Des incidences excentrées seront nécessaires.
Il s’agit là de reprise de traitement endodontique le plus souvent.
Plusieurs erreurs sont à éviter lors de la préparation de la CAE, car elles peuvent compromettre le maintien de la dent sur l’arcade.
Les ouvertures insuffisantes qui vont de l’effraction des cornes ou la trépanation partielle du plafond pulpaire à la mise de dépouille incomplète de la chambre pulpaire sont à l’origine de graves problèmes.
- Empêche l’élimination de la totalité du tissu pulpaire qui pourra être à l’origine de coloration ultérieure de la couronne et de réinfection.
- Elle rend l’accès aux canaux difficile et donne une visibilité nulle.
Par erreur d’appréciation de l’axe de la dent ayant pour origine une méconnaissance de la morphologie des dents ou de leurs inclinaisons.
- Certaines dents présentent en effet, une forme propice aux erreurs d’axe,
- C’est le cas des dents qui possèdent des rétrécissements important au collet comme les prémolaires ou les incisives inférieures,
- D’autres dents comme les incisives et les canines essentiellement ont une orientation naturelle oblique dans le plan vestibulaire ou lingual
- Perforation du plancher pulpaire
◻ Le pronostic est là plus défavorable surtout au niveau des molaires maxillaires. Elle peut nécessiter l’extraction totale ou partielle, au mieux, de la racine correspondante. A la mandibule, la séparation de racine sera possible.
- L’obturation pourra être tentée après arrêt de l’hémorragie ; mais avec des risques de voir se développer une lésion de la furcations.
- Ces accidents peuvent être évités en respectant les principes généraux des préparations des cavités d’accès endodontique.
- Perforation desmodontale consécutive à une fausse route
◻ Elle peut être dramatique dans certains cas, et nécessiter l’extraction de la dent. Si la perforation est accessible par élévation d’un lambeau, on pourra l’obturer en prévenant le patient. On pourra reprendre ensuite le traitement avec beaucoup de précautions.
CONCLUSION :
La cavité d’accès endodontique étant la 1ere étape opératoire de tout traitement endodontique, c’est de la qualité de sa réalisation que va dépendre au plus haut point le succès ou l’échec de toutes les étapes de préparation qui lui succèdent d’où l’intérêt du respect rigoureux des principes qui régissent sa réalisation.
PREPARATION ENDOCANALAIRE LA CAVITÉ D’ACCÈS ENDODONTIQUE
Une bonne hygiène bucco-dentaire repose sur un brossage efficace et l’usage régulier du fil dentaire.
Le diagnostic précoce des caries permet des soins moins invasifs et une meilleure conservation dentaire.
Maîtriser les techniques d’anesthésie locale améliore le confort du patient pendant les soins.
Les maladies parodontales demandent une approche pluridisciplinaire pour prévenir la perte dentaire.
L’occlusion influence la mastication et l’équilibre de l’articulation temporo-mandibulaire.
Les progrès en implantologie offrent des solutions durables et esthétiques pour les dents absentes.
Bien communiquer avec le patient favorise sa compréhension et son adhésion au traitement proposé.




Leave a Reply