Physiopathologie de l’inflammation
Physiopathologie de l’inflammation
Physiopathologie de l’inflammation
Définition
L’inflammation ou réaction inflammatoire est la réponse des tissus vivants, vascularisés, à une agression. Composante de l’immunité innée, elle est généralement protectrice :
- Participant aux processus de défense naturelle.
- Et de réparation des tissus endommagés.
Reconnue par Celsus, au 1er siècle, par quatre signes cliniques, les signes cardinaux de la réaction inflammatoire : Rubor et tumor cum calore et dolor (rougeur et œdème, avec chaleur et douleur).
Causes des réactions inflammatoires
Les causes sont multiples et représentent les agents pathogènes. Elles sont :
Exogènes
- Infection : bactéries, virus, parasites, champignons.
- Agents physiques : traumatismes, radiations, chaleur…
- Agents chimiques : caustiques, toxines…
- Corps étrangers.
Endogènes
- Défaut de vascularisation : réaction inflammatoire secondaire à une nécrose d’origine ischémique.
- Agression dysimmunitaire : anomalie de la réponse immunitaire, allergies, auto-immunité…
Ces causes déterminent des lésions cellulaires et tissulaires qui vont déclencher l’inflammation.
À noter :
- L’inflammation n’est pas synonyme d’infection, mais une infection est une cause d’inflammation.
- Un même agent pathogène peut entraîner des réactions inflammatoires différentes selon l’hôte : d’où l’importance des facteurs liés à l’hôte (ex. : l’état des défenses immunitaires).
Moyens de défense de l’organisme
Ils sont de deux types :
Statiques
- La peau et les muqueuses.
Mobiles
- Les cellules mobiles : polynucléaires (PN), macrophages, lymphocytes.
Les substances humorales élaborées par les cellules participant à l’inflammation peuvent avoir une action :
- Non spécifique : agents vasodilatateurs.
- Spécifique : neutralisation.
Grandes étapes de la réponse inflammatoire
Une réaction inflammatoire à un agent agresseur passe par la mise en jeu successive de moyens de défense non spécifiques et spécifiques.
Moyens de défense non spécifiques
Leurs caractéristiques sont :
- Mise en jeu rapide (clinique aiguë).
- Déclenchement non sélectif (n’importe quel agent agresseur).
- Absence de reconnaissance immunologique préalable de l’agresseur.
- Réponse cellulaire rapide (à polynucléaires).
- Réponse vasculaire rapide (phénomènes vasomoteurs).
Moyens de défense spécifiques
Leurs caractéristiques sont :
- Mise en jeu plus tardive et de plus longue durée (clinique chronique).
- Sensibilisation préalable et mise en jeu d’une réaction immunitaire.
- Réponse cellulaire lente : macrophages, lymphocytes, plasmocytes, fibroblastes.
- Réponse vasculaire lente : néoangiogenèse.
Modalités d’expression de la réaction inflammatoire
En conditions physiologiques, les défenses de l’organisme sont sollicitées en permanence pour assurer le maintien de l’intégrité du milieu intérieur : cette réaction d’homéostasie est sans traduction clinique, elle n’a qu’une traduction morphologique microscopique.
Parfois, l’inflammation peut être pathologique : c’est l’inflammation maladie. Ce caractère pathologique a comme origine soit :
- L’agressivité particulière de l’agent pathogène.
- Sa résistance à la mise en jeu des moyens de défense de l’organisme.
- L’exagération des phénomènes normaux.
- Des déficits fonctionnels.
Ce processus comprend :
- Des phénomènes locaux : l’inflammation se déroule dans un tissu conjonctif vascularisé (les tissus dépourvus de vaisseaux, comme le cartilage ou la cornée, sont incapables de développer une réaction inflammatoire complète).
- Des phénomènes généraux : exprimés biologiquement par le syndrome inflammatoire et cliniquement de façon variable, le plus souvent par de la fièvre et éventuellement une altération de l’état général.
L’inflammation fait intervenir des cellules, des vaisseaux, des modifications de la matrice extracellulaire et de nombreux médiateurs chimiques qui peuvent être pro- ou anti-inflammatoires.
Bien que le déroulement des réactions inflammatoires présente des caractères morphologiques généraux et des mécanismes communs, elles vont différer les unes des autres en fonction :
- De la nature de l’agent pathogène.
- De l’organe atteint.
- Du terrain physiologique de l’hôte.
Ces éléments conditionnent l’intensité, la durée de la réaction inflammatoire et l’aspect lésionnel.
Relation entre physiopathologie et clinique
Une réaction inflammatoire maladie, de manifestation clinique aiguë, correspond à une réponse immédiate à un agent agresseur, de courte durée (quelques jours ou semaines). Les inflammations aiguës guérissent spontanément ou avec une thérapeutique, mais peuvent laisser des séquelles si la destruction tissulaire est importante.
Ces inflammations correspondent à la mise en jeu des moyens de défense non spécifiques, parfois associée à la mise en jeu des moyens de défense spécifiques pour une courte durée.
Une réaction inflammatoire maladie, de manifestation clinique chronique, correspond à une inflammation n’ayant aucune tendance à la guérison spontanée et qui évolue en persistant ou en s’aggravant pendant plusieurs mois ou plusieurs années.
On peut distinguer deux types de circonstances de survenue des inflammations chroniques :
- Les inflammations aiguës évoluant en inflammations prolongées subaiguës et chroniques :
- Lorsque l’agent pathogène initial persiste dans les tissus (détersion incomplète).
- Lorsqu’une inflammation aiguë récidive de façon répétée dans le même organe, entraînant à chaque épisode des destructions tissulaires de moins en moins bien réparées.
- Les inflammations se manifestant d’emblée sous une forme apparemment chronique :
- La mise en jeu des moyens de défense non spécifiques est passée inaperçue car brève ou asymptomatique. C’est souvent le cas d’affections où les mécanismes dysimmunitaires sont prépondérants (ex. : hépatite chronique secondaire à une infection par virus de l’hépatite B ou C).
Mise en jeu des moyens de défense non spécifiques et inflammation aiguë
Une réaction inflammatoire maladie, de manifestation clinique aiguë, correspond à une réponse immédiate à un agent agresseur, de courte durée (quelques jours ou semaines). Se succèdent de façon rapide l’agression, la destruction cellulaire, la détersion et la réparation.
Cellules impliquées
Les polynucléaires (PN)
Pendant les 6 à 24 premières heures, les polynucléaires migrent de la microcirculation vers le site inflammatoire par diapédèse (traversée active des parois vasculaires).
Les polynucléaires neutrophiles (PNN)
Ils ont un rôle majeur. Leurs différentes fonctions sont :
- La phagocytose : capacité à englober, dans le cytoplasme du phagocyte, une particule étrangère vivante ou inerte, habituellement suivie d’une digestion de cette particule par les enzymes lysosomiaux.
- La régurgitation : capacité à libérer dans la matrice extracellulaire des produits de phagocytose (élément phagocyté et enzymes).
- La bactéricidie : production de radicaux libres bactéricides, mais entraînant des lésions du tissu environnant, et production d’enzymes bactéricides (lactoferrine, lysozyme).
Devenir des PNN :
- Production dans la moelle stimulée par des cytokines pro-inflammatoires.
- Migration sous l’influence de facteurs chimiotactiques en 20 minutes.
- Durée de vie : 20 jours, éliminés par apoptose ou exocytose.
Les PN éosinophiles
Ils complètent l’action des neutrophiles. Leurs différentes fonctions sont :
- Phagocytose limitée : complexes immuns.
- Libération de protéines enzymatiques : arylsulfatases, histaminases, jouant un rôle de protéines « tampon » face à la dégranulation des PN basophiles.
En excès, ces enzymes peuvent former des cristaux (cristaux de Charcot-Leyden) observables dans l’asthme, pathologie à l’origine de dégranulations répétées de nombreux polynucléaires éosinophiles.
Les PN basophiles et les mastocytes
Les polynucléaires basophiles sont présents dans le sang circulant. Les mastocytes sont des cellules non circulantes présentes dans les tissus. Leur contenu enzymatique est comparable.
Ils jouent un rôle important dans les phénomènes vasomoteurs associés aux réactions inflammatoires grâce à la libération du contenu enzymatique de leurs granules cytoplasmiques : histamine et héparine.
Les plaquettes
Les plaquettes jouent un rôle fondamental dans :
- L’hémostase : par leur agrégation.
- La protéolyse de la matrice extracellulaire : au niveau du site inflammatoire par dégranulation de leurs enzymes lysosomiaux (hydrolases, cathepsines).
- La libération de dérivés de l’acide arachidonique : prostaglandines, leucotriènes et thromboxanes ayant des actions locales (vasomotricité, attraction de polynucléaires) et des effets généraux (fièvre).
Médiateurs plasmatiques circulants
Leurs caractéristiques principales sont :
- Leur présence dans le plasma sous forme de précurseurs.
- Systèmes multiples à actions complémentaires ou antagonistes.
- Rôle à la fois dans le déclenchement et l’entretien de l’inflammation.
Le système kininogène-kallicréine-kinines
Polypeptides à action vasoactive formés à partir du kininogène plasmatique grâce à l’action d’enzymes : les kallicréines. Le membre le plus important de cette famille de polypeptides est la bradykinine (vasodilatateur).
Les kinines sont de puissants vasodilatateurs activés dans la 1ère heure de la réaction inflammatoire. Elles augmentent la perméabilité vasculaire et sont la principale cause de l’œdème lors des réactions inflammatoires. Leur action est puissante mais brève car leur durée de vie est courte.
Le système du complément : un système en cascade
Le système du complément regroupe un ensemble de protéines sériques (les facteurs du complément) dont l’activation s’effectue par des réactions de protéolyse en cascade. Il joue un rôle important dans :
- Le chimiotactisme des PNN.
- L’opsonisation des bactéries : certains facteurs du complément (C3b…) adhèrent aux bactéries, facilitant leur phagocytose par les PNN et les macrophages.
- La vasodilatation : C3a (anaphylatoxine) entraîne la dégranulation de mastocytes, de polynucléaires basophiles et la libération d’enzymes vasodilatatrices (histamine…).
Systèmes coagulation-fibrinolyse
Il s’agit d’un système en équilibre à l’état normal. La coagulation est activée par les agresseurs : une cascade de protéolyses aboutit à la production de fibrine à partir du fibrinogène. La fibrine limite le foyer inflammatoire. La fibrinolyse est activée par la nécrose cellulaire : la plasmine dégrade la fibrine en produisant des fibres de dégradation de la fibrine (PDF).
Les inhibiteurs plasmatiques des protéases
Ils interviennent dans la régulation des systèmes précédents, dont l’activation complète serait létale. Exemple : alpha1-antitrypsine.
Les médiateurs d’origine cellulaire
L’action directe des cellules est complétée par la libération de :
Dérivés de l’acide arachidonique
Libérés sous l’influence de la phospholipase A2 (provenant essentiellement des polynucléaires neutrophiles et des plaquettes) :
- Prostaglandines : vasodilatateurs puissants favorisant l’augmentation de la perméabilité vasculaire.
- Leucotriènes : jouent un rôle dans le système chimiotactique.
- Prostacycline : anti-agrégant plaquettaire et vasodilatateur.
- Thromboxane A2 : puissant agrégant plaquettaire et vasoconstrictreur.
Amines vasoactives
Les polynucléaires basophiles et les mastococytes libèrent de l’histamine ; les plaquettes libèrent de la sérotonine, tous deux des vasodilatateurs puissants.
Cytokines et facteurs de croissance
Les cytokines sont des peptides ou des protéines produites par de nombreuses cellules. Elles agissent par l’intermédiaire de récepteurs membranaires, sur la cellule qui les produit (effet autocrine), sur les cellules proches (effet paracrine) et sur des cellules situées à distance (effet endocrine).
Elles sont élaborées par les lymphocytes, les monocytes-macrophages et les fibroblastes. Ce sont des facteurs de coopération cellulaire à l’origine de trois effets principaux :
- La médiation de l’immunité naturelle : interférons provoquant une activité antivirale non spécifique.
- La stimulation de l’hématopoïèse : colony stimulating factors.
- La modulation de l’activité de nombreuses cellules : intervenant dans l’inflammation.
Expression morphologique de la mise en jeu des moyens de défense non spécifiques
La réponse homéostatique
Il s’agit de la réaction inflammatoire physiologique sans traduction clinique. Elle comprend trois phases principales :
Phase de limitation
Elle est liée à une réponse vasculaire immédiate comprenant :
- Une pression active : vasodilatation par ouverture des sphinctères précapillaires provoquée par les médiateurs chimiques mentionnés précédemment.
- L’œdème inflammatoire : par élévation de la pression capillaire après ouverture des sphinctères précapillaires et secondairement par modification de la perméabilité vasculaire.
- S’y associent des microthromboses en périphérie du foyer lésionnel et une hémorragie interstitielle.
Phase de détersion
Il s’agit de l’élimination des éléments étrangers ou nécrosés présents au niveau du foyer inflammatoire. Elle est réalisée par les polynucléaires neutrophiles ayant migré jusqu’au site inflammatoire par diapédèse et par les macrophages. Pour effectuer cette détersion, ces cellules utilisent leur capacité de phagocytose.
Phase de réparation
Après la détersion, le site inflammatoire est le siège d’une diminution des réponses vasculaire et cellulaire. Suit une activation du système fibroblastique avec multiplication cellulaire et synthèse de collagène. La réparation tissulaire peut prendre deux formes : la régénération et la cicatrisation.
- Régénération : lorsque la destruction du tissu est partielle, il peut revenir ad integrum et retrouver ses fonctions.
- Cicatrisation : aboutit à un tissu conjonctif néoformé qui remplace le tissu détruit ; elle est mutilante.
L’inflammation aiguë « maladie »
Sa physiopathologie est basée sur l’exagération des réponses vasculaire ou cellulaire normales, ou, plus rarement, sur des déficits fonctionnels congénitaux.
Exagération de la réponse vasculaire
- Inflammation œdémateuse exsudative : une exagération de la perméabilité vasculaire aboutit à un phénomène d’exsudation à l’origine d’un œdème interstitiel tissulaire. Une inflammation œdémateuse exsudative localisée au niveau d’une cavité (plèvre, péritoine, etc.) est à l’origine d’un épanchement. Une inflammation œdémateuse exsudative localisée au niveau d’un conduit (le conduit auditif, etc.) est à l’origine d’un écoulement.
- Lorsque l’exsudat est pauvre en fibrinogène : il est dit séreux.
- Lorsqu’il est riche en fibrinogène, celui-ci se coagule en un réseau de fibrine : il est dit séro-fibrineux. Dans ce cas, lors de la détection, soit la lyse de la fibrine par les enzymes des polynucléaires est complète, soit la détection est incomplète, et un tissu fibreux va se constituer en lieu et place de la fibrine : c’est l’organisation fibreuse.
- Inflammation hémorragique : l’augmentation de la perméabilité vasculaire, notamment par activation de la fibrinolyse lors, par exemple, d’une septicémie ou de phénomènes de coagulation intravasculaire disséminée (coagulation incontrôlée dans les capillaires de l’organisme), est à l’origine d’une inflammation hémorragique.
- Inflammation thrombosante : toute lésion endothéliale au cours d’une réaction inflammatoire est à l’origine de l’activation de la voie de la coagulation. La thrombose au cours de l’inflammation physiologique a pour but de freiner la dissémination de l’agent agresseur. L’inflammation thrombosante survient dans un tissu initialement normalement bien irrigué où une activation excessive de la coagulation est à l’origine de thromboses extensives. Leur effet secondaire est l’anoxie à l’origine d’une nécrose ischémique.
Exagération de la réponse cellulaire
- Inflammation suppurée : caractérisée par la présence massive de pyocytes (polynucléaires neutrophiles altérés). Le pus est un mélange de pyocytes, de fibrine et d’un matériel de nécrose tissulaire. Le plus fréquemment, ce sont des bactéries pyogènes qui sont à l’origine des inflammations suppurées. La présence de pus doit donc conduire à un examen bactériologique.
L’inflammation suppurée peut se rencontrer sous plusieurs formes :
| Forme | Description |
|---|---|
| Abcès | Suppuration limitée et collectée dans un organe plein (ex. : abcès sous-périosté). |
| Empyème | Suppuration limitée et collectée dans un organe creux (ex. : empyème sinusien). |
| Phlegmon | Suppuration ne se collectant pas, s’étendant et prenant un caractère régional (ex. : phlegmon amygdalien). |
Voici une sélection de livres:
- Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché
- Concepts cliniques en odontologie conservatrice
- L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement
- Guide clinique d’odontologie
- Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve
- La photographie en odontologie: Des bases fondamentales à la clinique : objectifs, matériel et conseils pratique
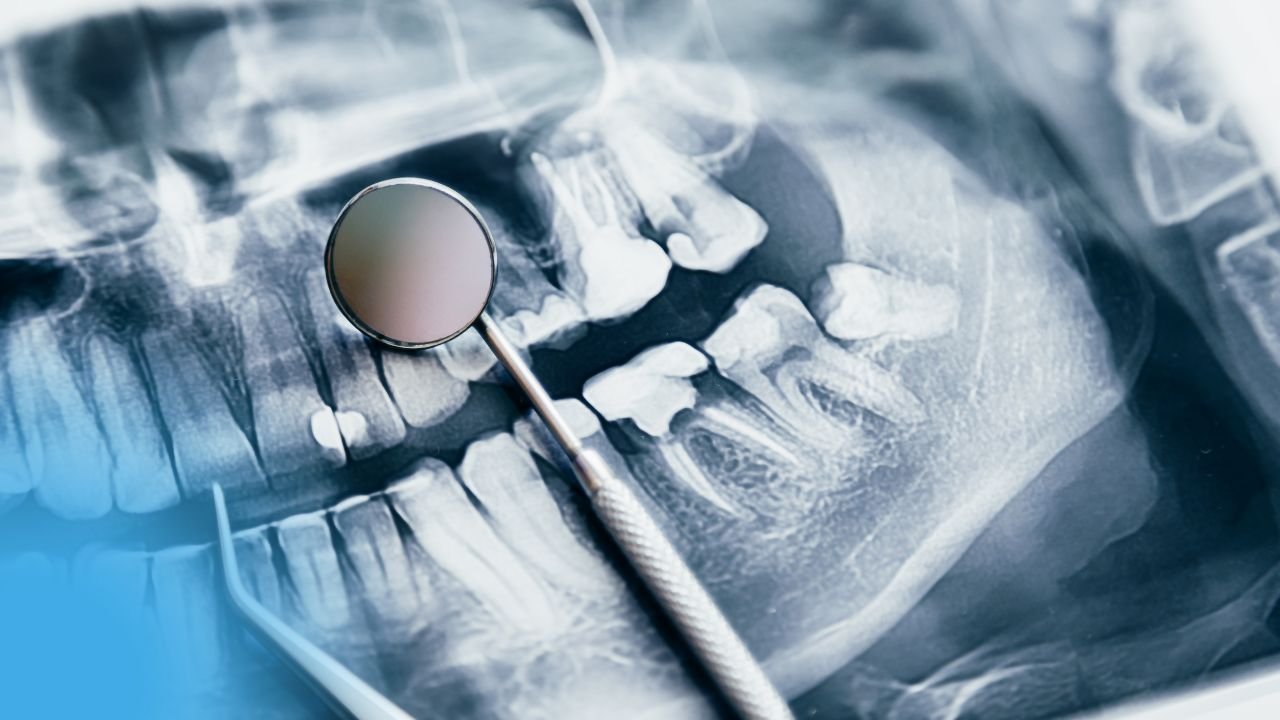



Leave a Reply