Pharmacologie Endodontique
Pharmacologie Endodontique
Pharmacologie Endodontique
I. L’endodonte pariétal
L’endodonte est caractérisé par une complexité particulière tant du point de vue anatomique qu’histologique.
Sur le plan anatomique
- Présence de :
- Canaux latéraux, secondaires et accessoires.
- Anastomoses et ramifications apicales.
Sur le plan histologique
Les tubuli dentinaires forment un système de communication tridimensionnel complexe entre l’environnement canalaire et buccal. Leur configuration varie selon les situations physiologiques ou pathologiques :
- Dents pulpées : Les tubuli contiennent les prolongements odontoblastiques et le fluide dentinaire, qui protège la pulpe et s’oppose à la pénétration des bactéries et toxines.
- Dents dépulpées : Les tubuli déshydratés ne contiennent que des débris nécrotiques des prolongements odontoblastiques. Ces tubuli peuvent être facilement traversés par des microorganismes, des toxines et des médicaments.
Les procédures mécaniques de préparation canalaire entraînent la formation d’une couche microscopique de débris appelée boue dentinaire (ou smear layer / enduit pariétal). La composition exacte de cette couche reste partiellement inconnue, mais elle est inconstante et comprend deux phases principales :
- Phase minérale : Composée de copeaux de dentine et de petits cristaux d’hydroxyapatite (0,5 à 1,5 µm de long).
- Phase organique : Constituée de résidus de la trame collagénique de la dentine et de la prédentine, de débris pulpaires, et éventuellement de microorganismes et leurs produits de métabolisme (toxines, enzymes).
Importance de l’irrigation
En raison de cette complexité endocanalaire, l’action mécanique des instruments seule ne permet pas un parage canalaire satisfaisant. L’irrigation est indispensable pour atteindre cet objectif, combinant :
- Action mécanique + Action chimique = Préparation bio-chimio-mécanique.
II. Irrigation endodontique
1. Définition de l’irrigation
Selon Grossman, l’irrigation consiste à éliminer par lavage, à l’aide d’une solution d’irrigation, tous les débris organiques, minéraux et microorganiques détachés et mis en suspension par l’instrumentation mécanique.
2. Propriétés requises d’un irrigant
Propriétés mécaniques
- Lubrification des instruments, facilitant le parage canalaire.
- Mise en suspension des débris pour leur élimination.
- Nettoyage des parois canalaires.
- Prévention de la formation de bouchons de débris dentinaires.
Propriétés chimiques
- Action mouillante : Abaissement de la tension superficielle.
- Action solvante :
- Sur le contenu : Solubilisation des débris organiques, cellulaires, bactériens et exsudats des canaux principaux et accessoires.
- Sur le contenant : Élimination de la boue dentinaire.
Propriétés biologiques
- Biocompatibilité.
- Action antiseptique : Effet bactéricide et virucide.
3. Produits utilisés
3.1 Hypochlorite de sodium (NaOCl)
Origine : Découvert au 18e siècle (eau de Javel), utilisé initialement pour le blanchiment textile.
Formule :
Cl₂ + 2 NaOH → NaOCl + NaCl + H₂O
Autres dérivés : Dichloroisocyanurate de sodium.
Mode d’action
- Réaction de saponification : Solvant organique et gras, dégrade les acides gras en sels d’acides gras (savon) et glycérol (alcool).
- Réaction de neutralisation : Neutralise les acides aminés, formant eau et sel.
- Formation d’acide hypochloreux : Le chlore se combine avec l’eau et la matière organique pour former l’acide hypochloreux (HOCl⁻) et des ions hypochlorite (OCl⁻), dégradant les acides aminés.
- Action solvante : Libère du chlore qui forme des chloramines avec les groupes protéiques aminés (NH), inhibant les enzymes bactériennes et le métabolisme cellulaire.
- pH élevé : Base forte (pH > 11), interfère avec l’intégrité de la membrane cytoplasmique, altère le métabolisme cellulaire et dégrade les phospholipides (peroxydation lipidique).
Caractéristiques
- Concentration : Utilisé entre 0,5 % et 6 %. Efficace dès 1 %, la concentration la plus courante en odontologie conservatrice et endodontique (OCE) est 2,5 % (mélange de 1 dose de NaOCl à 13° avec 1,6 dose d’eau distillée).
- Volume : Un changement fréquent de NaOCl frais est crucial. Une grande quantité compense une faible concentration, car le NaOCl s’inactive rapidement.
- Temps de réaction : À 0,5 %, destruction bactérienne en 30 minutes ; à 5-6 %, en 30 secondes. La présence de matière organique, exsudats inflammatoires ou biomasse microbienne réduit son efficacité.
- Effet sur la dentine : Dégrade le collagène de type I, affectant les propriétés mécaniques de la dentine.
- Profondeur de pénétration : Varie de 77 à 300 µm selon la concentration, le temps et la température.
- Effet sur les biofilms : À 3 % et 6 %, élimination complète des biofilms ; à 1 %, perturbation partielle.
- Température : Le chauffage des solutions à faible concentration améliore la dissolution tissulaire et l’effet bactéricide. Dispositifs de préchauffage des seringues ou chauffage in situ par ultrasons sont utilisés.
Limites et effets indésirables
- Toxique, goût désagréable (solutions à 6 % les plus toxiques).
- Combinaison avec chlorhexidine : Formation d’un précipité brun orangé (parachloroaniline, PCA), potentiellement mutagène.
- Combinaison avec EDTA : Perte de l’effet antibactérien. Une réutilisation de NaOCl après EDTA provoque une érosion de la paroi radiculaire, nuisant aux qualités mécaniques de la racine.
- Extrusion apicale : Peut causer des dommages tissulaires importants.
3.2 Digluconate de chlorhexidine (CHX)
- Efficacité antimicrobienne : De 0,2 % à 2 %, large spectre, forme de gluconate, fungicide, faible action virucide.
- Action solvante : Faible.
- Action sur la smear layer : Aucune.
- Limites : Efficacité réduite en présence de tissus nécrosés ou exsudats inflammatoires.
- Avantages : Faible toxicité, effet de substantivité (action prolongée). Peut être utilisé en rinçage final après EDTA.
- Effet synergique : Avec l’eau oxygénée.
- Indications : Patients intolérants à l’hypochlorite (gel à 2 %).
- Incompatibilités : Forme un sel avec EDTA ; complexe mutagène avec NaOCl.
3.3 Iodure de potassium d’iode
- Utilisation : Décontamination des surfaces, peau, champs opératoires.
- Efficacité : Bactéricide, fongicide, tuberculocide, virucide, sporicide.
- Limites : Moins efficace que NaOCl, efficacité réduite en présence de dentine, débris tissulaires ou cellulaires.
- Action solvante : Faible.
3.4 Produits oxydants
Peroxyde d’hydrogène (H₂O₂) à 10 vol. (3 %)
- Efficacité : Antiseptique sur germes anaérobies, inefficace sur aérobies.
- Effet effervescent : Élimination des débris.
- Associations : Parfois combiné à l’hypochlorite à 5 %.
- Biocompatibilité : Mauvaise, entraîne des réactions inflammatoires apicales.
- Propriétés : Hémostatique, action d’éclaircissement.
- Utilisation : Peu courante.
Peroxyde d’urée
- Forme : Poudre cristalline mélangée à du sérum physiologique.
- Propriétés : Bon antiseptique, lubrifiant, bonne biocompatibilité (pas de risque inflammatoire).
- Utilisation : Peu courante.
3.5 Agents chélateurs
EDTA (Acide Éthylène Diamine Tétracétique)
- Action : Déminéralisation de la dentine par substitution des ions calcium (Ca²⁺), provoquant une précipitation de sels solubles. Facilite la pénétration et l’élargissement des canaux fins et minéralisés.
- Formes :
- Liquide : Élimination chimique de la smear layer, associé à un tensioactif (ex. ammonium quaternaire) pour améliorer la mouillabilité et la pénétration dans les tubuli dentinaires. Exemple : Largal.
- Pâte : Effet moussant au contact de l’hypochlorite. Exemples : GlydePrep®, Canal+® (mélange EDTA, glycérine, peroxyde d’urée). Lubrification importante grâce à la glycérine, très utilisé en endodontie.
- Limites : Pas d’action antiseptique propre.
Acide citrique à 6 %
- Action : Chélatante, élimine la smear layer sans déminéralisation excessive des tubuli.
3.6 BioPure MTAD et Tetraclean
- MTAD : Solution aqueuse contenant 3 % de doxycycline (antibiotique à large spectre), 4,25 % d’acide citrique (déminéralisant), 0,5 % de détergent polysorbate.
- Tetraclean : Similaire à MTAD, mais avec une concentration moindre de doxycycline (50 mg/5 ml vs 150 mg/5 ml) et un détergent différent (polypropylène glycol vs Tween 80).
- Utilisation : Rinçage final, élimine la smear layer et les tissus organiques des canaux infectés.
3.7 QMiX
- Composition : Analogue de CHX, triclosan (bromure de N-cétyl-N,N,N-triméthylammonium) et EDTA (décalcifiant).
- Utilisation : Rinçage final.
3.8 Eau ozonée
- Composition : Ozone (O₃, oxygène triatomique), bactéricide puissant.
- Action : Formation de bulles provoquant des implosions au contact des parois canalaires, perturbant les biofilms, rompant les parois bactériennes, éliminant la smear layer et les débris tissulaires.
- Limites : Moins efficace contre Escherichia coli et les lipopolysaccharides dans le canal radiculaire.
3.9 Eau activée électrochimiquement
- Origine : Développée en Russie à l’Institut panrusse de génie médical (Moscou).
- Mécanisme : Utilisation d’un module électrolytique à écoulement (FEM) dans une solution saline pour produire une eau superoxydée (bactéricide et sporicide).
- Avantages : Non toxique, élimine efficacement la smear layer, faible risque de réaction allergique.
3.10 Désinfection photo-activée
- Agents photosensibilisants : Bleu de méthylène, chlorure de tolonium.
- Efficacité : En combinaison avec la lumière rouge (PAD), élimine 97 % des bactéries, y compris Enterococcus faecalis. Exemple : Dispositif FotoSan.
4. Techniques d’irrigation
A. Méthode manuelle
- Matériel : Seringue plastique, aiguille à usage unique, aspiration chirurgicale.
- Principe : Contact-Retrait-Éjection.
- Placer le stop de l’aiguille à la longueur de travail -3 mm.
- Insérer l’aiguille jusqu’au blocage par les parois, puis retirer de 1-2 mm pour créer un espace de reflux.
- Éjecter la solution sous faible pression, recueillie par aspiration à l’orifice coronaire.
B. Irrigation par pression négative apicale
1. EndoVac®
- Principe : La solution est déposée dans la chambre pulpaire via une macro-canule et aspirée jusqu’à l’extrémité du canal par une aiguille fine perforée, créant un circuit hydraulique.
- Avantages : Faible risque d’extrusion apicale, réduit la douleur postopératoire, bonne évacuation des débris.
2. RinsEndo®
- Principe : Injection-aspiration via une pièce à main reliée à la turbine de l’unit dentaire.
- Limites : Risque d’extrusion apicale.
C. Irrigation par système sonique et ultrasonique
1. Irrigation passive ultrasonore
- Principe : Plusieurs remplissages du canal avec la solution d’irrigation, suivis de cycles d’activation avec une lime ultrasonore.
- Avantages : Réchauffe le NaOCl, potentialise l’effet antibactérien, efficace pour éliminer les débris canalaires.
- Précaution : Utilisation uniquement après préparation complète pour éviter le contact direct avec les parois.
2. ProUltra® PiezoFlow® (Irrigation continue ultrasonore)
- Principe : Utilise une unité ultrasonore avec une aiguille de 25 G délivrant solution et vibration à pleine puissance.
3. EndoActivator®
- Principe : Pièce à main sonore sans fil, active des inserts en plastique flexibles à 10 000 cycles/min.
- Utilisation : Insert à 1 mm de la longueur de travail, mouvement vertical pendant 1 min (EDTA) et 30 s (NaOCl).
- Efficacité : Élimination des débris, hydroxyde de calcium et matériaux d’obturation lors de retraitements.
4. Seringue Vibringe®
- Principe : Seringue à piles générant des vibrations sonores à 9 000 cycles/min.
5. GentleWave®
- Principe : Unité centrale avec pompes à haute pression envoyant un débit d’irrigation à grande vitesse vers une pièce à main placée dans la chambre pulpaire. Crée une pression négative stable via aspiration.
- Mécanisme : Énergie sonore à large spectre.
D. Désinfection canalaire par laser
- Types de lasers : Ho:YAG, CO₂, Diode (efficace contre 99,98 % des bactéries et la smear layer).
- PIPS™ : Irrigation activée par laser Erbium à faible énergie, générant une onde de choc photoacoustique sans agrandissement des canaux.
E. Irrigation par nanoparticules antibactériennes
- Caractéristiques : Particules de 1 à 100 nm, large spectre antimicrobien, faible résistance microbienne.
- Utilisation : Mélangées avec irrigants, photosensibilisateurs ou matériaux d’obturation.
F. Protocole de désinfection suggéré
- Irrigation avec NaOCl (2,5-5 %) tout au long de l’instrumentation (aiguille à 3 mm de la longueur de travail sans blocage).
- Activation et chauffage du NaOCl frais (par cône de gutta, ultrasons, sonique ou laser) pendant ~30 s.
- Utilisation facultative de dispositifs à pression négative apicale (ex. EndoVac).
- Rinçage avec EDTA ou acide citrique (~1 min).
- Rinçage final :
- NaOCl frais (~1 min), ou
- CHX, QMiX, ou
- Alcool.
- Séchage avec pointes de papier et obturation.
III. Médications intracanalaires temporaires
A. Hydroxyde de calcium (Ca(OH)₂)
Origine : Chaux hydratée, obtenue par mélange de chaux vive (CaO) et d’eau. Poudre cristalline blanche, instable, se transformant en carbonate de calcium au contact de l’air.
pH : 9,5 à 12,5.
Présentation
- Formule magistrale : Mélange de poudre de Ca(OH)₂ avec sérum salé, solution anesthésique sans vasoconstricteur ou eau distillée, sur une plaque de verre, jusqu’à obtention d’une pâte homogène. Appliquée dans un canal sec à l’aide d’un bourre-pâte de Lentulo ou d’une broche, jusqu’à la limite déterminée par radiographie.
- Préparations commerciales : Pâte en seringue avec embouts (ex. Endocal).
- Cônes de Ca(OH)₂ : Gutta-percha (42 %), hydroxyde de calcium (52 %), chlorure de sodium, agent mouillant, pigments. Stables, flexibles, adaptés aux canaux courbés.
Propriétés
- Action antiseptique : pH de 11, aucun microorganisme pathogène ne survit.
- Action anti-inflammatoire : Contre l’action des ostéoclastes en s’opposant à l’acidose.
- Action ostéo-inductrice : Formation de barrières calcifiées (tissus durs néoformés).
- Effet hémostatique : Réduction de la perméabilité capillaire par les ions Ca²⁺.
- Action anti-exsudative : Lutte contre les sérosités et exsudats intracanalaires.
- Action sédative : Due à la libération de salicylates lors de la solubilisation.
B. Digluconate de chlorhexidine (CHX)
- Utilisation : Gel à 2 % comme médication intracanalaire.
- Efficacité : Mélangé à Ca(OH)₂, très efficace contre Enterococcus faecalis et Candida albicans.
C. Verre bioactif
- Composition : 53 % SiO₂, 23 % Na₂O, 20 % CaO, 4 % P₂O₅.
- Action : Bactéricide, mécanisme peu élucidé. En cours de recherche pour usage intracanalaire.
D. Désinfectants
1. Phénols et composés
- Phénol : Poison protoplasmique, coagule les protéines. Volatil, analgésique, très irritant. Exemple : CPCM de Walkoff (parachlorophénol, camphre, menthol).
2. Mercryl
- Composition : Mercurolentol, sulfate de lauryl, sodium.
- Efficacité : Antifongique (Candida albicans), bactériostatique à large spectre (cocci Gram+).
3. Aldéhydes
- Formol : Antiseptique puissant, toxique, moins irritant combiné à du créosote ou thymol. Contre-indiqué (ex. Osomol).
- Glutaraldéhyde : Moins volatil, moins irritant.
E. Antibiotiques
- Exemples : Grinazol (métronidazole), Septomixine (sulfate de polymixine, néomycine), Cortexan (sulfate de framycétine).
- Application : Introduits via bourre-pâte ou broche.
- Limites : Non utilisés en raison des risques d’allergies, sensibilisation et résistance.
F. Corticostéroïdes
- Exemple : Dexaméthasone.
- Effets : Réduit la douleur, mais diminue l’immunité, rendant le périapex vulnérable aux infections.
- Utilisation : Déconseillée comme médication intracanalaire systématique.
G. Sédatifs
- Exemple : Pulpéryl (non détaillé dans le texte).
Voici une sélection de livres:
- Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché
- Concepts cliniques en odontologie conservatrice
- L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement
- Guide clinique d’odontologie
- Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve
- La photographie en odontologie: Des bases fondamentales à la clinique : objectifs, matériel et conseils pratique



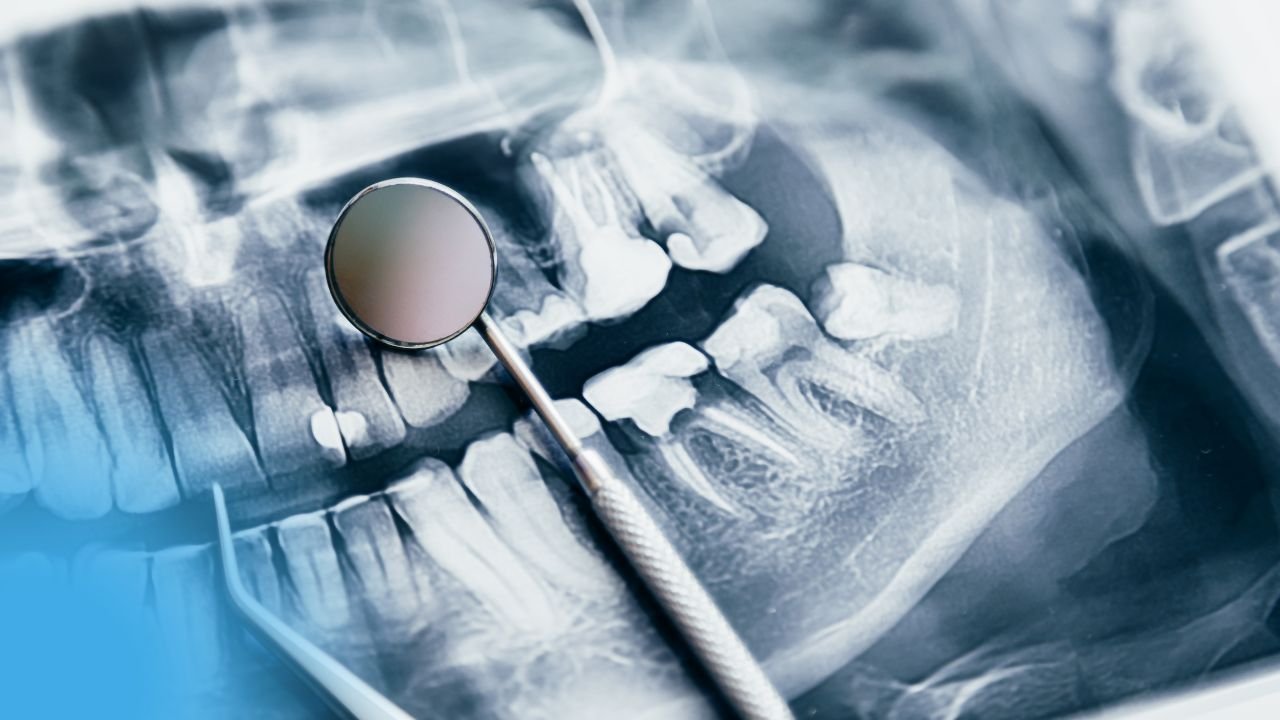
Leave a Reply