Parallélisme et rétention
Parallélisme et rétention
Parallélisme et Rétention en Prothèse Conjointe
La prothèse conjointe (PC) vise à restaurer une arcade dentaire partiellement édentée. Cette restauration doit répondre à deux objectifs fondamentaux : rétablir durablement les fonctions buccales (mastication, phonation, esthétique) et préserver l’intégrité des structures biologiques environnantes, telles que les dents supports, le parodonte et les tissus mous. Cet article explore en détail les concepts de r retention et de parallélisme, deux principes mécaniques essentiels pour assurer la stabilité et la longévité des prothèses dentaires.
La Rétention en Prothèse Conjointe
Définition de la Rétention
La rétention désigne la capacité d’une prothèse à résister à sa désinsertion, qu’elle soit volontaire (par exemple, lors d’un contrôle clinique) ou fortuite (sous l’effet de forces masticatoires ou accidentelles). Elle s’oppose aux mouvements qui tendent à desceller la prothèse selon son axe d’insertion. La rétention est un facteur clé pour garantir la stabilité fonctionnelle et la durabilité de la prothèse.
Types de Rétention
Rétention Primaire
La rétention primaire dépend de plusieurs paramètres liés à la préparation des dents supports :
- Hauteur de la préparation : Une préparation plus haute augmente la surface de contact entre la prothèse et la dent, renforçant ainsi la rétention.
- Surface totale de préparation : Une plus grande surface de préparation améliore la rétention en augmentant la zone de friction.
- Parallélisme approché des parois : Les parois de la préparation doivent être aussi parallèles que possible pour limiter les axes de désinsertion, tout en conservant une légère convergence (environ 6°) pour faciliter l’insertion de la prothèse.
Rétention Secondaire
La rétention secondaire repose sur des artifices mécaniques intégrés à la préparation pour renforcer la rétention primaire. Ces éléments incluent :
- Rainures : Des incisions linéaires dans la préparation qui augmentent la résistance aux forces de désinsertion.
- Boîtes : Des cavités rectangulaires creusées dans la dent pour créer des points d’ancrage.
- Puits : Des perforations profondes destinées à recevoir des tenons ou des éléments de fixation.
Rétention de Jonction
La rétention de jonction est assurée par les matériaux de scellement ou de collage, qui créent une liaison hermétique entre la prothèse et la dent. Les ciments de scellement et les résines adhésives jouent un rôle crucial dans ce type de rétention.
Forces agissant sur la Rétention
Les prothèses, notamment les bridges, sont soumises à différentes forces qui peuvent compromettre leur stabilité. Ces forces incluent :
- F1 : Force verticale directe : Appliquée sur la travée du bridge, elle provoque une flexion. Cette force est plus importante dans les cas suivants :
- Travée longue : Une longue portée entre les piliers augmente le risque de flexion.
- Section faible : Une section réduite de la prothèse diminue sa résistance mécanique.
- Alliage trop mou ou élastique : Un matériau peu rigide est plus susceptible de se déformer sous la contrainte.
- F2 : Force verticale indirecte : Résultant d’une action alimentaire interposée ou d’un contact prématuré avec une cuspide antagoniste.
- F3 : Force tangentielle : Générée lors des mouvements de protrusion ou de latéralité en présence d’interférences occlusales.
Facteurs Influant sur la Rétention
1. La Dépouille de la Préparation
La dépouille correspond à l’angle de convergence des parois de la préparation. Une préparation avec des parois parallèles est idéale pour maximiser la rétention, mais une légère convergence (environ 6° vers la face occlusale) est nécessaire pour permettre une insertion complète de la prothèse. Une préparation trop conique entraîne une perte de rétention en raison de la multiplication des axes de désinsertion.
2. Étendue de la Préparation
L’étendue de la préparation joue un rôle déterminant dans la rétention :
- Hauteur de la préparation : À diamètre égal, une préparation plus haute offre une meilleure rétention grâce à une plus grande surface de contact.
- Largeur de la préparation : À hauteur égale, une préparation plus large augmente la rétention en augmentant la surface de friction.
- Hauteur relative entre dent support et reconstruction : Une prothèse plus haute sur une préparation de même hauteur est moins rétentive en raison d’un bras de levier plus important.
- Importance du recouvrement : Une couronne à recouvrement total (englobant quatre parois opposées deux à deux) présente un seul axe d’insertion, contrairement à une couronne à recouvrement partiel, qui multiplie les axes de désinsertion.
3. État de Surface de la Préparation
La rugosité des surfaces en contact (prothèse et préparation) augmente la rétention en créant des micro-verrouillages qui s’opposent au descellement. Une préparation nette, sans polissage excessif, est donc préférable pour optimiser la rétention.
4. Moyens de Rétention Secondaire
Les moyens mécaniques complémentaires, tels que les rainures, boîtes et puits, renforcent la rétention en créant des points d’ancrage physiques. Ces éléments doivent être soigneusement planifiés pour ne pas fragiliser la structure dentaire.
5. Autres Facteurs Favorisant la Rétention
- Scellement : Les ciments de scellement contribuent à environ 13 à 15 % de la rétention totale.
- Collage : Les résines et composites adhésifs améliorent significativement la rétention grâce à leurs propriétés adhésives.
- Intimité du contact prothèse-préparation : Une coulée précise augmente le coefficient de frottement, renforçant la rétention.
- Réduction de la face occlusale : Une réduction excessive ou une mise à plat de la face occlusale réduit la hauteur de la préparation, diminuant ainsi la rétention.
Rétention dans le Cas de Dents Très Dégradées
Pour les dents fortement délabrées, la rétention peut être améliorée par l’utilisation d’un tenon radiculaire. La longueur du tenon doit être au moins égale à la longueur coronaire pour assurer une répartition optimale des contraintes mécaniques. Cette approche renforce la stabilité de la prothèse tout en minimisant les risques de fracture radiculaire.
Choix des Dents Supports
Le choix des dents supports est crucial pour garantir la stabilité et la longévité de la prothèse. Plusieurs lois mécaniques et biologiques encadrent ce choix :
Loi de Bélard
L’augmentation du nombre de points d’appui non alignés améliore l’équilibre de la prothèse en limitant les axes de rotation. Une répartition stratégique des piliers réduit les risques de basculement ou de descellement.
Loi de Roy
Roy divise l’arcade dentaire en cinq plans anatomiques. Pour neutraliser les forces exercées sur les dents piliers, il est recommandé de sélectionner des piliers situés dans différents plans, assurant ainsi une meilleure répartition des contraintes.
Loi de Duchange
Cette loi attribue un coefficient à chaque dent en fonction de sa capacité à supporter des contraintes. La somme des coefficients des dents piliers doit être supérieure ou égale à la somme des coefficients des dents remplacées. Voici un exemple de coefficients attribués :
| Dent | Coefficient |
|---|---|
| Incisives | 1 |
| Canines | 2 |
| Prémolaires | 3 |
| Molaires | 4-6 |
Loi de Sadrin
Cette loi met l’accent sur la neutralisation des forces de rotation. Une arcade avec une courbure prononcée génère un moment de renversement important, qui doit être contrebalancé par l’ajout de piliers supplémentaires. Les arcades ovoïdes, avec une flèche importante, nécessitent une attention particulière par rapport aux arcades carrées, où la flèche est réduite.
Rapport Corono-Radiculaire
Le rapport corono-radiculaire compare la longueur supra-osseuse (de la face occlusale à la crête alvéolaire) à la longueur intra-osseuse de la dent. Un rapport idéal de 2/3 (deux tiers intra-osseux, un tiers supra-osseux) minimise les contraintes mécaniques. Un niveau de crête osseuse trop apical augmente le bras de levier coronaire, rendant la dent plus vulnérable aux forces.
Configuration Radiculaire
Les racines avec une épaisseur vestibulo-linguale supérieure à leur largeur mésio-distale offrent une meilleure stabilité. Les racines divergentes des dents multiradiculées sont préférables aux racines coniques ou fusionnées. Sur les dents monoradiculées, des irrégularités ou une courbure au niveau du tiers apical renforcent l’ancrage.
Surface Radiculaire Efficace
La surface radiculaire recouverte par le ligament parodontal détermine la capacité de la dent à supporter des contraintes. Les dents volumineuses, avec une surface radiculaire importante, sont mieux adaptées à cet effet.
Axe d’Insertion
Définition de l’Axe d’Insertion
L’axe d’insertion est la ligne imaginaire selon laquelle la prothèse est mise en place ou désinsérée. Il est déterminé par la configuration des dents supports et leur état (pulpées ou dépulpées). En général :
- Une dent pulpée impose l’axe d’insertion, car elle est plus sensible aux contraintes.
- En présence de plusieurs dents pulpées, la dent la moins volumineuse ou en légère malposition influence l’axe.
- Pour les couronnes à recouvrement total ou partiel sur des dents cuspidées, l’axe est généralement parallèle au grand axe des dents.
Dans les cas complexes, une résection coronaire importante ou la réalisation d’un inlay-core avec tenon radiculaire peut être nécessaire pour corriger l’axe d’insertion.
Parallélisme
Définition du Parallélisme
Le parallélisme désigne l’alignement des parois des préparations dentaires pour permettre une insertion et une désinsertion fluides de la prothèse. En pratique, un parallélisme parfait est difficile à obtenir, et une légère convergence (presque parallélisme) est préférable pour faciliter la mise en place tout en maintenant une rétention optimale.
Importance du Parallélisme
Le parallélisme est étroitement lié à la rétention. Une préparation avec des parois trop divergentes ou coniques multiplie les axes de désinsertion, réduisant la stabilité de la prothèse. Une convergence contrôlée (environ 6°) permet d’équilibrer la facilité d’insertion et la rétention.
Conclusion
La rétention et le parallélisme sont des piliers fondamentaux de la prothèse conjointe. Une rétention efficace repose sur une préparation minutieuse, un choix judicieux des dents supports, et l’utilisation de moyens mécaniques et adhésifs complémentaires. Le parallélisme, quant à lui, garantit une insertion stable et prévisible de la prothèse. En respectant ces principes mécaniques et biologiques, le praticien peut assurer la longévité et la fonctionnalité des restaurations prothétiques, tout en préservant la santé des structures buccales.
Voici une sélection de livres en français sur les prothèses dentaires:
- Prothèse Amovible Partielle : Clinique et Laboratoire
Collège National des Enseignants en Prothèses Odontologiques (CNEPO), Michel Ruquet, Bruno Tavernier - Traitements Prothétiques et Implantaires de l’Édenté Total 2.0
- Conception et Réalisation des Châssis en Prothèse Amovible Partielle
- Prothèses supra-implantaires: Données et conceptions actuelles
- Prothèse complète: Clinique et laboratoire Broché – Illustré, 12 octobre 2017
- Prothèse fixée, 2e Ed.: Approche clinique Relié – Illustré, 4 janvier 2024

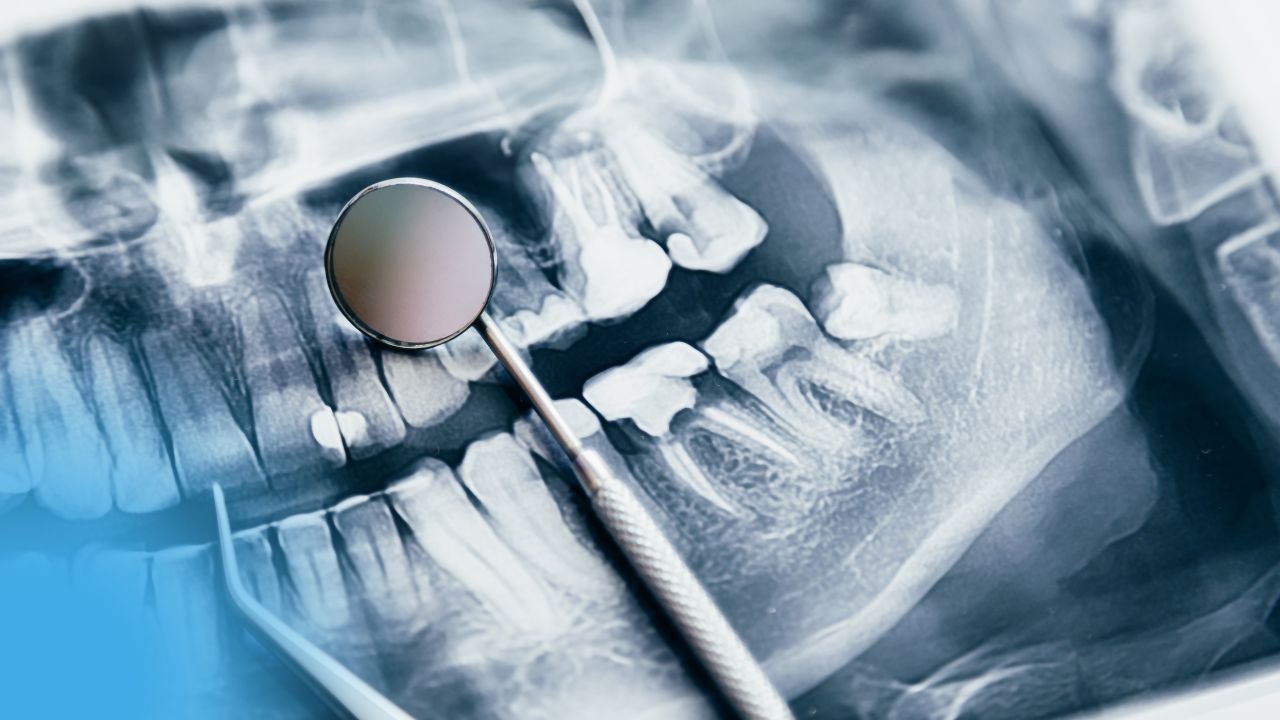


Leave a Reply