ODONTOLOGIE CHIRURGICALE ET TRAITEMENT PRESCRIPTIONS ET INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES CHEZ LE SUJET ÂGÉ
ODONTOLOGIE CHIRURGICALE ET TRAITEMENT PRESCRIPTIONS ET INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES CHEZ LE SUJET ÂGÉ
Introduction
Les personnes âgées sont non seulement victimes d’un vieillissement physiologique mais bien souvent aussi de polypathologies. Cette combinaison va modifier la pharmacocinétique et la pharmacodynamie des médicaments, avec augmentation des risques de toxicité, d’effets indésirables, et d’interactions.
Pour mieux cerner la problématique des prescriptions chez le patient gériatrique, il nous semble indispensable de bien définir le concept de personne âgée. En d’autres termes, quels sont les critères pris en compte pour qualifier un sujet de « personne âgée » ?
Rappel sur les aspects pharmacocinétiques et pharmacodynamiques
La bonne compréhension des différentes étapes pharmacocinétiques ainsi que des principaux mécanismes pharmacodynamiques des médicaments est un prérequis indispensable pour mieux assimiler les effets de la sénescence sur ces différentes étapes ainsi que les conséquences dans la prescription et le choix des molécules dans notre pratique quotidienne.
Aspect pharmacocinétique
La pharmacocinétique peut se définir comme le devenir d’un médicament dans l’organisme depuis le site d’administration jusqu’au site d’excrétion. Ce devenir passe par les étapes suivantes : voies d’administration, l’absorption et la biodisponibilité, le transport et la distribution, la biotransformation et l’excrétion.
Les voies d’administration
Elles sont multiples. On distinguera :
- Les voies systémiques : ce sont celles pour lesquelles le principe actif passe d’abord par la circulation sanguine avant d’atteindre la cible. Parmi elles :
- Les voies entérales : per os, sublinguale et rectale ;
- Les voies parentérales : intraveineuse, intramusculaire, sous-cutanée, pulmonaire.
- Les voies topiques ou locales : le principe actif agit au niveau du site d’administration. On distinguera : les voies cutanée, vaginale, oropharyngée et conjonctivale.
Absorption et biodisponibilité
- Le site d’absorption est en fonction de la voie d’administration. Lors de cette absorption, le principe actif doit franchir des barrières pour atteindre la circulation systémique. Parmi ces barrières, on peut noter : la muqueuse digestive, la barrière alvéolocapillaire.
- La biodisponibilité est la quantité du principe actif qui parvient à atteindre la circulation systémique. Elle dépend essentiellement de la qualité de l’absorption, des premiers passages hépatiques, entérocytaires et pulmonaires.
Transport et distribution
Cette distribution dépend d’une part des propriétés physico-chimiques (liposolubilité, hydrosolubilité) du principe actif et d’autre part de la composition des différents tissus (présence de récepteurs, de transporteurs, teneur en eau, en lipides et protéines).
La biotransformation
C’est la transformation du principe actif. Celle-ci a lieu principalement dans le foie mais aussi dans les poumons et les reins. Elle reste étroitement liée au bon fonctionnement de ces différents organes.
L’excrétion
C’est l’élimination du principe actif de l’organisme. Celle-ci a lieu principalement dans le foie (voies biliaires) et les reins. Elle reste intimement liée à la clairance hépatique et rénale.
Aspect pharmacodynamique
C’est l’étude des mécanismes d’action du principe actif ou de ses métabolites au niveau de la cellule cible permettant d’obtenir l’effet pharmacologique souhaité. Au niveau des cellules cibles (cellules de l’organisme ou agents pathogènes tels que les bactéries, les virus, les champignons).
Impact de la sénescence sur la pharmacocinétique
L’absorption
La sénescence est responsable des modifications suivantes : diminution de la motilité gastro-intestinale, augmentation du pH gastrique, diminution de la concentration des protéines responsables du transport actif, diminution de la surface d’absorption. Toutes ces modifications entraînent les conséquences pharmacocinétiques suivantes :
- Modification du degré d’ionisation des acides faibles et des bases faibles ;
- Un ralentissement de la vidange gastrique ;
- Diminution de l’absorption par transport actif.
Transport et distribution
Le vieillissement engendre une diminution de l’albumine sérique et une modification des différents compartiments dans l’organisme avec notamment une augmentation de la masse adipeuse et une diminution de la masse protéique et du volume d’eau corporelle.
| Compartiment | Modification due à la sénescence |
|---|---|
| Masse adipeuse | Augmentation |
| Masse protéique | Diminution |
| Volume d’eau corporelle | Diminution |
| Albumine sérique | Diminution |
La biotransformation
Essentiellement hépatique, la biotransformation est donc sujette aux modifications hépatiques dues à la sénescence. Parmi ces modifications, on note : une diminution de la masse hépatique, une diminution du nombre d’hépatocytes fonctionnels, une diminution de l’activité enzymatique avec diminution de l’oxydation et une diminution du flux sanguin hépatique. Comme conséquence ultime, une diminution de la clairance hépatique des médicaments à fort coefficient d’extraction hépatique, donc un risque de toxicité augmenté.
L’élimination
L’élimination des médicaments se fait essentiellement par le rein. Les modifications fonctionnelles dues à la sénescence rénale sont : diminution du flux sanguin rénal, diminution de la filtration glomérulaire, diminution de la sécrétion glomérulaire. Les conséquences pharmacocinétiques sont : diminution de l’élimination des médicaments ou de leurs métabolites et accumulation des médicaments à élimination tubulaire. Ces médicaments nécessitent une adaptation posologique en fonction de la clairance rénale.
Impact de la sénescence sur la pharmacodynamique
La sénescence peut entraîner une modification des différentes cibles cellulaires (notamment les récepteurs ou les cibles intracellulaires) du principe actif. Ceci entraîne soit une augmentation de la sensibilité à certains médicaments avec une apparition de plus d’effets indésirables, soit l’inefficacité du médicament. Cet impact sur la pharmacodynamique est d’autant plus important qu’il existe une polymédication. D’où l’intérêt d’évaluer le risque gériatrique avant chaque prescription chez les plus de 65 ans.
Interactions et iatrogénies médicamenteuses avec les médicaments de prescription courante en médecine bucco-dentaire
Définition d’une interaction médicamenteuse
L’interaction médicamenteuse survient lorsque deux médicaments A et B, administrés simultanément chez un patient, le médicament A (dit précipitant) interfère sur la pharmacocinétique et/ou sur la pharmacodynamique du médicament B (dit objet) entraînant ainsi une modification des effets cliniques du médicament. Parmi ces modifications cliniques, on peut citer :
- Une augmentation de l’efficacité clinique ;
- Une diminution de l’effet clinique ;
- Une majoration des effets secondaires connus ;
- L’apparition d’effets secondaires nouveaux.
Ces interactions sont classées en 5 catégories de gravité décroissante :
| Catégorie | Description |
|---|---|
| 1 | Interaction contre-indiquée |
| 2 | Interaction à éviter sauf justification thérapeutique |
| 3 | Interaction nécessitant une précaution d’emploi |
| 4 | Interaction à prendre en compte |
| 5 | Interaction sans conséquence clinique significative |
Définition de l’iatrogénie médicamenteuse
L’iatrogénie médicamenteuse désigne l’ensemble des conséquences négatives sur l’état de santé d’un patient engendrées par des prescriptions médicamenteuses, même en l’absence d’erreur de prescription. Particulièrement chez le sujet âgé (plus de 65 ans), elle est souvent la conséquence de trois principaux facteurs :
- L’existence d’une interaction médicamenteuse non prise en compte lors de la prescription (la plus fréquente due à la polymédication).
- La non-adaptation des posologies aux différentes modifications physiologiques dues à la sénescence et le non-respect des médicaments déconseillés chez le sujet âgé.
- La non-prise en compte de l’existence d’un terrain pathologique (comorbidité) ou d’une hypersensibilité.
Médicaments les plus prescrits chez le sujet âgé (toutes spécialités confondues)
Selon l’enquête ESP de 2000 faite par la HAS, les classes médicamenteuses les plus fréquemment prescrites (toutes spécialités confondues) chez les sujets de plus de 65 ans sont :
- Médicaments cardiovasculaires : anticoagulants, antihypertenseurs, hypolipémiants, antiarythmiques, vasodilatateurs nitrés ;
- Médicaments du système nerveux central et psychotropes : thymorégulateurs, antidépresseurs, médicaments sérotoninergiques ou adrénergiques ;
- Médicaments de l’appareil digestif : laxatifs, myorelaxants ;
- Médicaments de l’appareil locomoteur : antalgiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens, glucocorticoïdes ;
- Antalgiques : tous les paliers.
Il est donc primordial pour tout praticien de bien connaître les interactions entre les médicaments de prescription courante en odontostomatologie et les différentes classes médicamenteuses.
Médicaments les plus fréquemment prescrits en médecine bucco-dentaire
| Classe médicamenteuse | Exemples |
|---|---|
| Antalgiques | Paracétamol, ibuprofène, tramadol |
| Antibiotiques | Amoxicilline, métronidazole, clindamycine |
| Anti-inflammatoires | Ibuprofène, kétoprofène |
| Antiseptiques buccaux | Chlorhexidine |
| Anesthésiques locaux | Lidocaïne, articaine |
Principales interactions médicamenteuses en odontostomatologie
Les interactions médicamenteuses en odontostomatologie impliquent souvent des antibiotiques, des antalgiques et des anti-inflammatoires. Voici quelques exemples courants :
- Amoxicilline + Anticoagulants oraux (ex. warfarine) : Risque accru de saignement en raison d’une potentialisation de l’effet anticoagulant.
- Ibuprofène + Antihypertenseurs (ex. IEC) : Diminution de l’effet antihypertenseur et risque de néphrotoxicité.
- Métronidazole + Alcool : Effet disulfirame (nausées, vomissements, tachycardie).
- Clindamycine + Myorelaxants : Potentialisation de l’effet myorelaxant, risque de dépression respiratoire.
Règles de prescription chez le sujet âgé
Une bonne prescription chez les sujets âgés doit avoir pour objectif l’efficacité thérapeutique et la non-nuisance. Pour cela, il est indispensable d’analyser un certain nombre de paramètres avant toute prescription.
Liées au patient
Ces différents paramètres sont recueillis au cours d’un examen clinique complet et minutieux suivi des analyses biologiques et radiologiques si nécessaires :
- Le diagnostic précis et concis : Toute prescription doit être justifiée. C’est la base même du choix d’une classe thérapeutique.
- L’état d’hydratation du patient : Toute déshydratation entraîne un risque de toxicité rénale, hépatique et de surdosage.
- L’état nutritionnel du patient : La nutrition a une conséquence directe sur les protéines plasmatiques (albumine principalement) impliquées dans le transport des molécules et donc sur la fraction libre. Une malnutrition peut entraîner une augmentation de la fraction libre du médicament et donc un risque accru de surdosage et de toxicité.
- La fonction rénale : Évaluée par la clairance de la créatinine, elle est indispensable en cas de choix d’une molécule à extraction rénale ou à marge thérapeutique étroite. Elle peut nécessiter une adaptation posologique particulière.
- La fonction hépatique : Évaluée par le dosage des enzymes hépatiques, elle permet d’adapter la posologie des molécules à fort métabolisme ou extraction hépatique.
- La totalité des traitements en cours : La polymédication est très fréquente chez les sujets âgés avec un risque accru de l’iatrogénie médicamenteuse. Il est donc plus que nécessaire de bien lister toutes les molécules prises (y compris l’automédication) avant tout ajout de molécules afin de prévenir les interactions médicamenteuses et donc l’iatrogénie.
- Les pathologies associées : L’existence d’un terrain pathologique en sus des phénomènes de sénescence entraîne des modalités de prescriptions spécifiques. Il s’agit ici de rechercher les affections de longue durée (IRC, HTA, diabète).
- Les capacités cognitives : Nécessaires pour l’observance, la gestion et la compréhension des consignes de prise du traitement.
Liées à la molécule prescrite
- La voie d’élimination prépondérante : Si élimination rénale, adapter la posologie en fonction de la clairance de la créatinine. Si métabolisme et excrétion hépatique, la posologie sera fonction du bilan hépatique et de la prise éventuelle d’inhibiteurs ou d’inducteurs hépatiques.
- La durée d’action du médicament : Il est important de bien connaître la demi-vie de chaque molécule prescrite car elle permet de déterminer le nombre de prises par jour. Chez le sujet âgé, il est conseillé d’utiliser les molécules à demi-vie courte.
- Le caractère hydrophile ou lipophile de la molécule : Chez le sujet âgé, la masse graisseuse augmente au détriment du compartiment liquidien, entraînant un risque de surdosage pour les médicaments lipophiles. Il est donc indispensable de diminuer la dose des médicaments lipophiles.
- La marge thérapeutique de la molécule : Attention aux molécules à faible marge thérapeutique car risque accru de toxicité.
- Les effets indésirables, pharmacologiques (connus) ainsi que les contre-indications : Toujours prendre en considération ces caractéristiques pour choisir la molécule la mieux adaptée au patient.
- Le service médical rendu : Il prend en considération le rapport bénéfice/risque, la gravité de l’affection soignée et la place des molécules dans la stratégie thérapeutique.
- La forme galénique : La forme orale doit toujours être privilégiée sauf en cas de troubles sévères de la déglutition.
- Le caractère approprié ou non de la molécule : Certaines molécules sont déconseillées chez les patients âgés car les risques sont largement supérieurs aux bénéfices.
Une fois ces différents paramètres analysés, la molécule la mieux adaptée sera prescrite conformément aux recommandations et un suivi clinique et/ou biologique mis en place jusqu’à l’arrêt de la prise.
Conclusion
Le médicament est une chance pour le malade âgé. Bien prescrire suppose de bien connaître le malade à traiter. Le prescripteur doit coordonner la prescription avec ses confrères traitants. Une vigilance renforcée du prescripteur sur le risque iatrogène, et une meilleure éducation du malade âgé peuvent diminuer assurément le risque iatrogène et éviter les interactions et les effets indésirables.
Voici une sélection de livres:
- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011
- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996
- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE
- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient
- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé
- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1
- Endodontie, prothese et parodontologie
- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020
- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

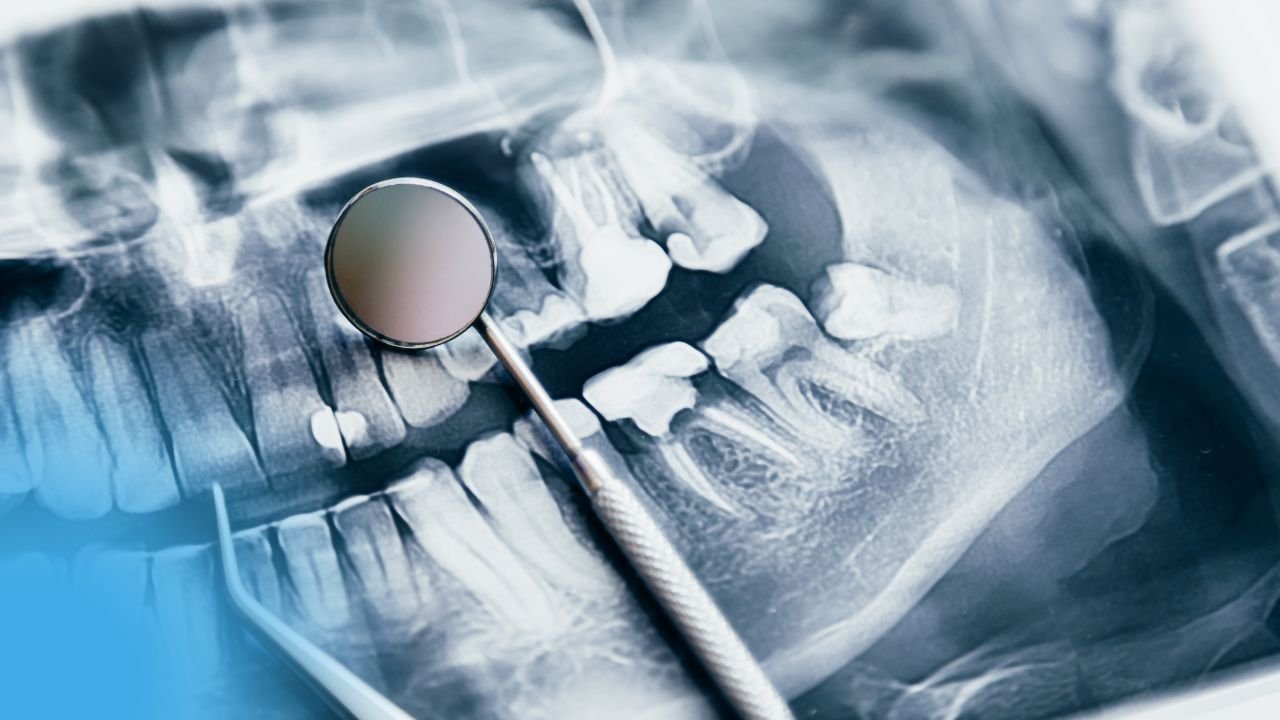


Leave a Reply