Mort et mort apparente
Mort et mort apparente
Définition de la Mort
La mort est définie comme la disparition définitive de la personne humaine, marquée par l’arrêt irréversible de l’activité cérébrale. Ce qui distingue fondamentalement les vivants des morts est l’absence d’activité cérébrale, confirmée par des critères cliniques et paracliniques précis. La mort, en tant que phénomène médical, est un état irréversible où les fonctions vitales, notamment celles du cerveau, cessent de manière définitive. Cette définition repose sur la compréhension que le cerveau est l’organe central de la conscience, de la régulation des fonctions vitales et de l’identité humaine.
La mort peut être distinguée de la mort apparente, un état où une personne semble morte (absence de respiration, de pouls ou de réactivité), mais où une intervention rapide, comme la réanimation cardio-pulmonaire, peut potentiellement rétablir les fonctions vitales. La distinction entre ces deux états est cruciale pour les professionnels de santé afin d’identifier les situations où une intervention est encore possible.
Physiopathologie de la Mort Encéphalique
Mécanismes de la Mort Encéphalique
La mort encéphalique survient lorsque le cerveau cesse de fonctionner de manière irréversible en raison d’un arrêt de la circulation cérébrale. Cet arrêt peut être causé par deux mécanismes principaux :
- Augmentation de la pression intracrânienne (PIC) :
Lorsque la PIC dépasse la pression artérielle moyenne (PAM), la perfusion cérébrale (PPC = PAM – PIC) devient insuffisante. Cela entraîne une ischémie cérébrale, c’est-à-dire un manque d’apport en oxygène et en nutriments au cerveau, provoquant des lésions irréversibles. - Interruption de la circulation cérébrale :
Cette interruption peut résulter d’une occlusion, d’une compression des vaisseaux cérébraux ou d’un arrêt circulatoire global, comme lors d’un arrêt cardiaque. L’ischémie et l’anoxie (absence d’oxygène) qui en résultent entraînent la destruction progressive des cellules cérébrales.
Conséquences de l’Arrêt Circulatoire
Lorsque la circulation sanguine s’arrête, les organes, y compris le cerveau et le cœur, ne reçoivent plus d’oxygène. Les lésions cérébrales commencent à apparaître dès la troisième minute d’arrêt circulatoire, et après huit minutes, les chances de survie deviennent quasiment nulles sans intervention immédiate. Les neurones, particulièrement sensibles à l’hypoxie, subissent des dommages irréversibles, entraînant la mort encéphalique. Ce processus est marqué par une cascade de réactions biochimiques, notamment la libération de radicaux libres, l’accumulation de toxines métaboliques et la destruction des membranes cellulaires.
Facteurs Précipitants
Les causes de la mort encéphalique incluent :
- Traumatismes crâniens graves.
- Hémorragies cérébrales (accident vasculaire cérébral hémorragique).
- Anoxie prolongée (par exemple, noyade ou asphyxie).
- Tumeurs cérébrales entraînant une compression.
- Infections graves, comme une méningite ou une encéphalite.
Conditions Diagnostiques de la Mort Encéphalique
Critères Cliniques et Étiologiques
Pour diagnostiquer la mort encéphalique, il est nécessaire de démontrer :
- Des lésions graves du système nerveux central (SNC), confirmées par des examens cliniques ou des techniques d’imagerie (comme un scanner ou une IRM), avec une étiologie connue expliquant l’état de mort encéphalique.
- L’absence de circonstances confondantes, qui pourraient mimer les signes de la mort encéphalique. Ces circonstances incluent :
- Hypothermie (température corporelle < 35°C).
- Hypotension sévère (PAM < 50 mmHg).
- Intoxication par des drogues dépressives du SNC (sédatifs, opioïdes, etc.).
- Curarisation (paralysie induite par des curares).
- Troubles métaboliques graves (hypoglycémie, acidose, etc.).
Importance de l’Évaluation Précise
L’évaluation des circonstances confondantes est essentielle pour éviter un diagnostic erroné. Par exemple, une hypothermie peut ralentir les fonctions cérébrales, imitant un état de mort encéphalique. De même, les médicaments sédatifs ou les curares peuvent masquer une activité cérébrale résiduelle. Une correction de ces facteurs doit être effectuée avant de poser un diagnostic définitif.
Examen Neurologique
L’examen neurologique est une étape clé dans le diagnostic de la mort encéphalique. Il repose sur trois critères principaux :
1. Absence Totale de Conscience et d’Activité Motrice Spontanée
- La personne ne présente aucune réponse à des stimuli douloureux, visuels ou auditifs.
- Aucun mouvement spontané n’est observé, que ce soit au niveau des membres, du visage ou des yeux.
2. Abolition des Réflexes du Tronc Cérébral
- Les réflexes suivants sont testés et doivent être absents :
- Réflexe pupillaire : absence de contraction des pupilles à la lumière.
- Réflexe cornéen : absence de clignement en réponse à une stimulation de la cornée.
- Réflexe oculo-céphalique : absence de mouvement des yeux lorsque la tête est tournée (test des « yeux de poupée »).
- Réflexe oculo-vestibulaire : absence de mouvement des yeux en réponse à une injection d’eau froide dans le conduit auditif.
- Réflexe de toux : absence de toux ou de réflexe nauséeux lors de la stimulation du pharynx ou de la trachée.
3. Absence Totale de Ventilation Spontanée
- Un test d’apnée est effectué pour confirmer l’absence de respiration spontanée. Ce test consiste à débrancher le patient du respirateur artificiel pendant une période déterminée, tout en surveillant l’absence de mouvements respiratoires et en maintenant une oxygénation adéquate.
Examens Paracliniques
Pour confirmer le diagnostic de mort encéphalique, des examens complémentaires sont souvent nécessaires, en particulier dans les cas où les critères cliniques ne suffisent pas ou lorsque la législation l’exige.
1. Électroencéphalogramme (EEG)
- Critères : Deux EEG nuls et aréactifs, réalisés à un intervalle minimum de 4 heures, avec une amplification maximale sur une durée d’enregistrement de 30 minutes.
- Signification : Un EEG nul indique une absence totale d’activité électrique cérébrale, confirmant la mort encéphalique.
2. Angiographie Cérébrale
- Critères : Une angiographie cérébrale objectivant un arrêt complet de la circulation encéphalique.
- Signification : L’absence de flux sanguin dans les artères cérébrales confirme l’ischémie totale et irréversible du cerveau.
Comparaison des Méthodes
| Méthode | Avantages | Limites |
|---|---|---|
| EEG | Non invasif, largement disponible | Sensibilité aux interférences, faux négatifs |
| Angiographie cérébrale | Haute spécificité, visualisation directe | Invasif, nécessite un équipement spécialisé |
Réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP)
Définition et Objectifs
La réanimation cardio-pulmonaire (RCP) est une intervention d’urgence visant à rétablir la circulation sanguine et la respiration chez une personne en état de mort apparente, c’est-à-dire :
- Inconsciente : absence de réponse au toucher, à la parole ou à des stimuli douloureux.
- Sans respiration : aucun mouvement respiratoire visible, aucun flux d’air détectable au niveau du nez ou de la bouche après libération des voies aériennes.
La RCP combine deux techniques principales :
- Ventilation artificielle : pour oxygéner le sang.
- Compressions thoraciques (ou massage cardiaque externe) : pour rétablir la circulation sanguine.
Protocole de la RCP : Le Concept ABC
Le concept de la RCP a été formalisé par Peter Safar, qui a introduit l’acronyme ABC :
- A pour Airway : Libération des voies aériennes (dégrafage des vêtements, bascule prudente de la tête, retrait d’obstructions visibles).
- B pour Breathing : Ventilation artificielle (bouche-à-bouche, bouche-à-nez, ou utilisation d’un ballon insufflateur).
- C pour Circulation : Massage cardiaque externe pour rétablir la circulation sanguine.
Techniques de Ventilation Artificielle
- Sans matériel : Bouche-à-bouche ou bouche-à-nez (pour les adultes), bouche-à-bouche-et-nez (pour les nourrissons).
- Avec matériel : Utilisation d’un ballon insufflateur avec masque ou embout buccal, permettant d’envoyer de l’air contenant 21 % de dioxygène. Une bouteille d’oxygène médical peut augmenter la fraction inspirée de dioxygène (FiO2).
- Précautions : L’insufflation d’air peut entraîner un passage d’air vers l’estomac, augmentant le risque de régurgitation. Une technique correcte est essentielle pour minimiser ce risque.
Techniques de Compressions Thoraciques
Les compressions thoraciques doivent être adaptées à l’âge de la victime :
- Adulte et enfant de plus de 8 ans : Le sternum doit descendre de 4 à 5 cm à chaque compression, à un rythme de 100 à 120 compressions par minute.
- Enfant de 1 à 8 ans : Le sternum doit descendre de 1/3 à 1/2 de l’épaisseur du thorax, en utilisant une seule main.
- Nourrisson de moins d’un an : Le sternum doit descendre de 1/3 à 1/2 de l’épaisseur du thorax, en utilisant deux doigts.
Protocole Recommandé
- Alternance : Effectuer 30 compressions thoraciques suivies de 2 insufflations.
- Rythme : Les compressions doivent être réalisées à un rythme de 100 à 120 par minute (par exemple, en comptant à voix haute « un-et-deux-et… » jusqu’à 30).
- Actions complémentaires :
- Appeler les secours immédiatement.
- Rechercher un défibrillateur automatique externe (DAE) si disponible.
- En cas de fibrillation ventriculaire (cause fréquente de mort subite), utiliser un DAE pour administrer un choc électrique visant à resynchroniser le cœur.
Réanimation Cardio-Pulmonaire Spécialisée (RCPS)
La RCPS, réalisée par une équipe médicale ou paramédicale, constitue le dernier maillon de la chaîne de survie avant l’admission à l’hôpital. Elle inclut :
- Intubation : Connexion d’un respirateur artificiel via un tube inséré dans la trachée.
- Voie veineuse : Pour administrer des médicaments, comme l’adrénaline, qui stimule le cœur.
- Capnométrie : Mesure du dioxyde de carbone (CO2) expiré pour évaluer l’efficacité de la réanimation. Une expiration de CO2 indique que l’oxygène atteint les cellules.
- Durée : La durée d’une RCPS sans reprise d’un rythme cardiaque est généralement limitée à 30 minutes, bien que cela reste empirique et dépende du contexte.
Mort Apparente vs Mort Réelle
Distinction Cruciale
La mort apparente se caractérise par une absence temporaire de signes vitaux, mais avec une possibilité de réversibilité grâce à une intervention rapide. En revanche, la mort réelle (ou mort encéphalique) est irréversible, marquée par la cessation définitive de l’activité cérébrale. Une évaluation rigoureuse est nécessaire pour éviter de confondre ces deux états, car une RCP inappropriée sur une personne en mort réelle est inefficace et peut retarder la reconnaissance du décès.
Importance de la Rapidité
Dans les cas de mort apparente, chaque minute compte. Par exemple :
- Après 3 minutes d’arrêt circulatoire, des lésions cérébrales irréversibles commencent à apparaître.
- Après 8 minutes, les chances de survie sans séquelles graves sont extrêmement faibles.
- Une RCP initiée dans les premières minutes augmente significativement les chances de survie.
Prise en Charge Éthique et Médico-Légale
Considérations Éthiques
Le diagnostic de mort encéphalique soulève des questions éthiques, notamment en ce qui concerne le prélèvement d’organes. Une fois la mort encéphalique confirmée, le patient est juridiquement considéré comme décédé, même si certaines fonctions corporelles (comme le battement cardiaque) peuvent être maintenues artificiellement. Les professionnels de santé-portal doivent respecter des protocoles stricts pour garantir un diagnostic précis et éthique.
Aspects Médico-Légaux
Dans de nombreux pays, le diagnostic de mort encéphalique nécessite la confirmation par plusieurs médecins et des examens complémentaires (EEG, angiographie). Ces protocoles visent à éviter toute erreur de diagnostic et à protéger les droits des patients et de leurs familles.
Conclusion
La compréhension de la mort et de la mort apparente est essentielle pour les professionnels de santé et le grand public. La mort encéphalique, marquée par l’arrêt irréversible de l’activité cérébrale, repose sur des critères cliniques et paracliniques rigoureux. La rétriques doivent être effectuées rapidement pour maximiser les chances de survie. La RCP est une intervention d’urgence cruciale dans les cas de mort apparente, mais elle ne peut inverser la mort réelle. Une approche éthique et professionnelle est nécessaire pour naviguer dans ces situations complexes, en respectant à la fois les avancées médicales et les considérations humaines.
Voici une sélection de livres:
- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011
- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996
- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE
- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient
- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé
- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1
- Endodontie, prothese et parodontologie
- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020
- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005



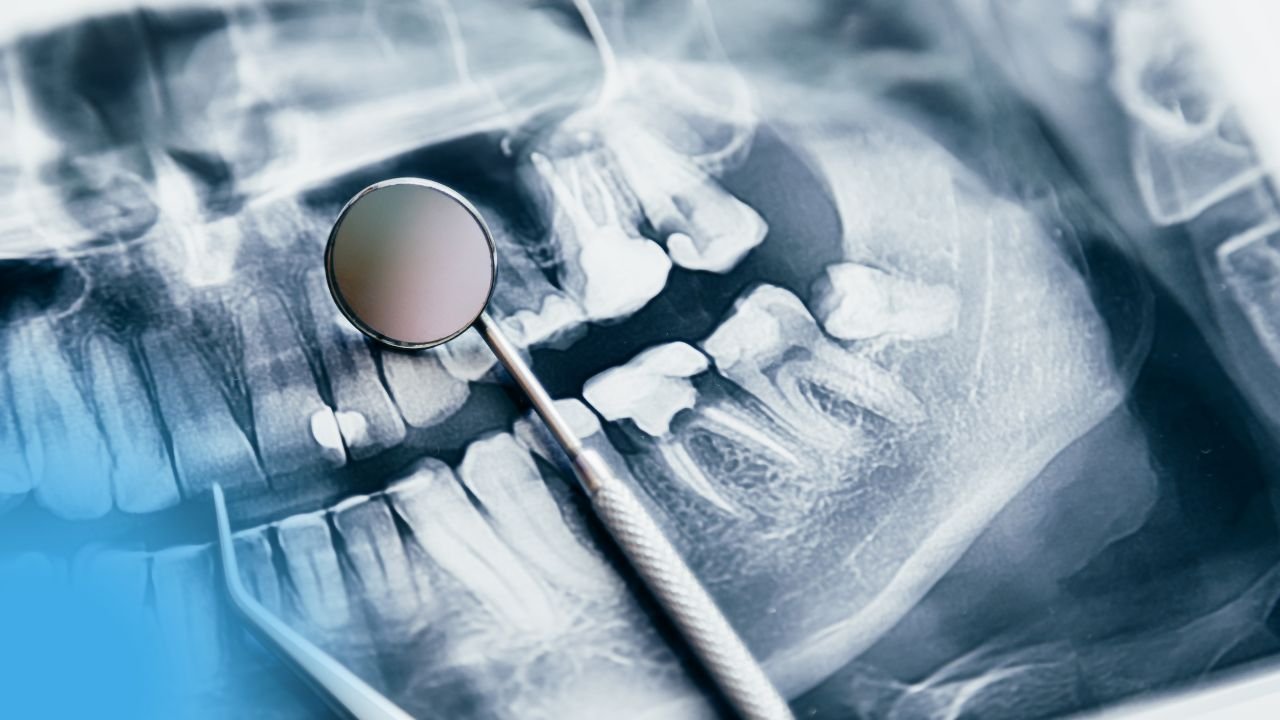
Leave a Reply