LES MALAISES
LES MALAISES
LES MALAISES
I. Définition
Le malaise est une sensation de mal-être avec une impression imminente de perte de connaissance, qui peut ou non survenir de façon plus ou moins complète. Il s’agit d’une situation pathologique aiguë ressentie par le malade ou son entourage comme une modification de son état antérieur. Le retour à la normale est spontané, rapide ou progressif. L’interrogatoire, l’examen clinique et des examens paracliniques simples permettent d’établir le diagnostic dans 70 à 80 % des cas. Il n’existe pas de relation entre la perte de connaissance (PC) et la sévérité de la pathologie sous-jacente. L’absence de perte de connaissance n’élimine pas une cause cardiaque.
II. Diagnostic Positif
Le diagnostic repose sur l’interrogatoire du patient, de l’entourage et de tout témoin visuel. Il est essentiel de recueillir les informations auprès des ambulanciers, des pompiers, de l’entourage, etc. Les points à préciser incluent :
- Circonstances de survenue :
- Progressive ou brutale
- Délai par rapport au repas
- Effort
- Changements de position
- Station debout prolongée
- Émotion, douleur
- Miction, effort de toux, compression cervicale
- Chute, traumatisme, plaie
- Source potentielle de monoxyde de carbone (CO)
- Mode de récupération
- Signes d’accompagnement
Symptômes
Le malaise peut se présenter de différentes manières, regroupant l’association inconstante de plusieurs symptômes tels que :
- Sentiment d’angoisse brutal, sous-tendu par des signes cliniques
- Douleurs
- Difficultés à respirer, sensation de manquer d’air
- Sueurs
- Palpitations
- Nausées
- Fourmillements
- Troubles de la vision (voile noir devant les yeux)
- Vertiges
- Sentiment de faiblesse généralisée
- Mouvements anormaux
- Impression de perte de conscience imminente
III. Diagnostic Différentiel
Le malaise peut être :
- Aigu, régressif avec troubles de la vigilance
- Associé à des états pathologiques d’apparition progressive
- Associé à des états pathologiques où les symptômes ne sont pas résolutifs, tels que :
- Troubles de la conscience
- Persistance d’une douleur thoracique ou abdominale
- Palpitations
- Céphalée
- Dyspnée
- Déficit neurologique
- Signes infectieux
- Troubles psychiatriques
Le malaise est souvent un signe associé et peut être un indicateur de gravité.
IV. Diagnostic Étiologique
L’interrogatoire et l’examen clinique permettent une orientation diagnostique dans 50 à 70 % des cas.
Examen Clinique Complet
- Cardiologique et neurologique : examen soigneux
- Recherche de lésions traumatiques
Interrogatoire et Examens
- ECG : seul examen obligatoire
- Causes principales :
- Vaso-vagales : 50 %
- Cardiaques : 5 à 20 %
- Hypotension orthostatique : 10 %
- Autres causes :
- Épilepsies
- Intoxications éthyliques
- Intoxication au monoxyde de carbone (CO)
- Causes psychiatriques
a) Causes Cardiaques
La syncope évoque une cause cardiaque (ni sensible, ni spécifique), ainsi que :
- Antécédents cardiaques
- Survenue à l’effort
- Prise d’anti-arythmiques
- Douleur thoracique
- Palpitations
- Dyspnée
L’interrogatoire et l’examen clinique orientent d’emblée vers :
1. Cardiopathies Obstructives
- Rétrécissement aortique (RAo)
- Cardiomyopathie obstructive (CMO)
2. Troubles de Conduction
- Sûr : Bloc auriculo-ventriculaire (BAV) complet
- Possible : Bloc de branche droit (BBD) et hémi-bloc postérieur gauche (HBPG)
3. Troubles du Rythme Cardiaque
- Dysfonction sinusale, maladie rythmique auriculaire
- Tachycardies paroxystiques
- QT long (traitement anti-arythmique, hypokaliémie)
4. Angor Syncopal
- Infarctus du myocarde
b) Hypotension Orthostatique
Recherchée systématiquement :
- Mesure après au moins 5 minutes
- Baisse de 30 mmHg de la pression artérielle systolique (PAS) ou 20 mmHg de la pression artérielle diastolique (PAD)
- Reproduction des symptômes
Causes Iatrogènes
- Diurétiques
- Antihypertenseurs
- Antidépresseurs, neuroleptiques
- Nitrés
- Bêtabloquants
Hypovolémie (Vraie ou Relative)
- Neuropathie périphérique, Parkinson
- Neuro-cardiogénique (malaises vaso-vagaux)
c) Malaises Vaso-vagaux
Représentent 50 % des étiologies :
- Caractéristiques typiques :
- Circonstances favorisantes, prodromes
- Perte de connaissance dans 1 cas sur 2
- Asthénie
- Sujet jeune
- Antécédents de malaises
- Test d’inclinaison
- Caractéristiques moins typiques : angor, etc.
d) Causes Neurologiques
Épilepsie
- Généralisée : diagnostic difficile en l’absence de témoins oculaires
- Partielle : diagnostic plus complexe
- EEG sans orientation clinique peu utile
- Accident neuro-vasculaire : rare
e) Diagnostics Divers
Métaboliques
- Hypoglycémie : toujours médicamenteuse, profonde, non réversible sans traitement
- Troubles de l’ionogramme
Intoxication
- Monoxyde de carbone :
- Syncope, céphalées, vertiges, vomissements
- Contexte collectif ou familial (chauffage défectueux)
- Alcoolique aiguë : recherche systématique devant tout malaise inexpliqué
Psychiatriques
- Synd
romes dépressifs
- Attaques de panique
- Somatisation
V. Prise en Charge
- Contacter les secours (risque de traumatisme lié à une chute)
- Allonger la personne dans un endroit tranquille
- Desserrer les vêtements pour faciliter la respiration
- Assurer un apport hydrique suffisant
- Envisager le port de bas de contention
- Si la personne reste inconsciente plus de 5 minutes : position latérale de sécurité
VI. Conclusion
Le terme “malaise” est imprécis et recouvre une grande diversité de diagnostics. La clinique et l’ECG suffisent généralement à poser le diagnostic.
SYNCOPE
I. Introduction
La syncope est une perte de conscience et du tonus postural, brutale, complète, de courte durée, avec une récupération complète spontanée, liée à une hypoperfusion cérébrale globale et transitoire. La lipothymie, de même physiopathologie, correspond à une ischémie cérébrale avec simple obnubilation, sans perte de conscience vraie, à début et fin plus progressifs et de durée généralement plus longue. Les étiologies peuvent être similaires.
Les syncopes représentent 3 à 5 % des admissions dans les services d’urgences. Il est crucial de les identifier parmi les pertes de connaissance brèves, puis de déterminer leur étiologie précise, sachant que les causes cardiaques, bien que moins fréquentes, sont les plus menaçantes.
Signes d’Accompagnement (Phase Prodromale)
- Obnubilation
- Malaise général, impression de faiblesse
- Sueurs
- Sialorrhée, nausées ou vomissements
- Bourdonnements d’oreilles, bruit de “cloches”
- Impression de tête vide
- Troubles visuels : brouillard, voile devant les yeux
Récupération
- Progressive, dans l’ordre : audition, vue, tonus postural
II. Interrogatoire (Patient et Entourage)
Questions sur le Contexte
- Antécédents familiaux : mort subite, cardiopathie congénitale arythmogène, évanouissements
- Antécédents personnels : maladie cardiaque, neurologique (Parkinson, épilepsie), désordres métaboliques (diabète)
- Circonstances avant l’épisode :
- Début et fin : brusque ou progressif
- Réalité de la perte de conscience
- Durée
- Amnésie
- Position : couché, assis ou debout
- Activité : repos, pendant ou après un exercice
III. Examen Clinique
Temps Cardiovasculaire
- Mesure de la tension artérielle (couché et debout)
- Prise du pouls, auscultation cardiaque et vasculaire
- ECG, ± massage sino-carotidien (après élimination d’un souffle) :
- Massage sous contrôle de la pression artérielle et ECG continu pendant 5 secondes (d’abord à droite, puis à gauche après 30 secondes)
Temps Neurologique
- Examen des fonctions motrices, sensitives, sensorielles
- Recherche de signes en foyer
Examen Général
IV. Examens Paracliniques
- Biologiques : glycémie, ionogramme sanguin, formule numération sanguine (FNS), enzymes cardiaques, calcémie
- ECG : recherche de bradycardie sinusale, bloc sino-auriculaire, bloc de branche bi- ou tri-fasciculaire, bloc auriculo-ventriculaire (BAV), extrasystoles ventriculaires (ESV) menaçantes
- Examens complémentaires (guidés par les premières constatations) :
- Holter
- Potentiels tardifs
- Épreuve d’effort
- Échocardiogramme
- Côté neurologique :
- EEG (de base, ± après privation de sommeil)
- Écho-Doppler des vaisseaux du cou
V. Étiologie
A. Syncopes d’Origine Cardiaque
Moins fréquentes (1/10) mais graves, avec risque de mort subite.
1. Troubles du Rythme et de la Conduction
- Bradycardie paroxystique, bloc AV, maladie rythmique auriculaire
- Dysfonctionnement d’un pacemaker ou défibrillateur
- Tachycardie supraventriculaire, tachycardie ventriculaire
2. Insuffisance Coronarienne
3. Obstacles à l’Éjection ou au Remplissage Ventriculaire
- Rétrécissement aortique (RAo) : à l’effort
- Tamponnade
4. Insuffisance Cardiaque Évoluée
- Cardiomyopathies dilatées
B. Syncopes d’Hypotension Orthostatique
Surviennent au lever par défaut de réajustement de la pression artérielle (chute significative et persistante : ≥ 20 mmHg systolique, ≥ 10 mmHg diastolique).
Hypovolémie
- Vraie :
- Déshydratation : diarrhée, vomissements, fièvre
- Iatrogène : diurétiques (sujet âgé)
- Hémorragie : interne, digestive, anémie de spoliation
- Iatrogène : anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
- Relative :
- Varices (contention élastique)
- Iatrogène : dérivés nitrés, activateurs des canaux potassiques (trop fortement dosés)
- Alcool
C. Syncopes Vaso-vagales (Neurocardiogéniques)
Les plus fréquentes en pratique.
D. Cas Sans Cause Retrouvée
Dans environ 40 % des cas, aucune cause n’est identifiée. Leur pronostic n’est pas nécessairement plus mauvais. La récidive dépend de la cause, les causes cardiaques favorisant la mort subite.
VI. Conduite à Tenir
Syncopes par Hypotension Orthostatique
- Hydratation et apport sodé adéquats (2 à 3 L de liquide et 10 g de NaCl)
- Midodrine si besoin (5-20 mg, 3 fois/j)
- Fludrocortisone en complément si nécessaire (0,1-0,3 mg, 1 fois/j)
- Contention élastique des membres inférieurs et bandages abdominaux pour réduire le stockage veineux
- Sommeil avec soulèvement de la tête (>10°) pour augmenter la volémie
VII. Conclusion
L’objectif principal de la prise en charge des syncopes est de réduire le risque de mort subite. L’évaluation initiale permet une stratification du risque et guide les examens complémentaires. La grande diversité des diagnostics envisageables est à noter, mais la clinique et l’ECG suffisent le plus souvent.
Voici une sélection de livres:
- Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché
- Concepts cliniques en odontologie conservatrice
- L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement
- Guide clinique d’odontologie
- Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve
- La photographie en odontologie: Des bases fondamentales à la clinique : objectifs, matériel et conseils pratique

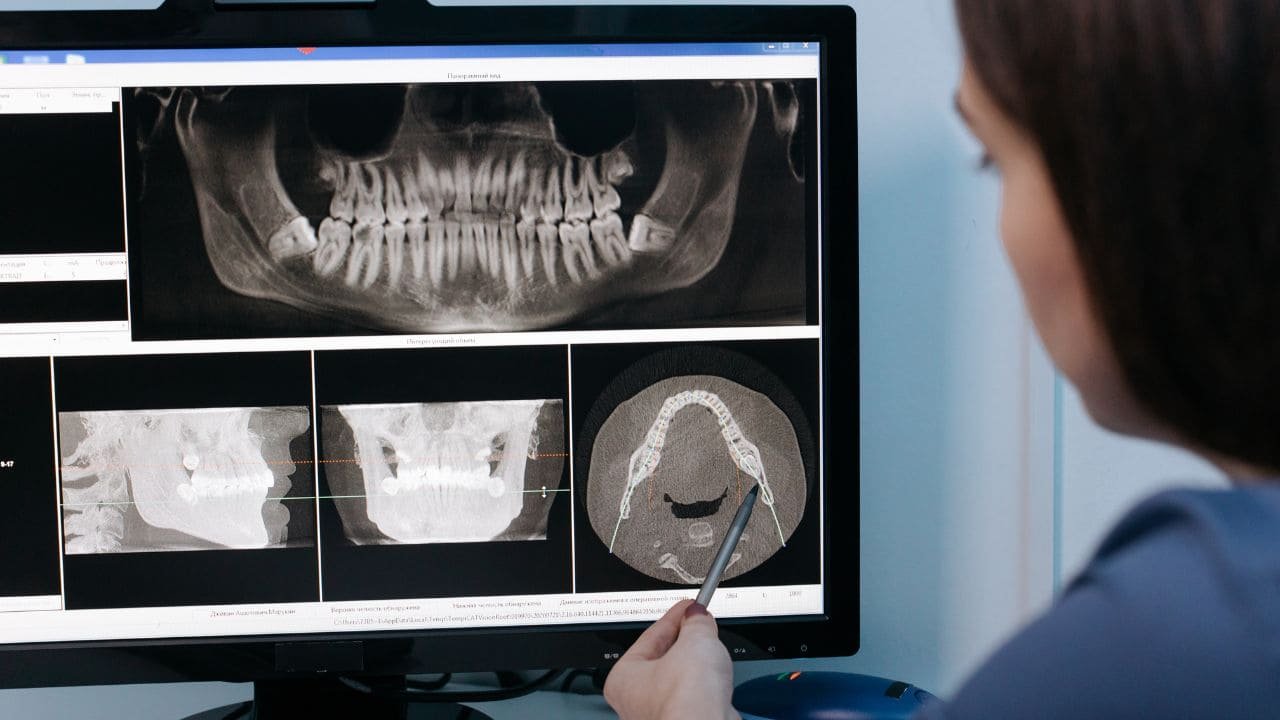


Leave a Reply