LES HEPATITES VIRALES
LES HEPATITES VIRALES
Les Hépatites Virales
Introduction
L’hépatite virale constitue un problème de santé publique international. La pandémie d’hépatite virale pèse lourdement sur les vies humaines et les systèmes de santé. En 2013, l’hépatite virale était la septième cause de mortalité dans le monde. Elle serait responsable de 1,4 million de décès par an dus aux infections aiguës ainsi qu’aux cancers du foie et aux cirrhoses liés aux hépatites. Environ 2,9 millions de personnes vivant avec le VIH sont co-infectées par le virus de l’hépatite C et 2,6 millions par le virus de l’hépatite B.
Définition et Généralités
Le terme hépatite désigne tout processus inflammatoire du foie. Une hépatite chronique désigne une inflammation du foie qui dure depuis plus de 6 mois. Le processus est aigu si l’évolution est inférieure à 6 mois. La cytolyse correspond à la rupture de la membrane cellulaire et à la libération des enzymes.
Rappel Anatomique
Le foie est l’organe le plus volumineux de l’organisme humain. Il appartient au système digestif et assure des fonctions nombreuses, vitales à l’organisme. Il est situé dans la partie supérieure droite de l’abdomen, partiellement protégé par les côtes.

- Le foie se divise en quatre lobes inégaux :
- Le lobe hépatique droit, le plus volumineux.
- Le lobe hépatique gauche, la partie la plus étroite de l’organe.
- Entre ces deux lobes majeurs, on distingue le lobe carré et le lobe caudé.
- Chaque lobe du foie est divisé en segments.
- Le foie est un des organes les plus densément vascularisés du corps humain. Il contient plus de 10 % du volume sanguin total du corps et est traversé par 1,4 litre de sang en moyenne à chaque minute (pour un adulte).
- Le foie reçoit le sang de deux vaisseaux majeurs : l’artère hépatique et la veine porte.
Rappel Histologique
On distingue :
- Infiltrat inflammatoire portal, plutôt lymphocytaire.
- Nécrose hépatocytaire.
- Fibrose : à point de départ portal, s’étend au lobule pour former des septas ou des ponts fibreux. Au maximum, elle réalise une cirrhose.
- Cirrhose : destruction de l’architecture par de la fibrose mutilante délimitant des nodules.
Rôle Physiologique du Foie
Le foie joue un rôle important dans notre organisme, il participe à la :
- Synthèse des protéines : synthétise des protéines plasmatiques :
- Albumine.
- Protéines de l’inflammation.
- Facteurs de la coagulation : tous les facteurs de la coagulation.
- Synthèse lipidique :
- Cholestérol.
- Triglycérides.
- Formation de lipoprotéines : VLDL, HDL.
- Synthèse glucidique.
- Organe de métabolisation : la plupart des médicaments sont métabolisés par le foie.
- Organe de production de la bile.
- La cytolyse hépatique entraîne la libération de molécules normalement contenues dans les hépatocytes, dont les transaminases. Les transaminases peuvent augmenter dans la plupart des maladies hépatiques. Les transaminases sont au nombre de deux :
- Aspartate Amino-Transférase (ASAT).
- Alanine Amino-Transférase (ALAT).
Causes et Facteurs de Risque
- Alcool : une consommation excessive d’alcool.
- Surpoids et un taux de cholestérol élevé (facteur de risque).
- Infection par d’autres virus (rare), en particulier chez les personnes immunodéprimées :
- Cytomégalovirus (CMV).
- Virus d’Epstein-Barr (EBV, agent de la mononucléose infectieuse).
- Virus varicelle-zona (VZV, agent de la varicelle et du zona).
- Virus herpes simplex (VHS).
- Infections bactériennes :
- Brucellose (transmise par le lait).
- Leptospirose (transmise par l’urine de rats).
- Typhus.
- Parasites unicellulaires, qui s’attaquent en général aussi à d’autres organes.
- Effets secondaires médicamenteux.
- Troubles du métabolisme du fer (hémochromatose) ou du cuivre.
- Troubles auto-immuns : maladies déclenchées par l’attaque subite du système immunitaire contre ses propres cellules.
- Hépatites d’origine virale.
Hépatites Virales
Généralités
Les hépatites sont des infections systémiques atteignant le foie, provoquant :
- Lésions inflammatoires.
- Altérations dégénératives pouvant évoluer vers fibrose et cirrhose.
- Augmentation des transaminases, variable selon l’infection virale.
Étiologies virales :
- Virus des hépatites A, B, C, D (delta), E.
- Autres virus pouvant donner une hépatite : Herpes viridae (HSV, VZV, EBV, CMV, HHV6), adénovirus, coxsackie virus…
Hépatite aiguë :
- Très rares formes fulminantes.
- Évolution vers résolution spontanée ou vers chronicité.
Hépatite chronique :
- Peut évoluer vers cirrhose et/ou carcinome hépatocellulaire pour les hépatites B, D et C.
- La majorité des hépatites virales sont asymptomatiques tant à la phase aiguë que chronique.
Diagnostic des Hépatites Virales Aiguës
- Souvent asymptomatiques.
- Si signes cliniques, ils sont aspécifiques : asthénie, arthralgies, nausées, parfois urticaire.
- Ictère : présence inconstante mais oriente sur une atteinte hépatique.
Biologie :
- ALAT > 10 fois la normale.
- Hyperbilirubinémie mixte, plutôt conjuguée.
Bilan de 1ère intention :
- IgM anti-VHA.
- IgM anti-VHE.
- Ag HBs et IgM anti-HBc (selon le contexte épidémiologique).
- Ac anti-VHC.
Les Différents Types des Hépatites Virales
Virus de l’Hépatite A
- Virus ARN nu : contamination fécale/orale.
- Prévalence liée au niveau socio-économique.
- Augmentation des cas symptomatiques et de la sévérité avec l’âge : ictère chez l’adulte.
- Incubation : 1 mois, excrétion dans les selles 10 jours avant à 10 jours après le début de l’ictère.
- Pas de passage à la chronicité.
- Diagnostic :
- Notion de voyages, consommation de coquillages.
- IgM spécifiques.
- Traitement : symptomatique.
- Déclaration obligatoire.
- Vaccin : inactivé.
Virus de l’Hépatite E
- Virus ARN nu.
- Génotypes 1 et 2 :
- Contamination fécale/orale.
- Contamination par viande de sanglier/porc mal cuite.
- Retour de voyages (Europe, USA).
- Génotypes 3 et 4 : zoonose.
- Augmentation des cas symptomatiques et de la sévérité avec l’âge, ictère chez l’adulte.
- Hépatite fulminante chez la femme enceinte au 3ème trimestre, mortalité 20 %.
- Incubation : 1 mois, pas de passage à la chronicité chez l’immunocompétent.
- Diagnostic :
- Notion de voyages, eau souillée ou consommation de viande mal cuite.
- IgM et IgG anti-HEV ; ARN HEV si immunodéprimé.
- Traitement : symptomatique.
- Vaccin : en cours de développement (approuvé en Chine).
Virus de l’Hépatite B
- Virus ADN, enveloppe résistante.
- Plus de 240 millions de porteurs chroniques dans le monde (Asie, Afrique).
- Virus présent dans les sécrétions sexuelles, salive, sang, lait, urines, selles, sueur.
- Transmission sanguine prédominante.
- Incubation : 2-3 mois, 80 % asymptomatique, peu de chronicité (10 %) sauf chez le nouveau-né (90 %) et les immunodéprimés (risque de réactivation virale).
- Chronicité avec différentes phases : surveillance au long cours car risque de carcinome hépatocellulaire.
- Profils sérologiques. Hépatite B aiguë symptomatique : déclaration obligatoire.
- Prévention :
- Vaccin.
- Mesures de prévention : transfusion sanguine (sérologie), sexuelle, lait, Ig spécifiques (cas nouveau-né).
- Traitement :
- Formes aiguës : symptomatique (traitement de la douleur, anti-émétiques…).
- Formes chroniques avec activité inflammatoire et réplication :
- Interféron (IFN) alpha pégylé.
- Analogues de nucléos(t)ides : Tenofovir, Entecavir.
Virus de l’Hépatite D (Delta)
- Virus ARN défectif : nécessite une co-infection avec HBV pour se répliquer (utilisation de l’enveloppe HBV).
- Répartition géographique : bassin méditerranéen, pays de l’Est, certains pays d’Afrique et d’Amérique du Sud.
- Transmission : identique au HBV (injection, tatouage, contact, sang, materno-fœtale).
- Co-infection HBV-HDV :
- Clinique proche du HBV, augmente le risque d’hépatite fulminante.
- Surinfection HBV par HDV :
- Augmente le risque d’hépatite fulminante.
- Risque d’hépatite D chronique (80 % des cas).
- Diagnostic :
- IgG, IgM anti-HDV élevés, ARN HDV (sang) à rechercher si patient infecté par HBV, si hépatite fulminante.
- Traitement :
- Interféron pégylé, IFN alpha pégylé (pendant 48 semaines).
- Contre-indiqué chez le cirrhotique.
- Prévention : Vaccin anti-HBV.
Virus de l’Hépatite C
- Virus à ARN (+), enveloppé.
- Transmission : sang, sexe, périnatal, inconnue.
- Génotypes :
- 1a, 1b : sang ou inconnu.
- 3a : toxicomanie.
- Asymptomatique dans 90 % des cas, passage à la chronicité dans 80 %.
- Diagnostic :
- Sérologique. Si présence d’Ac anti-HCV : RT-PCR et génotypage.
- Traitement antiviral en évolution constante :
- IFN alpha pégylé + Ribavirine (traitement de référence entre 2001 et 2011).
- Meilleure réponse pour les génotypes 2 et 3 vs génotype 1.
- Antiviraux spécifiques du VHC en évolution constante.
- Pas de vaccin.
Moyens Préventifs
Les mesures de prévention des hépatites B et C dans les cabinets dentaires doivent être suffisantes. Une prévention efficace repose sur :
- La stérilisation des dispositifs et la gestion des déchets.
- Le respect des règles d’hygiène :
- Stérilisation.
- Nettoyage du fauteuil dentaire.
- Changement du verre de rinçage pour chaque patient.
- Nettoyage du crachoir.
- Lavage des mains après chaque examen clinique.
- Recommandations de l’OMS :
- Protection des liquides biologiques (considérés comme un vecteur contaminant).
- Précautions universelles dans la pratique médicale.
- Création par le ministère de la Santé de services de médecine du travail en milieu de soins avec un système de surveillance du milieu de travail et de la santé du personnel.
- Amélioration des conditions de travail.
- Vaccination obligatoire et généralisée en cas de contamination.
- Prévention des hépatites virales B et C professionnelles.
- Utilisation de matériel stérile : stérilisation du matériel après chaque acte ou intervention.
- Prévention de la transmission mère-enfant par la vaccination à la naissance.
- Mesures pour améliorer la sécurité des produits sanguins et des injections.
- Dépistage précoce.
Conclusion
L’hépatite virale constitue un problème de santé publique. La prise en charge doit être précoce pour améliorer le pronostic vital. Le traitement est symptomatique et peut être spécifique par une vaccination (hépatite B, D). Les mesures de précaution sont nécessaires en milieu professionnel contre les hépatites B et C. Le dépistage doit être précoce.
Voici une sélection de livres:
- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011
- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996
- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE
- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient
- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé
- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1
- Endodontie, prothese et parodontologie
- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020
- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005
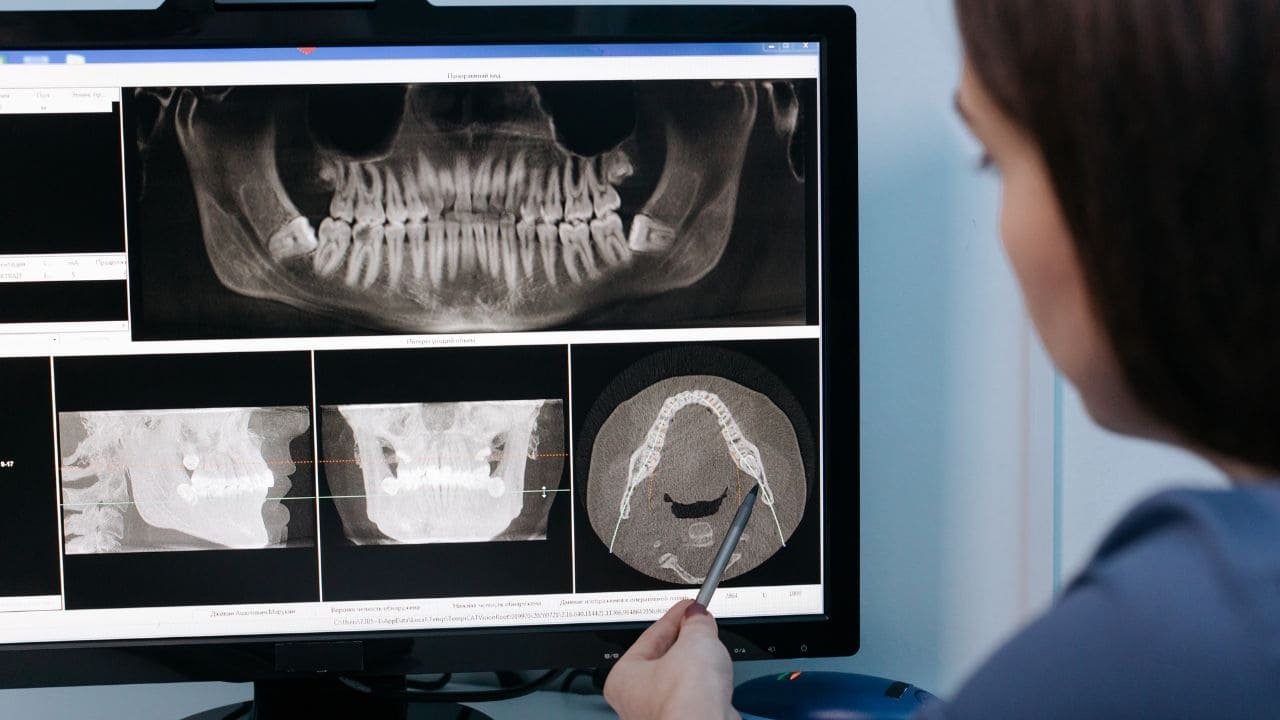



Leave a Reply