LES GREFFES GINGIVALES
LES GREFFES GINGIVALES
Les Greffes Gingivales
Introduction
Les maladies parodontales sont des maladies multifactorielles très complexes où interviennent différents acteurs. Cependant, la parodontite produit toujours une destruction des tissus parodontaux. Lorsque celle-ci se produit dans les secteurs concernés par l’esthétique, celle-ci est en jeu. La récession gingivale inévitable associée à cette destruction et au traitement parodontal chirurgical, est la plainte principale du patient ou de la patiente, dans cette région de la bouche.
Greffes Épithélio-Conjonctives
Définition
La greffe gingivale libre non enfouie ou épithélio-conjonctive est la transplantation autogène d’un tissu fibromuqueux d’un site donneur à un site receveur.
Objectifs
Deux objectifs principaux peuvent être recherchés :
- Augmentation de la hauteur et de l’épaisseur gingivales ;
- Recouvrement des récessions parodontales dans les classes I et II de Miller.
Indications
L’indication de la chirurgie ne peut être posée que 4 à 6 semaines après la thérapeutique initiale dans les secteurs sans implication esthétique majeure pour :
- Augmentation du tissu kératinisé ;
- Le recouvrement radiculaire (traitement des récessions simples ou multiples) ;
- L’aménagement des crêtes édentées et augmentation de leur volume ;
- L’aménagement péri-implantaire ;
- Le pansement biologique : comblement d’un alvéole après extraction ;
- Complément de la chirurgie maxillo-faciale : correction des fentes palatines ou des séquelles de l’intervention ;
- L’association aux lambeaux déplacés latéralement.
Contre-indications
D’ordre médical
- Non spécifié dans le document.
D’ordre esthétique
- Dans le recouvrement radiculaire des dents antéro-supérieures, surtout s’il s’agit d’un sourire gingival.
D’ordre parodontal
- En présence de poches ou récessions isolées ;
- Lorsque la gencive adjacente à la récession est enflammée.
D’ordre technique
- Au niveau de la 2ème molaire mandibulaire, la ligne oblique externe peut constituer un gêne ;
- Au niveau des secteurs molaires maxillaires, l’accès et la visibilité sont limités et la présence de la traction du muscle buccinateur ;
- Dans les régions linguales des incisives mandibulaires, la stabilisation et la vascularisation sont précaires.
Contre-indications spécifiques du recouvrement radiculaire par greffe gingivale
- La mauvaise qualité du tissu donneur ;
- Les récessions de classe 3 ou 4 de Miller ;
- Un diamètre mésio-distal de la racine exposée supérieur aux dimensions horizontales des tissus interproximaux.
Technique
Consiste en la mise en place, au niveau de la zone à traiter, d’un greffon épithélio-conjonctif prélevé de :
Le palais
- Dernière papille binoïde à la zone du canal palatin postérieurement.
Tubérosités
- La possibilité de prélèvement dépend de la présence ou non de la dent de sagesse.
- La densité fibreuse du tissu de tubérosité est supérieure à celle du chorion palatin.
Crête édentée
- Source donneuse pour des greffons de faible épaisseur.
Les différents temps opératoires
Préparation du lit receveur
Afin de permettre la vascularisation du greffon et éviter sa nécrose au cours de la cicatrisation, le lit receveur doit être large (du double de la taille de la zone avasculaire à recouvrir) et s’étend donc de part et d’autre de la récession. Le tissu épithélial est éliminé et un lit périosté est préparé au-delà de la ligne de jonction mucogingivale.
- Deux incisions horizontales sont réalisées au niveau de chaque papille bordant la récession sur une profondeur de 2 mm, elles se poursuivent par deux incisions verticales dépassant la ligne muco-gingivale de 3 mm.
- La dissection de cette partie muqueuse en épaisseur partielle se termine par sa section en lame.
Prélèvement du greffon
- Un patron est réalisé pour enregistrer les dimensions du site à traiter.
- Afin d’éviter les zones papillaires trop tourmentées et les zones à risque hémorragique, le prélèvement se fait le plus souvent à 2 ou 3 mm du bord gingival palatin des deux prémolaires et de la 1ère molaire.
- Le tissu prélevé est surdimensionné d’un tiers par rapport au patron, afin de compenser la rétraction du greffon liée à la contraction des fibres élastiques après prélèvement. Il doit avoir une épaisseur d’au moins 1 mm afin de prélever une bande de tissu conjonctif sous-jacent.
- Le site donneur est protégé par sutures, et mise en place d’un pansement chirurgical ou d’une gouttière thermoformée.
Application et suture du greffon sur le site receveur
- Il doit être parfaitement immobilisé à l’aide de sutures latérales et périostées, dans le but de permettre la formation d’un caillot de fibrine fin et régulier entre le lit périosté et la face interne conjonctive du greffon.
- Mise en place d’un pansement chirurgical.
Greffes Conjonctives Enfouies
Principes et intérêts
Historiquement, l’utilisation de greffes conjonctives a été proposée afin d’améliorer les résultats esthétiques des interventions par rapport à ceux obtenus avec des greffes épithélio-conjonctives. Le principe de la greffe de conjonctif associée au lambeau positionné coronairement consiste à placer un greffon conjonctif en position « sous-épithéliale ».
Indications
- Le recouvrement radiculaire ;
- L’épaississement gingival sur un pilier prothétique naturel ;
- L’épaississement de la muqueuse péri-implantaire.
Objectifs
Ils sont triples : recouvrement radiculaire, augmentation de la hauteur et de l’épaisseur de la gencive.
Techniques de prélèvement de greffon
Le prélèvement peut se faire dans l’épaisseur du palais ou à la tubérosité maxillaire. Différentes techniques ont été décrites : technique de la trappe, technique des incisions parallèles, technique de Bruno.
Technique de la trappe
Consiste à réaliser une incision parallèle à la ligne des collets palatins de la zone prémolaire et à environ 3 mm. La longueur de cette incision dépend du site à traiter. Elle est poursuivie de part et d’autre par des incisions perpendiculaires en direction du raphé médian. La trappe est alors disséquée et soulevée. Le prélèvement de conjonctif est réalisé à 1,5 mm d’épaisseur environ (pour recouvrement radiculaire).
Technique de Bruno
Consiste à faire une première incision au palais perpendiculaire au grand axe de la dent qui va jusqu’au contact osseux et se situe à environ 2 à 3 mm du rebord gingival. Une 2ème incision débute entre 1 à 2 mm de la précédente, selon l’épaisseur souhaitée du greffon, et s’enfonce parallèlement au grand axe des dents jusqu’au contact de l’os. L’étendue mésio-distale de ces incisions dépend de la longueur du site à traiter. Le greffon est prélevé à l’aide d’un décolleur fin. La plaie est fermée par une suture suspensive. Le greffon est examiné et la couche épithéliale aisément repérée. L’épithélium peut être supprimé à ce stade si l’opérateur le souhaite, ou conservé selon son utilisation.
Technique des incisions parallèles
Le prélèvement se fait à l’aide du bistouri à double lame d’Harris. Les deux lames s’enfoncent jusqu’au contact osseux puis par déplacement dans le sens mésio-distal, un greffon d’épaisseur constante est préparé. Son détachement est plus délicat que le prélèvement. Il faut changer d’instrument et reprendre une lame 15 de façon à joindre les deux traits d’incision aux extrémités latérales. Enfin, dans la partie apicale, le greffon doit être détaché, à la lame ou au décolleur. La plaie est fermée facilement par une suture suspensive ou des points séparés.
Tous ces protocoles permettent d’obtenir un greffon de tissu conjonctif d’épaisseur suffisante (au moins 1,5 mm) et de taille permettant de traiter une ou plusieurs récessions. Il convient néanmoins d’éliminer soigneusement les excès de tissu adipeux, ainsi que toute partie épithéliale (dans le cadre de la technique de Bruno notamment). L’utilisation de greffons conjonctifs permet d’obtenir une intégration tissulaire et une cicatrisation esthétiquement optimale, tout en permettant un épaississement tissulaire. En conséquence, différents auteurs ont décrit des techniques associant une technique chirurgicale (de type lambeau déplacé coronairement ou latéralement) et l’utilisation d’un greffon conjonctif.
Techniques de greffe
Il s’agit de la technique princeps décrite initialement par Langer en 1985, puis d’une modification qui consiste à recouvrir totalement le greffon et, enfin, d’une variante décrite par Bruno en 1994.
Technique de Langer (technique princeps)
Sur le site receveur, la surface radiculaire à recouvrir est d’abord préparée comme dans tous les autres cas de traitement des récessions. Puis des incisions intrasulculaires autour de la récession sont poursuivies par des incisions horizontales de part et d’autre de la jonction amélo-cémentaire. Ces incisions horizontales s’étendent aussi loin que possible mais respectent le système d’attache des dents voisines. Les papilles interproximales restent intactes. Ensuite, des incisions de décharge verticales ou, mieux, obliques pour déterminer un lambeau trapézoïdal à base pédiculée large, s’enfoncent au-delà de la ligne mucogingivale. Le lambeau est disséqué en demi-épaisseur. Le greffon est apporté sur le site receveur, essayé et adapté. Le greffon devra dépasser apicalement la récession de 3 mm, augmentant ainsi les chances d’apport vasculaire. Le greffon est alors immobilisé dans la position souhaitée par des sutures au tissu conjonctif sous-jacent interproximal et éventuellement au périoste avec du fil résorbable. Mais la suture du greffon à ce stade n’est pas obligatoire. Le lambeau est donc replacé sur le greffon. La partie située sur la surface radiculaire à recouvrir reste donc exposée et s’épithélialise pendant la cicatrisation.
Technique de la greffe de conjonctif avec recouvrement total du greffon par le lambeau positionné coronairement (GC + LPC)
Dans cette technique, l’enfouissement du greffon sous un lambeau positionné coronairement est total. L’emploi de cette technique est conditionné par la présence de tissu kératinisé apicalement à la récession : seules les classes I de Miller peuvent être concernées. La technique opératoire est celle d’un lambeau positionné coronairement (de préférence en épaisseur partielle, pour donner un lit mieux vascularisé au tissu conjonctif transplanté) associée à une greffe de conjonctif décrite précédemment. En cas de récessions contiguës, l’incision intrasulculaire est étendue aux deux dents proximales pour faciliter l’élévation du lambeau et éviter les incisions de décharge. En cas de vestibule court, une incision horizontale dans la région apicale est pratiquée, sur le principe du lambeau semi-lunaire.
Technique de Bruno
En 1994, Bruno a proposé quelques modifications dans la technique originale de Langer au niveau du site receveur. Il s’agit essentiellement d’éviter les incisions de décharge pour conserver le maximum d’apport vasculaire. Cette technique se rapproche de celle de l’enveloppe. La seule incision est horizontale, intrasulculaire autour de la dénudation et perpendiculaire à la surface des tissus mous dans les espaces interdentaires. Elle se situe au niveau de la jonction amélo-cémentaire. Pour faciliter la dissection et donner un accès pour la mise en place du greffon, elle est étendue de part et d’autre jusqu’à la dent voisine. La dissection en demi-épaisseur s’étend ensuite en direction apicale à partir de l’incision. Le greffon est glissé dans cette sorte de sac et son bord coronaire est placé au niveau de la jonction émail-cément. Il est fixé par du fil fin. Le lambeau est réappliqué et immobilisé par une suture non résorbable.
Technique de l’enveloppe
Elle a été décrite par Raetzke en 1985.
Objectifs
- Recouvrement des récessions parodontales ;
- Augmentation de la hauteur du tissu kératinisé ;
- Épaississement tissulaire.
Indications
Elle est destinée à permettre le recouvrement de récessions unitaires ou multiples, tout en recherchant un résultat esthétique important par absence d’incisions de décharge.
Technique
- Une incisionpickup est réalisée en épaisseur partielle tout autour de la récession pour préparer un lambeau muqueux qui reste cependant toujours attaché au niveau des papilles gingivales interdentaires. Une véritable poche entoure alors la récession. La vascularisation de l’enveloppe ainsi obtenue est assurée par les papilles, ainsi que par la partie apicale.
- Un greffon conjonctif est prélevé puis inséré dans l’enveloppe et vient recouvrir la totalité des récessions.
- Une pression digitale contre la zone de récession permet de favoriser un pontage primaire et d’éviter les sutures.
Technique de tunnellisation
Elle a été décrite par Allen en 1994 et par Azzi et Etienne en 1990.
Objectifs
- Traitement des récessions et intégration esthétique même dans des cas de classe III de Miller réputés difficiles à traiter la chirurgie pré-implantaire ;
- Augmentation de l’épaisseur et de la hauteur des tissus gingivais.
- Technique
- Dissection en épaisseur partielle autour des récessions qui se poursuit latéralement pour réunir toutes les récessions entre elles sans toutefois nuire à l’attache des papilles. Pour faciliter la progression de la lame 15C, il est indispensable de pouvoir soulever très légèrement, à l’aide d’un décolleur fin ou d’une sonde parodontale, les papilles interdentaires, ce qui permet de contrôler la dissection latérale et apicale.
- Le greffon conjonctif, débarrassé de son épithélium et dont les bords auront été préalablement biseautés, est alors engagé dans le tunnel gingival au contact des surfaces radiculaires sur le lit supra-périosté.
- Pour ce faire, une suture de type matelassier à l’une des extrémités du greffon guide celui-ci sous les papilles interdentaires.
- Il est enfin placé dans l’enveloppe à chaque extrémité mésiale et distale et suturé dans cette position par deux points simples périostés.
Avantages
- Cette technique permet de conserver une vascularisation optimale du site opératoire en raison de l’absence d’incisions de décharge et de la préservation des papilles.
- Elle est indiquée dans les secteurs esthétiques, dans les cas de récessions multiples ainsi qu’en chirurgie préprothétique.
- Elle permet la reconstruction ou la conservation de papilles interdentaires.
- L’intégration tissulaire est bonne.
Inconvénients
- La technique opératoire nécessite un opérateur expérimenté.
Conclusion
Lors de la première consultation, l’examen clinique permet de poser la nécessité d’une intervention de chirurgie mucogingivale. Le choix d’une technique se fait toujours en fonction de sa simplicité et de sa reproductibilité pour un type de lésion donné. Il faut noter que l’expérience du praticien est un facteur de succès important dans ce type d’intervention.
Voici une sélection de livres:
- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011
- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996
- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE
- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient
- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé
- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1
- Endodontie, prothese et parodontologie
- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020
- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005


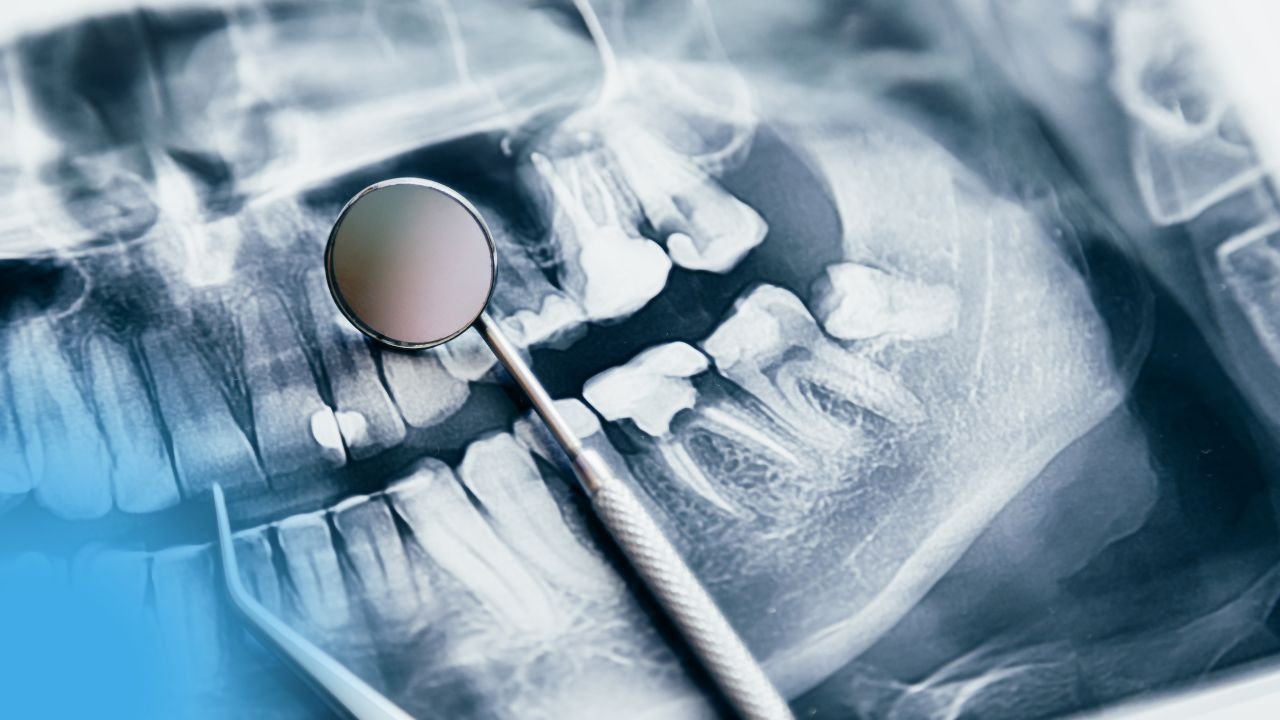

Leave a Reply