LES GINGIVOPATHIES
LES GINGIVOPATHIES
Introduction
On emploie le terme de parodontopathie dans un sens général qui englobe toutes les maladies du parodonte. Sur le plan anatomique, le parodonte se décompose en :
- Tissus superficiels de recouvrement : muqueuses et gencives.
- Tissus profonds : parodonte profond, comprenant l’os alvéolaire, le cément et le desmodonte.
Les parodontopathies se subdivisent en :
- Gingivopathies : qui affectent le parodonte superficiel.
- Parodontolyses : maladies qui affectent le parodonte profond.
Du point de vue anatomopathologique, les parodontopathies se rattachent à l’un des processus suivants :
- Processus inflammatoire.
- Processus dégénératif.
- Processus tumoral.
Définition
Les gingivopathies sont des processus inflammatoires qui n’affectent que le parodonte superficiel (l’épithélium gingival et le tissu conjonctif sous-jacent) sans atteindre et/ou détruire les structures parodontales profondes : il n’existe donc pas de pertes d’attache dans les gingivites. Elles s’observent aussi bien chez l’enfant que chez l’adulte. Leurs causes sont locales et générales.
La gingivite peut être :
- Vraie : lorsque seule la gencive est atteinte.
- Gingivostomatite : lorsque l’inflammation déborde le cadre gingival et s’étend à la muqueuse buccale dans son ensemble.
Classification des gingivopathies
Workshop international 1999 ARMITAGE
Le Workshop international de 1999 (Armitage) précise la classe des « maladies gingivales », qui se subdivisent en deux grandes catégories :
A. Maladies gingivales induites par la plaque dentaire
- Associées seulement à la plaque
- Sans cofacteurs locaux.
- Avec cofacteurs locaux.
- Maladies gingivales modifiées par des facteurs systémiques
- Endocriniens.
- Hématologiques.
- Maladies gingivales modifiées par des traitements médicamenteux
- Médications anti-épileptiques.
- Contraceptifs oraux.
- Maladies gingivales modifiées par la malnutrition
- Déficience en vitamines.
- Déficience autre.
B. Maladies gingivales non induites par la plaque dentaire
- Origine bactérienne spécifique
- Neisseria gonorrhoeae.
- Tréponème.
- Streptocoque.
- Origine virale
- Gingivostomatite herpétique.
- Herpès.
- Zona.
- Autre.
- Origine fongique
- Candidose.
- Érythème gingival linéaire.
- Autre.
- Origine génétique
- Fibrome gingival.
- Origine systémique
- Désordres muco-cutanés.
- Réaction allergique.
- Lésions traumatiques
- Réaction à des corps étrangers
- Autres origines
- Exemple : maladie de Rendu-Osler.
C. Gingivite nécrosante aiguë
La gingivite ulcéro-nécrotique aiguë est une infection favorisée par une mauvaise hygiène bucco-dentaire, le stress, les carences nutritionnelles, le tabagisme ou encore le manque de sommeil. Elle peut survenir à tout moment de la vie, mais elle touche généralement les personnes âgées de moins de 35 ans qui présentent une immunité défaillante ou qui se nourrissent de manière peu équilibrée. Elle peut également frapper les patients souffrant déjà de gingivite et qui ont subi un important choc émotionnel.
Évolution et durée de la gingivite
- Gingivite aiguë : Douloureuse, apparaît soudainement et est de durée très brève.
- Gingivite chronique : S’installe et évolue lentement, sans douleur, à moins d’être compliquée par des poussées subaiguës. C’est une gingivite marginale, lente et progressive, surtout en rapport avec le manque d’hygiène. Cliniquement, on constate un saignement important après exploration du sillon, avec un érythème évident et une perte du granité gingival. Sur le plan histologique, il se produit un remaniement des rapports entre l’épithélium et le tissu conjonctif. L’épithélium prolifère et les digitations épithéliales s’allongent dans le tissu conjonctif. La gingivite chronique est un conflit permanent entre le processus destructif et réparateur :
- D’une part, les irritants locaux persistants endommagent la gencive, prolongeant l’inflammation et provoquant une perméabilité et une exsudation vasculaire anormale, d’où dégénérescence tissulaire.
- D’autre part, de nouvelles cellules et fibres de tissu conjonctif, ainsi que de nombreux vaisseaux sanguins, se forment dans un effort constant de réparation tissulaire (tissu de granulation). Les actions réciproques de destruction et de réparation affectent donc la couleur, le volume, la texture, le contour et la consistance de la gencive.
- Gingivite subaiguë : Forme moins sévère que l’aiguë.
- Gingivite récidivante (récurrente) : Réapparaît après avoir été éliminée ou après disparition spontanée.
Distribution de la gingivite
La gingivite, selon sa répartition, peut être :
- Localisée : Limitée à la gencive d’une ou d’un groupe de dents.
- Généralisée : Affectant toute la cavité buccale.
- Papillaire : Touche les papilles (les premiers signes d’une gingivite apparaissent le plus souvent au niveau des papilles).
- Marginale : Intéresse la gencive marginale.
- Diffuse : Atteint à la fois la gencive marginale, papillaire et attachée.
Ces termes peuvent être combinés, par exemple : gingivite marginale localisée au bloc incisivo-canin inférieur.
Variations pathologiques de la muqueuse gingivale
L’examen clinique rigoureux de la gencive devrait préciser les changements de couleur, volume, consistance, contour, texture, ainsi que l’existence ou non de gingivorragies.
Changement de couleur de la gencive
Le changement de couleur est un signe clinique très important, voire déterminant, dans les gingivopathies. Il varie selon l’évolution et l’intensité de l’inflammation :
Inflammation chronique
Elle débute par une légère rougeur, passe au rouge, au rouge sombre, au rouge violacé et parfois au bleu foncé.
Inflammation aiguë
Le changement de couleur peut être marginal, localisé ou diffus selon que l’atteinte est plus ou moins aiguë :
- Marginal dans les gingivites aiguës nécrosantes (GUNA).
- Diffus dans la gingivostomatite herpétique.
- Localisé ou diffus dans la réaction aiguë aux irritants chimiques.
De façon générale, et selon l’intensité, on note au début un érythème rouge vif, puis, lorsque l’inflammation aiguë devient plus sévère, il devient gris ardoisé brillant, pour devenir progressivement gris blanchâtre terne. L’érythème est la première réaction à l’irritation, produit par une dilatation des capillaires et une augmentation du flux sanguin.
Changement de couleur dû à d’autres causes locales ou générales
Certaines colorations de la muqueuse gingivale peuvent orienter l’examen vers la recherche d’une affection générale :
- La pâleur évoque l’anémie.
- La cyanose évoque la leucémie.
- Le violacé évoque le diabète.
- Les taches rouges diffuses évoquent la gingivite desquamative ou la gingivostomatite de la ménopause.
Changement de volume
Il peut être augmenté, on parle alors d’accroissement gingival. Cette augmentation de volume, plus ou moins importante, localisée ou généralisée, peut siéger sur la gencive marginale, papillaire ou être diffuse et s’étendre à la gencive attachée. L’augmentation du volume de la gencive peut être due à :
- Œdème : Exsudat inflammatoire des vaisseaux vers la région inflammatoire, qui se manifeste cliniquement par une augmentation de volume de la gencive plus ou moins importante.
- Hypertrophie gingivale.
- Hyperplasie gingivale.
- Abcès gingival.
Rappelons que, sur le plan histologique, l’hyperplasie est une augmentation du volume d’un tissu ou d’un organe due à l’augmentation du nombre de ses cellules composantes, alors que l’hypertrophie entraîne l’augmentation de la taille par l’augmentation du volume de ces composants cellulaires.
Les accroissements gingivaux peuvent être d’origine inflammatoire, non inflammatoire ou résulter de la combinaison de ces deux phénomènes.
- Dans le stade d’une hypertrophie, la gencive peut présenter un aspect œdémateux, hyperthermique, mou, une couleur rouge violacée, saignant facilement, de surface lisse et brillante.
- L’hyperplasie se caractérise, au contraire, par une gencive ferme, dense, peu douloureuse, dont la couleur est presque normale.
Exemples de gingivites hyperplasiques et hypertrophiques
Hyperplasie gingivale d’origine médicamenteuse
Hyperplasie gingivale liée au Di-hydan (diphénylhydantoïne de sodium ou phénytoïne)
Médicament utilisé dans le traitement de l’épilepsie. Sur le plan clinique, on constate une hyperplasie généralisée de la gencive marginale et interdentaire ; l’hyperplasie peut progresser au point de recouvrir les dents et même d’interférer avec l’occlusion.
Hyperplasie liée à la cyclosporine A
Employée depuis 1984 pour prévenir les réactions de rejet de greffes d’organes et dans certaines maladies auto-immunes. Le tissu conjonctif gingival subit une croissance.
Hyperplasie liée aux antagonistes calciques
En particulier la nifédipine (Adalate®) employée dans le traitement de l’angine de poitrine et de l’hypertension artérielle.
Gingivite hyperplasique de la grossesse (gingivite gravidique)
Liée au complexe physiologique hypophyso-ovarien, l’hyperplasie est papillaire, marginale ou généralisée. La gencive est de couleur rouge, de consistance molle, d’aspect lisse et brillant avec une tendance hémorragique. Elle apparaît au 3e mois de la grossesse et régresse après l’accouchement.
Hypertrophie gingivale liée à une carence en vitamine C (scorbut)
Hyperplasie gingivale idiopathique ou fibromatose gingivale
L’hyperplasie gingivale peut être considérable, recouvrant plus ou moins complètement les couronnes des dents. La gencive est dense, ferme et indolore. Ce phénomène peut intervenir avant l’apparition des dents, parfois même à la naissance, et gêner considérablement leur éruption. L’étiologie en est inconnue. Une atteinte de plusieurs membres de la même famille évoque une composante génétique.
Épulis gingivales
Cliniquement, l’épulis désigne une excroissance gingivale hyperplasique localisée, apparaissant sur la gencive marginale ou les procès alvéolaires, surtout au niveau du secteur antérieur ou molaire. On distingue des épulis vasculaires, fibreuses et à cellules géantes.
Changement de la texture superficielle de la consistance
Une perte de granité de la surface gingivale est un signe précurseur de la gingivite. L’inflammation chronique donne une surface lisse et brillante ou ferme et nodulaire. La gingivite desquamative chronique entraîne une desquamation de la surface gingivale.
Altérations du contour gingival
Le contour gingival devient plus ou moins irrégulier selon l’importance de l’inflammation. Deux signes, souvent liés au trauma occlusal, sont particulièrement notables :
- Fissures de Stillmann : Dénudations radiculaires en forme d’apostrophe s’étendant du rebord gingival en direction apicale à des distances variables.
- Festons de MacCall : Hypertrophie en forme de « bouée de sauvetage » sur la gencive marginale.
Gingivorragies
Les gingivorragies désignent un saignement anormal des gencives, qui peut être spontané (lors de la phonation, la mastication ou la nuit pendant le sommeil) ou provoqué par le brossage et le sondage du sillon. Les gingivorragies sont variables selon leur sévérité, leur durée et la facilité avec laquelle elles sont provoquées. Le saignement est le signe le plus constant des gingivites inflammatoires.
Modifications gingivales au cours de certains syndromes généraux
Certains facteurs généraux modifient les possibilités réactionnelles de l’individu :
- Facteurs hormonaux : On observe une gencive rouge vif qui saigne au moindre contact avec une augmentation de volume dans les gingivites de grossesse (gravidique), pubertaire et ménopausique.
- Gingivites des leucémiques : Augmentation de volume marginale ou diffuse, localisée ou généralisée, avec une teinte violacée, une surface brillante et une forte tendance à l’hémorragie.
- Carence en vitamine C (scorbut) : Cette carence est incapable de déclencher une gingivopathie, mais facilite l’action des irritants locaux en modifiant les capacités de guérison.
Principaux tableaux cliniques des gingivopathies aiguës et subaiguës
Pour diagnostiquer une gingivite, il faut d’abord rechercher la lésion élémentaire :
- Érythème : La gencive est souple et d’un rouge intense. L’érythème est soit localisé, soit généralisé. Le signe caractéristique est donné par l’épreuve de la pression digitale, qui fait disparaître la coloration, laquelle réapparaît quelques instants après que la pression cesse (signe du godet).
- Érosion : Pertes de substances limitées à l’épithélium.
- Ulcération : Pertes de substances atteignant la membrane basale. Le fond de la lésion est souvent recouvert d’un « enduit pseudomembraneux » peu adhérant.
- Nécrose : Portion tissulaire atteinte de mortification. L’élimination des tissus nécrosés laisse une lésion irrégulière cratériforme, saignant au moindre contact.
- Vésicule : Soulèvement épidermique, gros comme une tête d’épingle, rempli d’un liquide clair.
- Pustule : Vésicule dont le contenu est purulent.
- Bulle : Soulèvement épidermique avec atteinte de la basale. Elle renferme un liquide et peut atteindre un diamètre de 5 mm.
Étude clinique de quelques gingivites aiguës
Cas de la gingivite érythémateuse (la lésion élémentaire est l’érythème)
On observe un liseré rouge au niveau du collet des dents, accompagné d’un œdème parfois hyperplasié. Signes fonctionnels : discrets, avec prurit et gingivorragies provoquées.
Cas de la gingivite ulcéreuse (la lésion élémentaire est l’ulcération)
Toute la muqueuse gingivale peut être atteinte. Les papilles sont décapitées, la gencive est recouverte d’enduits sanguinolents masquant les ulcérations. Signes fonctionnels : douleurs gingivales spontanées ou provoquées par la mastication et/ou les aliments épicés, hypersialorrhée, haleine fétide et adénopathie constante.
Cas de la gingivite nécrosante aiguë (gingivite ulcéro-nécrotique)
Lésions élémentaires : ulcération et nécrose. Il s’agit d’une perte de substance cratériforme saignant au moindre contact. Les lésions peuvent être plus ou moins étendues à la muqueuse buccale, et la forme sera plus ou moins sévère. Signes fonctionnels : douleurs diffuses spontanées, résistantes aux antalgiques, mastication douloureuse, haleine fétide, adénopathie constante. Signes généraux : hyperthermie, insomnie et asthénie.
Cas de la gingivite virale (exemple : herpétique)
Lésion élémentaire : la vésicule. Survient le plus souvent chez l’enfant après une maladie infectieuse (exemple : primo-infection herpétique).
Conclusion
L’évolution des gingivites d’origine locale se fait vers la guérison par un traitement symptomatique simple, c’est-à-dire par la suppression de la cause et l’établissement d’une hygiène bucco-dentaire convenable. En l’absence de traitement complet, les gingivites négligées récidivent et peuvent se compliquer en gingivostomatite ou devenir chroniques et évoluer en parodontite.
Voici une sélection de livres:
- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011
- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996
- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE
- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient
- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé
- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1
- Endodontie, prothese et parodontologie
- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020
- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

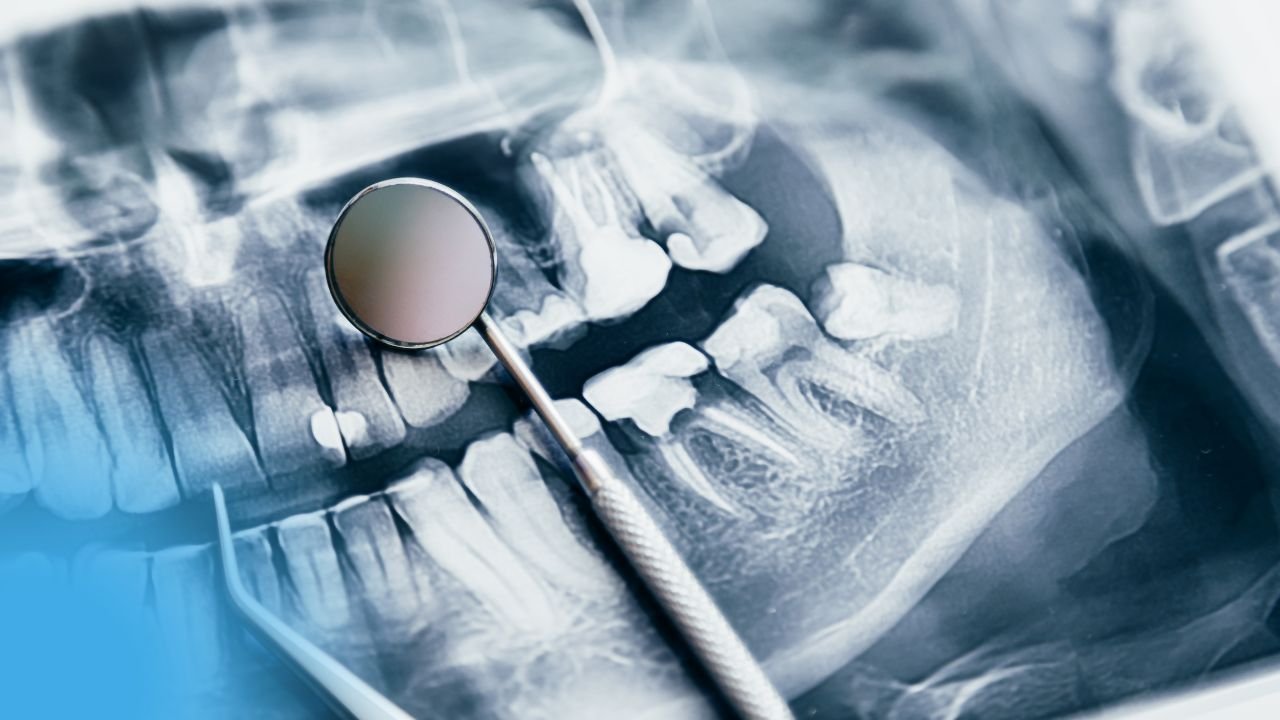


Leave a Reply