LES EXPLORATIONS BIOLOGIQUES EN ODONTOSTOMATOLOGIE
LES EXPLORATIONS BIOLOGIQUES EN ODONTOSTOMATOLOGIE
- INTRODUCTION:
Le diagnostic en médecine buccale est le résultat d’une synthèse des connaissances acquises et des renseignements recueillis auprès du patient, à travers : l’anamnèse, l’examen clinique et les explorations complémentaires (radiographiques et biologiques).
Les examens biologiques peuvent être indiqués pour :
- Confirmer ou infirmer le diagnostic d’une lésion ou d’une maladie de la muqueuse buccale.
- Établir le diagnostic des maladies systémiques pouvant avoir leurs premières manifestations au niveau de la cavité buccale : diabète, anémie, leucémie …
- Traiter les patients à risque dont les constantes doivent être contrôlés : cardiopathies, diabétiques…
- EXAMENS HEMATOLOGIQUES :
- Hémogramme ou formule-numération sanguine (FNS) :
L’hémogramme est une étude quantitative des éléments figurés du sang. En pratique courante, il comporte la lignée rouge (hématies ou globules rouges: GR), lignée blanche (leucocytes ou globules blancs: GB) et les plaquettes sanguines ou thrombocytes.
Les résultats de l’hémogramme varient physiologiquement en fonction du sexe, de l’âge et de l’ethnie.
- Lignée Rouge :
La lignée rouge est explorée par : le nombre des hématies (globule rouge GR), le taux d’hémoglobine (Hb), l’hématocrite (Ht), le volume globulaire moyen (VGM), la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine (CCMH)) et la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine (TCMH). Voir tableau ci-dessous.
| Hématies : | ||
| HommeFemme Nouveau-né | 4 500.000 à 5 000.000/mm3 ou 4,5 à 5,5×1012/l4 000.000 à 5 000.000/mm3 ou 4 à 5×1012/l4 000.000 à 5 500.000/mm3 ou 4 à 5,5×1012/l | |
| Leucocytes : | ||
| Adultes Enfant <5ans | 4.000 à 10.000/mm3 ou 4 à 10×1012/l4 000 à 15 000.000/mm3 ou 4 à 15×1012/l | |
| Plaquettes : 150.000 à 500.000/mm3 ou 150 à 500×1012/l | ||
| Hémoglobine : | ||
| Homme Femme Nouveau-né | 13 à 17g/dl12 à 15g/dl17 à 25g/dl | |
| Hématocrite : | ||
| HommeFemme | 40% à 54%37 % à 47% | |
| Autres indices érythrocytaires : | ||
| Valeur globulaire moyen (VGM) : 80 à 100flTeneur corpusculaire moyenne en hémoglobine (TCMH) : 27 à 32pgConcentration corpusculaire moyenne en hémoglobine (CCMH) : 32 à 36 g/dl | ||
Interprétation des résultats :
L’étude des globules rouges (ou hématies) est basée sur l’analyse de l’hémoglobine (Hb). L’hémoglobine est une protéine, dont la principale fonction est le transport du dioxygène dans l’organisme. Elle se trouve essentiellement à l’intérieur des globules rouges et est responsable de la couleur rouge du sang.
Toute augmentation du taux d’hémoglobine, oriente le diagnostic vers la polyglobulie. La diminution d’hémoglobine oriente le diagnostic vers une anémie.
L’anémie est la diminution de l’hémoglobine au-dessous de 13g/dl chez l’homme, de 12g/dl chez la femme et l’enfant, de 10,5g/dl chez la femme enceinte et le nourrisson de deux mois. En effet, c’est la réduction du taux d’hémoglobine qui définit l’anémie et non pas la diminution du nombre de globules rouges.
Les autres éléments de l’hémogramme (concentration corpusculaire moyenne [CCMH] et volume globulaire moyen en hémoglobine [VGM], réticulocytes) orientent le spécialiste vers le diagnostic étiologique de l’anémie, le taux de réticulocytes affirme le caractère régénératif ou non de l’anémie.
- L’hématocrite (Hte) est le pourcentage du volume occupé par les globules rouges par rapport au sang total 42-52 % chez l’homme et 38-48 % chez la femme.
- VGM volume globulaire moyen en Hb Hématocrite / nombre d’hématie. C’est le volume moyen des globules rouges exprimé en femtolitre (fl) 80 à 100 fl.
- Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine (CCMH) : Hémoglobine / hématocryte Elle donne la concentration de l’hg dans les érythrocytes 31-36 g /dl. La diminution de la CCMH définit classiquement l’hypochromie.
On ne note pas d’hyperchromie puisque au-delà d‘une certaine concentration, l’Hb ne se concentre plus, soit le patient est normochrome ou hypochromie, donc l’hyperchromie n’existe pas.
- Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine (TCMH) Hémoglobine/ nombre d’hématies. 27 à 32pg (picogramme) Elle donne la masse moyenne d’hg dans un érythrocyte
Le taux de réticulocytes affirme le caractère régénératif ou non de l’anémie. Ce paramètre a peu d’usage pratique.
L’anémie peut avoir différentes origines :
Le premier critère pour différencier entre les types d’anémie est le VGM qui est normalement compris entre 80 et 100 fl.
- En dessous de 80 on parle d’anémie microcytaire, le globule rouge est de petite taille
- En dessus de 100 on parle d’anémie macrocytaire et le GR est de taille augmenté
- Entre 80-100 c’est une anémie normocytaire.
Anémies microcytaire : les anémies microcytaires sont les plus fréquentes. Dont les causes sont soit la carence en fer, une inflammation, ou encore une thalassémie ; il faut savoir que le globule rouge contient de l’Hb qui lui-même contient du fer, et donc dans le cas où les réserves en fer sont basses lors d’une carence en fer, ou lorsque le fer est piégé dans les macrophages lors de l’inflammation, ou l’hémoglobine est produite en moindre quantité lors de la thalassémie, dans ces trois situations on parle d’anémie microcytaire puisque le fer et l’Hb sont diminués et donc insuffisants pour donner la taille normal du globule rouge.
Afin de rechercher la cause, on évalue : la carence en fer et l’inflammation.
- La carence en fer peut être due à un saignement chronique, et recherchée par une ferretinémie qui reflète les réserves de fer dans l’organisme.
-L’inflammation est recherchée par le dosage de la protéine de l’inflammation : C Réactive Protein CRP.
- Si les deux examens sont normaux on recherchera une thalassémie à l’aide d’une électrophorèse de l’Hb ; la thalassémie est une pathologie héréditaire due à une pathologie de fabrication des chaines de l’Hb.
Anémie normocytaire ou macrocytaire : on recherchera le taux de réticulocyte. Les réticulocytes sont des hématies qui viennent de quitter la moelle osseuse. Leur augmentation dans le sang : plus de 120 giga, signe une activité régénérative de la moelle osseuse pour combler un déficit lié à une anémie. On parlera alors :
- d’anémie régénérative (anémie post-hémorragique…); puisque la moelle essaye de régénérer le taux de GR et d’Hb,
- ou une anémie hémolytique par destruction des globules rouges due aux anomalies d’un ou de plusieurs de ses constituants ou à la présence de produits toxiques pour les hématies comme des auto- anticorps anti-globule rouge peuvent également provoquer cette anémie.
Lors de la diminution, on parle d’anémie non régénérative : un myélogramme est donc demandé ou on aspire la moelle osseuse pour évaluer son contenu :
- en cas d’anémie macrocytaire on retrouve des cellules osseuse mégaloblastiques donc géante, qui ne se divise pas pour donner les GR à cause du manque des précurseur des GR qui sont la vitamine B9, et la Vitamine B12, ce qui induit au dosage de ces deux vitamines pour rechercher le déficit, comme dans le cas de l’anémie de Biermer due au manque de la vitamine B12.
- Dans le cas d’une anémie normocytaire : le myélogramme retrouve peu de cellule, on parle d’aplasie médullaire, dans le cas où la moelle est riche en cellule c’est le signe d’une hémopathie.
- Lignée blanche :
Le deuxième élément de l’hémogramme caractérise la lignée blanche, concerne le nombre de leucocytes qui jouent un rôle fondamental dans la lutte contre l’infection et dans les processus de défense.
Normalement, le nombre de leucocytes se situe entre 4 et 10 giga/L. Variable d’un jour à l’autre, il augmente particulièrement en période postprandiale et en cas d’effort ou de stress.
− Chez l’adulte, elle s’inscrit dans les limites suivantes
| Catégories de leucocytes | Formule % | Nombre absolu(par mm3) | Unités (par litre) |
| Polynucléaires neutrophiles (PNN) | 45 à 70% | 1 800 à 7 000 | 1,8 à 7 x 109/l |
| Polynucléaires éosinophiles (PNE) | 1 à 5% | < 500 | <0,5 x 109/l |
| Polynucléaires basinophiles (PNB) | 0 à 1% | < 100 | <0,1 x 109/l |
| Lymphocytes | 20 à 40% | 1 500 à 4 000 | 1,5 à 4 x 109/l |
| Monocytes | 2 à 10% | 100 à 1 000 | 0,2 à 1 x 109/l |
2.1.2.1- L’augmentation des leucocytes au-delà de 10 giga/L caractérise une hyperleucocytose, d’origine réactionnelle ou maligne.
2.1.2.1.1- L’augmentation des polynucléaires neutrophiles > 10 000/mm3 (polynucléose ou neutrophilie) s’observe dans les infections bactériennes surtout et de façon générale dans les inflammations quelle qu’en soit la cause.
De petites polynucléoses chroniques s’observent également chez les fumeurs. Y penser encas de tabagisme important.
2.1.2.1.2- Une éosinophilie par augmentation du nombre de polynucléaires éosinophiles au-dessus de 0,5 giga/L, principalement d’origine allergique, parasitaire ou néoplasique.
2.1.2.1.3- Une basophilie, par augmentation du nombre de polynucléaires basophiles circulants au- dessus de 0,05 giga/L. Elle s’observe dans la maladie de Vaquez, certaines anémies hémolytiques chroniques, les leucémies et les syndromes myéloprolifératifs.
2.1.2.1.4- D’une monocytose, par augmentation du nombre de monocytes au-dessus de 1giga/L, qui se rencontre au cours de l’évolution de nombreuses maladies infectieuses ou parasitaires, d’un syndrome mononucléosique, de certaines affections malignes…
2.1.2.1.5- D’une lymphocytose, par augmentation du nombre de lymphocytes au-dessus de 4giga/L, qui peut avoir pour origine un processus infectieux la coqueluche (chez l’enfant elle peut être très importante), la brucellose, la typhoïde, à la phase de début de l’hépatite virale, de la varicelle, de la rubéole etc., ou traduire un syndrome prolifératif (lymphome).
2.1.2.2 : diminution du nombre de globules blancs circulants en dessous de 4 giga/L affirme un diagnostic de leucopénie. Une neutropénie isolée <500/mm3 (agranulocytose)
- La leucopénie est due le plus souvent à une réduction du nombre des neutrophiles inférieur à 0,5 giga/L (500/mm3), on parle d’agranulocytose est souvent d’origine toxique et doit faire rechercher avant tout une cause médicamenteuse agissant par un mécanisme immuno-allergique (fixation sur les polynucléaires du couple anticorps-médicament) ou toxique (toxicité directe sur la lignée granuleuse).
- La neutropénie peut être d’origine génétique comme la neutropénie familiale et cyclique, ou acquise ; rencontrée en cas d’infections parasitaires, virales ou bactériennes, de leucémie aussi comme une complication de la chimiothérapie antimitotique.
En général, les personnes avec des déficiences quantitatives et qualitatives des polynucléaires neutrophiles, présentent une destruction sévère des tissus parodontaux. La sévérité des manifestations parodontales est directement liée à la sévérité de la neutropénie. Par ailleurs, toute neutropénie expose à un risque infectieux important ce qui implique des mesures préventives. Une valeur inférieure à 1 giga/L nécessite le report des soins jusqu’à normalisation. En cas d’urgence bucco-dentaire, un traitement en milieu hospitalier est préconisé.
- Plus rarement, la baisse porte sur les lymphocytes dont le nombre inférieur à 1 giga/l définit une lymphopénie. Ce déficit peut être ou non associé à un déficit immunitaire qu’il soit primitif ou secondaire à différentes étiologies : infections, états inflammatoires, prise de médicaments immunosuppresseurs, chimiothérapie, radiothérapie…
- La baisse peut porter sur les monocytes, qui, au-dessous de 0.1 giga/L, définissent une monocytopénie, observée dans les aplasies médullaires graves, et l’anémie de Biermer.
- Lorsque tous les éléments figurés du sang sont diminués on parle de pancytopénie, pouvant être due à une aplasie médullaire qui correspond à une absence de production des cellules sanguines par la moelle osseuse ou d’insuffisance médullaire.
2.1.3 Plaquettes :
Une numération plaquettaire (NP) normale varie de 150 000 à 450 000/mm3. L’intérêt du dosage des plaquettes lors du bilan préopératoire est de dépister une thrombopénie (risque hémorragique) ou une thrombocytose (augmentation du nombre), qui peut provoquer une thrombose.
Les extractions dentaires peuvent être réalisées chez certains patients à partir de 80 000, si le patient présente un taux de 50 000 la prise en charge s’effectuera de préférence en milieu hospitalier, avec accord du médecin traitant qui peut effectuer un frotti sanguin (examen des éléments figurés du sang au microscope après coloration) et déterminer le nombre exact, ou alors opter pour une transfusion sanguine.
Thrombopathie : le nombre de plaquettes est normal mais leur qualité est altérée et ce qui favorise des hémorragies cutanéo-muqueuses. La cause la plus fréquente est médicamenteuse : salicylés, ticlopidine et anti-inflammatoires non stéroïdiens, et dans la thrombasthénie de Glanzman.
- Bilan de l’hémostase :
- Rappel physiologique de l’hémostase :
L’hémostase est l’ensemble des phénomènes physiologiques qui aboutissent à l’arrêt du saignement. Elle est classiquement divisée en trois étapes:
- l’hémostase primaire aboutie à la formation du clou plaquettaire. Elle suppose l’interaction des plaquettes avec le sous-endothélium exposé ou avec une surface endothéliale altérée ;
- la coagulation qui permet l’obtention du caillot de fibrine, lequel stabilise et solidifie le clou plaquettaire pendant toute la période de cicatrisation de la plaie. Elle se déroule en empruntant 2 voies, la voie extrinsèque ou tissulaire (implication des facteurs V, VII, X) et la voie intrinsèque ou plasmatique (implication des facteurs IX, X, XI, XII). Ces deux voies génèrent de la prothrombinase. A partir de ce complexe enzymatique débute la voie finale commune (facteurs I, II, et XIII) qui permet à la prothrombine d’être transformée en thrombine qui, à son tour, catalyse la transformation du fibrinogène en fibrine. Chaque voie correspond à une cascade enzymatique, pour laquelle les facteurs de la coagulation, leurs cofacteurs et les membranes cellulaires interagissent en séquences ordonnées.
Finalement, les facteurs de coagulation, inertes dans le plasma sous la forme de pro-enzyme, vont être activés tour à tour en enzymes activés.
- La fibrinolyse se déclenche en même temps que l’hémostase primaire et la coagulation. Elle élimine le caillot fibrino-plaquettaire afin de rétablir la circulation sanguine et de permettre la réparation de la lésion à l’origine de l’hémorragie.
Certains tests de laboratoire sont indispensables à l’évaluation et au diagnostic des troubles de l’hémostase et de la coagulation. On distingue des tests explorant l’hémostase primaire et autres explorant la coagulation et la fibrino-formation.
- Exploration de l’hémostase:
- Temps de saignement (TS):
Mesure la durée du saignement provoquée par une incision superficielle [soit au lobe de l’oreille (Duke), soit à l’avant-bras (Ivy)]. Peu utilisé.
Les valeurs normales dépendent de la technique utilisée [2 à 4 minutes (Duke), 3 à 5 minutes (Ivy «trois points»), Le risque hémorragique existe à partir de 10 minutes.
Un allongement du temps de saignement oriente le diagnostic vers deux types de maladies hémorragiques, la thrombopénie (la plus fréquente) et la thrombopathie qui est une anomalie fonctionnelle.
Une numération de plaquettes suffit pour retrouver une thrombopénie.
- Exploration de la coagulation
Le temps de Quick (TQ) ou taux de prothrombine (TP) et le temps de céphaline activé (TCA) permettent l’exploration globale de cette étape.
Temps de Quick ou taux de prothrombine (TP : Permet d’étudier la voie extrinsèque de la coagulation (facteurs : II, V, VII, X) vitamine K dépendants.
- soit en seconde/ à un témoin et on parle de TQ
- Soit en pourcentage varie entre 70 à 100% et on parle de TP
Permet d’explorer les facteurs provitamine K dépendants (PPSB prothrombine, proconvertine, facteur Stuart et l’anti hémophilique B). Le TP est bas en cas d’insuffisance hépatique.
- Dans le but de standardiser les résultats, il est préférable d’utiliser l’INR (international, normalized, ratio).
- L’INR est le rapport entre le TP (TQ) du malade et le TP témoin multiplié par l’ISI (index de sensibilité international)
- varie de 1 à 9 (quand l’INR croit, le TP diminue et inversement). L’INR est utilisé pour surveiller les malades traités par l’anti vitamine K (AVK). Chez les malades sous AVK, la zone d’efficacité thérapeutique (qu’il faut atteindre et maintenir) est définie par rapport au risque thrombo-embolique et correspond à un INR compris entre 2 et 4, soit un TP de 20 à 40 %. A ce chiffre l’incidence de saignement est moindre et gérable lorsque les moyens d’hémostase locaux sont bien conduits à savoir les sutures et la mise en place de Surgicel (Compresse hémostatique résorbable).
Le temps de céphaline activée (TCA): mesure le temps de coagulation à 37° C d’un plasma en présence de phospholipides (céphaline), d’un activateur (kaolin) et de calcium. Permet d’explorer tous les facteurs de la voie endogène sauf le VII.
L’allongement du TCA peut révéler un déficit en un facteur de coagulation, en particulier l’anti- hémophile A (VIII) et B (IX), potentiellement responsable d‘un risque hémorragique.
(TCA) normal est entre 30 et 45 secondes. Il ne doit pas excéder le temps témoins de 6 à 12 secondes. Le TCA sert également à contrôler les malades traités par héparines.
- Exploration du fibrinogène :
Le temps de thrombine (TT) évalue l’ensemble de la fibrinoformation. Il mesure le temps de formation du caillot à partir du fibrinogène. Il est anormal quand il dépasse 20 s.
- MESURE DE LA VITESSE DE SEDIMENTATION :
La mesure de la VS consiste à apprécier in vitro, la chute progressive des globules rouge au sein du plasma, lorsque le sang a été rendu incoagulable par de citrate de sodium. La VS permet une orientation diagnostique des maladies inflammatoires. Ce test peut être affiné par le dosage de la CRP protéine de l’inflammation.
- EXAMENS BIOCHIMIQUES
- Explorations biologiques du diabète
- : La glycémie à jeûn est le dosage du taux de glucose dans le sang. (Valeur normale ˂ 1 g/l ou comprise entre 3,9 et 5,4 mmol/l). Le diabète est défini par un niveau de glucose plasmatique à jeun ≥ 7 mmol/L (1,26 g/l), vérifié à deux reprises.
Facteurs de conversion : g x 5,56 = mmol- mmol x 0,18 = g
La Glycémie mesurée 2h après un repas est dite postprandiale, elle est ˂ 1,2 pour le non diabétique et ≥ 1,8 en cas de diabète sucré.
- Hémoglobine glyquée (HbA1c) : C’est une fraction de l’hémoglobine qui stocke le glucose en cas d’hyperglycémie (la durée de vie des hématies est de 3 mois). Ce paramètre permet donc d’évaluer l’équilibre du diabète sur les 2 ou 3 derniers mois. Une HbA1c > 7 % indique un déséquilibre : léger entre 7-8 %, moyen entre 8-9 %, et sévère lorsque l’HbA1c est > 9 %.
- Glycosurie : Lorsque le patient diabétique est bien équilibre, sa glycosurie de 24 heures sera nulle ou inférieur à 1g. La glycosurie est mise en évidence par les bandelettes N- Labstix.
- Explorations biologiques de la fonction rénale:
L’exploration de la fonction rénale s’avère parfois nécessaire, chez le sujet âgé ou quand une pathologie est suspectée, afin d’orienter le malade ou d’adapter sa prise en charge, notamment pour les prescriptions médicamenteuses.
- L’urée: déchet azoté qui provient de la dégradation des protides par le foie, filtrée par
les reins, éliminée dans les urines. Mesurer le taux sanguin (urémie) et urinaire (urines des 24h) permet d’identifier un éventuel dysfonctionnement des reins. Le rapport entre urée urinaire et urée sanguine est normalement supérieur à 10. S’il est inférieur à 10, une insuffisance rénale peut être suspectée. Le taux d’urée peut augmenter de manière significative dans plusieurs cas (chez un sujet âgé, lors d’efforts prolongés ou de régime hyperprotidique, en cas d’insuffisance cardiaque, lors d’une déshydratation ou après une intervention chirurgicale). Le taux d’urée baisse dans les hépatites toxiques, les insuffisances hépatiques sévères, les cancers hépatiques, les cirrhoses et les malnutritions.
- Créatininémie, créatininurie:
La mesure de la créatinine sanguine et urinaire renseigne sur la fonction rénale et sur la masse musculaire du patient. La créatinine est produite à partir de la créatine (molécule nécessaire à la
production d’énergie dans les muscles), la créatinine est transportée par le sang puis éliminée par les reins, dans les urines. Le dosage de la créatinine urinaire se fait par un recueil des urines produites par le patient sur une durée de 24 heures.
Le taux de créatinine peut varier d’un individu à un autre. En revanche, il est très stable pour une même personne. Chez un sportif, par exemple on observe un taux de créatinine plus élevé que la moyenne car les muscles travaillent plus intensément et produisent donc plus de créatinine. La masse musculaire d’une manière générale joue donc sur ce taux tout comme l’activité physique, une alimentation riche en protéines, l’âge ou encore le poids de l’individu. La baisse de la créatinine est rare. Elle se voit dans les états de dénutrition très avancés et dans certaines myopathies. La créatinine est élevée dans toutes
les insuffisances rénales. Les valeurs normales dans le sang sont de 80 à 110 μmol/l (9 à 13 mg/L) chez l’homme et de 60 à 90 μmol/L (7 à 10 mg/L) chez la femme. Ce dosage est important pour évaluer la clairance et préciser le degré d’une insuffisance rénale chronique (IRC).
Facteurs de conversion : mg x 8,8 = μmol- μmol x 0,11 = mg.
- Clairance de la créatinine endogène :
Les valeurs normales sont comprises entre 75 et 125 ml/minute. Elle baisse en moyenne de 1 % par an à partir de 40 ans. Cette mesure permet d’estimer le degré d’insuffisance rénale et d’en suivre la progression.
- Explorations biologiques de la fonction hépatique
- Transaminases (SGOT, SGPT) :
Les transaminases sont actives dans le foie, le cœur et les muscles. Elles passent dans le sérum en cas de cytolyse hépatique ou musculaire.
En clinique, on évalue l’activité de l’alanine-aminotransférase (ALAT) ou anciennement GPT est surtout présente dans le foie et celle de l’aspartate-aminotransférase (ASAT) ou anciennement GOT présente dans le cœur et les muscles ; en moindre quantité dans le foie.
Des augmentations très importantes des ALAT (10 à 100 fois les valeurs normales) s’observent dans les hépatites virales.
Une élévation importante des transaminases peut également s’observer en cas d’obstruction brutale de la voie biliaire principale ou d’angiocholite.
Des augmentations modérées des ALAT (inférieures à 20 fois les valeurs normales) s’observent dans les cirrhoses éthyliques et biliaires primitives, les hépatites médicamenteuses…
- Bilirubines :
La bilirubine est le produit de la dégradation de l’hémoglobine dans la rate. Libérée dans le plasma, sous forme insoluble, elle est véhiculée vers le foie, liée à l’albumine. Dans le foie, elle est conjuguée avec le glycuronate ce qui la rend soluble, puis elle est excrétée par les voies biliaires dans l’intestin. Dans l’intestin, les bactéries dégradent la bilirubine dont 80% sont éliminés dans les selles ce qui contribue à leur coloration.
Tout trouble de ce métabolisme de l’hémoglobine provoque une hyper bilirubinémie et un ictère. La bilirubine conjuguée soluble dans l’eau et présente dans les voies biliaires est dite « directe », la bilirubine non conjuguée libérée par la destruction des hématies et présente dans le sang est dite « indirecte ».
La concentration de la bilirubine plasmatique est de 3 à 12 μmol/l, en tout cas inférieure à 18 μmol/l (10 mg/l), elle est exclusivement sous forme non conjuguée. La bilirubine est augmentée en cas de cirrhose hépatique, d’ictère par hépatite, d’ictère mécanique ou d’ictère hémolytique.
- EXAMENS MICROBIOLOGIQUES, MYCOLOGIQUES ET VIROLOGIQUES
- Examens Microbiologiques :
Il est toutefois indiqué de pratiquer certains examens bactériologiques dans les lésions bucco-dentaires suppuratives qui résistent au traitement et dans les cas d’infections fongiques.
L’examen bactériologique consiste en une culture bactérienne et en un antibiogramme afin de déterminer la sensibilité des bactéries aux antibiotiques et donc adapter la thérapeutique en fonction du spectrogramme qui détermine contre quelle souche un ATB est plus efficace.
Il est impératif de procéder avant tout prélèvement à l’asepsie. Le prélèvement peut se faire à l’aide d’un écouvillon stérile ou par aspiration de la collection.
- Examens mycologiques :
Le champignon le plus fréquemment incriminé dans les affections fongiques de la cavité buccale est le Candida albicans.
- Au niveau de la cavité buccale, le prélèvement se fait à l’aide d’un écouvillon stérile, un grattage des structures concernées dans le but d’une identification et d’une analyse quantitative (nombre de champignon).
- Le prélèvement doit être effectué le matin à jeun et sans brossage dentaire ni bain de bouche préalable. L’idéal est d’effectuer sur place des frottis de l’exsudat et de l’ensemencer immédiatement sur milieu de SABOURAUD
- Examens virologiques:
- Sérologie hépatite B et C : Le diagnostic virologique direct repose sur la mise en évidence des antigènes du virus dans le sérum du malade. Le diagnostic de l’hépatite B (HB) repose sur la détection en ELISA d’antigènes viraux ou de leur anticorps, l’apparition des anticorps entraînant la disparition des antigènes.
- Sérologie de le HIV :
Le test ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) permet le dépistage d’anticorps VIH. En cas de positivité, ce test doit être confirmé par un test plus spécifique tel que l’analyse par la technique de Western-Blot.
- Examens Histologiques : on peut faire soit :
- Cytoponction : Elle s’adresse aux lésions profondes et pour l’exploration des adénopathies (Dc différentiel entre lymphome et métastases).
- Biopsie : La biopsie consiste à prélever un fragment de tissu vivant par des moyens chirurgicaux dans le but de pratiquer un examen histologique, biochimique, microbiologique ou immunologique.
- EXAMENS IMMUNOLOGIQUES :
Certaines maladies sont difficiles à diagnostiquer, nécessitent un diagnostic Cyto-immunologique à l’aide des tests immunologiques spécialisés. Ces tests sont l’immunofluorescence, directe et indirecte sont particulièrement, utile au diagnostic des lésions vésiculo – bulleuses qui passent rapidement au stade ulcéré. Ex: le Pemphigus
- CONCLUSION :
La connaissance des tests biologiques est indispensable pour les prescrire de manière pertinente et pour interpréter les résultats en collaboration avec le médecin traitant. Elle permet d’une part, le dépistage précoce de certaines pathologies à manifestations buccales et d’autre part une bonne planification des soins potentiellement à risque pour une prévention des complications lors des traitements bucco-dentaires.
LES EXPLORATIONS BIOLOGIQUES EN ODONTOSTOMATOLOGIE
Voici une sélection de livres:
Parodontologie Relié – 1 novembre 2005
Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011
Parodontologie Broché – 19 septembre 1996
MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE
Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient
Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé
Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1
Endodontie, prothese et parodontologie
La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020
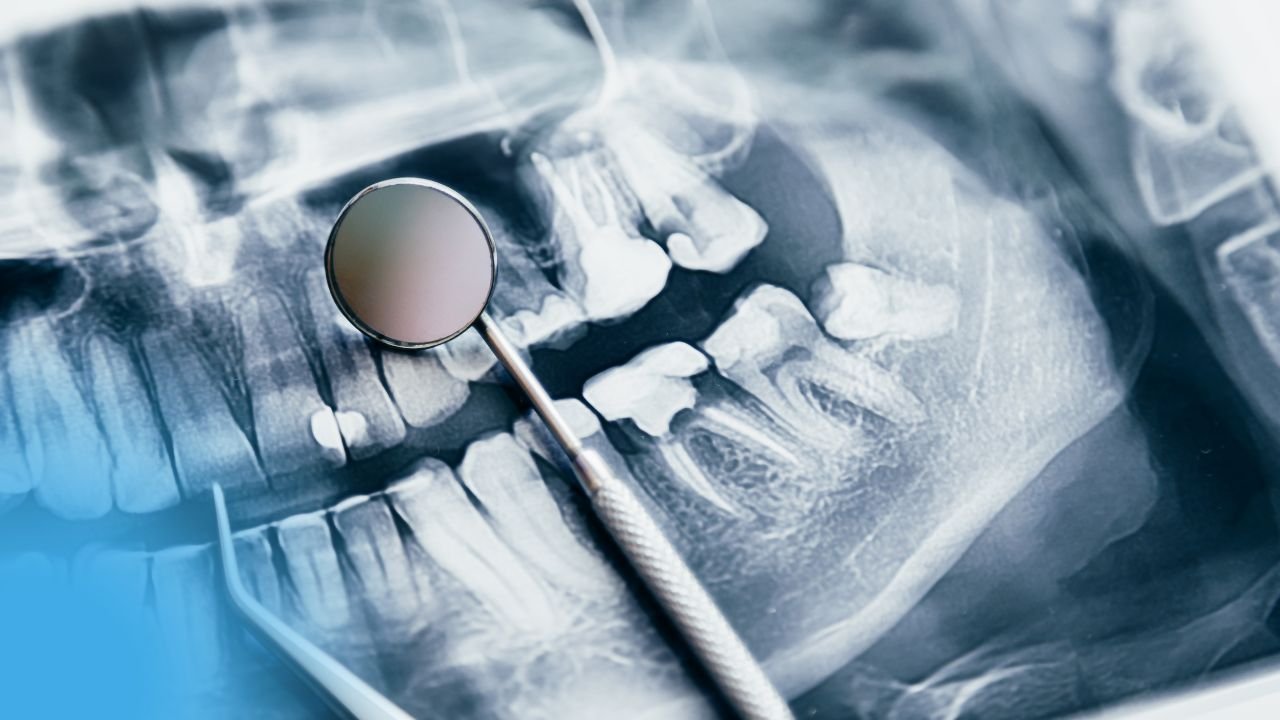



Leave a Reply