Les algies faciales
Les algies faciales
Introduction
La douleur est le motif de consultation le plus fréquent en odontostomatologie. Sa prise en charge thérapeutique est difficile, d’où la création de centres antidouleur pour accompagner les patients qui en souffrent. On distingue ainsi deux grands types de douleurs :
- Douleur aiguë
- Douleur chronique
Il appartient au médecin-dentiste de déterminer la cause de cette douleur, qui peut être évidente ou mise en évidence par un examen clinique complet. Il est donc impératif d’étiqueter la douleur pour pouvoir la traiter.
Définition
Douleur
« C’est une expérience sensorielle et émotionnelle associée à des lésions tissulaires présentes ou potentielles ou décrites en termes de lésions. » (International Headache Society IHS et l’International Association for the Study of Pain IASP).
Algies
Exacerbations sensitives assez fréquentes et variées ; différentes des névralgies car pas nécessairement dues à une atteinte propre du tissu nerveux lui-même.
Névralgies
Ce sont des douleurs bien localisées, électives d’un nerf sensitif irrité ou agressé.
Anatomie
La face est le support sensoriel le plus riche du corps. Le nerf trijumeau (V) par ses trois branches est responsable de son innervation sensitive.
Épidémiologie
L’algie oro-faciale est un motif de consultation très fréquent, touchant 8 à 10 % de la population, avec une proportion de femmes plus élevée que celle des hommes. Les étiologies sont d’une diversité remarquable et le diagnostic ainsi que la prise en charge thérapeutique sont très importants. La complexité des algies et la rigueur de leur prise en charge thérapeutique expliquent le « nomadisme » des patients souffrants.
Examen Clinique
L’examen clinique dure plus de 30 minutes et doit être méthodique. Il débute par l’interrogatoire, qui peut être difficile étant donné que le malade a souvent déjà consulté par le passé et présente une composante psychique avec notion de douleur chronique.
Anamnèse
Elle devra préciser :
- Le siège de la douleur : Face exclusive, crâne, hémi-crâne…
- Le côté de la douleur : Unilatérale, bilatérale ou alternante.
- L’intensité de la douleur : Utilisation de l’échelle visuelle analogique.
- Le caractère de la douleur : En éclair, coup de poignard, électriques → névralgie ; étau, pulsatile → migraines.
- La durée de la douleur : Secondes, minutes ou heures. Si la douleur persiste plus de 6 mois → douleur chronique ou douleur-maladie.
- La fréquence des accès douloureux : Jours, semaines, mois et intervalles libres entre les crises.
- L’évolution dans le temps : Âge de début, période d’accalmie, aggravation récente.
- Facteurs déclenchants : Soins dentaires, mastication, froid, prise d’alcool, stress…
- Existence de prodromes
- Signes accompagnateurs
- Traitement ou moyens utilisés et leur efficacité
Examen Clinique Proprement Dit
Examen Clinique Exobuccal
- Noter les déformations faciales, les lésions cutanées.
- Procéder à la palpation des lésions suspectes, de points électifs douloureux ou de zones gâchettes, palpation des adénopathies et de l’ATM.
Examen Endobuccal
- Noter l’ouverture buccale, l’état des muqueuses et procéder à un examen dentaire proprement dit.
Examens Complémentaires
- RVG, OPT, TDM et IRM : Surtout pour les investigations approfondies.
- Examens biologiques.
- Étude neurologique : Des XII paires crâniennes.
Étude Clinique
Nous distinguons :
- Algies faciales neurogènes
- Algies vasculaires
- Algies stomatologiques, ORL, ophtalmologiques
- Algies des ATM
- Douleurs orofaciales idiopathiques
Algies Neurogènes : Névralgies de la Face
Elles intéressent les branches sensitives : trijumeau (V) et le nerf glossopharyngien (IX). Elles sont soit symptomatiques, c’est-à-dire reliées à une pathologie, soit essentielles, sans étiologie retrouvée.
TOUTE NÉVRALGIE ATYPIQUE DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME SYMPTOMATIQUE JUSQU’À PREUVE DU CONTRAIRE.
Pathogénie
La pathogénie des névralgies essentielles peut être expliquée par plusieurs théories :
- La compression du nerf semble être l’hypothèse physiopathologique la plus admise actuellement.
- L’irritation du nerf à son origine ou sur son trajet a été aussi évoquée.
- D’autres auteurs avancent l’hypothèse de décharges semblables à l’épilepsie.
Névralgie Essentielle du Trijumeau (V) ou NFE
Le terme de névralgie est exclusivement réservé à la névralgie du trijumeau. Décrite par André en 1756, appelée « tic douloureux de Trousseau », son incidence est faible : 4,5 / 100 000. Elle survient chez les femmes après 50 ans (sex-ratio : 3/2) et reste exceptionnelle chez le jeune adulte. Des formes familiales ont été décrites (5 % des cas).
Caractéristiques de la Douleur
- Intéresse une des branches du trijumeau V, surtout V2.
- Presque toujours unilatérale.
- À chaque accès, la douleur atteint le même territoire, parfois plusieurs branches peuvent être touchées.
- La douleur est atroce, en éclairs fulgurants, en décharges électriques, en broiement, en coup de couteau, ou tel un arrachement.
- Pendant l’accès, le malade s’immobilise, se crispe, avec une décharge clonique au niveau de l’hémiface (réflexe moteur appelé « tic douloureux »).
- Les accès douloureux durent quelques secondes et sont groupés en salves pouvant atteindre 1 à 2 minutes.
- La fréquence est de 1 à 10 salves/jour.
- Chaque accès est suivi d’une période rétractaire sans douleur (accalmie totale).
- Les douleurs sont essentiellement diurnes.
- Les douleurs sont spontanées ou surviennent après stimulation ou attouchement d’une zone « gâchette » (trigger zone).
- L’excitation est variée : stimulation sensorielle (lumière, bruit), fonction habituelle (rire, mastication, élocution, rasage) imposant une attitude d’évitement et une attitude figée.
- L’examen clinique est normal, ne relevant aucun trouble dans le territoire du V.
Évolution
- Variable et discontinue.
- 1 patient sur 2 présente 2 accès/jour ; 28 % plus de 4.
- Cette fréquence tend à augmenter avec le temps.
- Les épisodes douloureux deviennent plus longs et plus sévères.
- Lorsque la sémiologie est typique, le diagnostic est aisé, cependant une IRM éliminerait éventuellement une cause inflammatoire ou un conflit vasculo-nerveux.
- La carbamazépine a une valeur de test diagnostique et thérapeutique.
Formes
- Formes bénignes : Les accès sont très espacés et brefs.
- Formes vieillies, chroniques : Avec fond douloureux.
- Formes bilatérales : 3 %, jamais simultanément.
- Formes avec orage vasomoteur : Larmoiement et rhinorrhée.
- Formes résistantes : À toute thérapeutique.
Névralgie Symptomatique du V
S’oppose à la névralgie essentielle par le fait qu’elle est secondaire à une pathologie précise et par sa sémiologie. Elle touche les sujets jeunes avec des douleurs après stimulation et persistance d’un fond douloureux entre les crises. Les accès sont à type de brûlures, de dysesthésies avec absence de zones gâchettes. On note également une localisation à plusieurs branches du V. L’examen neurologique révèle des troubles et la TDM et l’IRM signent la présence d’une étiologie centrale ou périphérique.
Névralgie Essentielle du Nerf Glossopharyngien
- Moins fréquente que celle du trijumeau (1 cas pour 70 à 100 cas de NFE).
- Touche l’adulte de plus de 60 ans.
- Unilatérale, mêmes caractéristiques que la NFE du V.
- Zone gâchette : Base de la langue ou l’amygdale irradiant vers l’oreille et l’angle mandibulaire.
- Douleur à l’arrière-gorge provoquée par la déglutition et souvent accompagnée de syncope : critère diagnostique.
- Peut s’accompagner de toux, d’hypersialorrhée et d’hypotension.
Névralgie Symptomatique du IX
Bien plus fréquente que la forme essentielle, ses étiologies sont diverses : infectieuses ORL, cancer ORL. Nous pouvons aussi citer le syndrome d’Eagle (processus styloïde long ou calcification du ligament stylohyoïdien).
Traitement
Formes Symptomatiques
- Traitement étiologique.
Formes Essentielles, surtout NFE
Traitement Médical
- En première intention : Prescription de carbamazépine (Tégrétol®), molécule la plus évaluée, efficace et généralement bien tolérée (effets secondaires : somnolence, troubles de l’équilibre). Posologie : 400 à 1200 mg/j.
- En seconde intention : Oxcarbazépine (Trileptal), baclofène (Liorésal), gabapentine (Neurontin) à dose-dépendante.
Traitement Chirurgical
- En percutané : Infiltration du nerf, alcoolisation du nerf ou thermocoagulation rétrogasserienne (entre le ganglion de Gasser et la racine trigéminale à température 60 et 70°C).
- Décompression vasculaire microchirurgicale : Stratégie chirurgicale classique consistant en une séparation de l’élément vasculaire du trijumeau :
- Par interposition d’une plaque en Téflon s’il s’agit d’une artère.
- Par coagulation et section s’il s’agit d’une veine.
- Ultime recours : Section du nerf (souvent échec).
Algies Faciales Vasculaires ou Cluster Headache
Elles intéressent la région péri- et rétro-orbitaire irradiant vers la tempe en « branche de lunettes », la joue, l’oreille, le maxillaire, l’hémicrâne. La douleur est unilatérale, de début brutal, intense, pénétrante, à type de broiement et reste identique pour un même patient. Sa sévérité fait que le patient arrête toute activité et s’accompagne généralement de signes végétatifs (95 % des cas) : larmoiement, congestion nasale avec saillie anormale de l’artère temporale avec hyperpulsation et sudation de l’hémifront.
- La douleur est épisodique : les crises surviennent en salves durant quelques semaines (3 à 15 semaines) séparées par un intervalle de 1 mois.
- La durée des crises varie de 15 à 180 minutes, atteignant l’acmé en 15 à 30 minutes.
- La fréquence est de 1 à 8 crises/jour avec une horaire fixe (nuit ou jour).
- L’algie est stéréotypée : pluriquotidienne, survenant à la même heure, de durée identique avec des épisodes de plusieurs semaines (accalmie également).
- L’alcool est un facteur déclenchant en période de crise, le tabac est un facteur associé fort.
- Le diagnostic est purement clinique et le diagnostic différentiel se fera généralement avec la migraine (présente des prodromes que l’algie vasculaire n’a pas). On note aussi que le patient est très agité, alors que dans la migraine, ce dernier a une tendance à l’isolement.
- Ce type d’algie peut conduire au suicide.
Parmi les Algies Faciales Vasculaires les Plus Fréquentes
- Dissection de l’artère carotide interne.
- Maladie de Horton ou céphalée gigantocellulaire : Artère temporale indurée, dilatée avec des nodosités sensibles. Pouls temporal peu ou pas perçu.
- Algie vasculaire de la face.
Algies Secondaires aux Affections Stomatologiques, ORL, Ophtalmologiques
Algies Faciales Stomatologiques
- Douleurs pulpaires : Hypersensibilité dentinaire, pulpite, parodontite apicale aiguë, fêlures dentaires, douleurs post-traitement endodontique.
- Douleurs muqueuses : Douleurs infectieuses (stomatite, gingivite, syndrome du septum, péricoronarite, infections mycosiques), douleurs traumatiques (ulcérations).
- Douleurs iatrogènes : Post-soins dentaires, alvéolites.
- Douleurs cancéreuses.
Algies Oculaires
- Conjonctivites et toutes pathologies oculaires.
Algies Otorhinolaryngologiques
- Sinusites aiguë et chronique maxillaires.
- Sinusite frontale.
- Sinusite sphénoïdale.
- Otalgie (otites : vertiges).
Algies dans le Cadre du DAM
Syndrome algo-dysfonctionnel de l’appareil manducateur : Défaut d’adaptation de l’appareil manducateur à un trouble de l’occlusion ou à une parafonction, majoré par un trouble psychique ou général (stress).
- Douleurs articulaires : Liées au déplacement discal qui se traduisent par un claquement au début, puis des craquements et douleurs.
- Douleurs musculaires : Liées aux spasmes des muscles.
Algies Oro-Faciales Idiopathiques
Ce sont des douleurs mal comprises, de mécanisme imparfaitement identifié et de traitement difficile. Le profil psychologique particulier du patient souffrant peut être identifié par sa demande pressante de soulagement et l’impossibilité du praticien d’y répondre, compliquant ainsi la situation et favorisant le « nomadisme médical ». En 2001, Woda et Pionchon individualisent un groupe de douleurs idiopathiques :
- Algie faciale atypique.
- Odontalgie atypique : Concerne une dent saine.
- Stomatodynie (glossodynie ou « Burning mouth syndrome ») :
- Syndrome rencontré chez les femmes en post-ménopause, vers les 60 ans, avec notion de cancérophobie.
- La douleur est linguale (la plus connue), localisée aux 2/3 antérieurs, brûlante, diurne, spontanée, aggravée par l’alimentation et sans aucune lésion visible.
- Elle peut s’accompagner de sécheresse buccale, de troubles gustatifs (il faut écarter les autres pathologies réelles : mucite post-radiothérapie, xérostomie).
Conclusion
Le diagnostic des algies de la face est souvent difficile. Il incombe au médecin-dentiste de réaliser une recherche étiologique minutieuse. Il ne faut pas hésiter à demander la collaboration d’autres spécialistes afin de pouvoir différencier entre la douleur-symptôme et la douleur-maladie.
Voici une sélection de livres:
- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011
- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996
- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE
- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient
- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé
- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1
- Endodontie, prothese et parodontologie
- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020
- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005


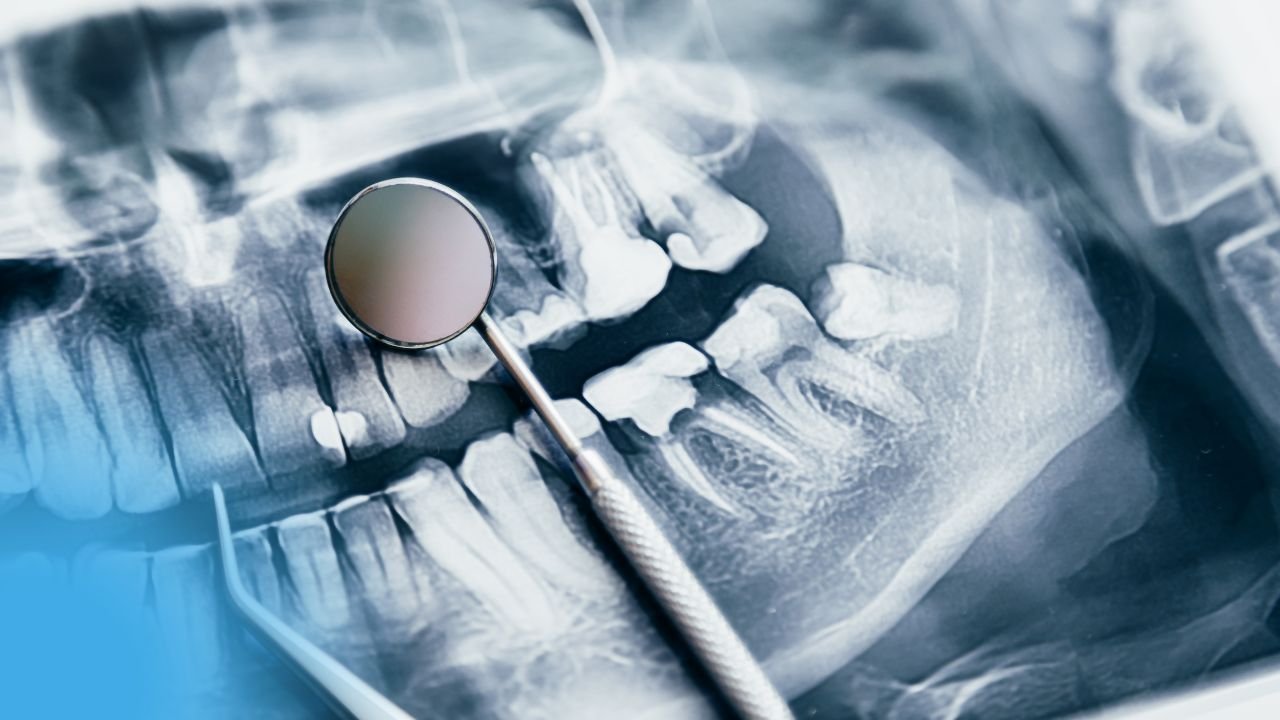

Leave a Reply