LE CEMENT (parodontologie)
LE CEMENT (parodontologie)
Introduction
Le cément est la couche de tissu minéralisé qui recouvre la surface radiculaire des dents et constitue l’interface entre la dentine radiculaire et le tissu conjonctif desmodontal et gingival.
Définition
C’est la couche de tissu minéralisé qui recouvre la surface radiculaire des dents. À ce niveau, les fibres ligamentaires sont insérées à la surface radiculaire de la dent, unissant celles-ci à la paroi osseuse de l’os alvéolaire et à la lamina propria de la muqueuse gingivale. Ainsi, il participe avec le desmodonte au maintien des dents dans leurs alvéoles.
La Cémentogenèse
Le cément prend naissance au feuillet interne de l’ectomésenchyme. Sa formation débute après la formation de la couronne et pendant la formation de la racine.
Après fragmentation de la gaine de Hertwig, les cellules mésenchymateuses indifférenciées s’insinuent à travers les cellules épithéliales et viennent au contact de la dentine. Sous son induction, elles se transforment en précémentoblastes, puis en cémentoblastes.
Les cémentoblastes élaborent le pré-cément ou matrice cémentoïde (substance fondamentale et fibres de collagène non organisées), qui subit une minéralisation par dépôts de cristaux d’hydroxyapatite parallèlement aux fibres de collagène (formation de cément primaire acellulaire).
La sécrétion de collagène devient de plus en plus importante, emprisonnant les cémentoblastes dans des lacunes creusées dans la matrice cémentaire (formation de cément secondaire cellulaire).
Les cellules épithéliales de la gaine de Hertwig migrent vers le ligament alvéolo-dentaire (LAD) sous forme de débris de Malassez.
Classification
L’aspect polymorphe du cément permet d’envisager plusieurs classifications :
Cément radiculaire et cément coronaire
En fonction de leur localisation.
Cément acellulaire et cément cellulaire
Caractérisés par la présence ou l’absence de cémentoblastes et de leurs prolongements.
Cément primaire et cément secondaire
Cément primaire
C’est la couche de cément initialement formée sur les deux tiers coronaires de la racine. Il est généralement acellulaire.
Cément secondaire
Il est constitué par les strates de cément après que la dent ait atteint son plan d’occlusion, sur les deux tiers apicaux de la racine. Il est généralement cellulaire, mais peut être acellulaire.
Cément fibrillaire et cément afibrillaire
Cément fibrillaire
La matrice est caractérisée par un fort pourcentage de fibres de collagène à striation périodique caractéristique. On distingue trois types :
- Cément à fibres extrinsèques
- Cément à fibres intrinsèques
- Cément à fibres mixtes
Cément afibrillaire
Il ne comporte pas de fibres de collagène.
Cément intermédiaire
C’est une zone étroite de cément mal défini, interposée entre la dentine radiculaire et le cément cellulaire, principalement observée au niveau apical des racines dentaires des molaires et des prémolaires. Elle est rarement observée au niveau des incisives et des dents temporaires.
Aspect Macroscopique du Cément
Propriétés physiques du cément
Couleur
Le cément est de couleur jaune clair, légèrement plus clair que la dentine, mais plus sombre et moins translucide que l’émail.
Dureté
Le cément est le troisième tissu minéralisé de la dent après l’émail et la dentine. Il est le moins dur et le moins résistant à l’abrasion.
Densité
Sa densité est faible par rapport à l’émail et la dentine, variant entre 0,1 et 0,5.
Absorption des rayons
Son absorption des rayons X est 2 à 6 fois plus faible que celle de la dentine.
Perméabilité
La perméabilité est une propriété étudiée grâce aux colorants vitaux et aux isotopes radioactifs. Le cément est un tissu perméable, mais cette perméabilité diminue avec l’âge.
Épaisseur du cément
L’aspect morphologique du cément varie en fonction de la région radiculaire, de l’âge, des stimulations fonctionnelles et de la migration des dents.
- Région moyenne de la racine : 16 à 60 µm
- Région apicale et bifurcation : 150 à 200 µm
- Épaisseur moyenne : 95 µm à 20 ans, 50 µm à 60 ans, triple à 70 ans
Rapports émail/cément
Trois cas de figure sont décrits :
- Sur 30 % des dents, le cément affronte directement l’émail.
- Sur 60 à 65 % des cas, le cément recouvre l’émail.
- Sur 5 à 10 % des cas, il n’y a pas de contact entre émail et cément.
Aspect Microscopique du Cément
Du point de vue histologique, on distingue le cément cellulaire et le cément acellulaire.
Caractéristiques générales du cément
Le cément radiculaire peut être acellulaire ou cellulaire. Il est caractérisé par :
Lamelles et lignes d’accroissement
Elles représentent l’aspect phasique et continu de la cémentogenèse au cours de la vie. L’espace entre deux lignes d’accroissement adjacentes dépend du rythme de la cémentogenèse.
Structures fibrillaires matricielles
Le cément radiculaire se caractérise par une matrice avec un fort pourcentage de fibres de collagène. On distingue :
- Fibres intrinsèques : Fines fibrilles de collagène synthétisées par les cémentoblastes.
- Fibres extrinsèques : Extrémités des fibres du ligament parodontal incluses dans le cément sous forme de fibres de Sharpey.
Cément acellulaire
C’est une mince couche de tissu minéralisé lamellaire recouvrant la dentine radiculaire, généralement sur le tiers ou la moitié cervicale de la racine. Son épaisseur augmente avec l’âge. On distingue deux types de fibres :
- Fibres intrinsèques : Synthétisées par les cémentoblastes, en nombre réduit, sans organisation précise.
- Fibres extrinsèques : Représentent 90 à 100 % de la masse du cément acellulaire. Ce sont des fibres de collagène en continuité avec les fibres ligamentaires (desmodontales), insérées à un angle plus ou moins droit à la racine dentaire, avec une striation périodique caractéristique.
Cément cellulaire
Il recouvre le cément acellulaire et le reste de la dentine. Il est riche en cellules, et son épaisseur augmente avec l’âge, pouvant atteindre 600 µm. Le cément acellulaire peut être interposé entre deux couches de cément cellulaire. Il contient des cellules, des prolongements cellulaires, des canaux accessoires et des fibres de collagène provenant du desmodonte.
Cémentoblastes
Ce sont des cellules cuboïdes contenant des organites intracellulaires développés, dont le rôle principal est la cémentogenèse.
Cémentocytes
Ce sont des cémentoblastes matures inclus dans des lacunes intracémentaires ou cémentoplastes. Ils contiennent des prolongements cellulaires orientés perpendiculairement à la surface desmodontale, situés dans des canalicules péri-cémentaires. Le nombre et le volume des organites diminuent vers la dentine radiculaire, jusqu’à ce que le cytoplasme devienne vacuolaire près de la jonction dentine-cément, indiquant une réduction de l’activité cellulaire.
Cellules épithéliales
Ce sont des amas cellulaires denses à noyau volumineux, avec des espaces intercellulaires étroits pourvus de jonctions intercellulaires. Leur origine provient des débris épithéliaux de la gaine de Hertwig incorporés au cours de la cémentogenèse.
Composition du Cément
Le cément est composé de :
- Matrice organique : 23 %
- Fraction minérale : 65 %
- Eau : 12 %
Fraction minérale
Elle est principalement formée de calcium et de phosphates sous forme de cristaux d’hydroxyapatite de petite taille, ainsi que de magnésium et d’une forte teneur en fluor. L’exposition du cément au milieu buccal entraîne des modifications de sa structure et de sa composition.
Matrice organique
La matrice organique extracellulaire est formée de collagène et d’une fraction non collagénique constituée de glycoprotéines, de mucopolysaccharides et de protéoglycanes.
Innervation et Vascularisation
Le cément n’est ni vascularisé ni innervé. Il se nourrit par diffusion desmodontale.
Physiologie du Cément
Fonction d’attache et de fixation
Les fibres de Sharpey, insérées à la fois dans le cément et dans l’os alvéolaire, assurent un système d’ancrage élaboré.
Fonction d’apposition
Le cément continue de se déposer après l’éruption dentaire, contribuant au maintien de la largeur physiologique de la racine au cours de l’éruption passive.
Fonction de réparation
Le cément participe à la réparation des lésions radiculaires. La fixation de nouvelles fibres n’est possible que par la formation d’une nouvelle couche cémentaire, assurant une cicatrisation desmodontale complète.
Fonction de protection
Le cément protège contre l’hypersensibilité dentinaire, qui survient lorsque la dentine n’est pas recouverte par le cément.
Fonction de perméabilité
La perméabilité est importante chez les jeunes et diminue avec l’âge. Le cément participe aux échanges entre la pulpe et le desmodonte, avec une sélectivité selon les substances et le sens de passage.
Fonction de résorption
Le cément est moins résorbable que l’os alvéolaire. La résorption est souvent suivie d’appositions et peut résulter d’une pression occlusale excessive.
Aspect Pathologique du Cément
Lésions du cément
Carie
Elle survient après mise à nu du cément, entraînant une déminéralisation diffuse des cristaux d’apatite par les acides du métabolisme bactérien.
Fracture
Une fracture cémentaire peut se produire sous l’effet d’une force extérieure violente (coup, morsure d’un objet dur). Les fractures sont réparées par des dépôts de fibres calcifiées et l’inclusion de nouvelles fibres parodontales.
Déchirure
C’est le détachement d’un fragment de cément de la surface radiculaire. Elle peut être complète, avec inclusion d’un fragment dans le ligament alvéolo-dentaire, ou incomplète, avec réattache partielle à la racine. Le fragment détaché peut se rattacher par la formation de néo-cément.
Résorption cémentaire pathologique
Elle peut être due à des causes locales, générales ou idiopathiques. Elle n’est pas forcément continue et peut alterner avec des périodes de réparation et de déposition cémentaire.
Ankylose
C’est la fusion du cément avec l’os alvéolaire, avec oblitération de l’espace desmodontal. C’est une forme anormale de réparation.
Cémentogenèse pathologique
Hypercémentose
L’hypercémentose, ou hyperplasie cémentaire, définit un épaississement pathologique de la couche de cément. Elle peut être circonscrite ou diffuse, localisée à une dent ou à un groupe de dents, et s’accompagne d’un élargissement nodulaire au niveau du tiers apical.
Cémentome
Ce sont des masses de cément situées apicalement aux dents, auxquelles elles peuvent adhérer. Ce sont des néoplasmes d’origine dentaire ou des malformations de développement. Elles sont plus fréquentes chez les femmes, à la mandibule, et peuvent être isolées ou multiples, déformant le contour de la mâchoire.
Cémenticules
Ce sont des masses globuleuses de cément organisées en lamelles concentriques fibrillaires. Elles peuvent être attachées à la surface radiculaire, libres dans le ligament alvéolo-dentaire ou fusionnées au tissu osseux alvéolaire. Elles proviennent de la minéralisation des restes épithéliaux de Malassez, de fibres de Sharpey ou de vaisseaux thrombosés du ligament alvéolo-dentaire. Leur fréquence augmente avec l’âge.
Énamélome
Aussi appelées perles d’émail, ce sont de petits dépôts d’émail observés sur la surface radiculaire, souvent au niveau inter-radiculaire. De forme sphérique ou ovalaire, ils peuvent être en continuité avec l’émail de la couronne ou séparés. Composés d’émail ou d’émail et de dentine avec chambre pulpaire, ils sont des anomalies embryologiques héréditaires ou congénitales, induites par une dysfonction des cellules de la gaine épithéliale de Hertwig.
Conclusion
Le cément, interface entre la dentine et le ligament parodontal, est un tissu compact relativement fin recouvrant les racines. Sa fonction principale est d’ancrer les dents aux maxillaires, lui conférant un rôle fondamental en physiopathologie parodontale.
LE CEMENT (parodontologie)
Voici une sélection de livres:
- Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché
- Concepts cliniques en odontologie conservatrice
- L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement
- Guide clinique d’odontologie
- Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve
- La photographie en odontologie: Des bases fondamentales à la clinique : objectifs, matériel et conseils pratique
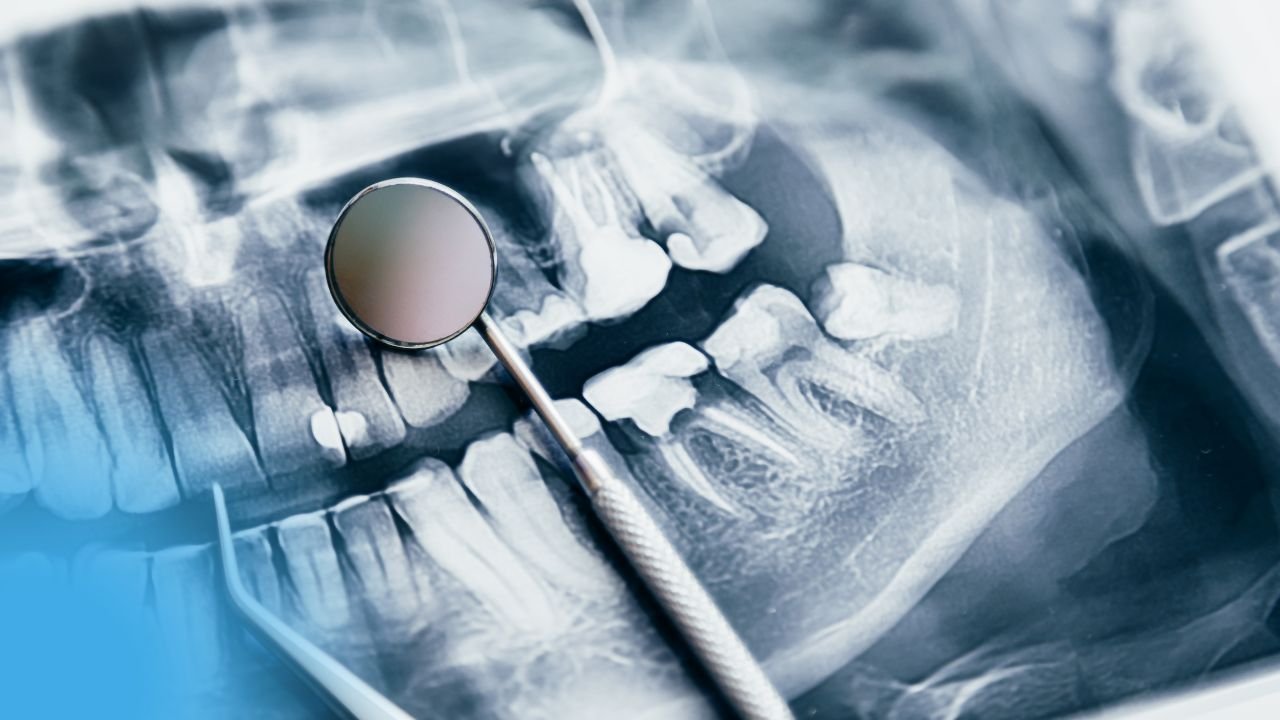



[…] desmodonte est destiné à maintenir la dent dans son alvéole. Il possède une activité métabolique intense […]
[…] riche en électrolytes et protéines, la salive pourrait remplacer les prises de sang pour certains diagnostics. Le protéome salivaire, avec 1166 protéines identifiées, est impliqué dans les voies de […]