L’asepsie en parodontologie
L’asepsie en parodontologie
Parmi toutes les spécialités, la médecine dentaire présente de nombreux risques, car elle implique fréquemment la prise en charge de patients atteints de pathologies à risque infectieux élevé, tout en travaillant dans un environnement riche en liquides physiologiques. Cela représente une source d’inquiétude justifiée en raison de la complexité et de la diversité des instruments dentaires, qui peuvent facilement causer des blessures et exposer les professionnels à du sang contaminé
C’est pourquoi l’asepsie et l’hygiène au cabinet dentaire revêtent une grande importance. Pour mieux comprendre ce sujet, nous pouvons nous poser les questions suivantes :
Asepsie : l’asepsie est un ensemble de techniques et de pratiques médicales visant à prévenir l’introduction de micro-organismes pathogène dans une zone stérile ou dans le corps humain dans le but d’éviter la contamination.Antisepsie : opération au résultat momentané permettant d’inhiber ou de tuer les microorganismes et/ou d’inactiver des virus sur des tissus vivants, à l’aide d’antiseptiques.
Désinfection : opération au résultat momentané permettant d’éliminer ou d’inhiber les microorganismes ou d’inactiver des virus sur des surfaces inertes contaminées, à l’aide de désinfectants.
Antiseptique et les désinfectants : sont des produits chimiques utilisés pour tuer ou inhiber la croissance des micro-organismes. Ils différent principalement en fonction de leur utilisation et de leur concentration.
- Les antiseptiques : sont conçus pour être utilisés sur la peau les muqueuses ou le tissu vivant. ils sont destinés à désinfecter la peau intacte, les plaies, coupures .donc ils sont formulés pour être moins concentrés que les désinfectants.
- Les désinfectants : sont utilisés pour désinfecter des surfaces inanimés, telles que les comptoirs les sols l’instrument donc ils sont généralement plus concentrés que les antiseptiques car ils ne sont pas destinés à être appliqués sur la peau ou les tissus vivants.
Stérilisation : opération permettant d’éliminer ou détruire tous les micro-organismes présents sur des s surfaces inertes avec maintien de l’état stérile grâce au conditionnement, autrement dit l’objectif de la stérilisation est de rendre un environnement ou un objet exempt de toute forme de vie microbienne, garantissant ainsi l’absence de contamination.
Risque infectieux : ce terme fait référence à la probabilité ou à la possibilité de la contracter une infection. Ce risque est généralement lié à des facteurs tels que l’exposition à des agents pathogènes (bactérie, virus, champignons), le non- respect des mesures d’hygiène.
Contagieux : ce terme est utilisé pour décrire la capacité d’une maladie ou d’une infection à se propager d’une personne à une autre. Donc une maladie est dite contagieuse si elle peut être transmise par le contact direct ou indirect avec une personne infectée.
Ancient Practices (Pratiques anciennes – Millénaires avant J.-C.) :
Le concept d’asepsie peut être aperçu dans les pratiques des civilisations anciennes, y compris les Égyptiens et les Grecs.
Les Égyptiens utilisaient le miel, une substance antimicrobienne naturelle, pour traiter les plaies.
Les Grecs reconnaissaient les qualités conservatrices de substances comme le vin, qu’ils utilisaient pour désinfecter les plaies.
- The Limited Understanding (Compréhension limitée – À travers l’Antiquité) :
Ces premières pratiques étaient basées sur des observations empiriques plutôt que sur une compréhension approfondie de la microbiologie.
Ignaz Semmelweis and Spontaneous Generation (Ignaz Semmelweis et la génération spontanée – 1818-1865) :
Au XIXe siècle, Ignaz Semmelweis, un médecin hongrois, a apporté une contribution significative au domaine de l’asepsie.
Dans les années 1840, Semmelweis travaillait dans une maternité où il a observé une incidence plus élevée d’infections puerpérales parmi les patientes assistées par des médecins par rapport à celles assistées par des sages-femmes.
Il a formulé l’hypothèse que les médecins, après avoir pratiqué des autopsies, transportaient des particules contenant des agents pathogènes d’une salle d’autopsie à une salle d’accouchement, ce qui provoquait les infections puerpérales.
Semmelweis a imposé des pratiques d’hygiène des mains rigoureuses, y compris le lavage des mains à l’eau de Javel, entre les autopsies et les accouchements.
Cette intervention a entraîné une réduction significative des taux d’infections puerpérales.
- The Opposition (L’opposition – XIXe siècle) :
Le travail de Semmelweis a été confronté à de la résistance et du scepticisme, car à l’époque, le concept de germes invisibles causant des infections n’était pas largement accepté.
Louis Pasteur and the Germ Theory (Louis Pasteur et la théorie des germes – 1822-1895) :
Au milieu du XIXe siècle, le travail révolutionnaire de Louis Pasteur, un microbiologiste français, a marqué l’histoire.
Dans les années 1860, Pasteur a réalisé des expériences avec des flacons à col de cygne, confirmant le rôle des micro-organismes dans les infections.
Ses expériences ont démontré que les micro-organismes présents dans l’air pouvaient être empêchés de contaminer les liquides stériles lors de l’utilisation de tels flacons.
Le travail de Pasteur a fourni des preuves cruciales contre le concept de génération spontanée et a confirmé la théorie des germes.
- La génération spontanée : également connue sous le nom d’abiogenèse, était une hypothèse scientifique largement acceptée dans l’Antiquité et le Moyen Âge.
Elle postulait que des formes de vie complexes pouvaient naître spontanément à partir de matière non vivante, telle que la boue, la viande en décomposition, ou des liquides organiques, sans avoir besoin d’une source préexistante de vie.
Joseph Lister and Antisepsies (Joseph Lister et l’antisepsie – 1827-1912) :
Le chirurgien britannique Joseph Lister a apporté une contribution significative à l’asepsie en chirurgie.
À la fin du XIXe siècle, Lister a introduit l’utilisation de l’acide carbonique (phénol) comme antiseptique pour stériliser les instruments chirurgicaux et l’environnement chirurgical.
Ses pratiques d’antisepsie étaient basées sur la connaissance croissante des germes et de leur rôle dans les infections, en particulier grâce aux travaux de Louis Pasteur.
Lister a systématiquement mesuré l’impact de ses nouvelles pratiques, observant une réduction significative des infections postopératoires.
Il a publié ses résultats, contribuant ainsi à changer la pratique médicale et à sauver de nombreuses vies.
Ses efforts ont marqué le début de la chirurgie aseptique moderne et lui ont valu le titre de “père de la chirurgie moderne.”
Modern Asepsie and Healthcare (Asepsie moderne et soins de santé – XXe siècle à aujourd’hui) :
- Aujourd’hui, les techniques aseptiques sont fondamentales dans les établissements de soins de santé.
- L’hygiène des mains, les pratiques stériles et la stérilisation de l’équipement médical sont essentielles pour prévenir les infections et garantir la sécurité des patients.
Les Sources de contamination
1/les mains du praticien et de son personnel sont le transport principal de toutes types de micro-organismes. Les doigts et les ongles sont en contact permanent avec la flore microbienne buccal.
2/la salive ce liquide biologique transparent peut être une source de contamination dans la cavité buccale par plusieurs façons .elle contient des bactéries (on estime qu’il Ya en moyenne 100 millions de bactéries par millilitre de salive dans la cavité buccale), virus ou champignons .et il favorise la transmission de certains maladies telle que la grippe, l’hépatite B, mononucléose
3/ le sang si une personne a une blessure dans la bouche telle qu’une ulcération ou une plaie ouverte et qu’elle entre en contact avec le sang contaminé, par exemple lors d’une manipulation d’un instrument dentaire existe un risque de transmission de pathologies infectieuses comme le VIH; syphilis et l’hépatite B et C.
4/secrétions nasales et respiratoires lorsque la personne tousse des gouttelettes contenant des particules de sécrétions nasales peuvent être expulsées dans l’aire.
5/tenue vestimentaire
Vêtements compris blouse blanche de travail
La blouse blanche symbolise aux yeux des patients la compétence de leur médecin dentiste .Mais ce vêtement peut aussi transporter de micro – organismes causes de maladies nosocomiales qui représentent un véritable problème de santé publique. Pour éviter la transmission de ces maladies certains vêtements de professionnelle de santé comme la traditionnelle blouse blanche pourraient être remisés au placard.
Voies de transmission
- Du patient au personnel
- DE personnel au patient
- De patient à patient
.c’est la transmission patient –personnel qui est la plus fréquente.
Personnel vers le patient
- Pas de transmission du HIV documentée depuis 1992
- Dernier case report concernant une transmission du HBV du personnel au patient en 1987
- pas de case report pour HCV
- être blesse ou présenter une affection qui permet une exposition au sang ou autre liquides biologiques
- Permettre au sang/liquide biologique d’atteindre une plaie du patient, des tissus traumatisés, une muqueuse.
Du patient vers le personnel
Si celle-ci ne se protège pas notamment contre le risque d’exposition au sang ; aux liquides biologiques et a une contamination par voie aérienne
- variable selon la prévalence dans la population
- variable selon la nature et la fréquence des contacts avec du sang /liquide biologique du patient à travers des portes d’entrées percutanées ou Trans muqueuses du personnel.
De patient à patient
Directement « salle d’attendre »ET surtout de façon indirecte par des instruments, par une faute d’asepsie (exemple mains du personnel souillées au contact du matériel ou de l’environnement. (
MODE DE TRANSMISSION
A/la transmission manu portée
Se produire lorsque les micro-organismes présents sur les mains les doigts et les gants d’un professionnel de la santé dentaire sont transférés à une surfaces ou un instrument puis a une autre personne. Le contact de la peau de dentiste avec les surfaces environnantes instruments souillés, les objets de secrétariat (stylo, ORDONNANCES, TELEPHONE…(
B/Aéroportée :
Les gouttelettes expulsées dans l’aire sont pleines des virus ; ou des bactéries c’est pour ça il faut un renouvellement d’air naturel par l’ouverture biquotidienne des portes et des fenêtres afin de diminuer le degré de contamination de l’air.
c/Sanguine ou salivaires
Comme Hépatite B et C ; Infection VIH
| Mode de transmission | Circonstances | Contamination infectieuse |
| Voie sanguine(Blood Stream) | -contact avec des microlésions de la peau.-piqure accidentelle par instrument souillés de sang | -Infection VIH-hépatite B et C |
| Voie respiratoire (respiratory route) | -inhalation d’aérosol infecté.-contact avec un patient infecté | -Tuberculose-grippe, méningite Diphtérie |
| Voie oculaire(oculaire route) | -projection de débris infectés sur l’œil exposé pendant une préparation de cavité ou un curtage….. | -infection cornéenne,kèrato-conjonctivites virales |
| Voie manu portée(hand-borne transmission) | Contact avec la salive infectée des patients | Infection digestive et cutanée |
Les agents contaminants et infectieux
Les germes susceptibles d’être transmis par les patients peuvent être séparés en trois groupes :
• Dans le premier, sont réunies les flores commensales orales et rhinopharyngées des patients sains, qui ne constituent aucune menace pour le personnel soignant.
• Le second groupe comporte des germes pathogènes, mais fréquents, comme les bactéries pyogènes (Staphylocoques aureus, Streptocoques pyogènes), les virus respiratoires, les virus des maladies de l’enfance, ainsi que les Candida Albicans.
• Le troisième groupe, est constitué de germes pathogènes portés par des patients malades et qui représentent un risque professionnel majeur pour le personnel soignant. Il s’agit de la tuberculose, de la grippe, des infections à herpès virus, des hépatites A, B et C et du SIDA.
Germes à risque mineur
Les bactéries
- Les staphylocoques
Le Staphylococcus aureus est l’une des souches les plus courantes de staphylocoques et est bien connu pour causer diverses infections notamment
1. Infections cutanées : Le Staphylococcus aureus est responsable de nombreuses infections cutanées, telles que les furoncles, les impétigos et les infections des plaies.
2. Infections des voies respiratoires : Il peut provoquer des infections des voies respiratoires, notamment des pneumonies.
3. Infections des voies urinaires : Les staphylocoques peuvent également causer des infections des voies urinaires.
4. Bactériémie : Lorsque les staphylocoques entrent dans la circulation sanguine, cela peut entraîner une bactériémie, une infection sanguine potentiellement grave.
5. Infections osseuses et articulaires : Les staphylocoques peuvent également infecter les os et les articulations, provoquant des ostéomyélites et des arthrites septiques.
6. Infections cardiaques : Le Staphylococcus aureus peut causer des infections cardiaques, telles que l’endocardite.
- Les streptocoques
Le Streptococcus pyogènes, également connu sous le nom de streptocoque du groupe A, est une bactérie à Gram positif qui peut provoquer diverses infections chez les êtres humains. Il est responsable d’un large
Éventail de maladies, allant des infections bénignes aux infections graves comme
1. Infections courantes : Streptococcus pyogènes est à l’origine d’infections fréquentes, notamment la pharyngite (angine streptococcique) qui se manifeste par des maux de gorge, de la fièvre et des maux de tête. Il peut également causer des infections cutanées, telles que des impétigos.
2. Maladies plus graves : Dans des cas plus graves, Streptococcus pyogènes peut provoquer des complications, notamment la fièvre rhumatismale aiguë, une inflammation des articulations et du cœur, ainsi que le syndrome de choc toxique streptococcique, une infection potentiellement mortelle.
Les virus respiratoires
Notent le rhinovirus le virus de la grippe le coronavirus et le virus de la rougeole qui infectent les voies respiratoires, y compris les voies nasales, la gorge, la trachée, les bronches et les poumons. Ces virus sont responsables d’un large éventail d’infections respiratoires, allant des infections bénignes du rhume aux infections plus graves, telles que la grippe et les infections des voies respiratoires.
Virus de maladie de l’enfance
1. Rougeole : La rougeole est provoquée par le virus de la rougeole (rubeola). Elle se caractérise par une éruption cutanée, de la fièvre, de la toux et des symptômes oculaires.
2. Oreillons : Les oreillons sont causés par le virus des oreillons (virus des parotides). Les symptômes incluent un gonflement des glandes parotides, de la fièvre et des douleurs.
3. Rubéole : La rubéole est due au virus de la rubéole. Elle provoque de légers symptômes de grippe et une éruption cutanée, mais elle peut être grave si elle est contractée pendant la grossesse.
4. Varicelle : La varicelle est provoquée par le virus varicelle-zona. Elle se manifeste par une éruption cutanée avec des démangeaisons, de la fièvre et des maux de tête.
5. Cinquième maladie (érythème infectieux) : Cette maladie est causée par le parvovirus B19 et se caractérise par une éruption cutanée en “coup de vent” sur le visage, des bras et des jambes.
Les champignons
Surtout le candidat Albicans. Les infections à Candida Albicans sont généralement regroupées sous le terme de candidoses. Elles peuvent affecter différentes parties du corps, notamment :
1. Candidose buccale : Elle se manifeste sous forme d’une infection de la bouche, souvent appelée “muguet” chez les nourrissons.
2. Candidose cutanée : Elle peut se produire sur la peau, en particulier dans les plis cutanés, provoquant une éruption cutanée rouge et irritante.
Germe à risque majeur
Le BK Les bacilles de Koch
Également connus sous le nom de Mycobacterium tuberculosis, sont des bactéries responsables de la tuberculose, une maladie infectieuse grave qui affecte principalement les poumons, mais qui peut également toucher d’autres organes du corps. Lorsqu’une personne est infectée par les bacilles de Koch, elle peut développer une infection tuberculeuse latente ou une tuberculose active. L’infection latente signifie que les bactéries sont présentes dans le corps, mais la personne ne présente aucun symptôme. Dans le cas de la tuberculose active, les symptômes tels que la toux persistante, la fièvre, la perte de poids et la fatigue se manifestent.
Le virus de la grippe
Également connu sous le nom de virus de l’influenza, est un virus respiratoire qui cause la grippe, une maladie infectieuse courante qui affecte les voies respiratoires et qui peut entraîner une variété de symptômes, allant de légers à graves. Il existe plusieurs types et sous-types de virus de la grippe, les plus courants étant les types A, B et C.
•Influenza A : C’est le type de virus de la grippe le plus courant. Il est associé à des épidémies et à des pandémies occasionnelles. Les souches d’influenza A sont classées en sous-types basés sur les protéines de surface, notamment l’hémagglutinine (H) et la neuraminidase (N). Par exemple, le H1N1 et le H3N2 sont des souches d’influenza A.
•Influenza B : Ce type de virus est responsable de la grippe saisonnière, mais il ne provoque généralement pas de pandémies. Il n’est pas classé en sous-types.
•Influenza C : Les infections à influenza C sont généralement plus bénignes que celles à influenza A ou B.
Le virus de l’herpès
1. Herpès simplex de type 1 (HSV-1) : HSV-1 est généralement associé aux lésions buccales, telles que les boutons de fièvre ou l’herpès labial. Il peut provoquer des lésions douloureuses autour de la bouche et des lèvres. Cependant, HSV-1 peut également provoquer des infections génitales, en particulier lors de pratiques sexuelles uro-génitales.
2. Herpès simplex de type 2 (HSV-2) : HSV-2 est plus fréquemment associé aux infections génitales, provoquant des lésions génitales douloureuses. Il peut également causer des infections oro-labiales, bien que cela soit moins courant.
Une caractéristique importante des virus de l’herpès est qu’ils peuvent entrer en phase d’infection latente après la première infection. Cela signifie que le virus se cache dans les cellules nerveuses et peut réapparaître périodiquement, provoquant des poussées d’herpès.
Le virus de l’hépatite
Les hépatites virales peuvent être provoquées par le virus de l’hépatite A (HAV), de l’hépatite B (HBV), de l’hépatite C (HCV). Tous ces virus peuvent donner les mêmes symptômes cliniques, mais les hépatites dues aux HAV ont une évolution favorable. Ce virus étant transmissible par voie oro fécale, il ne fait pas partie des risques professionnels.
1. Virus de l’hépatite B (VHB) : Transmis par le sang, les rapports sexuels non protégés, ou de la mère à l’enfant lors de l’accouchement. Les symptômes varient de légers à graves et peuvent inclure de la fièvre, des douleurs articulaires, des nausées et une jaunisse. L’hépatite B peut devenir chronique et causer des problèmes hépatiques à long terme.
2. Virus de l’hépatite C (VHC) : Principalement transmis par le sang contaminé, notamment par le partage de seringues ou d’aiguilles. La plupart des infections à VHC deviennent chroniques et peuvent
Provoquer des lésions hépatiques graves. Les symptômes aigus sont souvent légers.
Le VIH virus de l’immunodéficience humaine
Est un virus qui attaque le système immunitaire de l’organisme. Le VIH peut entraîner une infection à VIH, qui, si elle n’est pas traitée, peut progresser vers le sida (syndrome d’immunodéficience acquise).il se transmet principalement par le contact avec certains fluides corporels infectés, notamment le sang ou par contact avec les muqueuses (si pas de lunettes de protection et goutte de sang part dans l’œil contamination).
L’asepsie au bloc opératoire a pour but d’éviter la contamination de malade pendant son passage dans ce secteur, et en particulier pendant le temps de l’intervention chirurgicale
● Préparation de la salle opératoire :
- Quel que soit la salle d’opération, elle doit être tenue dans un état de propreté parfait (utilisée technique de balayage humide)
- -Le sol et les murs doivent être revêtus avec un matériau supportant le lavage et la désinfection, le sol doit être antidérapant et légèrement en pente pour l’évacuation des eaux.
- constructeur selon une architecture spécifique (ventilation et éclairage)
- -Le mobilier et les équipements réduits au strict minimum sont, si possibles, sur pieds pour faciliter l’hygiène des sols ou, mieux, sur roulettes pour en faciliter le déplacement.
- -Les réservoirs potentiels de micro-organismes (plantes vertes) sont à proscrire
Asepsie progressive : Démarche progressive de maîtrise des éléments de l’environnement par l’établissement d’une série de barrières successives afin de limiter le risque de contamination de la plaie opératoire.
Douane 1: le risque infectieux est minime, il s’agit essentiellement des halls d’entrée, couloirs de circulation, escaliers. Le traitement requis est un nettoyage de type «domestique» quotidien.
Douane 2 : dans cette zone sont regroupés la salle d’attente, le bureau, le cabinet de consultation ou de soins, et la salle de stérilisation
Douane 3: il s’agit de la salle d’intervention chirurgicale (implantologie, greffe osseuse), et des toilettes. Le traitement requis pour les zones 2 et 3 est le « bio nettoyage » quotidien, ou plus si nécessaire. Avec alternance de produits détergents et de produits détergents-désinfectants.
Bionettoyage : méthode destinée à réduire la contamination des surfaces et des sols, il concerne essentiellement les zones 2 et 3. Il comporte:
•Evacuation des déchets.
•Dépoussiérage humide.
•Nettoyage et désinfection.
•Hygiène personnel ( praticiens et les assistantes ) :
A-une formation initiale et continue doit être suivie pour concevoir, pratiquer, contrôler et assurer la chaîne d’asepsie.
B- Protection immunitaire :
B-1Vaccination:contre l’hépatite B, la diphtérie, tétanos, tuberculose, Poliomyélite.
B-2 Prévention des accidents d’exposition au sang (AES) et aux liquides biologiques
C● Protection physique :
Propreté corporelle
- Cheveux propres noués (recouvert par un bonnet Charlotte calot)
- Des ongles courts nets propres sans vernis (hygiène des mains et porte des gants à usage unique)
- Pas bijoux ni montre (mains. Avant-bras. Cou. Oreilles)
- Maquillage discret
- Des chaussures spécifiques (professionnels)
La tenue de travail. (Blouse professionnel)
- Port du masque : Être bien ajusté autour des joues et adapté à la forme du nez. Couvrir le menton. Une fois en place il faut éviter de le toucher.
- Une friction hydroalcoolique avant et après chaque changement de masque
- Les lunettes ou masque à visière : Les lunettes devront présenter une protection latérale, et donc bien couvrir les yeux pour éviter toute aérosolisation ou projection de débris et Gouttelettes.
- D Protection chimique (Lavage des mains) :
Les mains constituent le vecteur majeur: elles collectent et transmettent les bactéries, virus et levures.
- Elles doivent être très régulièrement lavées et/ou désinfectées selon des procédures strictes qui ont montré leur efficacité.
- Il existe 2 types de flores:
La flore commensale (résidente) : Elle est constituée de micro – organismes implantés naturellement sur la peau. Elle constitue une barrière à l’implantation durable d’autres espèces.
La flore transitoire : Elle est constituée par toutes les espèces microbiennes apportées par les contacts récents avec des objets, des surfaces ou des personnes.
- Le but du lavage des mains est de:
✓Eliminer la flore transitoire
✓ Diminuer la flore commensale
- Il existe 3 types de lavage des mains :
| Moyen | Durée | But | Indication | |
| Lavage simple | Savon liquide | Minimum 30 s | Diminution flore transitoire | Tout acte à bas niveau de risque infectieux (contact cutané) |
| Lavage antiseptique | Savon antiseptique | Minimum 60 s | Élimination de la flore transitoireDiminution de la flore commensale | Tout acte à niveau de risque intermédiaire (contact muqueux) |
| lavage chirurgical | Savon antiseptique (Bétadine ( | 5 à 6 min | Élimination de la flore transitoireDiminution de la flore commensale | -Solution moussante antiseptique à large spectre- Tout acte à haut niveau de risque infectieux |
| En cas d’absence d’eau et d’urgence | ||||
| Friction des mains avec un produit hydro- alcoolique : | Produit hydro alcoolique | Friction jusqu’à séchage complet des mains | Réduit provisoirement le nombre de micro-organismes. | Complément d’un lavage simple ou en substitut d’un lavage antiseptique |
Technique de lavage des mains
Le traitement par friction avec un produit hydroalcoolique ne peut être effectué que sur :
Lavage des mains se déroule sur des mains libre de bijoux et sans vernis avec des ongles courts , d’abord remplir la paume d’une main avec une dose de produit hydro-alcoolique suffisant puis fractionner paume contre paume par un mouvement de rotation, le dos de la main gauche avec un mouvement d’avant en arrière exerce par la paume de la main droite et vice versa , les espaces interdigitaux paume contre paume et doigts entrelacés en exerçant un mouvement d’avant en arrière, le dos des doigts dans la paume de la main opposée avec un mouvement d’aller-retour latérale, le pouce de la main gauche par rotation dans la main droit et vice versa , la pulpe des doigts de la main droite dans la paume de la main gauche et vice versa , une fois sèches vos main sont prêtes
La durée : minimum 20 s.
Le protocole d’asepsie pour la prise en charge d’un patient à risque infectieux élevé en dentisterie est essentiel pour minimiser le risque de transmission d’infections au personnel dentaire et à d’autres patients. Voici un exemple de protocole d’asepsie à suivre :
- Évaluation préliminaire :
- Identifiez la nature spécifique du risque infectieux du patient, qu’il s’agisse d’une maladie infectieuse active, d’une immunodéficience, d’une maladie transmissible, etc.
- Consultez le dossier médical du patient pour obtenir des informations pertinentes.
- Planification :
- Planifiez le traitement de manière à minimiser le temps passé en contact étroit avec le patient.
- Identifiez une salle de traitement dédiée, si possible, pour isoler le patient.
- Équipement de protection individuelle (EPI) :
- Le personnel dentaire doit porter des gants, des masques, des lunettes de protection et des blouses.
- Utilisez un EPI de niveau approprié en fonction du risque infectieux.
- Isolement du patient :
- Isoler le patient dans une salle de traitement dédiée si disponible.
- Utilisez des barrières physiques pour limiter le contact du patient avec d’autres patients dans la salle d’attente.
- Techniques de prévention des infections :
- Stérilisez et désinfectez rigoureusement tout l’équipement dentaire et les surfaces de la salle de traitement.
- Utilisez des films plastiques de protection sur les surfaces difficiles à nettoyer.
- Nettoyez les équipements entre chaque patient, en suivant les protocoles de désinfection appropriés.
- Lavage des mains :
- Le personnel dentaire doit se laver soigneusement les mains avant et après chaque interaction avec le patient.
- Utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool si le lavage des mains n’est pas possible.
- Préparation de l’équipe de soins :
- Tout le personnel dentaire doit être formé pour prendre en charge des patients à risque infectieux élevé.
- Le personnel doit être informé des procédures spécifiques à suivre.
- Procédures de traitement :
- Minimisez les procédures non essentielles.
- Utilisez une aspiration de haute qualité pour réduire les particules en suspension dans l’air.
- Employez des procédures dentaires à faible production de gouttelettes et d’aérosols, si possible.
- Communication :
- Communiquez clairement avec le patient sur les mesures de précaution prises pour assurer sa sécurité et celle du personnel dentaire.
- Suivi :
- Assurez un suivi adéquat du patient pour détecter tout signe d’infection ou de transmission potentielle.
Example
Les directives de prévention des infections et les protocoles d’asepsie lors de la prise en charge de patients atteints du VIH (virus de l’immunodéficience humaine) sont essentiels pour minimiser le risque de transmission du VIH au personnel de santé et pour assurer des soins dentaires sûrs et efficaces. Voici quelques mesures importantes à prendre en compte lors de la prise en charge de ces patients :
- Évaluation préliminaire :
- Identifiez le statut VIH du patient et sa charge virale si possible.
- Discutez des antécédents médicaux du patient et de son état de santé général.
- Planification du traitement :
- Planifiez les procédures dentaires de manière à minimiser le temps de contact étroit avec le patient.
- Identifiez une salle de traitement dédiée si possible, pour isoler le patient.
- Équipement de protection individuelle (EPI) :
- Le personnel dentaire doit porter des gants, des masques, des lunettes de protection et des blouses.
- Utilisez une EPI de niveau approprié en fonction du risque infectieux.
- Isolement du patient :
- Isoler le patient dans une salle de traitement dédiée si disponible.
- Utilisez des barrières physiques pour limiter le contact du patient avec d’autres patients dans la salle d’attente.
- Techniques de prévention des infections :
- Stérilisez et désinfectez rigoureusement tout l’équipement dentaire et les surfaces de la salle de traitement.
- Utilisez des films plastiques de protection sur les surfaces difficiles à nettoyer.
- Nettoyez les équipements entre chaque patient, en suivant les protocoles de désinfection appropriés.
- Lavage des mains :
- Le personnel dentaire doit se laver soigneusement les mains avant et après chaque interaction avec le patient.
- Utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool si le lavage des mains n’est pas possible.
- Préparation de l’équipe de soins :
- Tout le personnel dentaire doit être formé pour prendre en charge des patients atteints du VIH.
- Le personnel doit être informé des procédures spécifiques à suivre et des précautions à prendre.
- Procédures de traitement :
- Minimisez les procédures non essentielles.
- Utilisez une aspiration de haute qualité pour réduire la production de gouttelettes et d’aérosols.
- Employez des procédures dentaires à faible production de gouttelettes et d’aérosols lorsque possible.
- Communication :
- Communiquez clairement avec le patient sur les mesures de précaution prises pour garantir la sécurité et la confidentialité de ses informations.
- Suivi :
- Assurez un suivi adéquat du patient pour détecter tout signe d’infection ou de complications liées au VIH.
Example
Les directives de prévention des infections et les protocoles d’asepsie pour la prise en charge des patients dans le contexte de la pandémie de COVID-19 peuvent varier en fonction des recommandations des autorités sanitaires locales et des établissements de santé. Cependant, voici quelques lignes directrices générales qui ont été largement recommandées pour minimiser le risque de transmission du COVID-19 en dentisterie :
1. Évaluation préalable :
• Avant la prise en charge du patient, effectuez une évaluation des symptômes du COVID-19, comme la fièvre, la toux, la perte de goût ou d’odorat, et posez des questions sur les contacts récents avec des cas confirmés de COVID-19.
2. Équipement de protection individuelle (EPI) :
• Le personnel dentaire doit porter une EPI adéquate, y compris des masques N95 ou équivalents, des gants, des lunettes de protection, des blouses et des visières faciales.
3. Mesures d’hygiène des mains :
• Le lavage des mains fréquent avec de l’eau et du savon, ainsi que l’utilisation de désinfectants pour les mains à base d’alcool, sont essentiels.
4. Distanciation sociale :
• Réduisez le nombre de personnes dans la salle d’attente en espaçant les rendez-vous.
• Lorsque cela est possible, maintenez une distance physique d’au moins 1 mètre entre les personnes.
5. Précautions aéroportées :
• Utilisez des dispositifs d’aspiration à haute efficacité pour réduire la production de gouttelettes et d’aérosols pendant les procédures dentaires.
6. Désinfection et stérilisation :
• Désinfectez et stérilisez tous les équipements, surfaces et instruments conformément aux protocoles spécifiques au COVID-19.
7. Protection du personnel dentaire :
• Assurez-vous que le personnel dentaire est correctement formé pour utiliser l’EPI, et fournissez-leur un endroit sûr pour se changer et se débarrasser de l’EPI usagé.
8. Communication :
• Communiquez clairement avec le patient sur les mesures de précaution prises pour assurer leur sécurité et celle du personnel dentaire.
• Affichez des informations sur l’hygiène des mains et la distanciation sociale dans les zones publiques.
9. Ventilation :
• Améliorez la ventilation dans les salles de traitement en augmentant la circulation de l’air extérieur.
10. Évaluation continue :
• Restez informé des mises à jour et des recommandations des autorités sanitaires locales et ajustez vos pratiques en conséquence.
Stérilisation des instruments :
Le traitement des dispositifs médicaux se fait selon une chaine de stérilisation qui répond à une série de normes actuellement en médecine (chaîne asepsie)
Règles générales à respecter pour la stérilisation du matériel:
- On ne stérilise bien que ce qui est propre, sec et fonctionnel
- Tout matériel arrivant dans les locaux sales doit être considéré comme septique contaminé
- Tout matériel doit être considéré comme fragile, délicat et coûteux
- L’ordre, la rigueur, la minutie et l’attention sont indispensables
- Le matériel doit être démonté avant traitement et ne jamais être forcé
- Les moyens techniques de stérilisation doivent être maîtrisés.
Pourquoi parler d’hygiène au cabinet dentaire ?
Pourquoi le risque d’attraper une maladie est plus important dans un cabinet dentaire
Beaucoup de personnes passent dans le cabinet dentaire, un lieu petit et cloisonné;
Certains de nos actes, voir la plupart, font saigner, et nos instruments entrent en contact avec le sang et la salive du patient.
Un accès de toux ou un éternuement peut facilement disperser de la salive contaminée ou d’aérosols d’agents pathogènes.
> Le contact avec le sang et la salive du patient implique :
a. Si le patient est porteur d’une maladie ; le personnel du cabinet pourra être contaminé
b. Par contre, si nos instruments ne sont pas propres ; on peut transmettre une maladie au patient
> Le risque de contamination existe donc dans les 2 sens :
Patient => praticien, praticien => patient, en plus de la « contamination croisée » de patient à patient
> Notre but est d’éviter par tous les moyens possibles la transmission de maladies au sein du cabinet dentaire.
Principales maladies infectieuses pouvant être contractées au cabinet dentaire :
Affections rhinopharyngées
Affections cutanées
Maladies virales (rougeole, rubéole, oreillons,…)
Maladies transmissibles
Tuberculose
Grippe
Hépatite
Pneumopathies
SIDA,
Sources de contamination:
✔ Instruments et équipements (boutons de commande, surfaces, têtière,..)
✔Vêtements
✔ Crachoir et aspirateur ; éléments les plus souillés du cabinet dentaire
✔ L’air-spray des turbines et des contre-sangles, aérosol septique
✔ Films radiographiques
LE CABINET DENTAIRE:
Pour minimiser le risque de transmission, l’organisation architecturale du cabinet dentaire doit permettre d’adapter une méthode systématique de contrôle de I ‘hygiène et de l’asepsie.
II faut y établir une circulation «à sens unique, non seulement pour le patient mais aussi pour les dispositifs médicaux :
Patient : doit suivre un circuit simple et précis depuis son entrée dans le cabinet jusqu’à sa sortie.
Instruments : Les instruments stériles sont stockés à proximité de l’unit dentaire. Après utilisation, le circuit des instruments souillés doit être court, qui une fois décontaminés sont apportés dans la salle de stérilisation.
Le patient ne doit pas croiser le cheminement de I ‘instrumentation, la salle de stérilisation ne lui étant pas accessible.
Cette double circulation n’est pas toujours idéalement possible sans croisement mais le cheminement strict de l’instrumentation doit être privilégié.
L’unit dentaire : Critères de choix pour assurer une hygiène optimale:
- Siège et dossier lisses et dépourvus de coutures, sellerie démontable facilement
- Surfaces de l’unit lisses, sans rebord anguleux
- Cordons lisses pour les instruments dynamiques
- Crachoir lisse et système d’aspiration démontable pour un nettoyage désinfectant aisé
- Tablette de soin simple à nettoyer, démontable si possible
- Commandes à pédale, permettant l’activation du fauteuil, de l’instrumentation dynamique et des programmations.
Protection de l’équipe dentaire :
- Hygiène vestimentaire
- Lavage des mains
- Barrières protectrices (gant, masque, lunette)
- Linges professionnels
- Vaccination
LA CHAINE DE STERILISATION:
1. Pré désinfection : (décontamination)
a. Définition :
« C’est le premier traitement à effectuer sur le matériel et les objets souillés dans le but de diminuer la population de micro-organismes et de faciliter le nettoyage ultérieur »
N.B: la solution de pré désinfection doit donc avoir
- une fonction de nettoyage
- une fonction antimicrobienne
b. 0bjectifs :
- Protéger le personnel de toute contamination
- Améliorer les étapes de stérilisation, en réduisant la contamination initiale
- Faciliter le nettoyage des dispositifs médicaux
c. Procédure :
- Préparation du bain
- Immersion totale des instruments
- Après le temps de trempage : lavage.
2. Nettoyage :
a. Définition :
« Consiste à éliminer des surfaces ou des objets, sans les endommager, les salissures et les souillures dans le but de présenter un état de propreté contrôlable à l’œil nu
Le nettoyage mécanique suit donc le nettoyage chimique par détergent-désinfectant. II permet d’éliminer un plus grand nombre de micro-organismes
b. Conditions pour un bon nettoyage :
- Action chimique des produits solubilisant les souillures
- Action mécanique qui consiste à frotter pour décoller les salissures
- Action de la chaleur favorisant le nettoyage
- Temps de nettoyage.
c. Moyens de nettoyage :
- Nettoyage manuel :
Instruments trempés dans un bain tiède contenant un détergent ou désinfectant- détergent.
Nettoyer à l’aide d’une brosse souple. Ensuite les instruments sont rincés durant 05 minutes puis parfaitement asséchés.
Inconvénients : risque de contamination :
- Du personnel : piqures et coupures
- Pour l’environnement : nébulisation au brossage.
- Nettoyage par ultrasons :
Très adapté aux instruments aux structures complexes (instruments endodontiques, fraises, instruments striés)
-Instruments totalement immergés dans un bain où les ultrasons sont maintenus de 4-15 minutes
– Rincer durant 05 minutes puis parfaitement assécher.
- Nettoyage automatique:
Par machine à laver:
- Phase de rinçage « mouillage » correspondant à un pré-nettoyage
- Phase de lavage à chaud: produit détergent +température élevée
- Phase de rinçage
3. La désinfection :
a. Définition :
« C’est une opération au résultat momentané, permettant d’éliminer ou de tuer les micro-organismes et/ou d’inactiver les virus indésirables portés sur des milieux inertes contaminés en fonction des objectifs recherchés »
Les Milieux inertes : sols, surfaces, instruments, air, eau, etc. …]
b. Procédés :
La désinfection ne s’applique qu’aux objets thermosensibles, tout instrument qui supporte la chaleur est stérilisé.
- . Désinfection chimique à froid:
La désinfection se fera sur du matériel propre. L’instrumentation aura dons été pré désinfectée, rincée, nettoyé et rincée.
Le produit le plus utilisé est le Glutaraldéhyde qui possède un spectre d’activité très large couvrant les bactéries, les moisissures, les virus, les formes sporulées.
Mode opératoire :
> Immerger l’objet propre durant 30min (se conformer aux recommandations du fabricant)
> Rincer dans l’eau correspondant au niveau de désinfection recherché.
- Désinfection à chaud :
Désinfection par thermo-désinfecteur
Désinfection par désinfecteur à vapeur d’eau.
c. Instruments rotatifs :
Pièces à main, contre-sangles, et turbines doivent être pré désinfectés, nettoyés, lubrifiés et stérilisés après chaque traitement.
- Pré désinfection et nettoyage manuel:
- Nettoyer la face externe à l’aide d’une lingette imbibée d’une solution décontaminant
- Instruments rotatifs en place, évacuer l’eau des canalisations durant 30 secondes
- Retirer la fraise, déconnecter l’instrument rotatif
- Envoyer un spray nettoyant, lubrifiant
- Replacer la fraise, replacer I ‘instrument rotatif sur les cordons
- Faire fonctionner 30 secondes pour évacuer l’excès de lubrifiants
- Retirer la fraise, déconnecter I ‘instrument rotatif
- Essuyer la face externe de l’excès de lubrifiants
- Essuyer la fibre optique avec un coton imbibé d’alcool.
- Pré désinfection et nettoyage des instruments rotatifs par automate:
- Terminator, Assistina, Tuboclid,
- Life time, Dac2000, hygiène center
4. Conditionnement:
Les conditionnements réutilisables comprennent des conteneurs en aluminium ou en acier inoxydable qui sont étanches et munis de filtres ou de soupapes.
Les conditionnements à usage unique sont constitués de sachets et gaines de stérilisation en papier ou en papier et plastique et dans les qualités requises sont définies dans les normes NF NE 868.
Pour qu’un objet stérilisé dans un autoclave conserve son état stérile il doit être emballé préalablement à la stérilisation.
> Le conditionnement doit:
- Permettre l’action de l’agent stérilisant, sans être dégradé
- Assurer le maintien de la stérilité du contenu
- Préserver les propriétés des dispositifs médicaux
- Permettre le prélèvement et l’utilisation des objets stérilisés dans des conditions aseptiques
> Modes de conditionnement:
- Conditionnements rigides
- Conditionnements pliés
- Emballages thermo scellés
5. Stérilisation :
La stérilisation correspond à l’élimination de tous micro-organismes, le résultat de cette opération aboutit à l’état de stérilité
Il existe divers modes de stérilisation au cabinet dentaire on peut citer: la chaleur humide, la chaleur sèche, la vapeur chimique…
Stérilisation à la chaleur sèche (POUPINEL)
Elle nécessite une température élevée et un cycle long: 3h à 170°C ou 1h30 à 180°C
Les instruments rotatifs ne peuvent pas y être stérilisés de même que les tissus,
Compresses, caoutchouc et certains plastiques.
Stérilisation à la chaleur humide (autoclave)
La stérilisation à la vapeur d’eau est le procédé de référence en l’état actuel de nos connaissances.
L’association de chaleur et d’eau (sous forme saturée) réalise une dénaturation protéique.
L’agent stérilisant est la vapeur d’eau, saturée à une température de plus de 100°C donc sous pression avec système de pré vide, cette vapeur doit être exempte d’impuretés afin de ne pas causer des dégâts aux instruments et à l’autoclave.
Un cycle de stérilisation comprend l’évacuation de l’air, la montée en température, le plateau thermique (présence exclusive de vapeur d’eau saturée) la descente de température et le retour à la pression atmosphérique.
Le plateau thermique correspond à la phase de stérilisation, les paramètres choisis pour tout le cycle sont ceux du plateau thermique.
La stérilisation nécessite une température de 134°C maintenue pendant 18 minutes.
Stérilisation à la vapeur chimique (chemiclave)
Elle utilise un mélange de vapeur chimique insaturé de formaldéhyde, d’acétone et d’alcools
Elle permet de stériliser turbine, contre angle et pièce à main préalablement mis dans des emballages étanches pour éviter l’oxydation.
Cependant les vapeurs de formol sont irritantes pour les yeux.
6_Stockage
Une fois les dispositifs médicaux et chirurgicaux stérilisés ils seront stocké dans un endroit propre fermé à l’abri de l’humidité.
Stérilisation des instruments ne supportant pas la chaleur
- Les instruments ne supportant pas la chaleur seront désinfectés à froid par un moyen chimique (Glutaraldéhyde 2%)
- L’instrument est trompé pendant 30 min pour obtenir une action virucide et 120 min pour une action sporicide. (Les étapes du protocole de stérilisation restent les mêmes)
Contrôle du stérilisateur :
Ce sont des contrôles réguliers qui permettent d’assurer le fonctionnement correct de l’appareil :
- Test biologique par l’emploi d’indicateur de stérilisation chaque semaine.
- Test d’étanchéité au vide chaque semaine.
- Test de Bowie-Dick (test de pénétration de la vapeur) tous les jours.
Ces contrôles doivent obéirent aux normes NF NE 554 (validation et contrôle de routine pour la stérilisation à la vapeur d’eau).
7_L’étiquetage des dispositifs médicaux conditionnés :
Pour assurer la traçabilité du processus de stérilisation, les instruments dentaires conditionnés sont étiquetés. L’étiquette indique toutes les informations permettant de retracer les différentes étapes et les personnes impliquées dans le cycle de stérilisation.
Avec la solution stéroïde proposée par CQO, vous pouvez réaliser un marquage rapide à l’issue du cycle : 30 étiquettes créées en 30 secondes. La création des étiquettes avec un Datamatrix simplifie le report des informations dans le dossier du patient. Ce procédé permet également de reporter des informations complètes et de réduire le risque d’erreur.
Plus récemment, ces procédures d’hygiène et d’asepsie des dispositifs médicaux ont été complétées par des mesures visant à limiter la propagation des virus par voie aérienne et la contamination par contact direct et/ou par l’intermédiaire de surface non traitées.
Après avoir pris connaissance des risques infectieux et des solutions pour le diminuer, chaque professionnel de santé, en particulier les médecins dentistes est obligé d’appliquer ces méthodes d’asepsie et de les suivre mot à mot afin de protéger nos vies et celles de nos patients.
1-UNAIBODE. Hygiène au bloc opératoire. De la pratique à l’évaluation. Masson éditeur, Paris, 2006, 91 p.
2-Hôte T.: Le concept de l’asepsie progressive et son impact sur le comportement Dans le bloc opératoire. Inter Bloc 1994; 13:24-7.
3- World Health Organization. Hand hygiene technical reference manual. 2010. Available from: December 1, 2013
http://www.who.int/gpsc/5may/tools/trainingeducation/en/index.htmla
4-drouhet G. Pré-désinfection : une étape incontournable dans la chaine de stérilisation, Clinique 2004 ; hors-série : pp 5-14.
5-drouhet G ; Missaka P. Maitrise de la chaine de stérilisation. Journal de Parodontologie et d’implantologie oral ; 24 (2) :pp.91-105.
6-D. Thiveaud, A-M. Grimoud, Marty, C.Roques, J-P. Lodter, G.Chabanon : Hygiène : structures, matériels, méthodes ; 23-815-A-10 ; EMC 2005.
7- JEAN BARBEAU. DANIEL GRENIER:/contrôle des infections médecine dentaire Edition 2009.
8-Ferrec G. Stérilisation du matériels di chirurgie au cabinet. AOS 2007 ; 237 ; pp.61-81.
9-Ministre de la santé et des solidarités .guide de prévention des infections liées aux soins en chirurgie dentaire et en stomatologie. Deuxième Edition, juillet 2006.
10-Mikassa P, DROUHET G. Hygiène, Asepsie Ergonomie – un défi permanent .collection JPOI, Edition CPD, 2001.
11- SILVIN A-M ; DROUET G. Le nécessaire pour un nettoyage optimal au cabinet dentaire. Clinc 2004 hors-série
pp.47-51.
L’asepsie en parodontologie
Voici une sélection de livres:
Parodontologie Relié – 1 novembre 2005
Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011
Parodontologie Broché – 19 septembre 1996
MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE
Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient
Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé
Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1
Endodontie, prothese et parodontologie
La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020
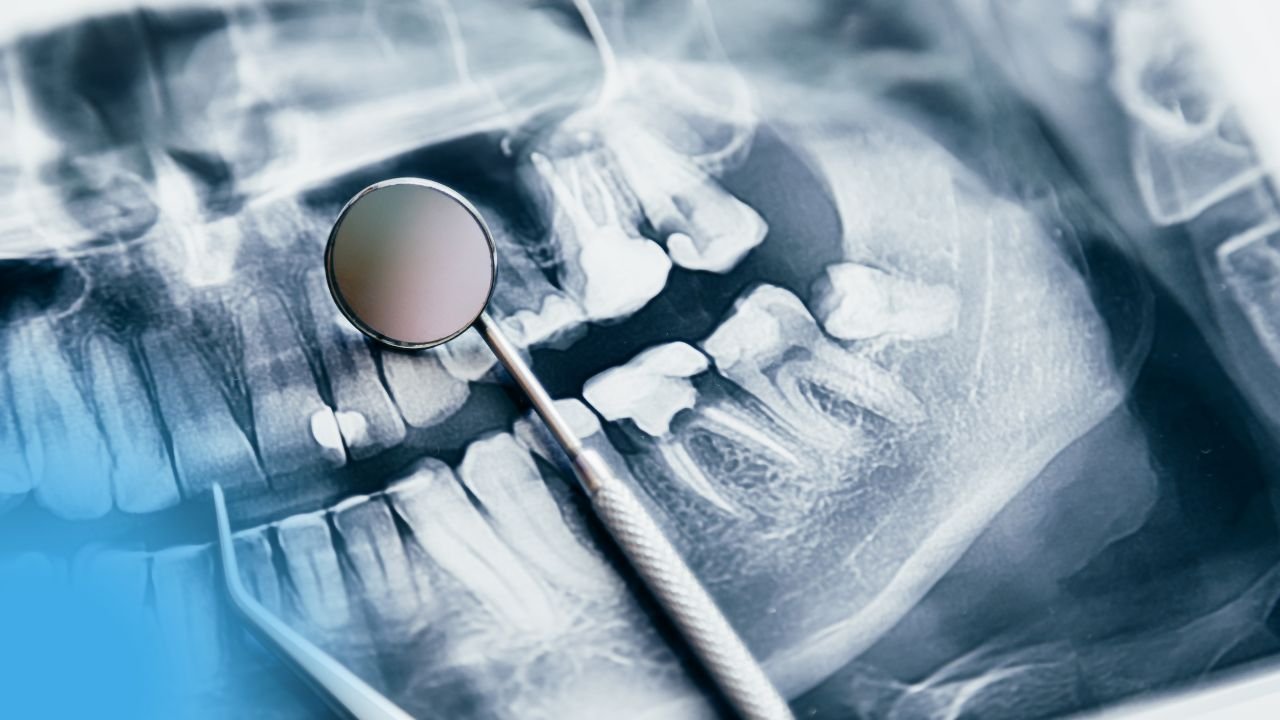



Leave a Reply