La stabilisation des prothèses par les empreintes tertiaires (Prothèse Dentaire)
La stabilisation des prothèses par les empreintes tertiaires (Prothèse Dentaire)
1. Introduction
Les contours extérieurs de la prothèse doivent représenter une suite de surfaces inclinées de telle sorte que l’activité musculaire assure la stabilité de la prothèse. (Wilfried Fish) Le principe fondamental dans la construction d’une prothèse amovible complète est que chaque surface de la prothèse doit être modelée pour s’adapter à chaque portion des tissus du patient. (Wilfried Fish)
2. Rappel
Muscles en rapport avec la prothèse:
Côté vestibulaire : se compose de :
- Masséter
- Buccinateur
- Orbiculaire des lèvres
- Houppe du menton
- Modiolus : c’est un véritable noeud musculaire où convergent tous les muscles de la face. Il est constitué de six muscles : le buccinateur, l’orbiculaire des lèvres, le risorius, le grand zygomatique, le releveur de la lèvre supérieure, l’abaisseur de la lèvre inférieure.
Côté lingual : se compose de trois muscles :
- Ptérygoïdien médial
- Mylohyoïdien
- Langue
3. Définitions
a/ Couloir prothétique :
C’est l’espace prothétique disponible (ni une zone neutre ni un espace passif). C’est l’espace édenté où la résultante des forces horizontales développées par la langue et la sangle buccinato-labiale ne doit pas dépasser la rétention globale des prothèses (Klein, 1988).
b/ La fausse gencive :
D’après E. Batarec, la fausse gencive est la partie vestibulaire de la base prothétique qui correspond en denture naturelle à la muqueuse et à la gencive kératinisée, elle comprend la gencive marginale, papillaire et adhérente ou fixée.
c/ Les Surfaces polies stabilisatrices :
Ce sont des zones ménagées au niveau de l’extrados prothétique, ayant pour rôle de permettre à la musculature paraprothétique de participer à l’équilibre des prothèses, mais aussi de faciliter l’évacuation du bol alimentaire. Elles sont composées d’une succession de concavité et convexité qui laissent libre cours au jeu musculaire. Cela permet d’éviter la désinsertion de la prothèse mais surtout d’assurer une meilleure rétention.
4. Rôles des extrados prothétiques
4.1 Rôle esthétique :
Le soutien des organes paraprothétiques est rétabli par la forme et le volume des extrados.
4.2 Rôles mécaniques :
a/ Rétention musculaire
- Rétention passive : Au repos, les corps musculaires (joues, lèvres, langue) en s’appliquant sur les extrados prothétiques, plaquent les prothèses sur les tissus de soutien ostéo-muqueux (lorsque les extrados présentent des plans inclinés divergeant vers la surface d’appui).
- Rétention active : Elle est sous la dépendance de la contraction musculaire (muscles stabilisateurs) et de l’action des extérocepteurs.
b/ Stabilisation :
La stabilité prothétique est influencée par les contractions musculaires et les pressions qui en découlent. La prothèse doit se situer au point d’équilibre entre les pressions vestibulaires labiales et jugales d’un côté et linguales de l’autre, pour assurer une meilleure stabilité et donc une meilleure intégration prothétique.
4.3 Rôle fonctionnel
- La phonation :
Les troubles phonétiques sont dus aux mauvaises relations entre la pointe de la langue et la face linguale des dents antéro-supérieures. Le recouvrement des reliefs palatins antérieurs supprime des repères tactiles importants d’où le rôle des surfaces polies stabilisatrices qui doivent fournir un appui adéquat à la langue lors de la prononciation de certains phonèmes (les palato-linguales par exemple). - La mastication :
Les surfaces polies stabilisatrices facilitent l’évacuation et la déflexion du bol alimentaire. - La déglutition :
Si les surfaces polies stabilisatrices n’ont pas un contour adéquat, elles peuvent entraîner une gêne à la déglutition pouvant même s’accompagner de douleurs ou de blessures.
5. Comment exploiter les surfaces polies?
5.1 Sculpture des surfaces polies stabilisatrices
La surface polie stabilisatrice est sculptée de façon à permettre le positionnement dynamique des muscles participant à la stabilisation, rétention de la prothèse et défection du bol alimentaire.
Selon Rignon-Bret, l’architecture prothétique vestibulaire comprend :
- Une concavité antérieure pour le muscle orbiculaire des lèvres.
- Une légère convexité au niveau de la région canine limitant la bosse canine.
- Une concavité dans la région des prémolaires autorisant la dynamique du carrefour musculaire du modiolus.
- Une convexité dans la région molaire, en regard des zones para-tubérositaires et des poches de Fish.
- Une légère concavité au niveau de la zone postérieure de la maquette mandibulaire, pour permettre le libre jeu du masséter.
Au niveau lingual, les prothèses mandibulaires ayant des plans divergeant vers la surface d’appui doivent présenter, au niveau de la région sublinguale, une double concavité dans le sens antéro-postérieur et mésio-distal qu’on nomme berceau lingual pour permettre à la langue de stabiliser la prothèse, sans pour autant avoir des contre-dépouilles pouvant causer le soulèvement de la prothèse par la langue.
En palatin :
Il est nécessaire de respecter une certaine épaisseur afin de laisser l’espace libre pour la langue et de reproduire le plus fidèlement possible l’anatomie des papilles palatines. Il existe 3 façons de reproduire les papilles palatines : soit directement par sculpture, soit à l’aide de cires préformées calibrées, soit en brunissant une feuille d’étain sur le modèle en plâtre et la reporter sur la cire.
| FOMPIGNOLI M. [20] <br> RIGNON-BRET C. [23] | HUE O. [8] | |||
|---|---|---|---|---|
| Maxillaire | Mandibule | JUNG T. [11] | ||
| Zone incisive | Concavité | Forme et volume contribuant au rétablissement de l’esthétique | Concavité | |
| Bosse canine | Convexité | Convexité (entre canine et 1ère prémolaire) | nature | |
| Zone prémolaire | Concavité | Concavité (entre la face distale de la 1ère prémolaire et la face mésiale de la 2ème prémolaire) | Seule une forme convexe améliore la rétention et l’entretien prophylactique de la prothèse | |
| Poches de Fish et d’Elsenring | Convexité | La prothèse est épaisse dans sa partie supérieure, mais mince dans sa partie médiane | Convexité (de la 2ème prémolaire jusqu’à la partie centrale de la 2ème molaire) | |
| Partie postérieure des poches de Fish et en regard des fibres antérieures du masséter | Légère concavité | Concavité distale (pour le buccinateur et le masséter) | ||
| Partie sublinguale | Double concavité horizontale et sagittale | Concavité entre la région et sublinguale : concavité plus marquée | ||
| Au niveau postérieur | Pas de contre-dépouille | Concavité | ||
| Partie postérieure des volets linguaux | Suit le profil des surfaces d’appui |
Les règles de modelage de l’extrados prothétiques selon les auteurs.
5.2. Les empreintes de l’extrados prothétique :
Les surfaces polies favorables à la stabilisation des prothèses sont obtenues habituellement par une sculpture de la cire. Cependant en cas de besoin, on peut avoir recours aux techniques d’empreintes spécifiques appelées empreintes tertiaires.
5.2.1 L’Empreinte Tertiaire
Selon Le joyeux :
On appelle empreinte tertiaire ou complémentaire l’empreinte de tous les éléments anatomiques et physiologiques en relation avec l’extrados, et avec l’arcade dentaire, d’une prothèse complète.
- Elle peut indifféremment utiliser des porte-empreinte individuels, en complément d’une empreinte secondaire, des duplicatas de prothèses ou la prothèse elle-même.
- L’empreinte tertiaire ou empreinte des organes para-prothétiques peut être construite selon quatre techniques différentes :
- Au stade de l’empreinte secondaire de la surface d’appui immédiatement après la réalisation de cette dernière.
- Au stade de l’enregistrement de la relation intermaxillaire centrée.
- Au stade consacré à l’essai fonctionnel.
- Au stade post-prothétique (sur prothèse).
Principes fondamentaux
Pour que l’espace biofonctionnel utile devant être occupé par la prothèse soit d’une façon optimale, il faut respecter certains impératifs :
- La dimension verticale d’occlusion doit être parfaitement rétablie. Pour cela, l’empreinte doit être prise avec des prothèses en occlusion correcte et se limiter aux surfaces de l’extrados en contact avec les organes paraprothétiques.
- Un rempart d’épaisseur réduite au minimum doit être constitué afin de créer un support indispensable au matériau à empreintes. Il peut s’agir soit de l’arcade dentaire, soit d’un bourrelet d’occlusion.
- Le matériau idéal pour ce type d’empreinte qui possède un temps de plasticité suffisant (Hydrocast, Coe-Comfort).
- L’empreinte ne doit être prise qu’après une mise en condition pré ou post prothétique destinée à augmenter au maximum le volume de l’espace utile réservé à la future prothèse.
Objectifs
- Permet d’améliorer la stabilité d’une prothèse existante ou de compléter une empreinte secondaire.
- Augmenter les surfaces prothétiques en contact avec les tissus, et donc de favoriser l’adhésion.
- Favoriser l’intégration organique et psychique du corps étranger constitué par la prothèse.
- Eviter les stases alimentaires dans les cavités jugales ou linguales.
- Améliorer l’esthétique, la phonation et les fonctions de mastication et de déglutition.
Indication
- Son indication peut être posée après quelques jours d’utilisation de la prothèse, mais également dès l’examen préprothétique et en fonction des difficultés anatomiques rencontrées. (Sangiuolo)
- Tous les cas pour augmenter la stabilité de la prothèse surtout inférieure.
- Difficultés anatomiques rencontrées.
Matériaux utilisés
- Les cires plastiques à température buccale du type Korecta wax, Adheseal.
- Les résines à prise retardée (Hydrocast, Coe comfort…).
- Une pâte Eugénol-oxyde de zinc.
- Un élastomère de synthèse.
Technique
- W. Fish dès 1933, met l’accent sur l’importance du modelé des surfaces polies stabilisatrices pour la stabilité des prothèses et proposa des profils stabilisants semi-empiriques.
- Heath préfère stimuler de façon symétrique la proprioception linguale et l’extéroception jugale et labiale en appliquant le produit simultanément sur les faces vestibulaires et linguales de l’extrados.
- Le patient est ensuite invité à parler, à déglutir et à effectuer les différents mouvements fonctionnels pour éliminer les excès du matériau et libérer le jeu des différents muscles concernés.
- Il est impératif que la prise finale se déroule alors que la cavité buccale est au repos, pour appréhender la position d’équilibre musculaire.
- L’extrados de la région palatine de la prothèse est en relation avec la langue (véritable gouvernail du chant et de la parole).
- Il sert de point d’appui à la pointe de celle-ci ou à sa face dorsale au cours de la phonation et de la déglutition. Le schéma classique de Turner met en évidence les points d’articulation des consonnes.
L’empreinte tertiaire selon J. Lejoyeux
- L’empreinte tertiaire ou empreinte des organes para-prothétiques peut être entreprise et construite selon deux techniques différentes.
- Au stade de l’empreinte secondaire de la surface d’appui immédiatement après la réalisation de cette dernière.
- Après l’enregistrement de la relation intermaxillaire centrée et son transfert sur l’articulateur.
Technique
- L’empreinte secondaire anatomo-fonctionnelle est obtenue avec un porte-empreinte individuel dont le bourrelet est le plus étroit possible dans le sens vestibulo-lingual.
- Empreinte prise sous pression occlusale.
- Le dernier temps, esthétique et phonétique de l’empreinte analytique anatomofonctionnelle de correction des bords est remplacé par la séquence de l’empreinte tertiaire des organes para-prothétiques.
- Les versants vestibulaires et linguaux de l’empreinte secondaire sont revêtus d’un matériau à empreinte restant plastique à la température buccale.
- Le matériau préparé en respectant les indications du fabricant, est étendu sur les faces externes du bourrelet et sur la totalité de l’extrados du porte-empreinte.
- Celui-ci est réintroduit en bouche. Le patient se retrouve en occlusion. Il renouvelle méthodiquement les différents tests dynamiques et phonétiques suivants :
- Projection des lèvres en bouche fermée,
- Rétraction des commissures,
- Déglutition,
- Ouverture moyenne, puis de plus en plus grande de la bouche,
- Mastication d’un petit morceau de caoutchouc,
- Mobilisation de la langue dans toutes les directions,
- Lecture rapide à haute voix, bien articulée, d’un texte correctement rédigé.
- Au terme de ces épreuves fonctionnelles, la totalité du matériau doit avoir été en contact avec les organes para-prothétiques et refléter leur physiologie particulière propre au patient.
La stabilisation des prothèses par les empreintes tertiaires (Prothèse Dentaire)
Voici une sélection de livres en français sur les prothèses dentaires:
Prothèse fixée, 2e Ed.: Approche clinique Relié – Illustré, 4 janvier 2024
Prothèse Amovible Partielle : Clinique et Laboratoire
Collège National des Enseignants en Prothèses Odontologiques (CNEPO), Michel Ruquet, Bruno Tavernier
Traitements Prothétiques et Implantaires de l’Édenté Total 2.0
Conception et Réalisation des Châssis en Prothèse Amovible Partielle
Prothèses supra-implantaires: Données et conceptions actuelles
Prothèse complète: Clinique et laboratoire Broché – Illustré, 12 octobre 2017
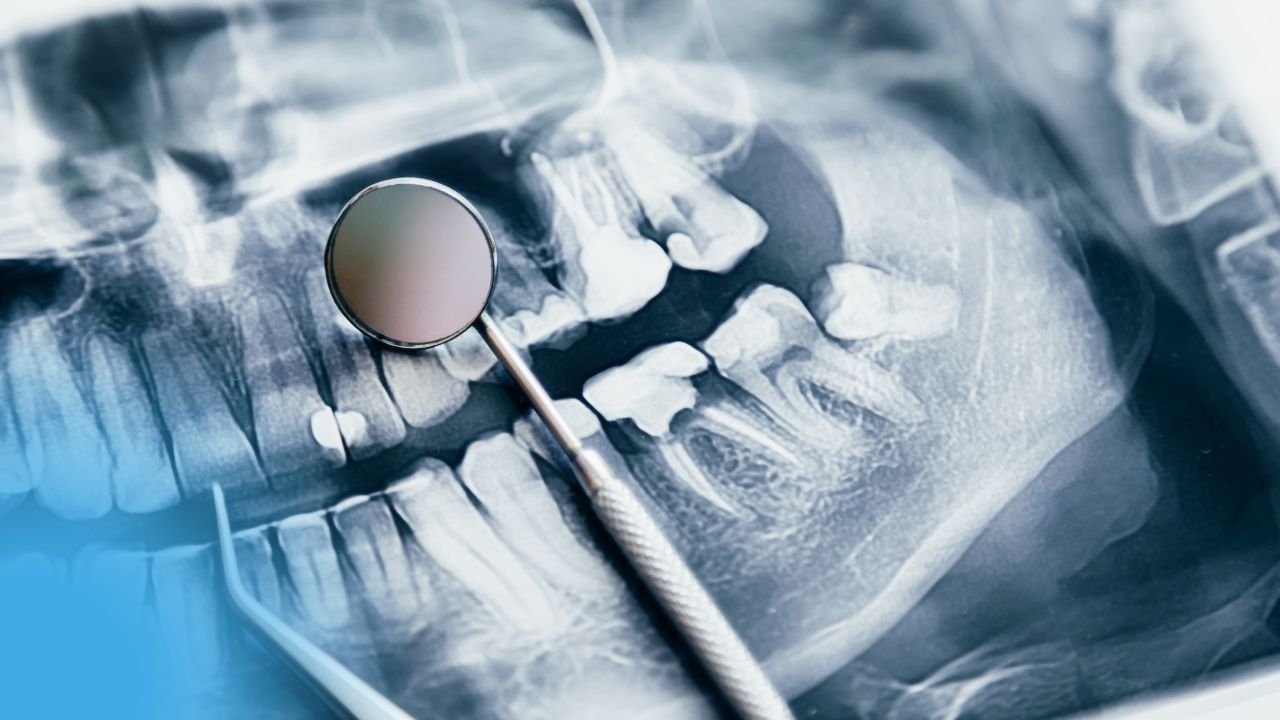



Leave a Reply