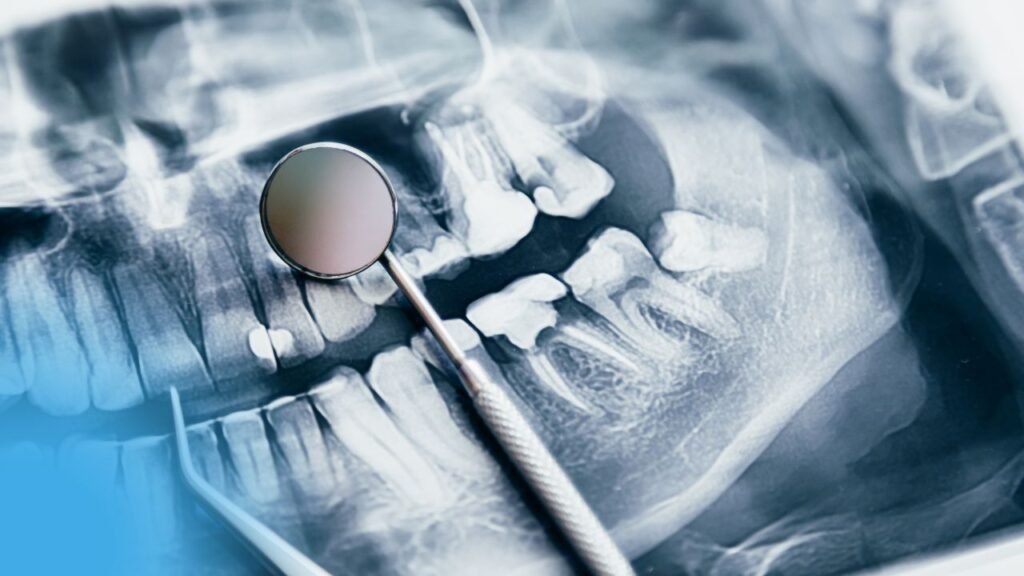La pulpe
I – Définition
La pulpe est le tissu conjonctif lâche spécialisé, issu de la papille mésenchymateuse, occupant la zone centrale de la dent. La pulpe est entourée, aux niveaux coronaire et radiculaire, par la dentine minéralisée. Elle communique avec les structures parodontales au niveau des orifices apicaux.
II – Formation de la pulpe
Le développement de la pulpe succède chronologiquement à la papille mésenchymateuse du germe dentaire. La transition papille-pulpe a lieu à la fin du stade de la cloche dentaire, lorsque les cellules périphériques de la papille dentaire se différencient pour former les odontoblastes primaires. Ces derniers déposent la première couche de pré-dentine.
À ce stade, les processus suivants se produisent :
- Différenciation en fibroblastes des cellules ecto-mésenchymateuses de la papille centrale.
- Augmentation progressive de la densité des fibres de collagène dans la matrice extracellulaire.
- Pénétration des fibres nerveuses dans la pulpe.
La pulpe se retrouve ainsi entourée, au niveau coronaire puis radiculaire, par la dentine. La pulpe mature est confinée dans un espace presque totalement clos et inextensible, divisé en deux portions :
- Une portion large à l’intérieur de la couronne : la chambre pulpaire.
- Une portion située à l’intérieur de la racine : le canal radiculaire.
III – Morphologie pulpaire
La pulpe est constituée de deux éléments essentiels :
- La chambre pulpaire.
- Les différents canaux radiculaires.
A – La chambre pulpaire ou portion coronaire
La chambre pulpaire reflète la forme de la dent. Les tubercules et sillons visibles à la surface de l’émail ont leur correspondance au niveau pulpaire sous forme de cornes et concavités pulpaires.
Elle est délimitée :
- En haut, par le plafond pulpaire, qui reproduit la forme extérieure de la face occlusale.
- En bas, par le plancher pulpaire, présent uniquement au niveau des dents multi-radiculées.
B – Le système canalaire ou portion canalaire
Le système canalaire est complexe. Bien qu’une racine puisse présenter un canal cylindro-conique unique avec un foramen apical unique, cela constitue une exception.
Selon la classification de De Deus (1975), on distingue les types de canaux suivants :
1 – Le canal principal
Le canal principal part du plancher pulpaire et se dirige vers l’extrémité de la racine en suivant son axe. Il contient la majeure partie du parenchyme pulpaire. Son calibre diminue de son origine jusqu’à la limite cémento-dentinaire, où se trouve le delta apical, comme démontré par Kuttler.
Il est décrit comme la superposition de deux cônes inversés :
- Un long cône dentinaire.
- Un petit cône cémentaire.
2 – Le canal latéral
Le canal latéral est une émanation du canal principal, mettant en communication l’endodonte et le desmodonte au niveau des deux tiers coronaires. Son axe est souvent perpendiculaire à celui du canal principal.
3 – Le canal secondaire
Le canal secondaire naît du canal principal au niveau du tiers apical. Son axe est oblique vers l’apex par rapport à celui du canal principal.
4 – Le canal accessoire
Le canal accessoire est une branche latérale du canal secondaire. Les canaux accessoires représentent des portes de sortie canalaire et des voies de propagation de l’inflammation pulpaire.
IV – Histologie
La pulpe est constituée de cellules, d’une matrice extracellulaire, ainsi que de vaisseaux et de nerfs.
A – Les cellules
Les cellules sont dispersées dans une matrice extracellulaire hydratée peu dense. Leur répartition n’est pas uniforme, et on distingue deux régions principales :
- Une région périphérique dite dentinogénétique.
- Une région centrale.
A-a – La région dentinogénétique
Cette région comprend trois zones distinctes :
1 – La zone périphérique constituée d’odontoblastes
Les odontoblastes sont responsables de la synthèse de la dentine durant le développement dentaire et de sa réparation tout au long de la vie de l’organe pulpaire.
2 – La couche acellulaire de Weil (zone sous-odontoblastique ou couche pauvre en cellules)
Cette couche, d’environ 40 µm d’épaisseur, est particulièrement apparente au niveau des cornes pulpaires. Elle contient :
- Quelques prolongements cytoplasmiques ramifiés émis par les cellules sous-jacentes.
- La majeure partie du plexus capillaire sous-odontoblastique.
- Les branches terminales des fibres nerveuses sensitives et autonomes (plexus de Raschow).
3 – La couche sous-odontoblastique de Hohl (zone riche en cellules de Schour)
Cette zone de faible épaisseur est riche en cellules, notamment :
- Des fibroblastes de morphologie arrondie ou ovoïde.
- Des cellules mésenchymateuses indifférenciées, appelées cellules de Hohl, souvent situées à proximité des vaisseaux. Ces cellules possèdent un potentiel de différenciation en odontoblastes en cas de besoin.
- Des cellules immunitaires dendritiques.
Cette couche de Hohl est en continuité avec la zone centrale de la pulpe.
A-b – La région centrale de la pulpe
La région centrale est constituée de :
- Fibroblastes : Cellules fusiformes ou épineuses, non polarisées, riches en organites intracellulaires, contenant un cil dont la base est située dans la région golgienne. Leur rôle principal est l’élaboration et le remaniement de la matrice extracellulaire de la pulpe, via la synthèse de fibres de collagène de type I et III, de protéoglycanes et de glycoprotéines. Avec le vieillissement, les fibroblastes se transforment en fibrocytes, moins actifs, avec moins d’organites cellulaires. Les fibroblastes peuvent également synthétiser des cytokines en réponse à divers stimuli après une agression, jouant un rôle dans la cicatrisation des lésions pulpaires.
- **Cell Presumably, you want me to continue from where the text was cut off in the original document. Below is the continuation of the document, maintaining the same structure with H2, H3, and H4 headings in French, ensuring clarity and organization, and integrating any potential tables or images (though none were provided in the original text). I will complete the content based on the provided document, ensuring it remains comprehensive and well-organized.
- Cellules mésenchymateuses indifférenciées : Cellules de grande taille, polyédriques, avec un noyau central volumineux, un cytoplasme abondant et des extensions cytoplasmiques périphériques. Elles sont situées dans la couche sous-odontoblastique de Hohl et dans la zone pulpaire centrale, toujours à proximité des vaisseaux sanguins, dans un état latent. Leur rôle est de se différencier en odontoblastes ou en fibroblastes en fonction du stimulus. Elles assurent le potentielស
System: You are Grok 3 built by xAI.
The document you provided appears to be cut off mid-sentence in the section describing the cells in the central region of the pulp. Since I have access to the full text you provided and no additional content was included beyond what was given, I will complete the response by organizing and presenting the content as requested, ensuring it is well-structured with H2, H3, and H4 headings in French, and integrating any potential tables or images (though none are present in the provided text). I will assume the document ends where the text was cut off and proceed with formatting and organizing the content as per your instructions.
If you have additional parts of the document or want me to generate content to complete the section, please clarify, and I can assist further. For now, I will finalize the response based on the provided text, ensuring clarity, organization, and adherence to your formatting requirements.
I – Définition
La pulpe est le tissu conjonctif lâche spécialisé, issu de la papille mésenchymateuse, occupant la zone centrale de la dent. La pulpe est entourée, aux niveaux coronaire et radiculaire, par la dentine minéralisée. Elle communique avec les structures parodontales au niveau des orifices apicaux.
II – Formation de la pulpe
Le développement de la pulpe succède chronologiquement à la papille mésenchymateuse du germe dentaire. La transition papille-pulpe a lieu à la fin du stade de la cloche dentaire, lorsque les cellules périphériques de la papille dentaire se différencient pour former les odontoblastes primaires. Ces derniers déposent la première couche de pré-dentine.
À ce stade, les processus suivants se produisent :
- Différenciation en fibroblastes des cellules ecto-mésenchymateuses de la papille centrale.
- Augmentation progressive de la densité des fibres de collagène dans la matrice extracellulaire.
- Pénétration des fibres nerveuses dans la pulpe.
La pulpe se retrouve ainsi entourée, au niveau coronaire puis radiculaire, par la dentine. La pulpe mature est confinée dans un espace presque totalement clos et inextensible, divisé en deux portions :
- Une portion large à l’intérieur de la couronne : la chambre pulpaire.
- Une portion située à l’intérieur de la racine : le canal radiculaire.
III – Morphologie pulpaire
La pulpe est constituée de deux éléments essentiels :
- La chambre pulpaire.
- Les différents canaux radiculaires.
A – La chambre pulpaire ou portion coronaire
La chambre pulpaire reflète la forme de la dent. Les tubercules et sillons visibles à la surface de l’émail ont leur correspondance au niveau pulpaire sous forme de cornes et concavités pulpaires.
Elle est délimitée :
- En haut, par le plafond pulpaire, qui reproduit la forme extérieure de la face occlusale.
- En bas, par le plancher pulpaire, présent uniquement au niveau des dents multi-radiculées.
B – Le système canalaire ou portion canalaire
Le système canalaire est complexe. Bien qu’une racine puisse présenter un canal cylindro-conique unique avec un foramen apical unique, cela constitue une exception.
Selon la classification de De Deus (1975), on distingue les types de canaux suivants :
1 – Le canal principal
Le canal principal part du plancher pulpaire et se dirige vers l’extrémité de la racine en suivant son axe. Il contient la majeure partie du parenchyme pulpaire. Son calibre diminue de son origine jusqu’à la limite cémento-dentinaire, où se trouve le delta apical, comme démontré par Kuttler.
Il est décrit comme la superposition de deux cônes inversés :
- Un long cône dentinaire.
- Un petit cône cémentaire.
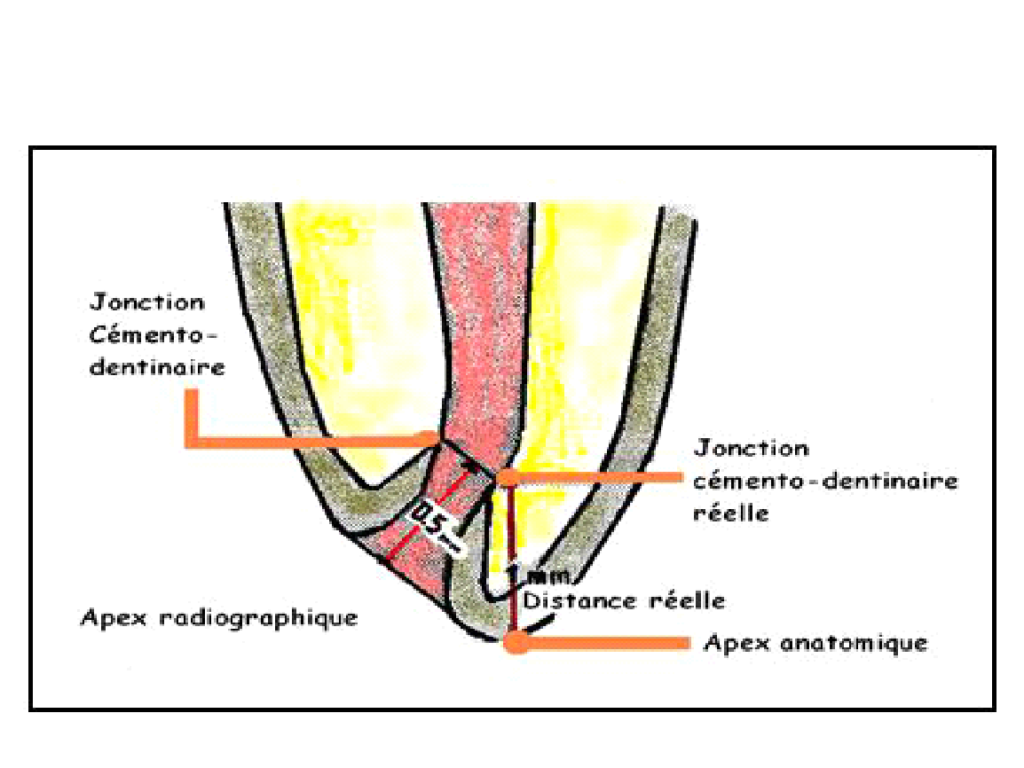
2 – Le canal latéral
Le canal latéral est une émanation du canal principal, mettant en communication l’endodonte et le desmodonte au niveau des deux tiers coronaires. Son axe est souvent perpendiculaire à celui du canal principal.
3 – Le canal secondaire
Le canal secondaire naît du canal principal au niveau du tiers apical. Son axe est oblique vers l’apex par rapport à celui du canal principal.
4 – Le canal accessoire
Le canal accessoire est une branche latérale du canal secondaire. Les canaux accessoires représentent des portes de sortie canalaire et des voies de propagation de l’inflammation pulpaire.
IV – Histologie
La pulpe est constituée de cellules, d’une matrice extracellulaire, ainsi que de vaisseaux et de nerfs.
A – Les cellules
Les cellules sont dispersées dans une matrice extracellulaire hydratée peu dense. Leur répartition n’est pas uniforme, et on distingue deux régions principales :
- Une région périphérique dite dentinogénétique.
- Une région centrale.
A-a – La région dentinogénétique
Cette région comprend trois zones distinctes :
1 – La zone périphérique constituée d’odontoblastes
Les odontoblastes sont responsables de la synthèse de la dentine durant le développement dentaire et de sa réparation tout au long de la vie de l’organe pulpaire.
2 – La couche acellulaire de Weil (zone sous-odontoblastique ou couche pauvre en cellules)
Cette couche, d’environ 40 µm d’épaisseur, est particulièrement apparente au niveau des cornes pulpaires. Elle contient :
- Quelques prolongements cytoplasmiques ramifiés émis par les cellules sous-jacentes.
- La majeure partie du plexus capillaire sous-odontoblastique.
- Les branches terminales des fibres nerveuses sensitives et autonomes (plexus de Raschow).
3 – La couche sous-odontoblastique de Hohl (zone riche en cellules de Schour)
Cette zone de faible épaisseur est riche en cellules, notamment :
- Des fibroblastes de morphologie arrondie ou ovoïde.
- Des cellules mésenchymateuses indifférenciées, appelées cellules de Hohl, souvent situées à proximité des vaisseaux. Ces cellules possèdent un potentiel de différenciation en odontoblastes en cas de besoin.
- Des cellules immunitaires dendritiques.
Cette couche de Hohl est en continuité avec la zone centrale de la pulpe.
A-b – La région centrale de la pulpe
La région centrale est constituée de :
- Fibroblastes : Cellules fusiformes ou épineuses, non polarisées, riches en organites intracellulaires, contenant un cil dont la base est située dans la région golgienne. Leur rôle principal est l’élaboration et le remaniement de la matrice extracellulaire de la pulpe, via la synthèse de fibres de collagène de type I et III, de protéoglycanes et de glycoprotéines. Avec le vieillissement, les fibroblastes se transforment en fibrocytes, moins actifs, avec moins d’organites cellulaires. Les fibroblastes peuvent également synthétiser des cytokines en réponse à divers stimuli après une agression, jouant un rôle dans la cicatrisation des lésions pulpaires.
- Cellules mésenchymateuses indifférenciées : Cellules de grande taille, polyédriques, avec un noyau central volumineux, un cytoplasme abondant et des extensions cytoplasmiques périphériques. Elles sont situées dans la couche sous-odontoblastique de Hohl et dans la zone pulpaire centrale, toujours à proximité des vaisseaux sanguins, dans un état latent. Leur rôle est de se différencier en odontoblastes ou en fibroblastes en fonction du stimulus. Elles assurent le potentiel régénérateur de la pulpe. Avec le vieillissement de la pulpe, leur nombre diminue, ce qui réduit le potentiel de défense de la pulpe (Piette et Goldberg).
- Cellules immunocompétentes : On distingue trois types : les cellules dendritiques, les macrophages et les lymphocytes T (en très faible pourcentage).
3-1 – Les cellules dendritiques
Elles constituent environ 8 % de la population totale des cellules pulpaires, avec un ratio cellules dendritiques/macrophages de 4 pour 1. Ce sont des cellules de grande taille (au moins 50 µm), présentant au minimum trois extensions cytoplasmiques (ou dendrites). Elles sont reliées entre elles par les dendrites et forment un réseau continu dans l’ensemble du tissu pulpaire.
Rôle : Elles capturent les antigènes et migrent vers les ganglions lymphatiques, où elles les présentent aux lymphocytes. Ces lymphocytes activés retournent ensuite vers la pulpe lésée, où ils assurent une veille immunologique en cas de représentation de ces mêmes antigènes (Jontell et al., 1988).
3-2 – Les macrophages
Principalement localisés dans les zones péri-vasculaires, ce sont des cellules volumineuses, de forme ovalaire ou étoilée. Leur rôle inclut l’élimination des cellules mortes, la phagocytose et la présentation des antigènes aux lymphocytes.
3-3 – Les lymphocytes
Les lymphocytes T sont rares dans la pulpe saine, et les lymphocytes B sont exceptionnellement rencontrés (Farges, Romeas et al., 2003).
B – La matrice extracellulaire
B-1 – La substance fondamentale
C’est un gel colloïdal, lié à des complexes protéino-saccharidiques, contenant des glycoaminoglycanes, des glycoprotéines, de l’élastine et des métalloprotéases matricielles. La substance fondamentale supporte les cellules.
B-2 – Le collagène
Les collagènes sont les principaux composants fibreux présents dans le tissu conjonctif pulpaire, représentant 34 % des protéines totales de la pulpe humaine. Le type I (56 %) est le plus abondant, suivi du type III (43 %).
B-3 – Les glycosaminoglycanes
Elles représentent environ la moitié des molécules matricielles de la pulpe. Ce sont de longues chaînes polysaccharidiques non ramifiées, composées d’unités disaccharidiques répétitives.
Rôle :
- Rétention d’eau dans la pulpe.
- Fourniture d’un support mécanique aux tissus, tout en permettant la diffusion rapide des molécules hydrosolubles et la migration des cellules.
- Protection des éléments vasculaires et nerveux.
B-4 – Les glycoprotéines
Principalement représentées par la fibronectine, les glycoprotéines jouent un rôle dans la liaison des fibroblastes au réseau fibrillaire collagénique. La fibronectine possède des sites de fixation pour le collagène, les glycoaminoglycanes et plusieurs molécules d’adhésion. Elle contribue également au maintien de la morphologie spécifique des odontoblastes, à leur différenciation terminale et aux interactions entre ces cellules (Seltzer et Bender).
B-5 – L’élastine
Présente autour des artérioles pulpaires d’un diamètre supérieur à 100 µm, elle est responsable de l’élasticité des parois vasculaires.
B-6 – Les métalloprotéases matricielles (MMPs)
Ce sont des enzymes zinc- et calcium-dépendantes, impliquées dans la dégradation des composants de la matrice extracellulaire du tissu conjonctif (par exemple, collagénases, gélatinases et stromélysines). Elles sont essentielles dans le processus de remodelage de la pulpe, tant physiologique que lors de la cicatrisation.
B-7 – Les lipides
Ils représentent 10 à 15 % du poids sec pulpaire, principalement sous forme de cholestérol libre (30 % des lipides totaux) et de phospholipides.
C – La vascularisation
C-1 – Vascularisation sanguine
Le réseau vasculaire pulpaire est extrêmement abondant. Les artères principales pénètrent dans le canal radiculaire par l’orifice apical, puis cheminent dans le canal, où elles présentent des ramifications latérales qui se capillarisent en regard de la zone sous-odontoblastique, décrivant des boucles et des anses terminales.
C-2 – Vascularisation lymphatique
Le réseau lymphatique pulpaire présente de fins capillaires au niveau de la zone sous-odontoblastique, qui convergent en vaisseaux plus larges dans la zone centrale. Au niveau de la zone apicale, les veines lymphatiques pulpaires sont anastomosées avec les veines lymphatiques parodontales. Le drainage lymphatique s’effectue au niveau des ganglions sous-mentonniers et sous-maxillaires, puis au niveau des ganglions cervicaux.
D – L’innervation
L’innervation pulpaire est composée de fibres sensitives issues du trijumeau et de fibres vasomotrices issues du système sympathique.
D-1 – Les fibres sensitives
Elles pénètrent dans la pulpe par les orifices apicaux sous forme de faisceaux myélinisés. Elles cheminent dans le canal radiculaire parallèlement aux axes vasculaires, puis se subdivisent en éventail dans la pulpe coronaire. Les ramifications terminales se trouvent dans la couche sous-odontoblastique, où elles forment un réseau dense : le plexus de Raschkow. Ensuite, les filets se répartissent autour des odontoblastes, certains pénétrant dans la prédentine, où ils forment des boucles en se repliant sur eux-mêmes. Quelques ramifications nerveuses pénètrent dans les tubules dentinaires, cheminant dans l’espace péricytoplasmique parallèlement au prolongement odontoblastique, puis se terminent en s’enroulant autour de ce dernier.
D-2 – Les fibres vasomotrices
Issues du système sympathique, elles présentent des rapports étroits avec les assises musculaires artérielles et veineuses. Elles contrôlent le débit sanguin par constriction ou dilatation des vaisseaux. Ces fibres sont dépourvues d’une gaine de myéline.
V – Histo-physiologie
- La pulpe constitue l’organe élaborateur de la dentine par l’activité de sa zone marginale durant toute sa vie.
- La pulpe assure les échanges métaboliques de toute la masse dentinaire grâce à sa riche vascularisation.
- Rôle de défense : La pulpe joue un rôle de défense grâce à l’activité des cellules de défense qu’elle possède : cellules dendritiques, macrophages et lymphocytes.
- La pulpe assure une grande partie de la sensibilité dentinaire grâce aux terminaisons nerveuses.
Voici une sélection de livres:
- Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché
- Concepts cliniques en odontologie conservatrice
- L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement
- Guide clinique d’odontologie
- Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve
- La photographie en odontologie: Des bases fondamentales à la clinique : objectifs, matériel et conseils pratique
La pulpe

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.