La Prothèse Conjointe et Parodonte / Prothèse Dentaire
La Prothèse Conjointe et Parodonte / Prothèse Dentaire
Introduction
La réalisation prothétique, autrefois présentée comme une succession d’actes mécaniques, est aujourd’hui considérée comme une phase thérapeutique intégrée dans une démarche globale fondée sur des éléments biologiques, en particulier parodontaux.
Rappels sur le Parodonte
Le parodonte est un complexe tissulaire constitué par l’ensemble des tissus qui entourent et soutiennent la dent, assurant la liaison des dents aux maxillaires. Il comporte deux parties principales : le parodonte superficiel et le parodonte profond.
Le Parodonte Superficiel
| La Gencive | Le Sillon Gingivo-Dentaire | La Jonction Dento-Épithéliale | L’Espace Biologique |
|---|---|---|---|
| Tissu épithélio-conjonctif constitué par la gencive papillaire, la gencive marginale et la gencive attachée. | Profondeur de 0,5 à 3 mm entourant toute la dent. Son appréciation est indispensable pour déterminer la situation future de la limite dento-prothétique. | Jonction délimitant le fond du sulcus, constituant la frontière entre le milieu interne et externe, perméable au fluide gingival et aux produits microbiens. | Espace compris entre le fond du sulcus et le sommet de la crête osseuse alvéolaire (2 mm). Doit être respecté car il constitue une zone interdite à la limite prothétique. |
Le Parodonte Profond
| Le Cément | Le Desmodonte | L’Os Alvéolaire |
|---|---|---|
| Tissu calcifié d’origine conjonctive recouvrant la surface radiculaire. Assure la fixation des fibres du desmodonte. | Tissu conjonctif fibreux renfermant des fibres de collagène réunissant la dent à l’os. | Tissu minéralisé essentiel assurant la liaison de la dent au maxillaire. |
Buts de la Prothèse Fixée
- Protection et conservation des dents résiduelles d’une denture partiellement détruite, complément indispensable du traitement parodontal.
- Restauration des couronnes détruites pour éviter les déséquilibres au sein de chaque arcade en :
- Créant des relations normales entre les dents.
- Rétablissant une protection et une stimulation des tissus de soutien.
- Répartition harmonieuse des forces occlusales pour éviter les surcharges des organes dentaires isolés.
- Rétablissement d’un plan d’occlusion harmonieux en éliminant les interférences et les parafonctions préjudiciables au parodonte.
- Rétablissement d’une dimension verticale (DV) correcte favorisant une fonction harmonieuse.
- Rétablissement de l’esthétique.
- Contention pour soulager les dents piliers affaiblies par :
- Des surcharges excessives.
- Un support parodontal réduit.
- Une combinaison des deux.
Principes de la Prothèse Conjointe
- Réalisation dans un milieu sain.
- Ne doit pas favoriser les dépôts bactériens.
- Permettre l’élimination facile de la plaque bactérienne.
- Éviter toute surcharge occlusale sur le parodonte.
- Assurer une protection et stimulation du parodonte superficiel et profond.
Examen Initial et Plan de Traitement
L’examen clinique est indispensable pour le diagnostic et l’élaboration du plan de traitement. Il comprend :
- Anamnèse.
- Examen exo-buccal.
- Examen endo-buccal.
- Évaluation de l’état parodontal : parodonte sain ou malade, apte à résister à l’agression potentielle d’une prothèse fixée.
Contrôle de Plaque
Le pronostic à long terme de la prothèse est directement lié à la qualité du contrôle de plaque.
Maladie Parodontale
- Une restauration prothétique ne peut être envisagée si le parodonte est malade.
- Gingivites : absence d’atteinte du support osseux, lésions totalement réversibles.
- Parodontite à début précoce (patients < 35 ans) : évolution rapide, stabilisation difficile.
- Conservation de l’intégrité des arcades pour retarder les extractions, même en cas de lyse osseuse sévère, afin d’éviter un édentement important ou total.
- Inflammation parodontale : nécessite un traitement parodontal préalable.
- Poches parodontales (révélées par sondage) et lyse osseuse (appréciée par radiologie) : traitement étiologique et de régénération avant prothèse.
- Mobilité dentaire : évaluée avec le manche du miroir ou entre les doigts pour mesurer l’ampleur du déplacement sous une force. Entrave la mastication et la rétention des prothèses.
Même si le parodonte est sain, des défauts peuvent empêcher un résultat prothétique satisfaisant, nécessitant des corrections telles que :
- Élongation coronaire.
- Freinectomie.
- Recouvrement des récessions.
- Augmentation de la gencive attachée.
- Alignement du feston gingival.
- Traitement des crêtes édentées par addition ou soustraction des tissus.
Examen Radiologique
- État du parodonte profond et contour des tissus muqueux.
- Aspect de la trabéculation osseuse.
- Forme, profondeur et direction des racines.
- Rapport couronne/racine.
- Atteintes carieuses et qualité des traitements endodontiques.
- Présence de racines résiduelles ou de kystes.
Examen des Modèles
- Analyse de l’occlusion pour décider si la prothèse peut s’inscrire dans le schéma occlusal existant ou si des corrections sont nécessaires.
- Une prothèse fixée sur un déséquilibre occlusal non résolu aggravera ce déséquilibre, d’où la nécessité d’une analyse occlusale pré-prothétique.
- Établissement d’un plan d’occlusion harmonieux par :
- Techniques soustractives (meulage sélectif).
- Techniques additives (corono-plastie).
Étapes Prothétiques
Réduction Coronaire
- Réduction homothétique pour une épaisseur uniforme du matériau.
- Réduction insuffisante : restauration augmentée de volume, défavorable au parodonte.
- Réduction excessive : risque de lésion pulpaire.
- Préparation selon des principes établis :
- Formes assurant rétention et stabilité des prothèses.
- Préservation de la santé parodontale avec des lignes de finition précises, compatibles avec les impératifs esthétiques.
- Respect de l’espace biologique au laboratoire.
- Les lignes cervicales (LC) doivent être courbes, continues et parfaitement visibles au laboratoire.
Rapport de la Limite Cervicale avec la Gencive Libre
Définition
- La limite cervicale (LC) marque l’extrémité apicale de la zone dentaire abrasée pour recevoir un élément prothétique.
- Lien d’intégration biologique, physiologique et esthétique.
- Frontière objective entre la partie préparée et non préparée d’une dent.
- Située à trois niveaux : supra-gingivale, juxta-gingivale ou sous-gingivale.
Limite Supra-Gingivale
| Indications | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|
| Dents postérieures, esthétique non prioritaire, faces non visibles, hauteur coronaire suffisante, hygiène bucco-dentaire satisfaisante, moignons suffisamment hauts. | Économie de tissu dentaire, facilité d’exécution (visibilité), aucune irritation gingivale, accessibilité au brossage prophylactique. | Risque carieux (émail cervical non protégé), inesthétique. |
Limite Juxta-Gingivale
| Situation | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|
| Continuité entre la LC et le collet clinique. | Pas de lésion parodontale, protection de l’émail supra-gingival. | Risque d’accumulation de plaque bactérienne, pouvant provoquer une inflammation gingivale, même avec un ajustage précis. |
Limite Infra ou Sous-Gingivale
| Situation | Indications | Inconvénients |
|---|---|---|
| Située dans le sulcus sans atteindre le fond du sillon gingivo-dentaire (SGD), ne dépassant pas 0,5 à 0,7 mm (accessible au brossage). | Dents antérieures, esthétique primordiale, dents délabrées ou couronnes courtes (rétention). | Risque majeur pour l’adaptation gingivo-prothétique. |
Le choix de la limite cervicale dépend de :
- Conditions cliniques (couronne courte, longue, détruite par carie, fracturée, vitalité pulpaire).
- Considérations esthétiques (dent antérieure ou postérieure, face vestibulaire ou palatine).
- Notion de l’espace biologique.
- Hauteur de la gencive attachée.
- Aptitude du patient à éliminer la plaque bactérienne.
Préparation et Parodonte (Précautions)
- Ne pas préparer dans un sulcus enflammé.
- Adapter la forme et la situation de la préparation au type de parodonte.
- Éviter une limite de préparation dans l’espace biologique.
- Pour une préparation intra-sulculaire :
- Sonder le sulcus avant préparation.
- Protéger la gencive marginale.
- Préparer des limites nettes.
Les Empreintes
Matériaux à Empreintes
| Matériaux | Propriétés |
|---|---|
| Hydrocolloïdes (alginates de classe A type I ou II, hydro-alginates, hydrocolloïdes réversibles) | Mauvaise résistance mécanique aux déformations, élasticité médiocre, source de contraintes lors de la désinsertion, mauvaise stabilité dimensionnelle, faible viscosité avant prise (non compressifs, non agressifs pour le parodonte), hydrophiles, enregistrement des limites intra-sulculaires sans pression excessive ni perturbation par le fluide gingival. |
| Élastomères (silicones par polycondensation, silicones par polyaddition, polyéthers) | Grande élasticité, meilleure stabilité dimensionnelle, moins bonne affinité pour l’eau. |
Accès aux Limites Cervicales
- Respect du profil d’émergence radiculaire : enregistrer les 2 ou 3/10e de mm non préparés au-delà de la limite.
- Accès difficile, nécessitant une ouverture préalable du sulcus pour colonisation par le matériau à empreinte.
- Facteurs influençant le protocole :
- Profondeur et anatomie du sillon gingivo-dentaire.
- Texture et épaisseur de la gencive libre et des tissus marginaux.
- Techniques d’accès agressives pour le parodonte marginal (doivent être temporaires).
- Objectifs de la déflexion tissulaire :
- Création d’un espace de 2/10 mm de largeur.
- Espace allant au moins à 2/10 mm au-delà de la limite.
- Angle de 30° entre tissus calcifiés et épithélium interne du sulcus.
- Écartement du bord libre de la gencive de 1 mm.
Techniques d’Accès aux Limites Cervicales
| Technique | Protocole | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|---|
| Déflexion par cordonnets | Insérer un ou deux cordonnets au fond du sulcus avant préparation, parfois imprégnés d’une solution chimique (chlorure d’aluminium). | Atraumatique, utilisable dans de nombreuses situations, protège l’attache épithéliale, instrumentation peu coûteuse. | Profondeur sulculaire minimale, méthode longue pour préparations multiples, anesthésie parfois nécessaire. |
| Déflexion par système Expasyl | Injection intra-sulculaire de kaolin via seringue spécifique, repousse chimiquement la gencive marginale, action astringente et hémostatique (chlorure d’aluminium). | Non agressif pour le parodonte, pas d’anesthésie nécessaire, protocole rapide, compatible avec d’autres techniques, pas de contre-indications absolues. | Risque d’injection dans un site non rinçable (poche parodontale), matériel et matériaux spécifiques. |
| Déflexion médiate par prothèse provisoire | Surdimensionnement de la zone cervicale des prothèses provisoires pour provoquer une déflexion horizontale, nécessite une séance supplémentaire pour l’empreinte. | Intérêt pour profils anatomiques complexes, réalisation simultanée de la prothèse provisoire et de l’accès aux limites. | Manque de contrôle, résultat inconstant, séance clinique supplémentaire, phénomènes inflammatoires réactionnels, rétractions parfois irréversibles. |
Mise en Place de la Prothèse Provisoire (Transitoire) en Résine
Vis-à-vis du parodonte, la prothèse transitoire :
- Maintient la gencive marginale dans une position physiologique après préparation.
- Facilite la cicatrisation des tissus parodontaux.
- Contrôle la stabilité du parodonte marginal avant la prothèse permanente.
- Anticipe la forme de la prothèse permanente et évalue le besoin de chirurgie parodontale esthétique.
Élaboration des Modèles
- Perte d’information au laboratoire due au sciage (fractionnement) et au détourage, entraînant la disparition de la réplique de la gencive marginale, compliquant la définition du profil d’émergence.
Essayage de l’Armature
Contrôles cliniques liés au parodonte :
- Précision de l’ajustement des bords de l’armature sur les limites des préparations (vérification visuelle et avec sonde, sans accrochage à la jonction dent/armature).
- Absence de compression de la gencive marginale par le contour de l’armature.
- Respect des embrasures.
- Choix d’alliages appropriés et préparation parodontale préalable pour éviter un sur-contour prothétique au détriment de la papille interdentaire.
Travées des Bridges ou Pontics
- Ne doivent pas favoriser l’accumulation de débris alimentaires ni exercer de pression sur la crête.
- En harmonie avec les dents adjacentes et antagonistes pour respecter le parodonte et l’occlusion.
- Choix dicté par les exigences esthétiques, fonctionnelles, biomécaniques et hygiéniques (convexe dans les sens vestibulo-lingual et mésio-distal).
Travée à Contact Muqueux Large en Forme de Selle
- Esthétique (forme proche de la dent).
- Large surface concave en contact avec la crête.
- Embrasures fermées.
- Impossible à nettoyer, passage du fil de soie sous la muqueuse.
- Favorise l’inflammation des tissus sous-jacents (irritation du parodonte marginal).
Travée à Contact Muqueux Linéaire
- Contact sur le versant vestibulaire de la crête.
- Plus hygiénique et esthétique.
- Contact franc requis, un écart favorisant la rétention alimentaire.
Travée sans Contact Muqueux
- Distante de la crête, permettant une bonne hygiène mais inesthétique.
- Préconisée dans les secteurs postérieurs des molaires inférieures.
Forme de Contour des Dents Prothétiques
Réalisation de la Face Vestibulaire et Linguale
- Bombé pour assurer la déflexion du bol alimentaire.
- Profil d’émergence en harmonie avec les faces vestibulaires et linguales des dents adjacentes et antagonistes.
- Ligne du plus grand contour des faces vestibulaires des dents cuspidées située dans le 1/3 cervical.
- Référence aux faces homologues des dents adjacentes.
Réalisation des Contacts Proximaux
- Empêche le tassement alimentaire dans les espaces interdentaires.
- Assure la stabilité des arcades par blocage horizontal.
Réalisation des Embrasures
- Protège les papilles en permettant l’élimination de la plaque bactérienne.
- Rétention alimentaire si l’espace est trop grand.
- Compression de la papille si l’espace est trop restreint.
Réalisation des Faces Occlusales
- Pointes cuspidiennes en contact avec les fosses antagonistes pour diriger les forces occlusales selon l’axe vertical de la dent, stimulant l’os.
- Anatomie correcte pour :
- Meilleur écrasement de l’aliment avec réduction des forces exercées.
- Maintenir les aliments sur la surface occlusale et permettre leur évacuation loin de la papille.
Scellement de la Prothèse
- Joint dento-prothétique le plus fin possible, sinon le ciment de scellement se dégrade, favorisant l’accumulation de plaque.
- Pas de débris de ciment dans le sulcus ou au-delà (curetage du SGD).
- Scellement provisoire pour une courte durée afin de contrôler :
- Contours de la prothèse et absence de lésion parodontale.
- Bonne tolérance par le patient (tissus parodontaux et occlusion).
- Scellement définitif pour maintenir la prothèse fixée.
Plan d’Entretien de la Prothèse Fixée
Enseignement de l’Hygiène Rigoureuse
- Utilisation de moyens et matériel adaptés aux formes des restaurations.
- Hygiène bucco-dentaire rigoureuse pour prévenir l’accumulation de plaque et assurer la pérennité des résultats.
Visite de Contrôle (Bi-Annuelle)
- Interrogatoire : symptômes survenus depuis l’insertion de la prothèse.
- Examen de l’hygiène et de l’état parodontal :
- Révélateurs de plaque, inflammation, dépistage des poches, apparition ou récidive d’affection parodontale.
- Examen de la prothèse :
- Traction ou pression sur chaque restauration pour détecter un descellement.
- Sondage de la limite dento-prothétique pour détecter des caries.
- Vérification des contacts proximaux pour évaluer leur efficacité.
- Présence de facettes d’usure signalant un déséquilibre occlusal ou bruxisme.
- Examen du parodonte profond :
- Recherche des signes cliniques d’atteinte parodontale ou de mobilité dentaire.
- Examen radiologique complémentaire.
- Contrôle de l’équilibre occlusal :
- Stabilité occlusale et harmonie fonctionnelle perturbées dans le temps.
- Nouvel équilibre musculaire post-insertion pouvant déplacer la mandibule vers une position plus postérieure.
- Abrasion justifiant un meulage d’équilibration, visible sur :
- Couronnes naturelles.
- Matériaux des restaurations, à des degrés différents.
Conclusion
Le traitement prothétique vise le rétablissement d’une fonction masticatoire individuelle idéale et d’une esthétique satisfaisante pour chaque patient. Il suit une séquence systématique. La phase pré-prothétique repose sur des principes biologiques et scientifiques, nécessitant une connaissance approfondie de l’étiologie et du développement des pathologies dentaires.
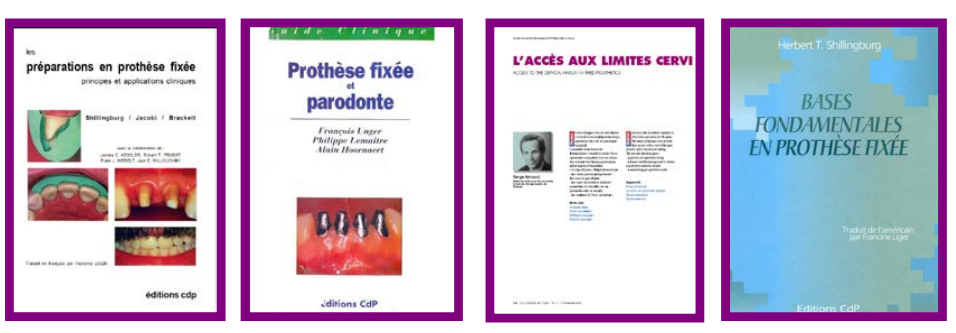
La Prothèse Conjointe et Parodonte / Prothèse Dentaire
La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes. Les étudiants en médecine dentaire doivent maîtriser l’anatomie dentaire et les techniques de diagnostic pour exceller. Les praticiens doivent adopter les nouvelles technologies, comme la radiographie numérique, pour améliorer la précision des soins. La prévention, via l’éducation à l’hygiène buccale, reste la pierre angulaire de la pratique dentaire moderne. Les étudiants doivent se familiariser avec la gestion des urgences dentaires, comme les abcès ou les fractures dentaires. La collaboration interdisciplinaire avec d’autres professionnels de santé optimise la prise en charge des patients complexes. La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes.




Leave a Reply