IMAGERIE MÉDICALE EN OCE
IMAGERIE MÉDICALE EN OCE
Imagerie Médicale en OCE
Définitions
Radiologie
La radiologie est une science clinique basée sur l’utilisation diagnostique (radiodiagnostic) ou thérapeutique (radiothérapie) des rayonnements ionisants. La radiologie diagnostique est le domaine qui sert le plus directement à la médecine dentaire.
Radiographie
Le terme « radiographie » s’applique communément à la prise de clichés chez le patient. La radiographie est le reflet photographique d’un objet, enregistré sur un cliché radiologique obtenu par le passage de rayons X au travers de cet objet.
Imagerie
L’image est, par définition, la représentation imprimée d’un sujet quelconque.
Principes Biophysiques des Rayons X
Lorsque le filament de la cathode est porté à haute température par le courant, il se forme dans le vide un nuage d’électrons. Ces électrons, projetés à haute vitesse, percutent la cible (plaque en tungstène), ce qui donne naissance au rayon X. C’est en percutant l’atome de tungstène que l’électron, brutalement stoppé, libère son énergie pour former un photon X. Les électrons issus de la cathode peuvent arracher un ou plusieurs électrons K de l’atome de tungstène.
Matériels Radiographiques
Les Générateurs
Le générateur est constitué de :
- Tube radiogène : Produit les rayons X.
- Alimentation électrique : Fournit l’énergie nécessaire.
Types de générateurs :
- Générateur à kilovoltage fixe : Seul le temps d’exposition est variable.
- Générateurs à puissance variable : De 50 à 100 kV.
Les Cônes
La longueur du cône varie de 10 à 50 cm, ce qui donne deux types :
Cônes courts :
- Utilisés dans la technique de la bissectrice.
- Faible longueur entraînant un rayonnement diffusé, nuisant à la qualité de l’image radiologique.
- Irradient inutilement le patient, progressivement abandonnés.
Cônes longs :
- Longueur de 35 à 50 cm.
- Collimation :
- Circulaire : 7,5 cm de diamètre.
- Rectangulaire : 3,5 à 4,5 cm de section.
- Avantages :
- Meilleure qualité d’image.
- Réduction importante de l’irradiation dans les structures profondes de la face.
- Nécessite une distance foyer-objet plus grande.
Les Minuteries
Elles assurent le passage du courant à haute tension dans le tube à rayons X, en donnant la valeur correcte de l’exposition selon la zone à radiographier.
Types de minuteries :
- Mécaniques.
- Électromécaniques.
- Électroniques.
Les Films, Leurs Accessoires et Leur Traitement
Film Intra-Oral
Le film radiographique est formé d’un support en polyester de 0,175 mm d’épaisseur, recouvert de part et d’autre d’une mince couche adhésive (0,01 mm) d’une émulsion photosensible (0,01 mm d’épaisseur) et d’une couche protectrice de gélatine dure.
Rôle des cristaux d’halogénure d’argent en suspension dans la gélatine :
- Augmenter la sensibilité du film.
- Améliorer l’absorption des rayons X.
- Réduire le temps d’exposition.
Les films intra-oraux sont présentés dans une enveloppe opaque pour éviter l’exposition à la lumière et tout risque d’humidité. Une mince feuille de plomb dans l’emballage réduit l’irradiation des tissus situés derrière le film et limite les flous.
Films Auto-Développants
Constitués d’une enveloppe principale hermétique en matériau plastique bicolore (blanc et bleu ciel), renfermant :
- Dans sa partie supérieure : la pellicule radiographique.
- Dans sa partie inférieure (légèrement renflée) : un dispositif contenant une solution exclusive de développement et de fixation.
Avantage : Manipulation aisée et instantanée en pleine lumière.
Accessoires
Porte-Films
- Support permettant de garder le film plan et à distance de la dent.
- Supprime l’exposition de la main du patient au rayonnement.
Grilles Millimétrées
- Grilles rigides :
- Formées d’un quadrillage millimétré très fin inclus dans un support de plexiglas, légèrement supérieur au format des films rétro-alvéolaires.
- À usage multiple et stérilisables.
- Grilles souples :
- Feuille de papier autocollante porteuse d’un millimétrage radio-opaque.
- Coûteuses et à usage unique.
Dispositif de Lecture de Film
- Les clichés sont examinés par transillumination et agrandissement au moyen d’une loupe, d’une visionneuse ou d’un négatoscope à intensité variable :
- Négatoscope sur fauteuil dentaire pour clichés intra-oraux.
- Négatoscope pour clichés extra-oraux.
Développement des Films
Développement Manuel Classique
À une température de 20 °C, les étapes sont :
- Tremper le film dans le révélateur pendant 4 minutes.
- Rincer le film pendant 15 secondes.
- Tremper le film dans le fixateur pendant 10 minutes.
- Laver le film à l’eau courante pendant 20 minutes.
- Sécher le film.
Traitement du Film Auto-Développant
- Exercer une pression sur la partie inférieure du film pour libérer la solution révélatrice et fixatrice.
- Masser pendant 30 à 45 secondes avec le pouce, de haut en bas.
- Retourner la pellicule et ramener le liquide vers la partie inférieure.
- Ouvrir l’enveloppe, saisir la pellicule avec une pince, rincer sous l’eau pendant 2 minutes et sécher.
Causes d’Échec de la Radiographie Conventionnelle
| Cause | Conséquence |
|---|---|
| Milliampérage et kilovoltage insuffisants | Image radiographique claire |
| Milliampérage et kilovoltage excessifs | Image trop sombre et contraste insuffisant |
| Exposition nulle (minuterie non déclenchée) | Film clair transparent |
| Surexposition | Image trop sombre |
| Sous-exposition | Image trop claire et contraste insuffisant |
| Film plié avant l’exposition | Cassure de l’émulsion, lignes noires après traitement |
| Film exposé à deux reprises | Double image, film ininterprétable |
| Film placé à l’envers | Rayonnement absorbé par la feuille de plomb, sous-exposition |
| Mobilisation du tube pendant l’irradiation | Image floue |
| Empreintes des doigts | Claires sur le film |
| Film transparent | Film immergé par erreur dans le fixateur en premier |
| Voile jaune | Révélateur épuisé ou trop faible |
| Voile brun | Fixateur épuisé ou trop faible |
| Température du révélateur trop basse | Image radiolaire |
| Température du révélateur trop haute | Image sombre |
| Cliché jaune clair | Lavage insuffisant |
Techniques Radiographiques en Odontologie Conservatrice
Paramètres Essentiels en Radiologie
- Temps d’exposition : Durée de l’émission des rayons X, influençant la densité et le contraste de la radiographie.
- Milliampérage (10 à 15 mA) : Quantité d’électrons bombardés par seconde, soit la quantité d’électricité passant dans le tube.
- Tension (70 kV) : Différence de potentiel entre l’anode et la cathode, déterminant la vitesse des électrons et la nature/quantité du rayonnement.
- Distance focale : Distance foyer-film, influençant l’intensité du rayonnement X selon la loi de Kepler (inversement proportionnelle au carré de la distance). Si la distance focale double, le temps de pose doit être multiplié par 4.
Techniques de Radiographie Intra-Orale (Conventionnelles)
Les radiographies intra-buccales couramment utilisées sont :
- Péri-apicale.
- Inter-proximale.
- Occlusale.
Techniques de Radiographie Péri-Apicale
Radiographie Préopératoire
Apporte des informations sur :
- L’allure générale de l’odonte au niveau radiculaire et canalaire.
- L’existence éventuelle de lésions péri-apicales ou latéro-radiculaires radiologiquement visibles.
Radiographie Per-Opératoire
Permet de contrôler les différentes phases du traitement :
- Radiographie avec limes en place : Définit la longueur de travail.
- Radiographie avec cônes de gutta en place : Contrôle ultime après la mise en forme des canaux et avant l’obturation.
- Autres clichés : En cas de difficultés (calcifications, recherche de canal, butée, négociation de courbure).
Radiographie Post-Opératoire
- Indispensable pour contrôler immédiatement la qualité des obturations canalaires.
- Permet de suivre l’évolution péri-apicale et parodontale, et de vérifier à long terme l’efficacité des traitements endodontiques.
Incidences Orthogonales
Utilisées avec la technique de la bissectrice ou des plans parallèles.
Technique de la Bissectrice (« Dieck Dite ») :
- Décrite en 1911, méthode ancienne pour clichés rétro-alvéolaires réalisés au fauteuil.
- Principe : Le rayon directeur est perpendiculaire à la bissectrice de l’angle formé par le grand axe de la dent et le plan du film (règle d’isométrie de Cieszinski). L’opérateur doit visualiser la position de la bissectrice.
Mise en place du film et technique d’angulations :
- Au maxillaire supérieur :
- Région des incisives et canines :
- Le film est appliqué contre le palais, le pouce du patient maintenant le film en contact avec le bord libre des incisives (dépassant de 5 mm).
- Le rayon principal est orienté perpendiculairement à la bissectrice virtuelle, centré sur le milieu de la dent.
- Région des prémolaires et molaires :
- Le film est placé horizontalement, maintenu par le pouce du patient.
- Le rayon principal est orienté perpendiculairement à la bissectrice de l’angle formé par le plan du film et l’axe de la dent.
- À la mandibule :
- Région des incisives centrales, latérales et canines :
- Le film est placé verticalement, dépassant le bord libre d’environ 5 mm.
- Le rayon principal est dirigé entre l’incisive centrale et latérale (ou centré sur la canine).
- Région des prémolaires et molaires :
- Le film est maintenu fermement contre la dent, sans le plier, après déplacement de la langue.
- Le rayon principal est orienté perpendiculairement à la bissectrice.
Technique des Plans Parallèles :
- Plus récente, perfectionnée par Fitzgerald, appelée technique du « long cône » ou « faisceaux parallèles ».
- Principe : Le film est maintenu en arrière et parallèle au grand axe de la dent. Le rayon directeur est perpendiculaire à la dent et à la surface du film, nécessitant une distance foyer-objet importante.
Mise en place du cliché et angulations :
- Utilisation d’angulateurs spéciaux avec un bloc de morsure maintenant le film parallèle à la dent, solidaire d’une tige métallique avec un anneau de visée.
- Le cône long est placé au contact de l’anneau, assurant le parallélisme entre la tige et le cylindre.
- Au maxillaire supérieur :
- Région des incisives et canines :
- Le film est positionné verticalement, à 2,5 cm en arrière des apex, parallèle au grand axe des incisives centrales.
- Maintenu par des rouleaux de coton, un abaisse-langue ou un porte-film en plastique.
- Le rayon principal est dirigé au-dessus de la région nasale, perpendiculaire aux dents et au film.
- Région des prémolaires :
- Le film est introduit horizontalement, sans toucher la langue ni le palais.
- Le rayon principal est orienté perpendiculairement avec une angulation de 30 à 40° (région sous-orbitaire).
- Région des molaires :
- Le film est positionné plus distalement.
- Le rayon principal est orienté perpendiculairement avec une angulation de 20 à 30° (arcade zygomatique).
- À la mandibule :
- Région des incisives :
- Le cône est orienté sur l’espace inter-proximal entre incisive centrale et latérale, perpendiculairement au film, avec une angulation de -15 à -20° (région sous-mentonnière).
- Région des prémolaires :
- Le cône est orienté sur l’espace inter-proximal des prémolaires, perpendiculairement, avec une angulation de -10 à -15° (milieu de la branche horizontale de la mandibule).
- Région des molaires :
- Le film est placé parallèlement aux dents, contre la face interne de la mandibule, dépassant le bord libre de 3 mm.
- Le rayon principal est orienté perpendiculairement sous l’angle de la mandibule, avec une angulation de 0 à -5°.
Comparaison entre les deux techniques :
- La technique des plans parallèles est préférée :
- Qualité supérieure des radiographies.
- Réduction des risques d’irradiation.
- Meilleure définition et rapports plus exacts entre les structures anatomiques voisines.
Incidences Particulières
- En complément d’un cliché orthogonal, une incidence latérale oblique (distale ou mésiale) est réalisée pour discriminer des structures contiguës (ex. : racines confondues).
Règle de Clark :
- La racine la plus éloignée du film subit le plus grand déplacement dans le sens du rayonnement.
- Pour une radiographie mésiale excentrée, le cône localisateur est placé à 20° mésialement par rapport à la position orthogonale.
Règle de Walton :
- Pour un cliché distalé, le tube est déplacé de 20° en distal dans le plan horizontal.
- Utilisé pour les molaires maxillaires pour éviter la superposition de l’os malaire sur les apex et repérer le 4e canal.
Règle de Slowey :
- Détecte les coudes vestibulaires ou palatins des incisives et canines.
- Si le coude se projette dans le sens du rayon principal, il s’agit d’un coude palatin (et inversement).
Radiographies Inter-Proximales (Bite Wing)
Définition
- Technique proposée par Raper en 1913, variante de la rétro-alvéolaire.
- Utilise des films horizontaux avec une ailette de papier mordue par le patient.
Intérêt de la Technique
- Visualisation des couronnes dentaires et de la partie supérieure des racines.
- Détection des caries proximales coronaires ou cervicales.
- Appréciation de la forme et du type du rebord alvéolaire, de la lamina dura et de l’espace desmodontal.
- Analyse des détails des restaurations et des modifications pulpaires.
Examen Occlusal
Définition
- Méthode ancienne, diffusée en France par Belot dès 1907.
- Utilise un film de 57 × 76 mm, dit « mordu », maintenu dans le plan occlusal par une légère morsure du patient.
- Complémentaire des incidences fondamentales (panoramique ou rétro-alvéolaire), offrant une 3e dimension horizontale du volume maxillo-dentaire.
Mise en Place du Film Occlusal et Procédés d’Angulation
- Le film est introduit en bouche dans le sens de sa plus grande dimension.
- Le patient serre les dents pour maintenir le film (comme pour mordre un sandwich).
- Le rayon directeur est :
- Orthogonal (clichés ortho-occlusaux).
- Oblique (clichés dysocclusaux) par rapport à l’axe du film.
Intérêt de la Technique
- Vision dans un plan perpendiculaire à celui de la panoramique dentaire sur un secteur limité.
- Visualisation de la morphologie d’une dent, de la position d’une dent incluse, ou du secteur d’un traumatisme dentaire.
- Analyse des rapports d’une lésion osseuse.
Techniques Extra-Orales
Panoramique Dentaire
Méthode d’exploration radiographique permettant d’obtenir sur un seul film, avec une faible exposition, l’image des arcades dentaires et des articulations temporo-mandibulaires (ATM).
Avantages :
- Examen complet de l’appareil masticatoire, incluant les ATM et les sinus maxillaires.
- Analyse des anomalies fonctionnelles ou morphologiques et de leur répercussion sur l’appareil masticatoire.
- Cliché d’ensemble pour la planification et l’évaluation des traitements.
- Réduction de l’exposition du patient grâce à une stratégie d’exploration rationnelle.
Techniques de Radiographie Numérique
Radiovisiographie (RVG)
Système d’imagerie numérisée, rapide, à faible dose, obtenu à l’aide d’une petite sonde intra-orale.
Composants :
- Source de rayons X.
- Capteur des rayons X.
- Unité de traitement.
Avantages de la RVG :
- Solidité des capteurs.
- Faible coût d’entretien grâce à des protections à usage unique.
- Image instantanée à l’écran.
- Lecture plus précise grâce au zoom.
- Exposition moindre aux rayons X.
- Représentation dimensionnelle en couleur.
- Conservation des données par patient.
- Envoi des radiographies par e-mail pour l’échange d’informations.
- Inversion du contraste et visualisation en couleur.
- Pivotement de l’image en 3D.
- Mesure de la longueur de travail.
Cône Beam
Le « Cone Beam » utilise le principe de la tomographie volumétrique. Un faisceau de rayons X conique est capté par une surface de détection étendue. La source de rayons X et la surface de détection réalisent une rotation synchrone de 360° autour de la tête du patient.
Perspectives du Cone Beam :
- Détermination du nombre de racines et de canaux.
- Détection des fêlures et fractures radiculaires.
- Mise en évidence des résorptions radiculaires.
- Diagnostic précoce des lésions péri-apicales.
- Détermination de l’étendue des lésions maxillaires d’origine dentaire et de leurs rapports avec les éléments anatomiques.
Mesures de Radioprotection
- Tabliers de protection : Protègent les femmes enceintes et le personnel des rayons X.
- Position de sécurité : Se tenir entre 90° et 135° par rapport au faisceau, si possible derrière le patient.
- Distance de la source : S’éloigner d’au moins 2 mètres de la source de rayons.
Voici une sélection de livres:
- Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché
- Concepts cliniques en odontologie conservatrice
- L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement
- Guide clinique d’odontologie
- Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve
- La photographie en odontologie: Des bases fondamentales à la clinique : objectifs, matériel et conseils pratique

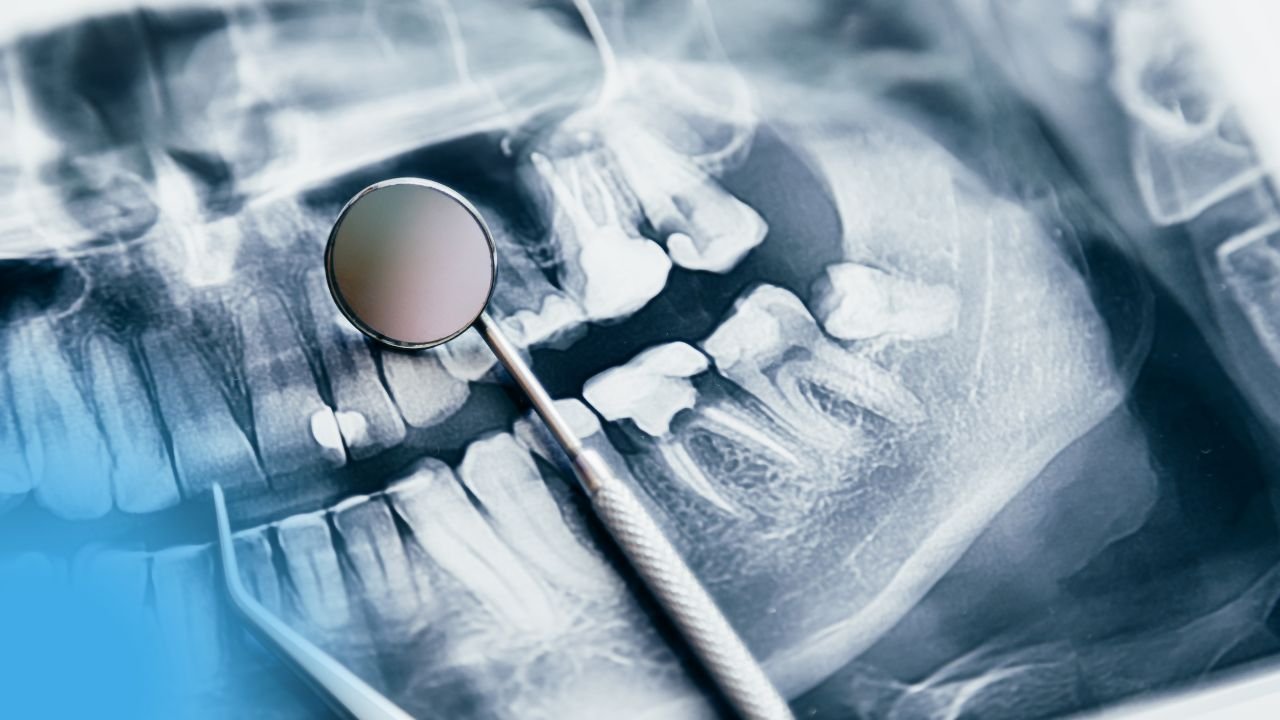


Leave a Reply