Histologie de la muqueuse linguale
Histologie de la muqueuse linguale
Introduction
La langue est un organe très différencié, qui intervient non seulement dans la fonction du goût mais aussi dans la parole et la mastication. Elle est attachée au plancher de la cavité buccale. La langue est limitée par la muqueuse linguale.
Histologie
La muqueuse est constituée :
- D’un épithélium épidermoïde, pluristratifié pavimenteux non kératinisé.
- D’une membrane basale, elle se caractérise surtout par la présence des papilles linguales et les bourgeons du goût.
- D’un chorion, irrégulièrement festonné de papilles conjonctives qui soulèvent plus ou moins l’épithélium pour former des papilles filiformes, fungiformes ou caliciformes. Ces papilles peuvent être plus ou moins nombreuses suivant les préparations examinées. Le chorion est abondamment vascularisé, riche en leucocytes. Dans sa partie profonde, on peut voir de nombreux acinus séreux correspondant aux glandes salivaires linguales.
Elle présente un aspect variable suivant la région considérée :
- Sous la langue et les bords, la muqueuse est lisse et l’épithélium est relativement mince.
- Au niveau du frein, il s’infléchit et devient l’épithélium du plancher buccal. Cet épithélium repose sur un chorion dense.
- Sur la face supérieure, la muqueuse est épaisse, et elle se caractérise surtout par la présence de différenciations : les papilles linguales et des bourgeons du goût.
Les papilles linguales
On décrit trois types différents de papilles linguales selon leur structure morphologique et leur topographie : les papilles filiformes, fungiformes et caliciformes.
Papilles filiformes
- Sont dispersées sur toute la surface et confèrent au dos de la langue son aspect râpeux.
- Longues, minces et rectilignes, supportées par un axe papillaire conjonctif unique.
- L’extrémité subit une pseudo-kératinisation.
- Elles ne contiennent pas de bourgeons du goût.
- Elles ont un rôle mécanique : forment une surface râpeuse sur le dos de la langue pour limiter le glissement des aliments lors de la mastication.
Papilles fungiformes
- En forme de champignon, comme leur nom l’indique.
- Plus grosses que les papilles filiformes mais prédominent sur les bords de la langue.
- Un plexus vasculaire est présent sous l’épithélium, expliquant l’aspect macroscopique de ces papilles qui apparaissent sous forme de points plus rouges sur la surface de la langue.
- Elles présentent, en moins grand nombre et de façon variable selon les espèces, des bourgeons du goût analogues à ceux observés au sein de l’épithélium des papilles caliciformes.
Papilles caliciformes ou circumvallées
- Appelées le V lingual, elles sont au nombre de 9 à 12. Elles sont disposées en forme de V à la base de la langue.
- Elles sont volumineuses.
- Elles sont enfoncées dans la muqueuse. Contrairement aux papilles précédentes, elles ne dépassent pas à la surface de la langue et sont entourées d’une dépression, d’un sillon circulaire, le vallum, au fond duquel débouchent les canaux excréteurs de glandes séreuses microscopiques : les glandes de Von Ebner.
Bourgeons du goût
Formations intra-épithéliales de forme ovoïde ; ce sont des chémorécepteurs. Ils sont contenus dans les papilles fungiformes et les papilles caliciformes. Ils sont constitués de plusieurs types de cellules :
- Des cellules fusiformes et claires qui ont valeur de cellules de soutien (il existe aussi des cellules plus basales, probablement impliquées dans le renouvellement).
- D’autres cellules fusiformes plus sombres sont les cellules sensorielles qui font synapse avec des afférences nerveuses à leur pôle basal. Le pôle apical des cellules sensorielles possède un pinceau de longues microvillosités qui portent les récepteurs membranaires du goût.
Les microvillosités de l’extrémité des cellules sensorielles convergent vers un mince pertuis qui constitue l’ouverture du bourgeon du goût vers la lumière du vallum : le pore gustatif.
Au fond du vallum, par l’intermédiaire de canaux excréteurs épithéliaux unistratifiés, débouchent des glandes plus profondes, dont les acinis sont dispersés entre les travées conjonctives séparant les faisceaux des muscles striés squelettiques de la langue. Il s’agit des glandes de Von Ebner. De nature séreuse préférentielle, les glandes de Von Ebner participent à la vidange du vallum et des particules alimentaires qui peuvent y pénétrer.
Histologie de la muqueuse linguale
Voici une sélection de livres:
Parodontologie Relié – 1 novembre 2005
Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011
Parodontologie Broché – 19 septembre 1996
MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE
Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient
Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé
Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1
Endodontie, prothese et parodontologie
La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

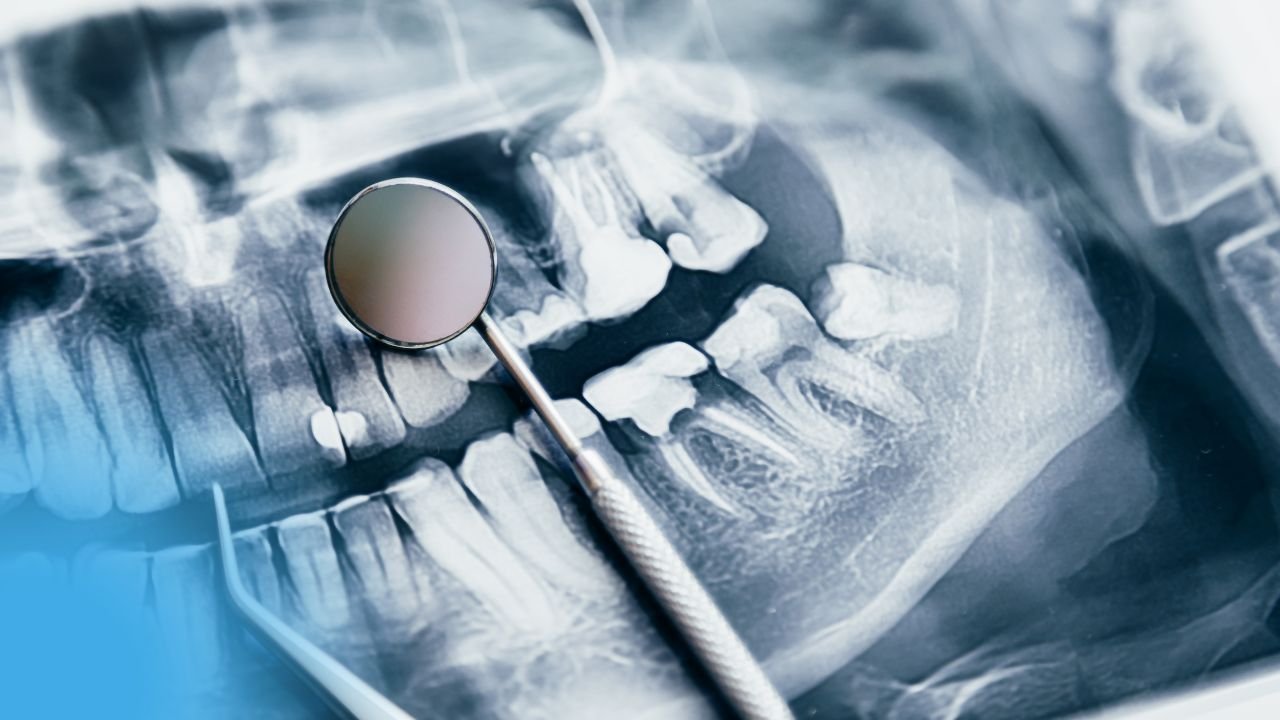


Leave a Reply