Généralités et terminologie en implantologie
Généralités et terminologie en implantologie
Généralités et terminologie en implantologie
Introduction
Remplacer des dents perdues par un artifice prothétique a été une préoccupation humaine depuis l’aube des temps. De nombreuses découvertes archéologiques l’attestent, tout au long de l’histoire des hommes et en tous lieux. Les artifices sont d’origines variées : minérale, animale et humaine.
Historique
Six périodes distinctes caractérisent l’évolution de l’implantologie (McKinney, 1991) :
1. Période antique (avant J.-C. à 1000 après J.-C.)
Les premières implantations de dents sont effectuées au temps des dynasties de l’Égypte ancienne et des cultures précolombiennes. Des traces de cette période ont été retrouvées également en Amérique latine et centrale (Mayas, Aztèques, Incas) et au Moyen-Orient.
Les dents utilisées étaient celles des animaux ou sculptées dans l’ivoire. Dans la culture égyptienne, l’édentement des défunts était traité avant de procéder à la momification.
2. Période médiévale (de 1000 à 1800)
Durant cette période, l’implantologie était limitée aux transplantations. En Europe, la transplantation était réalisée d’un patient à un autre. Les dents étaient prélevées chez des individus appartenant aux couches sociales défavorisées.
3. Période fondamentale (de 1800 à 1910)
L’implantologie endo-osseuse commence véritablement à cette époque en Amérique du Nord. Les matériaux utilisés étaient l’or, le bois et les métaux (platine, argent, étain).
La prothèse était réalisée seulement après cicatrisation tissulaire. Les principes de biocompatibilité et de stabilité furent élaborés. Berry, en 1888, insistait sur la nécessité d’une stabilité immédiate de l’implant et l’utilisation de matériaux sûrs, évitant toute transmission de maladie.
4. Période prémoderne (de 1910 à 1930)
Payne et Greenfield sont les précurseurs de l’implantologie. En Amérique du Nord, l’or et la porcelaine étaient utilisés.
Greenfield introduisit une technique suggérant une mise en fonction différée de l’implant (6 à 8 semaines). Il établit le premier protocole scientifique vers 1910 et insista sur l’importance d’un contact étroit os-implant. Les notions de chirurgie propre et de mise en fonction différée furent évoquées.
5. Période moderne (de 1930 à 1978)
Cette période est caractérisée par l’étude de différents biomatériaux ainsi que par l’introduction d’innovations chirurgicales et prothétiques. En Europe et en Amérique du Nord, porcelaine, vitallium et titane étaient utilisés. Trois types d’implants furent mis au point :
Implants endo-osseux I
Adams préconisa un implant enfoui en forme de vis avec un capuchon de cicatrisation. En 1939, Strock créa un implant vis en vitallium, puis mit au point, avec son frère, l’implant endodontique.
Implants sous-périostés
Ils furent mis au point en 1941 par Dahl en Suède. Ils avaient des formes standard de grande étendue après prise d’empreinte chirurgicale et étaient localement adaptés en fonction de la situation osseuse rencontrée.
Implants endo-osseux II
À partir des années 1940, différentes formes d’implants furent créées. L’implant hélicoïdal en spirale en acier inoxydable ou en tantale (Formiggini, 1947). Chercheve, en 1962, élabora un implant en double hélice spirale accompagné d’un kit chirurgical pour son insertion.
Scialom fut le promoteur d’un implant en trépied (implant aiguille). Les trois parties du trépied se réunissaient pour supporter la prothèse.
En 1967, Linkow introduisit l’implant-lame en titane, puis en alliage de titane. Au début des années 1970, des implants en céramique frittée et en carbone vitrifié furent réalisés.
L’implantologie des années 1950 à 1970 fut celle de tous les essais et de toutes les erreurs. À cette époque, l’obtention d’une interface fibreuse péri-implantaire était souhaitée. Le but était de mimer le ligament alvéolo-dentaire afin d’amortir les chocs à l’interface. De ce fait, l’ankylose, avec son contact direct os-implant, était considérée comme un handicap dans le pronostic implantaire.
Juillet mit au point l’implant tridimensionnel, qui nécessitait un placement latéral à travers la table corticale vestibulaire.
6. Période contemporaine (ostéo-intégration ou période Brånemark)
Régions : Amérique du Nord, Europe
Matériaux utilisés : titane, alliage de titane, hydroxyapatite, céramique
Les premières recherches sur l’intégration tissulaire des matériaux furent réalisées en Suède au début des années 1950. Un premier protocole clinique fut mis au point pour l’animal afin de tester la restauration d’un édentement obtenue à l’aide d’une prothèse fixée. Des chiens partiellement édentés furent traités à l’aide de prothèses implanto-portées. Les fixtures étaient préalablement mises en nourrice pour obtenir une période de cicatrisation osseuse de 3 à 4 mois.
7. Période post-Brånemarkienne
Quelques études cliniques et animales publiées au début des années 1990 montrèrent qu’une mise en charge immédiate des implants pouvait conduire à un taux élevé d’ostéo-intégration.
Terminologie
Ostéo-intégration
Définie par Brånemark et al. (1985) comme étant une jonction anatomique et fonctionnelle directe entre l’os vivant remanié et la surface de l’implant mis en charge.
L’édifice implantaire est généralement constitué de deux parties :
- Une partie endo-osseuse appelée implant.
- Une partie émergeant dans la cavité buccale, appelée pilier. Celui-ci est relié à l’implant par un système d’attachement.
Implant dentaire
L’implant est constitué de trois parties :
- Col de l’implant
- Corps de l’implant
- Apex
Cette séparation en différentes parties permet de simplifier la description d’un implant et de les classer en différentes familles.
1. Col de l’implant
Le col de l’implant est la partie qui réalise la connexion avec le pilier. Il constitue une zone de jonction et sa fonction est d’organiser harmonieusement la transition entre les éléments adjacents.
2. Corps de l’implant
Le corps implantaire est la partie la plus étendue de l’implant, située entre le col et l’apex. Il définit la silhouette de l’implant et contient les spires qui en assurent la stabilité primaire.
3. Apex
L’apex est la partie terminale de l’implant, prolongeant et terminant le corps. Cette partie peut être soit active (sécante), soit passive (arrondie).
Bibliographie
- Manuel d’implantologie clinique : Concept, protocoles et innovations récentes, 2e édition, M. Davarpanah, S. Szmukler-Moncler, P. M. Khoury, B. Jakubowicz-Kohen, H. Martinez.
- Accéder à l’implantologie, Patrick Missika, Anne Benhamou, Isabelle Kleinfinger, édition CDP, Collection JPIO Formation continue du chirurgien-dentiste.
Voici une sélection de livres:
- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011
- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996
- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE
- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient
- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé
- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1
- Endodontie, prothese et parodontologie
- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020
- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

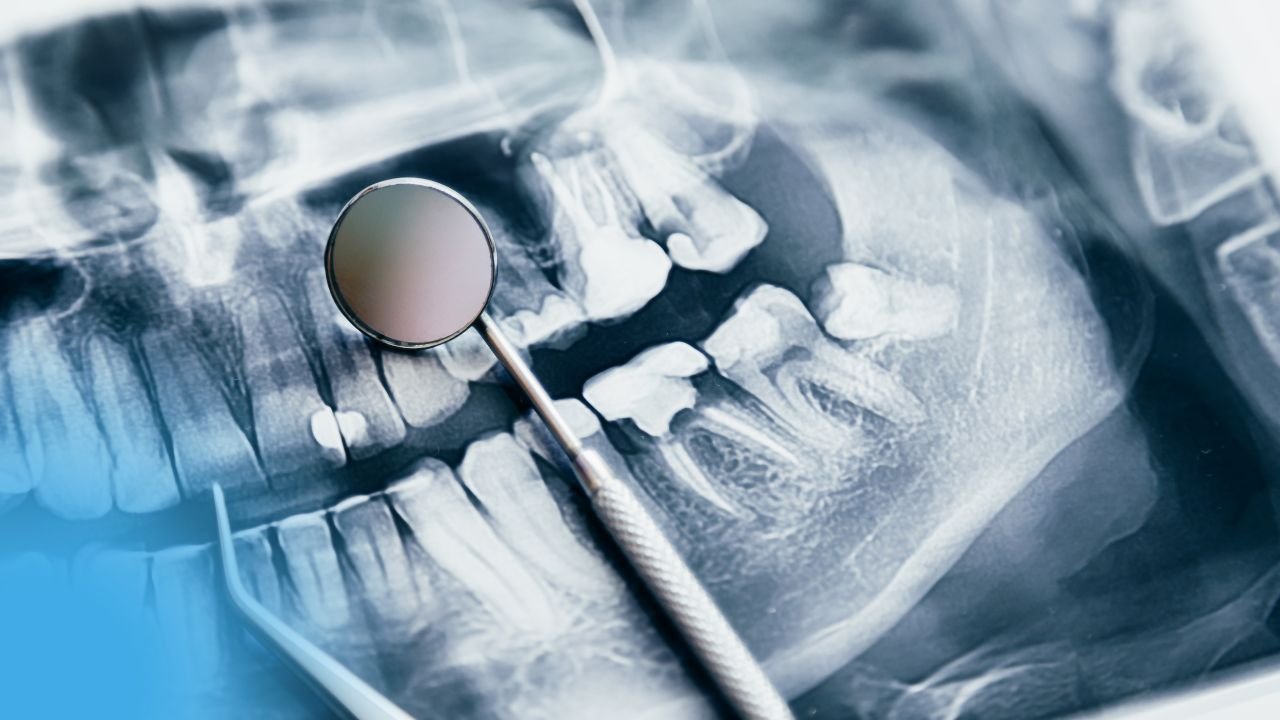


Leave a Reply