FORMATION DE L’IMAGE RADIOLOGIQUE
FORMATION DE L’IMAGE RADIOLOGIQUE
Les différentes densités en radiologie
- Les différentes densités en radiologie. –
Un cliché radiographique comporte une échelle de densité allant du blanc au noir. Ces différentes densités résultent de l’absorption différentielle des rayons X par les milieux traversés. Ce phénomène d’absorption est fonction de la masse atomique du milieu traversé :
- – Les molécules comportant des atomes lourds : calcium, iode, baryum, vont se comporter vis-à-vis des rayons X, comme un écran les empêchant plus ou moins d’atteindre le film ; la conséquence au point de vue radiographique est une plage plus ou moins blanche ;
- – A l’opposé, s’il n’y a que de l’air interposé entre le tube à rayon X et le film, celui-ci sera impressionné au maximum donnant une surface noire
- Dans le corps humain, du point de vue radiographique, entre les dentés extrêmes que sont l’os, densité calcique, et l’air, densité aérique, se placent les densités hydriques et graisseuses qui sont intermédiaires. Sont de densité hydrique les muscles, les vaisseaux, les différents parenchymes, foie, rate, reins, etc.
La relativité des différentes densités
radiologique
- La relativité des différentes densités radiologique.-
L’image radiographique d’une structure dépend du milieu qui sert de
référence.
Suivant le milieux de référence, certaines images seront visible ou invisible : une métastase hépatique de même tonalité hydrique que le reste du parenchyme, hépatique, n’est pas visible sur l’abdomen sans préparation. Par contre, une métastase pulmonaire sera évidente car la tonalité hydrique de la métastase apparaît sur la clarté aérique du poumon.
- Sur des clichés sans préparation, au sein des structures de densité hydrique, qui sont blanches, la graisse apparaît plus ou moins grise :
- Au niveau des psoas ou elle dessine le contour externe des muscles,
- Au niveau des reins dont elle souligne la silhouette.
- Au niveau des articulations, ou les bourses graisseuses péri-articulaires sont souvent visibles, permettant parfois d’affirmer l’existence d’un épanchement intra-articulaire
L’absorption dépend de l’épaisseur des
milieux traversés par le faisceau de rayons X.
- L’absorption dépend de l’épaisseur des milieux traversés par le faisceau de rayons X. —Il évident qu’en présence de deux structures identiques l’image sera plus blanche du coté le plus épais.
- Cette notion d’épaisseur permet d’expliquer la visibilité de certaines structures peu épaisse ; ainsi, au niveau du poumon les scissures sont de tonalité hydrique et ont une épaisseur inférieure à un millimètre. Sur un cliché thoracique de face, seule la petite scissure est visible, car situé horizontalement dans le sens du rayon directeur. Elle se comporte ainsi au point de vue absorption, comme une épaisseur d’eau de plusieurs centimètres, par contre, la grande scissure abordée presque perpendiculairement par le rayonnement, se comporte comme un millimètre d’eau et ne pourra pas être visible. La visibilité de la petite scissure de face est inconstante ; en effet, il suffit d’une très faible variation de la position de la scissure, par rapport au rayonnement incident, pour que celle-ci s’efface sur le cliché.
- Le même phénomène de tangence explique qu’une bronche soit invisible dans le parenchyme pulmonaire; en effet, ses parois sont fines, elle contient de l’air et est entouré d’air. La bronche ne devient visible, à l’état normal, que lorsque le conduit est vu en fuite sur une certaine longueur, elle apparaît alors comme un fin anneau blanc entouré d’air des deux cotés.
Conditions pour qu’il existe une
image de bord sur une radiographie.
- Conditions pour qu’il existe une image de bord sur une radiographie. —
Sur un cliché radiographique, peut se définir comme la séparation existante entre deux plages de tonalité différente. Fait important, l’œil n’est sensible qu’à des variations brutales de densité. Les variations progressives sont très difficiles à apprécier.
- Pour qu’il se forme un bord entre deux milieux, il faut qu’il existe une brusque variation de l’absorption entre ces deux milieux. Pour que cette variation d’épaisseur soit brutale, il faut que la zone où se produit cette variation soit abordée tangentiellement par le rayonnement
- Ainsi sur un cliché de thorax de face, chez une femme, l’ombre des seins est visible sous la forme de deux opacités limitées en bas par un contour net. Ce contour inférieur net est créé par une zone de tangence au niveau du sillon sous mammaire entre le sein (structure de tonalité hydrique) et l’air extérieur. Si l’on soulève le sein, il est possible de supprimer la zone de tangence et par la même le contour inférieur. A signaler que seul ce contour inférieur disparaît, il n’existe pas d’hyperclarté à ce niveau, car l’épaisseur de tissu traversé reste la même des deux cotes. Ceci est différent d’une mammectomie qui entraîne par contre une hyperclarté du coté où l’exérèse chirurgicale a été pratiquée.
Condition pour qu’il existe une ligne
radiologique.
- Condition pour qu’il existe une ligne radiologique. — Contrairement à un bord qui ne nécessite qu’une variation brusque de densité, une ligne suppose deux variations brusques de densités. Ainsi, dans le poumon, les scissures qui sont des feuillets de densité hydrique peu épais, peuvent apparaître sous la forme de fines lignes blanches sur la radiographie si le rayonnement incident est parallèle à ces structures. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, l’absorption dépend de l’épaisseur du milieu traversé par le faisceau de rayons X.
Le signe de la silhouette.
- Le signe de la silhouette. —
Comme nous venons de le voir, les images de bords visibles sur les clichés représentent des interfaces entre
deux zones de densités différentes abordées tangentiellement par le rayonnement incident.
- De même, deux structures de tonalité identique situées dans des plans différents, vont entraîner, en se superposant des images de bords distinctes. Ce phénomène de sommation des images est facile à reproduire sur un négatoscope : une feuille de papier placée sur un négatoscope donne une plage grise, si deux feuilles sont placées de façon rigoureusement jointive, aucune ligne ne les sépare (deux structures de tonalité identique au contact l’une de l’autre apparaissent confondues). Par contre, si les deux feuilles sont dans des plans différents, si elles se superposent en partie, il apparaît une image de sommation et les bords des deux feuilles sont visibles.
- Ainsi, une opacité parenchymateuse située au contact de la silhouette cardiaque effacera le bord du cœur. Par contre, si une opacité se projette sur la silhouette cardiaque mais sans effacer les bords, cela signifie qu’elle n’est pas située dans le même plan et par conséquent qu’elle est postérieure car la masse cardiaque est située dans la portion antérieure du thorax.
- Deux structures de tonalité identique au contact l’une de l’autre ne sont séparées par aucun bord et apparaissent confondues (l’eau dans l’eau est invisible). Par contre, deux opacités hydriques situées dans des plans différents conservent leurs contours, ainsi sur un cliché du thorax de face en haute tension, le bord gauche de l’aorte descendante est visible à travers la masse cardiaque, en effet, le cœur est en avant dans le thorax et l’aorte descendante est en arrière au contact de l’air du poumon gauche. Pour que le bord gauche de l’aorte soit visible, il est nécessaire d’avoir un cliché de thorax de face en haute tension (en basse tension, la totalité des rayons peut être arrêtée par le cœur, la silhouette cardiaque est blanche et l’on ne voit rien à
travers le cœur).
Le signe de la silhouette.
- Ce signe de la silhouette permet sur un cliché de thorax de profil de repérer les coupoles :
- la coupole droite est visible sur toute sa longueur ; en effet elle sépare la masse hydrique du foie en bas de clarté aérique du poumon droit en haut ;
- à gauche, en avant le cœur, qui est de tonalité
hydrique, vient s’appuyer sur la coupole diaphragmatique. Les deux structures étant de même tonalité hydrique aucune ligne ne les sépare ; ainsi la coupole gauche s’efface en avant au contact du cœur.
La trame pulmonaire
- La trame pulmonaire. —
sur un cliché du thorax de face, la visibilité de certaines structures ne dépend que du milieu qui les entoure :
- La trachée, conduit aérien est visible au sein de la masse médiastinale. A l’opposé, les vaisseaux pulmonaires ne sont visibles que par contraste sur l’air du parenchyme pulmonaire. Les vaisseaux intramédiastinaux et les bronches intra-parenchymateuses sont invisibles.
- – la trachée et l’origine des bronches souches sont visibles ; en effet, elles sont de tonalité aérique au sein de la masse hydrique du médiastin. Les bronches plus distales ne sont pas visibles, car leurs lumières contiennent de l’air et elles cheminent dans le parenchyme rempli d’air. Les parois bronchiques elles-mêmes sont trop minces pour être visibles. Cependant, dans la région juxta-hilaire, lorsqu’une bronche à un trajet de quelques centimètres parallèle à celui du rayonnement incident, les parois bronchiques ainsi enfilées deviennent visibles sur le cliché sous la forme d’un mince anneau blanc entouré d’air de part et d’autre. La branche de l’artère pulmonaire satellite est elle aussi visible pour les mêmes raisons sous la forme d’une pastille blanche. Ainsi est réalisée la classique image en lunette borgne ;
- – A l’opposé, les vaisseaux pulmonaires sont confondus au sein de la masse médiastinale car ils sont de tonalité hydrique. Dans le parenchyme pulmonaire, la vascularisation pulmonaire réalise la trame vasculaire qui normalement est visible jusqu’à un centimètre de la périphérie du poumon (à l’extrême périphérie les vaisseaux pulmonaires sont trop fin calibre pour être visibles sur les clichés).
- Dans certains cas pathologiques les alvéoles pulmonaires sont remplies de liquide. Les bronches intrapulmonaires, qui ont une charpente cartilagineuse, restent pleines d’air. Ainsi se forme le bronchogramme aérien : les bronches de densité aérique apparaissent sous la forme de petites traînées noires au de l’opacité hydrique. Ce bronchogramme aérien affirme la nature parenchymateuse de l’opacité et traduit l’existence d’une condensation pulmonaire par comblement des alvéoles.
La projection des images sur un plan.
- La projection des images sur un plan. — La radiographie consiste à projeter sur le plan du film la somme de toutes les structures rencontrées.
- – Si, sur un cliché d’abdomen de face, l’opacité d’une pièce monnaie se projette sur l’estomac, il n’est pas possible de dire si cette pièce de monnaie est dans l’estomac ou sur la peau, sauf si l’on a examiné le patient ou si l’on dispose d’un cliché de profil.
- De même, une tumeur cutanée (une verrue par exemple), siégeant sur la face antérieure du thorax, donnera (dans la mesure ou elle est silhouettée par l’air extérieur) la même image qu’une tumeur intrapulmonaire silhouettée par l’air des poumons.
- La projection sur plan peut « raccourcir » certaines structures. Ainsi, la portion horizontale de la crosse aortique forme de face le bouton aortique. Seule l’OAG, déroule complètement la crosse aortique.
FORMATION DE L’IMAGE RADIOLOGIQUE
Voici une sélection de livres:
Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché
Concepts cliniques en odontologie conservatrice
L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement
Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve


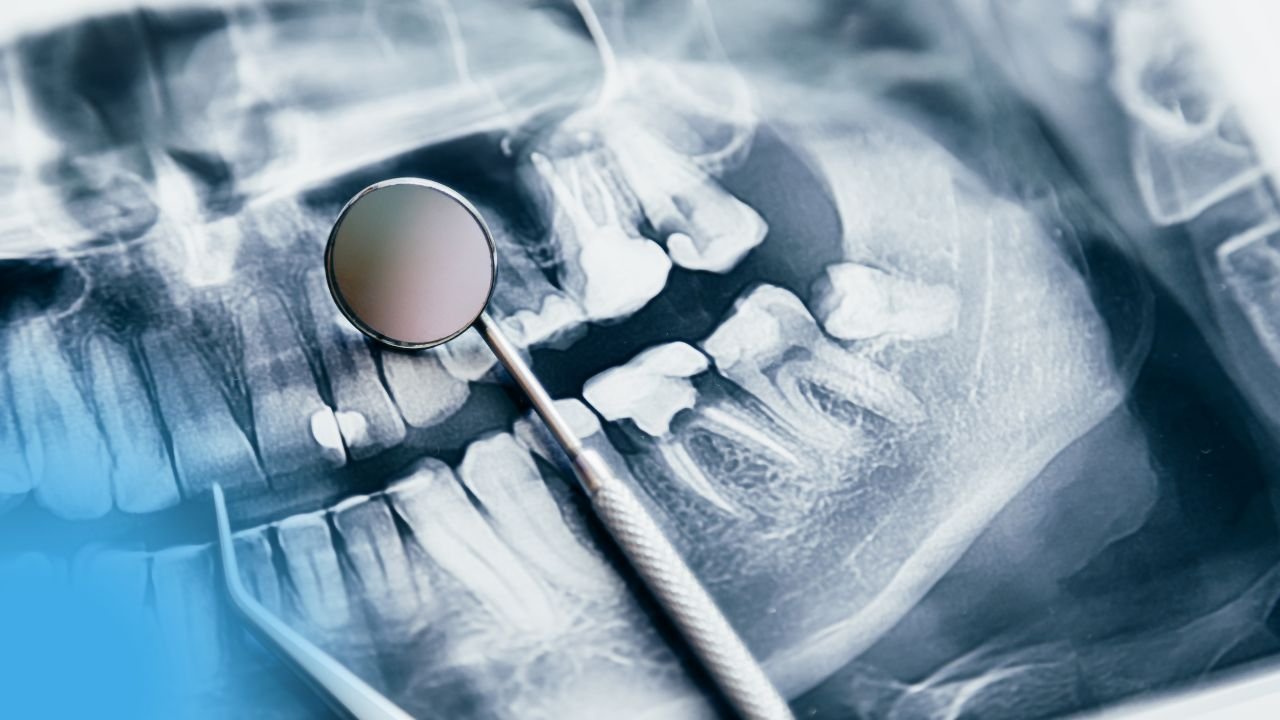

Leave a Reply