Ethique et odontologie
Ethique et odontologie
Objectifs pédagogiques
- Définir les différents concepts de l’éthique.
- Connaître les principes de l’éthique médicale.
Plan
- Introduction
- Définitions
- La morale
- L’éthique
- L’éthique médicale
- La bioéthique
- La déontologie
- Les principes de l’éthique médicale
- Qui décide de ce qui est éthique ?
- Conclusion
Introduction
Le code de déontologie médicale, la loi sanitaire et les concepts éthiques d’Hippocrate visent à garantir et à renforcer les droits des personnes malades et des usagers du système de santé. Ils donnent au malade un véritable pouvoir de décision. Les dispositions de ces principes éthiques, déontologiques et juridiques tentent de rétablir les relations de confiance entre les médecins et les malades en insistant sur :
- Le droit à la confidentialité,
- Le respect de la dignité humaine,
- La vérité due au malade.
Il s’agit là de valeurs intemporelles, universelles, qui ne dépendent pas des circonstances. La « société médicale » ne diffère pas du reste de la société ; elle a donc besoin, pour son fonctionnement, d’un certain nombre de règles lui permettant de s’organiser. Ces règles sont :
- Sociales (Droit),
- Corporatistes (déontologie),
- Professionnelles (éthique),
- Personnelles (morale).
Définitions
La morale
Le terme « morale » désigne l’ensemble des règles, d’actions et des valeurs qui fonctionnent comme normes dans une société. La morale réfère à un ensemble de valeurs et de principes qui permettent de différencier le bien du mal, le juste de l’injuste, l’acceptable de l’inacceptable, et auxquels il faudrait se conformer. Ces principes varient selon :
- La culture,
- Les croyances,
- Les conditions de vie,
- Les besoins de la société.
Ils ont souvent pour origine ce qui est positif pour la survie de l’ethnie, du peuple ou de la société. Certains auteurs distinguent la morale du terme éthique, tandis que d’autres les considèrent comme synonymes.
L’éthique
Le mot « éthique » vient étymologiquement du grec « ETHOS », qui signifie manière d’être et de se comporter selon les mœurs. L’éthique est la science et l’étude de la morale valide pour un groupe social à un moment donné. Elle ne constitue pas un ensemble de valeurs ni de principes en particulier, mais plutôt une réflexion argumentée en vue du bien-agir. Elle propose de s’interroger sur les valeurs morales et les principes moraux qui devraient orienter nos actions dans différentes situations, dans le but d’agir conformément à ceux-ci. L’éthique porte sur :
- Le bon et le mauvais comportement,
- Ce qu’il faut faire et ce qu’il faudrait s’abstenir de faire.
L’éthique médicale
L’éthique médicale est la partie de l’éthique consacrée aux questions morales relatives à la pratique médicale. Elle s’intéresse principalement aux problèmes soulevés par l’exercice de la médecine. Elle se réfère aux valeurs humaines qui doivent conditionner l’action du médecin-dentiste. Elle définit ainsi le comportement médical, et sa finalité est le bien commun et la bonne prise en charge médicale du patient.
La bioéthique
La bioéthique est une réflexion sur les progrès de la recherche dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. L’article 354 de la loi n° 18-11 du 02/07/2018 relative à la santé (LRS) définit la bioéthique comme étant « l’ensemble des mesures liées aux activités relatives :
- À la transplantation et à la greffe d’organes, de tissus et de cellules,
- Au don et à l’utilisation du sang humain et de ses dérivés,
- À l’assistance médicale à la procréation,
- À la recherche biomédicale. »
La déontologie
La déontologie signifie simplement l’éthique appliquée à un champ professionnel. Elle regroupe l’ensemble des règles qui régissent l’exercice d’une fonction professionnelle. C’est une discipline dont l’objet est l’étude des normes de comportement professionnel spécifiques aux professions de la santé. Elle s’exprime le plus souvent à travers « un code professionnel », qui, en médecine dentaire, est l’exposé des règles de bonne conduite envers :
- Les malades,
- Les familles,
- Les confrères,
- Les collaborateurs,
- La société.
Ce code constitue le code de déontologie médicale.
Les principes de l’éthique médicale
Respect de la dignité humaine
Les patients doivent être traités avec respect et dignité tout au long du processus de prise en charge. Cela inclut :
- Le respect de leur intégrité physique et psychologique,
- Le respect de leur vie privée et familiale.
La justice, l’équité et la non-discrimination
Le principe de la justice stipule que des patients dans des situations semblables devraient avoir accès aux mêmes soins. Les malades doivent être traités de manière équitable, sans distinction de :
- Race,
- Religion,
- Origine nationale,
- Appartenance politique ou sociale,
- Ou autres critères similaires.
L’article 7 du code de déontologie médicale stipule :
« La vocation du médecin et du chirurgien-dentiste consiste à défendre la santé physique et mentale de l’homme et à soulager la souffrance dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine sans discrimination de sexe, d’âge, de race, de religion, de nationalité, de condition sociale, d’idéologie politique ou toute autre raison, en tant de paix comme en temps de guerre. »
Le respect de l’autonomie du patient
L’autonomie désigne la capacité de penser, de décider et d’agir librement de sa propre initiative. Chaque personne a le droit de prendre les décisions qui la concernent, notamment celle d’accepter ou de refuser le traitement qui lui est proposé. De ce principe découle le devoir d’informer le patient et de recueillir son consentement, devoir explicitement énoncé dans :
- Les articles 43 et 44 du code de déontologie,
- L’article 343 de la loi relative à la santé,
- La déclaration de l’AMM (Association mondiale médicale) sur les droits du patient.
Le respect du processus de décision : l’information et le consentement aux soins
La loi insiste sur le droit du patient à recevoir une information claire, loyale, complète, intelligible, appropriée et continue avant tout acte médical, dans une perspective de consentement éclairé. Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé, hormis deux situations (article 344 de la loi relative à la santé) :
- L’urgence ou l’impossibilité d’informer, qui dispense le professionnel de cette obligation.
- La volonté explicite du malade de ne pas être informé.
L’information doit porter sur :
- Les différentes investigations, traitements, actions de prévention proposés ;
- Le contenu des actes envisagés : leur utilité, leur urgence éventuelle ;
- Les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ;
- Les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus.
L’information du patient constitue l’étape préalable à l’obtention de son consentement. Le patient capable de discernement décide du déroulement, de l’interruption ou du renoncement à une mesure médicale proposée, après en avoir été informé de façon complète et adaptée (consentement libre et éclairé).
Le secret médical
Le patient confie ses secrets avec la certitude qu’ils ne seront pas trahis, que le médecin ne les révélera pas à des tiers, même après sa mort. C’est la base de la relation médecin-malade.
La compassion
La compassion, définie comme la compréhension et la sensibilité aux souffrances d’autrui, est essentielle à la pratique de la médecine. Pour traiter les problèmes du patient, le médecin doit :
- Reconnaître les symptômes et leurs causes sous-jacentes,
- Vouloir aider le patient à obtenir un soulagement.
Les patients répondent mieux au traitement s’ils sentent que le médecin est sensible à leur problème et qu’il soigne leur personne plutôt que leur seule maladie.
La bienfaisance
La bienfaisance consiste à promouvoir ce qui est le plus avantageux pour le patient. Le principe moral général de faire du bien aux autres est mis à l’avant-plan dans une relation professionnelle attentionnée. La définition de ce qui est « le plus avantageux » peut reposer sur :
- Le jugement du professionnel de la santé,
- Les désirs du patient.
Généralement, ces deux opinions concordent.
La non-malveillance
La non-malveillance vise à éviter de causer un préjudice. La plupart des traitements entraînent un certain degré de risque ou des effets secondaires. Ce principe rappelle de réfléchir au préjudice possible, surtout lorsque le patient ne peut pas être guéri. Une thérapeutique n’est justifiée que si ses bénéfices attendus pour le patient sont proportionnés par rapport à l’agressivité du traitement.
La compétence
Les médecins ont l’obligation d’assurer des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises et actuelles de la science. La compétence est à la fois attendue et exigée des médecins. Le manque de compétence peut avoir des conséquences graves, voire entraîner la mort. Les médecins reçoivent pour cela un enseignement long, destiné à acquérir :
- Un niveau de connaissances scientifiques,
- Des compétences techniques,
- Des connaissances, compétences et comportements éthiques.
Qui décide de ce qui est éthique ?
En Algérie, la loi n° 18-11 du 2 juillet 2018 relative à la santé fixe les dispositions générales relatives à l’éthique médicale au titre VII en créant le conseil national de l’éthique des sciences de la santé. Ce conseil siège à Alger et est composé des membres suivants :
- Un représentant du ministre de la défense nationale ;
- Un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ;
- Un représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
- Un représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
- Deux (2) représentants du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
- Dix-neuf (19) professeurs hospitalo-universitaires désignés par le ministre chargé de la santé ;
- Cinq (5) praticiens médicaux de la santé désignés par le ministre chargé de la santé ;
- Un représentant du conseil supérieur islamique ;
- Un représentant du conseil national de déontologie médicale.
Missions principales du conseil
Parmi les missions principales du conseil figurent l’encadrement des aspects éthiques liés au développement des activités sanitaires, notamment en matière de :
- Greffe et transplantation d’organes, de tissus et de cellules,
- Essais cliniques,
- Recherche scientifique.
Ce conseil peut être saisi par toute personne physique ou morale pour toute question posant un problème éthique et entrant dans le cadre de sa mission.
Conclusion
L’acte médical ou la prise en charge par les professionnels de santé doit :
- Se conformer aux exigences de la loi,
- Suivre les principes déontologiques de la profession,
- Être en conformité avec les valeurs éthiques de la profession.
Cette triangulation incontournable permet de donner aux problèmes moraux et humains que pose l’exercice médical un ensemble de réponses permettant d’orienter la conduite médicale selon des principes acceptables pour la dignité et la liberté de l’individu.
Voici une sélection de livres:
- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011
- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996
- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE
- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient
- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé
- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1
- Endodontie, prothese et parodontologie
- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020
- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005
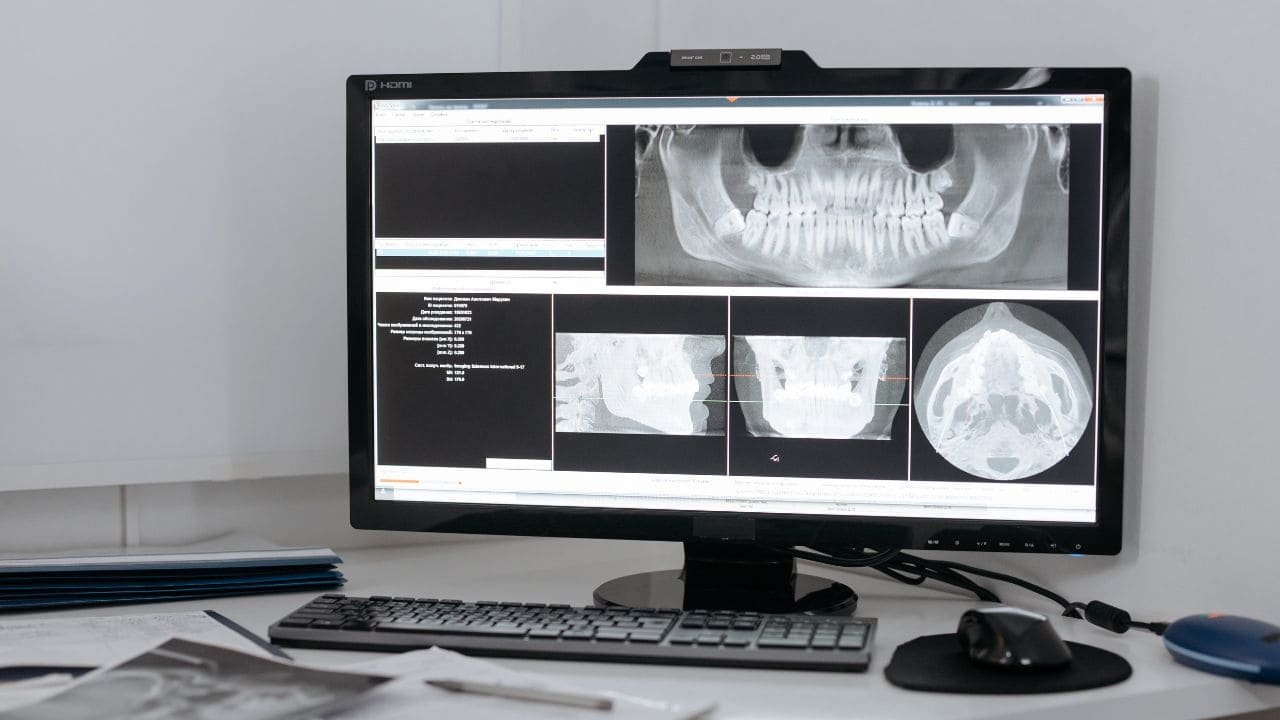


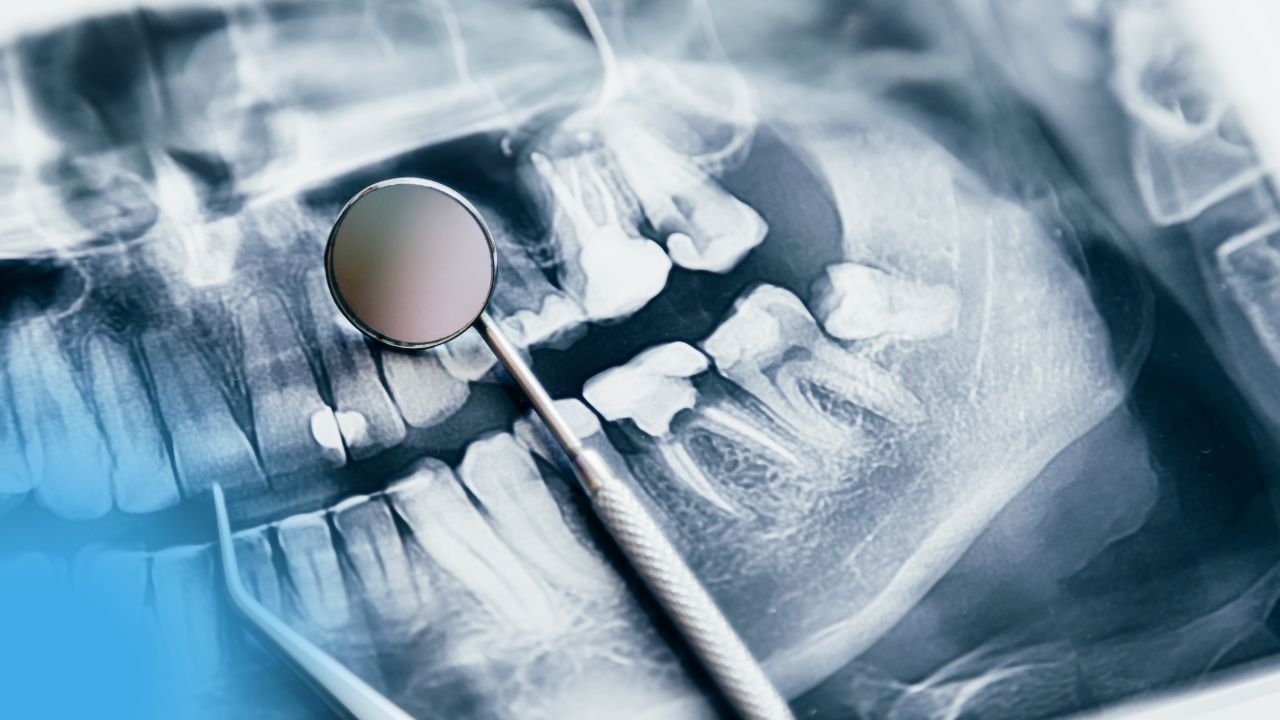
Leave a Reply