Ecosystème Buccal
Ecosystème Buccal
Introduction
La bouche est une cavité naturelle complexe qui forme le segment initial du tube digestif. Elle est un acteur essentiel des fonctions vitales qui sont la nutrition, le langage et la communication. L’ensemble de la bouche (dents, parodonte, muqueuses, langue) est constamment hydraté et lubrifié par la salive. À tout âge, un équilibre s’établit entre la prolifération bactérienne, le flux salivaire et la réponse tissulaire : c’est l’écosystème buccal.
1. Définition
1.1. Écologie
C’est l’étude des relations des organismes entre eux et des organismes avec leur milieu.
1.2. Écosystème
Un système d’interactions établies entre des groupes d’organismes et leur milieu physique ou inanimé.
1.3. Niche écologique
Un habitat qu’occupe un organisme en même temps que le rôle qu’il y tient.
2. Composition de l’écosystème buccal
2.1. Communauté abiotique
Elle comprend tous les éléments physiques et biochimiques de l’écosystème :
- Éléments physiques : dents, muqueuses.
- Éléments biochimiques : salive et fluide gingival.
2.2. Communauté biotique
Ce sont tous les éléments vivants de l’écosystème : bactéries, levures, protozoaires.
3. Flore buccale
3.1. Définition
La flore buccale est un ensemble d’éléments microbiens d’espèces différentes, vivant dans un milieu en parfait équilibre. La cavité buccale est formée de zones écologiquement différentes. Chaque zone pouvant être colonisée par des germes qui lui sont propres. Toute modification d’une de ces régions pouvant avoir des répercussions sur la flore buccale. La flore buccale est très diversifiée et complexe. Plus de 200 espèces ont été répertoriées. Cette flore particulièrement riche constitue avec le milieu buccal un écosystème dans lequel toute rupture d’équilibre peut être le point de départ d’un processus pathologique.
3.2. Composition de la flore buccale
La flore commensale est constituée des espèces habituellement présentes dans la bouche. La flore de passage est constituée d’espèces qui transitent occasionnellement par la cavité buccale sans s’y établir de façon durable. Cette flore est riche en bactéries (plus de 500 espèces, soit environ 20 genres bactériens). Les microorganismes largement prédominants sont les bactéries.
3.2.1. Cocci Gram positif
Les streptocoques représentent le pourcentage le plus important de la flore. Ils appartiennent à la famille des streptococcacées qui comprend sept genres, parmi eux les streptococcus. Ils se présentent en diplo, ou le plus souvent en chaînettes, immobiles. Leur pouvoir antigénique (présence ou non d’antigène), ceux qui le possèdent sont dits groupables, et ceux qui ne le possèdent pas sont dits non groupables. Les streptocoques les plus abondants sont les non groupables.
Les principales espèces humaines sont :
- S. mitis ; S. milleri : retrouvés au niveau de tous les sites.
- S. salivarius : abondant au niveau de la salive et de la muqueuse linguale.
- S. sanguis : l’une des premières bactéries qui a colonisé la surface dentaire.
- S. mutans : il est régulièrement isolé dans les parties denses de la plaque, il est considéré comme l’une des bactéries les plus actives dans l’élaboration de la plaque, il ne peut survivre dans la cavité buccale qu’en présence de surface dure. Seules certaines souches apparaissent cariogènes.
3.2.2. Cocci Gram négatif
- Neisseria : bactérie aérobie, immobile, groupée en diplocoque possédant une catalase et une oxydase.
- Veillonella : bactéries anaérobies strictes, ce sont des commensaux habituels de la cavité buccale.
3.2.3. Bâtonnets et filaments Gram positif
- Lactobacilles : sont immobiles et aérotolérants. Ils se retrouvent en faible quantité et ils interviennent dans le catabolisme des hydrates de carbone en acide lactique. L’acidification du milieu provoquée par ces bactéries est probablement un des facteurs de la genèse de la carie.
- Actinomyces : c’est une bactérie filamenteuse anaérobie et c’est l’hôte habituel du tartre et de la plaque bactérienne. Leur proportion augmente relativement avec le développement de la gingivite. Elle représente 35 % de la flore parodontale chez l’individu sain.
- Actinomyces viscosus : détecté dans la carie superficielle de la racine.
- Actinomyces naeslundii : rôle pathogène mineur.
- A. israelii : les plus importants.
- Corynébactérie : Genre corynebacterium. C’est un bacille G+ anaérobie facultatif. Ils sont appelés couramment : diphtéroïdes. Ils représentent 24 % de la plaque d’un sujet sain.
3.2.4. Bâtonnets et filaments Gram négatif
- Campylobacter : 5 % de la flore du sillon gingival. C’est un bacille à G- mobile.
- Bacteroides : bacilles à G- anaérobies strictes au niveau du sillon gingival, l’espèce est dite bacteroides pigmentée :
- Bacteroides melaninogenicus : rarement chez les enfants, leur nombre s’accroît avec le développement de la parodontite.
- Bacteroides gingivalis.
- Fusobacterium : bacille qui, dans certaines circonstances, participe à des infections mixtes en association avec les spirochètes (angine de Vincent), gingivite ulcéro-nécrotique.
3.2.5. Spirochètes
Bactéries à Gram -, spiralées et déformables, seul le Treponema existe dans la cavité buccale. Leur habitat est la plaque sous-gingivale.
3.2.6. Autres germes
- Champignons : Candida albicans.
- Amibes : Entamoeba gingivalis.
- Virus.
3.3. Notions générales sur la bactérie
3.3.1. Définition
Organisme vivant, microscopique et unicellulaire.
3.3.2. Structure de la bactérie
- Capsule : substance visqueuse, plus ou moins épaisse qui entoure la paroi. Elle permet à la bactérie d’adhérer plus facilement aux autres êtres vivants tout en la protégeant de la phagocytose.
- Paroi cellulaire : enveloppe rigide plus ou moins épaisse présente chez toutes les bactéries. Elle constitue le squelette externe et est responsable de la forme de celle-ci. La paroi évite l’éclatement de la cellule.
- Membrane cytoplasmique : elle est semi-perméable, elle contrôle l’entrée et la sortie de différentes substances. Le passage des substances à travers la membrane s’effectue par diffusion, osmose et transport actif.
- Ribosomes : très fines granulations servant à la synthèse des protéines bactériennes.
- Flagelles : filaments longs et très fins servant au déplacement de plusieurs sortes de bactéries. Le nombre et la position des flagelles constituent un critère de classification des bactéries à flagelles.
- Pili : filaments relativement courts possédés par beaucoup de types de bactéries. Il y a les pili communs, rigides et servant de moyen de fixation à différentes surfaces, et les pili sexuels pour la transmission du matériel génétique d’une bactérie à une autre.
4. Adhérence bactérienne
4.1. Surfaces en présence
L’adhérence bactérienne est un phénomène physicochimique qui met en présence les surfaces buccales colonisées et les surfaces bactériennes.
Surfaces buccales
Elles sont constituées de tissus mous (muqueuse : labiales, palatines, linguales et jugales) et les tissus durs dentaires. Toutes ces surfaces sont recouvertes d’un gel hydraté composé de glycoprotéines (mucine salivaire). Au niveau des dents, les mucines sont dénaturées et forment un film organique : la pellicule. Au niveau des tissus mous, pas de base stable vu la desquamation.
Surfaces bactériennes
Dans la nature, la plupart des bactéries sont entourées d’une matrice fortement hydratée qu’on appelle glycocalyx (Costerton 1981), c’est une matrice de fibres polysaccharidiques. La glycocalyx est souvent constituée d’hétéropolysaccharides que les bactéries élaborent à partir de n’importe quel hydrate de carbone de sucre. Les pili qui sont des appendices fibreux répartis le long de la paroi bactérienne.
4.2. Types d’adhérence
- Adhérence à une surface dentaire : émail, dentine, cément par la phase minéralisée. La pellicule exogène acquise est interposée entre cette surface et les bactéries. Ce type d’adhérence est stable (surface non desquamante favorable à la formation d’une communauté bactérienne).
- Adhérence aux cellules épithéliales : propre aux tissus mous. C’est une adhérence instable vu la desquamation qui ne permet pas l’accumulation d’une monocouche.
- Adhérence à une bactérie déjà fixée : Adhérence interbactérienne : homotypique (même espèce), hétérotypique (différentes espèces).
4.3. Mécanisme de l’adhérence
Attachement initial
- Force électrostatique : les cellules bactériennes portent à leurs surfaces une charge négative, la surface de la dent est aussi chargée (-) donc on aura des forces répulsives, cependant elles sont également soumises à des forces attractives dites électrodynamiques ou forces de van der Waals.
- Attraction des bactéries vers la surface dentaire : ces forces attractives entrent en jeu et des liaisons hydrogènes s’établissent entre polysaccharides des bactéries et protéines de la pellicule. Les pili vont établir un contact entre surface dentaire et bactéries.
Fixation des bactéries
Grâce à des molécules « adhésines » qui sont présentes à la surface bactérienne souvent sur les pili. Les adhésines de nature protéique et les pili sont appelés aussi fimbriae.
Colonisation et croissance bactérienne
5. Facteurs écologiques influençant la croissance bactérienne
- Pression d’oxygène : la pression d’O2 au niveau de la cavité buccale est importante, c’est ce qui permet la distinction entre aérobie et anaérobie.
- Température : elle agit sur l’activité enzymatique des bactéries.
- Pression osmotique : elle est à peu près égale à la pression interne des bactéries, ces dernières ont une paroi qui leur permet de résister à toute variation de pression osmotique.
- Humidité : les conditions d’humidité sont parfaites pour la croissance bactérienne.
- pH salivaire : intervient dans la régulation du métabolisme bactérien. Un pH acide active la croissance de lactobacilles, un pH alcalin favorise l’agrégation.
- Facteurs nutritionnels : pour pouvoir se développer, la cellule bactérienne doit être approvisionnée en source de carbone et d’énergie. À la surface dentaire, les nutriments sont fournis par la salive. Dans la poche gingivale, les bactéries disposent de tous les nutriments apportés par les fluides tissulaires.
6. Facteurs influençant la flore
- Lactoferrine : Protéine fixatrice du fer produite par les polynucléaires neutrophiles du parenchyme glandulaire et par les cellules épithéliales des muqueuses orales. Possède des effets bactéricide, bactériostatique, virucide, fongicide, antitumoral et anti-inflammatoire.
- Lysozyme :
- Action antiseptique bactéricide (Gram+) et bactériostatique.
- Action antifongique.
- Lactoperoxydase :
- Action antiseptique par oxydation du thiocyanate en utilisant le peroxyde d’hydrogène (H₂O₂) pour former un ion hyperactif : hypothiocianate (SCNO) qui dénature les protéines microbiennes.
- Action antivirale et antifongique.
- Âge : peut faire varier la croissance bactérienne.
Conclusion
La flore buccale est très complexe, elle varie en fonction de l’âge, des sites anatomiques et des conditions physiques. La carie et les parodontopathies peuvent être vues comme les conséquences d’un déséquilibre de l’écosystème buccal.
Ecosystème Buccal
Voici une sélection de livres:
- Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché
- Concepts cliniques en odontologie conservatrice
- L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement
- Guide clinique d’odontologie
- Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve
- La photographie en odontologie: Des bases fondamentales à la clinique : objectifs, matériel et conseils pratique

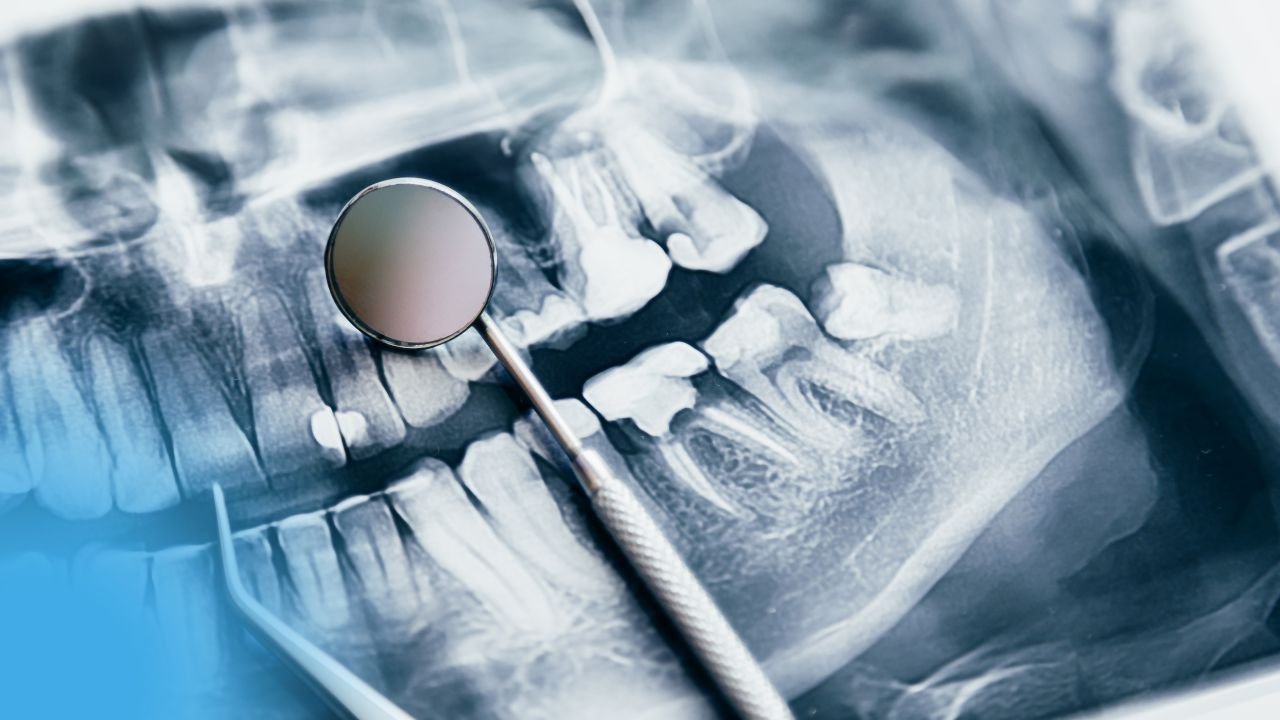


Leave a Reply