CHOIX ET UTILISATION CLINIQUE DES DIFFERENTS MATERIAUX
CHOIX ET UTILISATION CLINIQUE DES DIFFERENTS MATERIAUX
INTRODUCTION
De nombreux matériaux sont à la disposition des praticiens. Comment sélectionner l’un ou l’autre?
Il faut savoir que si les indications sont bien précises, dans la plupart des cas il subsiste des particularités que nous devons connaître afin que notre choix soit judicieux.
Rappel :
Classées selon 4 tailles, et ceci quel que soit le site d’origine de la lésion.
- Taille 1 – Lésion atteignant la dentine; le traitement par la seule reminéralisation est insuffisant.
- Taille 2 – Lésion modérée de la dentine; la préparation de la cavité laisse apparaître un émail sain, soutenu par du tissu dentinaire, ne présentant pas de risque d’effondrement sous une charge occlusale normale. La dent demeure suffisamment solide pour supporter une restauration.
- Taille 3 – Lésion cavitaire franche fragilisant les cuspides et les bords incisifs; ces structures sont susceptibles de s’effondrer sous la contrainte occlusale. La préparation cavitaire exige l’élimination des parties fragilisées afin de pouvoir renforcer les structures résiduelles par un comblement intra-cavitaire.
- Taille 4 – Lésion cavitaire étendue au point de détruire la majeure partie des structures dentaires.
LES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX
- Matériaux d’obturation définitive
- Matériaux d’obturation provisoire
- Matériaux thérapeutiques ou cicatrisants = matériaux de coiffage
- Bases intermédiaires = fonds de cavités = substituts dentinaires
- Matériaux de scellement
I – LES CRITÈRES DE CHOIX DES MATÉRIAUX
MATÉRIAUX D’OBTURATION DÉFINITIVE
- Situation de la dent : aspect esthétique ou inesthétique
- Propriétés mécaniques du matériau : résistance aux forces de compression, d’abrasion ou d’usure, de traction…
- Importance de la perte de substance
- Occlusion, le RCI,
MATÉRIAUX D’OBTURATION PROVISOIRE
- À durée limitée
- À durée + ou – longue
MATÉRIAUX THÉRAPEUTIQUES OU CICATRISANTS
Matériaux dentinogènes et matériaux cementogènes
MATÉRIAUX DE SCELLEMENT
Compatibilité avec le matériau scellé
II – CLASSIFICATION DES CVI SELON L’USAGE CLINIQUE :
- Type I : Ciments de scellement
- Type II a : Obturation esthétique
- Type II b : Obturations d’aspect métallique (cermets)
- Type III a : Liner/base à prise rapide ou polymérisant à la lumière
- Type III b : Produits de reconstitution interne
- Type IV : Ciments de scellement pour puits et fissures
II – UTILISATION CLINIQUE DES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX
LES MATÉRIAUX DE PRÉVENTION
Les sealants, les VI de scellement type IV
Le scellement des sillons :
- Les résines composites fluides = sealant, exigent un champ opératoire sec pour que le collage soit efficace.
- Les verres ionomères de scellement type IV sont préférés dans le cas où cette condition ne peut être satisfaite (dent n’ayant pas atteint le plan d’occlusion chez l’enfant polycarieux).
Les composites fluides = flow :
En cas d’ouverture des sillons.
MATÉRIAUX D’OBTURATION DÉFINITIVE = DE RESTAURATION
- Les verres ionomères modifiés par adjonction de résine, les composites hybrides, les composites microfins, les amalgames.
Les matériaux esthétiques :
- Ils sont utilisés essentiellement (site 2) sur les dents antérieures et les restaurations visibles au sourire (faces mésiales des 1 et 2PM).
- Ils possèdent une teinte voisine de celle des dents (à sélectionner à l’aide d’un teintier) et une aptitude au polissage.
Les matériaux inesthétiques :
- Il s’agit de l’amalgame aux propriétés mécaniques meilleures que celles des composites (usure, aptitude au polissage, résistance à la compression).
Pour le Site 1
- TAILLE 1 :
- Les VI auto polymérisables ou hybrides = matériau de choix en raison de leurs propriétés d’adhésion et de relargage de fluor. Un conditionnement à l’acide polyacrylique à 10 % est nécessaire.
- TAILLE 2 :
- Les VI auto ou hybrides.
- Technique sandwich : Stratification de VI et composite :
- Si utilisation de VI auto = déminéralisation de la surface du VI pour favoriser le collage.
- Si utilisation de VI hybride = la déminéralisation n’est pas nécessaire.
- TAILLE 3 :
- L’amalgame = matériau de choix après isolation thermique à l’aide de VI (ép=0,5mm) ou d’eugénate.
- *Les composites après étude de l’occlusion pour réduire la charge occlusale.
- TAILLE 4 :
- L’amalgame après isolation thermique.
LES RESTAURATIONS DE SITE 2
TAILLE 1
- Les VI représentent les matériaux de choix. Si les charges occlusales supportées par la restauration sont importantes ou si des impératifs esthétiques existent, une épaisseur du matériau doit être supprimée à l’aide d’une fraise diamantée cylindrique sous jet d’air/eau afin de ménager un espace suffisant pour la mise en place d’un composite.
- Le VI comme substitut dentinaire est éliminé sur une hauteur = 2 mm afin de dégager les parois d’émail.
- Procéder au collage du composite sur l’émail (biseautage, mordançage…).
TAILLE 2
- *L’amalgame après isolation = matériau de choix.
- *Le composite hybride monté par couche après une isolation au VI (scellement étanche aux micro infiltrations).
- *VI.
- *VI recouvert de composite si les charges occlusales sont trop importantes.
TAILLE 3
- Si les limites marginales amélaires sont satisfaisantes :
- VI + substitut dentinaire + collage de résine composite sur les bords.
- Si le support amélaire périphérique est insuffisant pour assurer une bonne adhésion :
- La technique sandwich ouvert : La technique précédente est réalisée en laissant le VI à découvert au niveau cervical mais cette fois après avoir retouché le VI pour ménager un bon espace de collage pour le composite hybride.
- *La technique sandwich peut être envisagée.
- *Restauration à l’amalgame après pose d’un fond : VI fluide = faible ratio poudre/liquide.
TAILLE 4
- Au niveau des dents antérieures = résultat de traumatisme :
- *Technique sandwich ouvert ou fermé.
- *Stratification de composites :
- Composites hybrides utilisés en palatin.
- Composites microfins (rendu esthétique) utilisés en vestibulaire.
- Au niveau des dents postérieures :
- *L’amalgame est le matériau de choix.
LES RESTAURATIONS DE SITE 3
- *Les VI de restauration esthétique type II.1 auto ou photopolymérisable.
TAILLE 1
- Les CVI auto ou hybrides si toutefois il existe un impératif esthétique = stratification de composite particulièrement si le RCI du patient n’est pas élevé.
TAILLE 2, 3, 4
- Les CVI représentent le matériau de choix.
LES MATÉRIAUX DE PROTECTION DENTINO-PULPAIRE
Tous les produits sont + ou – toxiques selon leur concentration. La meilleure protection pour la pulpe = épaisseur dentinaire suffisante = effet tampon.
La surface dentinaire occupée par les tubuli = 1 % à la jonction émail/dentine, 22 % à proximité de la pulpe.
Le mordançage dentinaire ouvre les tubuli et élimine la boue dentinaire → la micro infiltration bactérienne +++++.
*LES MATÉRIAUX DE PROTECTION DENTINO-PULPAIRE
Il s’agit de matériaux utilisés en couche très fine.
LES VERNIS
- C’est un matériau de très faible viscosité, utilisé pour réduire les risques de micro infiltrations précoces autour des obturations à l’amalgame.
LES RÉSINES NON CHARGÉES
- Auto ou photopolymérisables peuvent être utilisées comme :
- Fond de protection des cavités ou
- Agents de liaison avec les résines composites.
- Amélioration de l’étanchéité vis-à-vis des micro infiltrations.
L’HYDROXYDE DE CALCIUM
- Le pH fortement alcalin 12-13 peut être mis en contact du tissu pulpaire lésé qui, débarrassé des germes, survivra.
- Du fait de sa résorption avec le temps, il est réservé à la protection pulpaire et sera protégé d’un VI qui assure l’étanchéité.
LES FONDS DE CAVITÉ = SUBSTITUT DENTINAIRE
LES CIMENTS ZnO-E
- Anti-inflammatoire, antibactérien, légère anesthésie, assure une bonne étanchéité sur les bords de la cavité.
Inconvénients :
- S’hydrolyse avec le temps (pas plus de 6 mois).
- Ne peut être mis au contact du tissu pulpaire = l’hydrolyse (humidité pulpaire) libère l’eugénol = irritant pour la pulpe.
- Ne peut être mis sous un composite = eugénol empêche la polymérisation des résines.
Indications :
- Coiffage pulpaire indirect.
- Obturation provisoire 3 semaines.
- Désinfection des surfaces cariées en présence de tissu dentinaire pathologique.
LES CIMENTS AU PHOSPHATE DE Zn
- Ne présentent aucun intérêt thérapeutique pour la pulpe.
LES CVI
- *Excellent substitut dentinaire.
- *Couche d’échanges ioniques scelle les tubuli dentinaires.
- *Légèrement antibactérien.
- *Possèdent de bonnes propriétés physiques.
LE MTA
- C’est également un matériau à base de silicate tricalcique.
- Le pH alcalin.
- Semble supplanter le Ca(OH)₂ sur le plan du pouvoir dentinogénétique, ostéogénétique et des propriétés mécaniques.
LE BIODENTINE
- Excellent substitut dentinaire sous tous les types de restauration.
- Peut servir de base et de restauration provisoire : dans les cas de coiffage (jusqu’à 6 mois dans le milieu buccal).
REMARQUES
La plupart des matériaux peuvent se présenter sous plusieurs consistances et peuvent donc, selon cette dernière, avoir de nombreuses indications. Ces dernières peuvent se confondre ou rester indépendantes. Ex :
- *L’eugénate peut servir en même temps pour le coiffage et comme matériau d’obturation provisoire.
- *Le composite pour le scellement d’un tenon fibré et pour une restauration esthétique.
CONCLUSION
Une panoplie de matériaux s’offre aux odontologistes avec des propriétés particulières à chacun. Le médecin dentiste se doit de les connaître afin de sélectionner le meilleur et d’améliorer ses performances en clinique.
CHOIX ET UTILISATION CLINIQUE DES DIFFERENTS MATERIAUX
Voici une sélection de livres:
Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché
Concepts cliniques en odontologie conservatrice
L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement
Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve

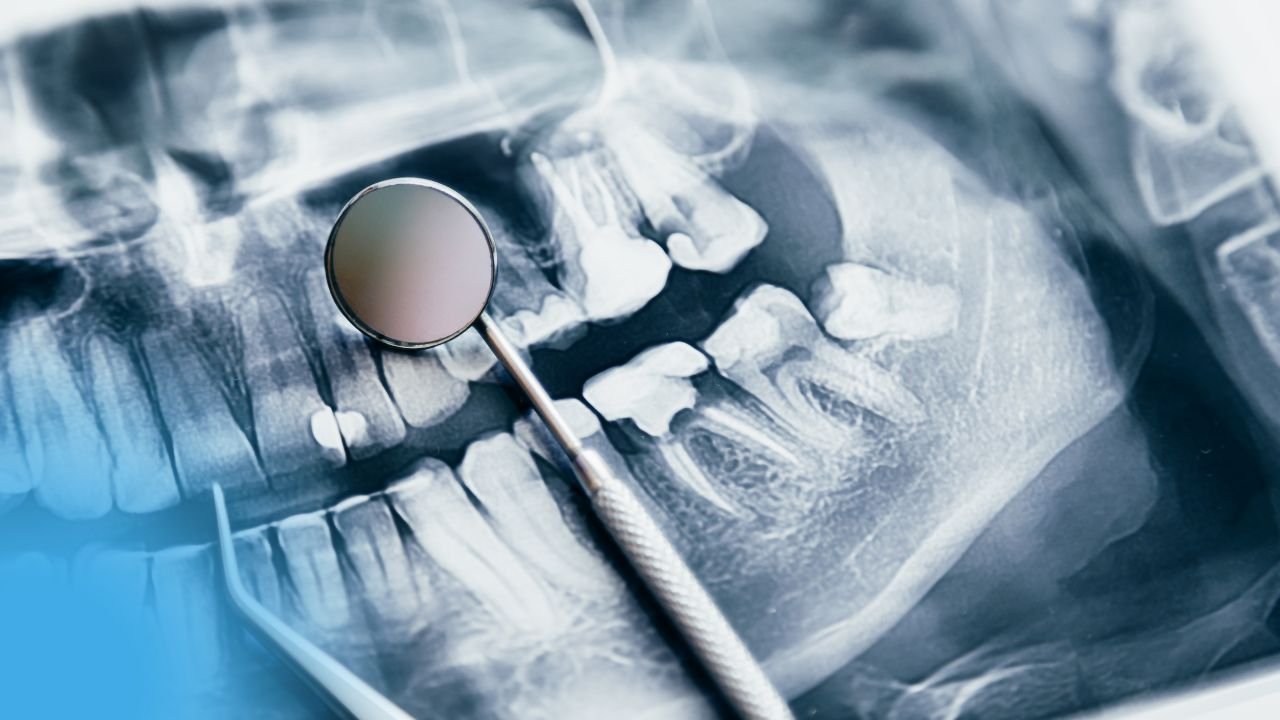


Leave a Reply