Anti-inflammatoires en odontostomatologie: avantages et inconvénients des AINS versus corticoïdes
Anti-inflammatoires en odontostomatologie: avantages et inconvénients des AINS versus corticoïdes
- Introduction
La prescription de tout médicament, anti-inflammatoires compris, doit tenir compte du rapport entre son efficacité (bénéfice : B) et sa toxicité (risque : R). Cette dernière peut être liée : à ses propriétés pharmacodynamiques et/ou pharmacocinétiques ; à des facteurs de risque présents chez un patient soit de façon quasi permanente (allergie) soit à un moment précis de son existence (âge, grossesse, pathologies diverses, traitements associés…). Le choix d’un anti- inflammatoire doit tenir compte de l’efficacité du produit et des facteurs de risque (rapport B/R) afin qu’une prescription à visée thérapeutique ne se complique pas d’une réaction pouvant être grave, voire menacer la vie du patient.
C’est dans cet esprit que nous débattrons de cette question après avoir donné quelques précisions quant aux mécanismes d’action des anti-inflammatoires.
- Genèse de l’inflammation
L’inflammation indique la riposte de l’organisme à une agression dont la nature en odontostomatologie est habituellement soit infectieuse (maladies parodontales) soit traumatique (chirurgie implantaire ou parodontale, extractions de sagesses incluses, etc.). La réaction inflammatoire a généralement pour but de protéger l’hôte mais peut, en odontostomatologie, contribuer également à la destruction tissulaire aboutissant chez certains individus à la perte
d’attache et à la mobilité dentaire, voire à la perte des dents.
- Différentes phases de l’inflammation
L’inflammation se développe en deux phases.
- Phase précoce vasculaire
Elle nécessite l’intervention de l’histamine, des kinines (notamment de la bradykinine) et des prostaglandines. Ces médiateurs provoquent une augmentation de la perméabilité capillaire responsable de la fuite hors des vaisseaux des protéines, d’eau et d’électrolytes donc d’oedème et de douleur. Cette phase est accessible aux AINS qui inhibent la production des prostaglandines, issues de l’action de l’une des enzymes de dégradation de l’acide arachidonique, en l’occurrence, la cyclo-oxygénase.
La cascade de réactions inflammatoires débute à partir des phospholipides membranaires dont la dégradation aboutit à la production de l’acide arachidonique. Ce dernier conduit, par deux voies métaboliques différentes, à la synthèse des prostaglandines (voie de la cyclo-oxygénase : COX) et à celle des leucotriènes (voie de la lipo-oxygénase)
Il existe deux isoformes de la cyclo-oxygénase (COX) :
- la COX1 : isoforme constitutive de la plupart des tissus. Les prostaglandines issues de la COX1 assurent différentes fonctions telles que lutte contre l’ulcère digestif (PGE2), déroulement de la grossesse (PGF2a) et oxygénation fœtale en maintenant ouvert le canal artériel (PGE2), etc. L’inhibition de la COX1 par les AINS explique d’ailleurs la plupart de leurs effets secondaires ;
- laCOX2 : isoforme inductible par les cytokines, l’endotoxine, etc. qui interviennent dans la genèse de l’inflammation, douleur et fièvre. L’inhibition de la synthèse de la COX2 explique les effets thérapeutiques des anti-inflammatoires.
- Phase tardive cellulaire avec migration des monocytes et macrophages
Ces dernières sécrètent l’interleukine 1 (IL1) et le tumor necrosis factor-alpha (TNF-a) qui font partie des principales cytokines inflammatoires. Ces dernières sont à l’origine de la production de l’IL8 et du macrophage chemo-attractant protein-1 (MCP-1) qui attirent les neutrophiles et les mastocytes au foyer inflammatoire.
- Mécanismes d’action des anti-inflammatoires
Les mécanismes par lesquels les anti-inflammatoires s’opposent à l’inflammation et en suppriment les conséquences (oedème, douleur, trismus) dépendent de l’anti-inflammatoire utilisé.
- Mécanismes d’action des corticoïdes Sur les cytokines
L’expression de nombreux gènes impliqués dans la réaction inflammatoire (cytokines, enzymes, récepteurs, adhésion des molécules…) est inhibée par les corticoïdes. Ces derniers se fixent sur les récepteurs cytosoliques et, après différentes étapes intermédiaires, aboutissent à l’augmentation de la transcription des gènes codant pour les protéines anti-inflammatoires incluant la lipocortine 1, l’interleukine 10, antagonistes de récepteur d’interleukine 1 .
L’action anti-inflammatoire des corticoïdes résulte en réalité de l’interaction entre les récepteurs activés des corticoïdes et les facteurs de transcription, notamment nuclear factor-kappaB (NFkappaB) et l’activator protein-1 (AP-1) qui sont les médiateurs de l’expression des gènes de l’inflammation. Par ailleurs, les interactions entre corticoïdes et NF-kappaB aboutissent à une modification de l’activité des histones (protéines basiques en contact étroit avec l’ADN) et à un remodelage de la chromatine.
Les cytokines modulent l’expression des molécules d’adhésion cellulaire (cadhérines, intégrines, sélectines, immunoglobulines dont l’intercellular adhesion molecule-1 [ICAM-1]). En inhibant
l’expression des gènes des cytokines, les corticoïdes inhibent également leur activité modulatrice sur l’expression des molécules d’adhésion cellulaire.
Sur l’acide arachidonique
Les corticoïdes en stimulant la lipomoduline inhibent l’activité des phospholipases C réduisant ainsi la production de l’acide arachidonique et, en conséquence, la synthèse des prostaglandines et celle des leucotriènes (Fig. 1).
- Mécanismes d’action des AINS
Les AINS ne s’opposent qu’à la production des prostaglandines en inhibant la voie de la cyclo- oxygénase, ce qui montre qu’ils n’interviennent que sur la phase vasculaire précoce de
l’inflammation. Ils sont donc moins efficaces que les corticoïdes.
- Toxicité et effets indésirables des anti-inflammatoires
- Toxicité et effets indésirables des corticoïdes
Si l’utilisation des corticoïdes sur de courtes périodes peut être responsable de la survenue de réactions cutanées , de myopathie , d’hyperglycémie , de pancréatite , et de problèmes psychiatriques, neurologiques , vasculaires hématopoïétiques et immunologiques , ces effets sont généralement modérés et ne sont observés qu’avec des doses élevées de cortisol (80 à 200 mg ou équivalents). Ces effets régressent généralement à l’arrêt du traitement. Cependant, il faut en tenir compte et éviter de les administrer à des patients présentant, au préalable, de telles pathologies.
Ces effets sont surtout observés avec le cortisol (non utilisé comme anti-inflammatoire mais comme traitement substitutif de l’insuffisance corticosurrénalienne).
En revanche, l’utilisation prolongée des corticoïdes provoque de l’ostéoporose, de l’insuffisance corticosurrénalienne , des pathologies digestives ulcéreuses , des effets secondaires
ophtalmologiques tels que glaucome, de l’hyperlipidémie . Cette utilisation prolongée
contrecarre, chez l’enfant, la croissance par atteinte des cartilages épiphysaires . L’emploi régulier des corticoïdes utilisés par voie buccale, en modifiant le pH salivaire, peut également provoquer l’érosion des dents observée, par exemple, chez les asthmatiques les utilisant en inhalation.
D’une façon générale, les effets secondaires des corticoïdes sont de type métabolique (métabolisme hydrominéral, glucidique, calcique, protidique). Ils inhibent également l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et sont immunosuppresseurs et ulcérigènes.
Effets métaboliques
Effet sur le métabolisme hydrominéral
Il se traduit par une rétention du Na+ associée à une hypokaliémie et une alcalose. Ces effets sont fréquents avec le cortisol, mais faibles, voire absents avec les corticoïdes de synthèse (seuls ces derniers sont utilisés en odontostomatologie).
Cependant si le patient est simultanément traité par d’autres hypokaliémiants (diurétiques de
l’anse ou thiazidiques, minéralocorticoïdes, amphotéricine B ), l’hypokaliémie s’aggrave et il
faut donc éviter d’utiliser un corticoïde.
Effet sur le métabolisme des glucidiques
L’emploi des corticoïdes retentit sur le métabolisme des glucides et provoque une augmentation de la néoglycogenèse et donc de la glycémie. L’organisme réagit en augmentant la sécrétion de l’insuline qui augmente l’appétit et, surtout, mobilise les réserves lipidiques (effet sur le métabolisme des lipides) vers la face et le tronc provoquant ainsi une obésité faciotronculaire (syndrome de Cushing : face lunaire).
Chez le sujet déjà diabétique, la demande de l’insuline augmente sous corticoïdes.
Effet sur le métabolisme calcique
L’emploi des corticoïdes diminue l’absorption duodénale du Ca2+ aboutissant ainsi à une hypocalcémie. Cette dernière est suivie de la stimulation des parathyroïdes et de la libération de la parathormone (PTH). La PTH chélate le Ca2+ de l’os normalisant ainsi la calcémie mais au prix d’une résorption osseuse avec la survenue d’une ostéoporose chez l’adulte et d’un rachitisme chez l’enfant.
Effets sur la réponse immune
Il s’agit d’une réaction entraînant l’aggravation d’une infection existante ou l’activation d’une infection latente et l’accroissement de la susceptibilité à l’infection. Le risque est plus élevé chez les patients recevant de fortes doses de corticoïdes et chez ceux recevant, en plus, d’autres immunosuppresseurs.
Les enfants recevant de fortes doses de corticoïdes présentent un risque spécifique du développement de maladies infantiles telles que la varicelle.
Quelques cas d’accidents mortels ont été rapportés chez les patients atteints de varicelle et ayant pris des corticoïdes. La corticothérapie est donc contre-indiquée chez les enfants atteints de la varicelle ou susceptibles d’en être contaminés.
Effets sur le tractus gastro-intestinal
Les corticoïdes comme les AINS sont toxiques pour la muqueuse digestive. En effet, les corticoïdes augmentent la fréquence de survenue des ulcères gastro-duodénaux (UGD) qui passe de 1 % (patient contrôle ne recevant pas de corticoïdes) à 2 % sous corticoïdes. Cependant, ce risque semble être plus élevé avec les AINS. Il en est de même des hémorragies digestives faibles avec les corticoïdes mais plus abondantes lors de l’association corticoïdes-AINS . Une telle association est donc à éviter.
Effets sur le fonctionnement de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien
La cortisolémie matinale est très élevée (5 fois plus que la nuit) et provoque, de ce fait, par un mécanisme de feed back négatif, la mise au « repos » des glandes surrénales.
Lorsque la cortisolémie diminue (vers minuit), il y a de nouveau la reprise de l’activité surrénalienne (rythme circadien). En cas de corticothérapie prolongée, la survenue d’une insuffisance corticosurrénalienne est une réalité incontestable. Lorsqu’elle survient, elle persiste durant toute la phase de l’administration des corticoïdes et environ 1 an après son interruption et peut provoquer, en cas de stress (quelle qu’en soit la cause) un collapsus circulatoire. Les recommandations en matière de corticothérapie doivent donc être parfaitement respectées par
l’odontologiste (Cf. infra). En cas de traitement pour une durée inférieure ou égale à 5 jours, le traitement doit être interrompu brutalement. En revanche, si la durée du traitement est supérieure à 6 jours, le traitement doit être interrompu de façon progressive.
L’emploi local (nasal, oculaire…) des corticoïdes peut également, aux posologies élevées et en cas d’utilisation prolongée, provoquer une insuffisance corticosurrénalienne (ICS).
Corticoïdes et grossesse
L’emploi des corticoïdes durant la grossesse fait poser la question de leurs éventuels effets tératogènes et/ou foetotoxiques :
- sont-ils tératogènes ? Si des fentes sphénopalatines ont été rapportées chez l’animal, aucun effet notable de ce type n’est à craindre dans l’espèce humaine. En effet, un rapport du UK Commettee on Safety of Medecine conclut qu’il n’y a aucune preuve convaincante que l’emploi des corticoïdes durant la grossesse puisse augmenter l’incidence de malformations congénitales. Si en cas d’utilisation prolongée et répétée il y a un risque de retard de développement intra-utérin, le traitement de courte durée ne semble poser aucun problème ;
- sont-ils foetotoxiques ? Aucune étude, à notre connaissance, n’a démontré d’effets toxiques chez le foetus ni sur le développement psychologique de l’enfant. La survenue d’insuffisance corticosurrénalienne ou d’immunosuppression n’a pas été rapportée chez l’enfant traité avant la naissance par les corticoïdes.
Interactions médicamenteuses D’ordre pharmacocinétique
Au niveau hépatique : les inducteurs enzymatiques [36] tels que les barbituriques, carbamazépine, phénytoïne, rifampicine peuvent en augmentant la destruction des corticoïdes en réduire l’efficacité. Le phénomène inverse s’observe avec les inhibiteurs enzymatiques tels que le ritonavir, les antifungiques (kétoconazole, itraconazole) ou encore l’érythromycine [37] qui augmentent les concentrations plasmatiques des corticoïdes.
Au niveau rénal : les diurétiques de l’anse et les diurétiques thiazidiques qui favorisent
l’excrétion des ions K+ provoquant ainsi une hypokaliémie peuvent lors de leur association aux corticoïdes provoquer une perte excessive du K+ responsable d’hypokaliémies sévères. Un risque similaire d’hypokaliémie existe lors de l’association des corticoïdes à l’amphotéricine B et aux bronchodilatateurs tels que les b2 agonistes.
L’hypokaliémie provoquée par les corticoïdes peut accroître le risque de la genèse des torsades de pointe (arythmie ventriculaire sévère) lors de l’emploi des médicaments potentiellement
torsadogènes (sultopride, macrolides, Prepulsid®, quinidine et quinidiniques, sotalol, amiodarone, la plupart des neuroleptiques, etc.).
Interactions d’ordre pharmacodynamique
- Avec les anticoagulants antivitamine K (AVK) et héparines : attention à l’effet propre des corticoïdes et à la potentialisation probable des effets des AVK et de ceux des héparines.
- Avec les AINS.
- Avec les vaccins vivants atténués (VVA) : risque de maladie généralisée éventuellement mortelle, notamment chez les sujets immunodéprimés.
Les VVA sont des vaccins dirigés contre des virus (poliomyélite par voie orale, rougeole, rubéole, oreillons, fièvre jaune, …).
Il existe un seul vaccin antibactérien de ce type largement utilisé chez l’homme : le vaccin contre la tuberculose ou BCG (bacille de Calmette-Guérin).
- Toxicité et effets indésirables des AINS
La toxicité et les effets secondaires des AINS sont de trois types : allergique, prostaglandines indépendantes (PG indépendantes) et prostaglandines dépendantes (PG-dépendantes).
Effets allergiques
De nombreuses réactions telles que rash cutanés, urticaires, rhinites et angiooedèmes peuvent s’observer avec n’importe quel AINS.
Cependant, trois faits sont à signaler :
- les chocs anaphylactiques bien que possibles sont rares ;
- des réactions de bronchospasme connues sous le nom de l’asthme à l’aspirine ne seraient pas des réactions de nature allergique mais PG-dépendante (Cf. infra) ;
- des atteintes cutanées ou muqueuses sévères telles que syndrome de Lyell (nécrolyse épidermique) ou de Stevens- Johnson semblent avoir une composante allergique. De telles réactions sont rapportées avec la plupart des AINS, notamment avec les oxicams. Certains auteurs imputent de telles réactions à la plupart des AINS et à l’aspirine et soulignent sa nature allergique.
Effets indésirables PG-indépendants
Au niveau du système nerveux central : les effets néfastes centraux de l’aspirine sont observés notamment à de fortes doses et incluent céphalées, vertiges, nervosités, acouphène, dépression,
somnolence et insomnies. La perte d’audition et l’acouphène sont les réactions les plus fréquentes observées avec les AINS.
Au niveau oculaire : une baisse très importante de l’acuité visuelle peut s’observer avec les AINS notamment avec l’ibuprofène. En effet, utilisé à raison de 400 mg, 3 fois par jour, l’ibuprofène a provoqué une baisse considérable de l’acuité visuelle (10/100) et la suppression de la réponse lors de potentiels évoqués visuels (VEP) ainsi qu’une perte de champ visuel.
Le retour à la normale n’est observé qu’au bout d’environ 1 an et sous traitement avec une héparine de bas poids moléculaire associée à un corticoïde (méthylprednisolone). Il s’agit d’une névrite optique avec déficit du champs visuel : visual field defect .
Au niveau cardiovasculaire : l’ensemble des AINS peuvent accroître la pression artérielle. Ce risque est plus élevé avec l’indométacine, le piroxicam et l’ibuprofène. Ils s’opposent également à l’action antihypertensive des médicaments antihypertenseurs : d’une part par la rétention du Na+ liée à leur emploi et d’autre part probablement par un effet anti-PG. De plus, ces produits peuvent provoquer une insuffisance cardiaque.
Syndrome de Reye : il s’agit de la survenue sous aspirine d’une encéphalopathie d’origine hépatique souvent associée à une stéatose du foie et à une sévère hypoglycémie. Ce syndrome survient notamment chez l’enfant avant l’âge de 12 ans lorsqu’il souffre de pathologies infectieuses virales telles que la varicelle. L’utilisation d’un AINS, dans le traitement de la fièvre et/ou de la douleur, n’est pas recommandée chez l’enfant atteint de varicelle ou d’influenza . Les autorités sanitaires anglaises préconisent de ne pas prescrire d’aspirine chez les
adolescents de moins de 16 ans . Autres effets :
- hépatite cholestatique avec le sulindac et pancréatites également avec sulindac ont été rapportées ;
- par ailleurs, l’emploi chronique des AINS peut chez la femme être responsable d’infertilité. Cet effet semble être lié à l’inhibition de la synthèse des PG via COX2, compromettant ainsi l’ovulation. Les auteurs suggèrent d’éviter de recourir aux AINS si la femme souhaite une grossesse .
Effets indésirables PG-dépendants
Au niveau digestif : les AINS peuvent provoquer une inflammation ou un ulcère au niveau du tractus digestif. Des complications hémorragiques d’UGD ne sont pas rares. Le mécanisme est
complexe. Il est à la fois lié à la toxicité locale PG-dépendante et à la toxicité générale PG- indépendante des AINS. Ce dernier mécanisme s’explique par l’inhibition de la COX1 constitutive permettant dès lors la rétrodiffusion cellulaire des ions H+ précisément inhibée par les PG. De ce fait, l’utilisation des anti-COX2 sélectifs était recommandée car, a priori, ces produits étaient moins toxiques pour la muqueuse digestive. Leur retrait du fait de leur retentissement cardiaque relance le problème de l’emploi des AINS chez les patients souffrant déjà d’UGD.
De nombreux facteurs favorisent la survenue d’UGD. Il s’agit du sujet âgé, d’antécédents d’UGD ou d’antécédents d’hémorragie gastroduodénale, d’emploi concomitant de corticoïdes.
Le risque est également élevé chez l’enfant ainsi que chez les patients chez qui la présence d’Helicobacter pylori a été confirmée.
Le risque d’UGD persiste même si Helicobacter pylori a été éradiqué .
En cas de prescription d’un anti-inflammatoire chez un sujet atteint d’UGD et/ou de RGO, il faut
- préférer les corticoïdes aux AINS ;
- faire précéder la prise d’anti-inflammatoire de la prise d’un inhibiteur de pompe à protons tel que l’oméprazole (Mopral®, par exemple, 1 cp de 20 mg la veille de la prise des corticoïdes, poursuivre le traitement avec Mopral® pendant toute la durée de corticothérapie et l’arrêter 48 heures après l’arrêt des corticoïdes).
Au niveau rénal : les AINS peuvent provoquer des désordres rénaux avec une insuffisance rénale fonctionnelle, voire organique (par modifications des régimes de pression au niveau des artères glomérulaires) lors de leur utilisation topique ou systémique. La plupart de ces effets sont liés à
l’inhibition de la synthèse des PG. Les facteurs de risque sont le sujet âgé, ceux traités par des diurétiques ou par des inhibiteurs de l’enzyme de conversion.
Au niveau pulmonaire : il semblerait que la survenue de l’asthme à l’aspirine soit liée à
l’inhibition de la synthèse des PG pulmonaires dont la présence dans les bronches provoque, physiologiquement une bronchodilatation. L’inhibition de leur synthèse laisse le champ libre aux leucotriènes également présents dans les bronches qui provoquent donc une bronchoconstriction. L’hypothèse d’une action antiprostaglandine l’emporte sur celle d’une réaction allergique. En effet, l’asthme provoqué par l’aspirine contre-indique l’emploi de tous les AINS. Ces derniers ne partageant pas tous la même structure (pas d’analogie structurale entre les différents AINS), une
réaction d’allergie croisée est donc a priori exclue, ce qui plaide en faveur d’un mécanisme commun partagé par tous les AINS en l’occurrence un effet antiprostaglandine.
AINS et grossesse
Il est toujours difficile de parler d’effet tératogène de l’aspirine et des AINS en général (à
l’exception des indoliques) en l’absence de preuves formelles, il est en revanche unanimement admis que les AINS inhibent la synthèse des PG de type :
- PGE2, favorisant la fermeture prématurée du canal artériel foetal avec pour conséquence une hypertension artérielle pulmonaire persistante à la naissance. Des cas d’insuffisance ventriculaire droite ont également été rapportés ;
- * PGF2a, dont l’inhibition de la synthèse augmente d’une part la durée de la grossesse (risque de postmaturité évaluée par certains auteurs à 1 semaine) et d’autre part augmente la durée de
l’accouchement. Il est à rappeler que les concentrations utérines de PGF2a sont supérieures chez la femme enceinte par rapport à son homologue non enceinte et que ces concentrations
augmentent avec l’évolution de la grossesse.
Elles jouent un rôle important (à côté de l’ocytocine posthypophysaire) dans le déclenchement des contractions utérines permettant l’accouchement ;
- thromboxane A2 (TXA2), dont l’inhibition de production consécutive à l’inhibition de la voie de la COX1 par les AINS, notamment l’aspirine, explique l’effet antiagrégant plaquettaire des AINS (cet effet est irréversible avec les salicylés), ce qui explique les hémorragies per partum avec de tels produits.
Interactions médicamenteuses
Elles sont nombreuses et parfois de conséquences graves.
L’administration d’un AINS nécessite au préalable un interrogatoire soigneux visant à connaître le(s) traitement(s) prescrit(s) à un patient.
Les interactions s’expliquent par deux grands mécanismes.
Pharmacocinétique
Lorsque l’administration de l’AINS interfère avec l’une des étapes cinétiques d’un autre médicament. Il s’agit donc d’interaction à différents niveaux.
Au niveau digestif : avec les pansements gastriques (Gaviscon ®, Phosphalugel®, Maalox®…) dont la présence retarde l’absorption des AINS. De plus, en alcalinisant les urines, les antiacides
(pansements gastriques) augmentent l’excrétion des AINS conduisant ainsi à une baisse de concentration et en conséquence d’efficacité de ces produits.
La prise de pansements digestifs est indiquée soit pour un UGD, soit pour un reflux gastro oesophagien (RGO), deux pathologies pouvant contre-indiquer l’administration des AINS qui sont rappelons-le ulcérigènes.
En revanche, le métoclopramide augmente l’absorption digestive de l’aspirine. Au niveau plasmatique : les AINS (médicaments acides faibles) se fixent sur l’albumine plasmatique sur laquelle se fixent également tous les autres médicaments acides faibles. Lorsque deux médicaments acides faibles sont simultanément présents, une compétition dans la fixation aux protéines plasmatiques peut avoir lieu et c’est toujours l’AINS qui chasse l’autre acide faible, quel qu’il soit. S’il s’agit d’une AVK, l’augmentation de sa fraction libre (donc non liée à
l’albumine) accroît l’INR (International Normalized Ratio), donc la toxicité des AVK qui se traduit par des réactions hémorragiques d’autant plus sévères que l’INR est plus élevé.
À noter que :
- seule la fraction libre d’un médicament est active. Lorsque le médicament est fixé aux protéines plasmatiques, la quantité fixée indique la fraction de réserve qui se libère au fur et à mesure que la fraction libre est détruite et éliminée ;
- l’INR remplace aujourd’hui le taux de prothrombine dont l’évaluation de l’efficacité des AVK. En règle générale, sa valeur thérapeutique se situe entre 2,5 (thrombose veineuse profonde) et 4,5 (prothèse valvulaire cardiaque). La valeur imposée par le cardiologue ne doit en aucun cas être modifiée par l’odontologiste ou le stomatologue sous peine de réactions hémorragiques (si l’INR augmente, lors d’interaction AVK-AINS, par exemple) ou thrombotiques (si l’INR diminue).
Une interaction pharmacocinétique par compétition au niveau de l’albumine peut également s’observer entre :
- AINS et sulfamides hypoglycémiants avec pour conséquence la chute de glycémie pouvant, dans les cas sévères, conduire au coma hypoglycémique ;
- AINS et méthotrexate (MTX) pouvant conduire à l’augmentation de la toxicité du MTX avec hémorragie de toutes les muqueuses, et atteintes des lignées sanguines.
Le MTX est un antinéoplasique qui appartient à la famille des antimétabolites (antivitamine B9) antiacide folique. Il est habituellement utilisé dans le traitement des carcinomes bronchiques,
placentaires, mammaires ainsi que dans le traitement de polyarthrite rhumatoïde et dans celui du psoriasis.
Au niveau rénal : l’aspirine augmente la toxicité des sels du lithium dont elle augmente la rétention. En fait, le lithium suit le métabolisme du Na+. La rétention du Na+ par les AINS explique la rétention du Li2+ avec risque neurologique et cardiovasculaire.
La cardioprotection exercée par l’aspirine est abolie lors de son association à l’ibuprofène. Une telle association est donc à éviter. Il en est de même de toute association des AINS entre eux Interactions pharmacodynamiques
Le plus grand risque consiste en l’accroissement de la toxicité digestive des AINS associés entre eux ou associés aux corticoïdes.
Il ne faut pas oublier que certains AINS comme l’aspirine et l’ibutilide ont des propriétés antithrombotiques (antiagrégants plaquettaires) et de ce fait leur association à d’autres antithrombotiques (AVK, héparines et fibrinolytiques) comporte un risque sérieux de réactions hémorragiques.
- Applications cliniques des anti-inflammatoires
- Pourquoi utiliser un anti-inflammatoire ?
L’emploi des anti-inflammatoires est justifié dans le traitement de l’inflammation et des douleurs qui, en odontostomatologie, sont très souvent d’origine inflammatoire. Il n’y a que peu d’études comparant l’efficacité des corticoïdes à celle des AINS. La plupart des études disponibles comparent l’efficacité des AINS à celle des analgésiques et montrent que les antiinflammatoires sont plus efficaces que le paracétamol dans la suppression des douleurs dentaires soulignant ainsi la nature inflammatoire de ces douleurs.
- Pourquoi utiliser un corticoïde ?
L’efficacité des corticoïdes dans le traitement des douleurs d’origine inflammatoire et dans celui de l’inflammation ellemême est soulignée dans de nombreux travaux. Une première étude
indique l’efficacité des corticoïdes dans les douleurs dentaires (endodontic interappointment pain) avec inflammation pulpaire asymptomatique. Les auteurs ont utilisé, en double aveugle, soit 3 cp de 12 mg de dexaméthasone, soit une dose équivalente d’un placebo (dextrose) en apparence identique aux comprimés de dexaméthasone. Les résultats ont montré que
l’administration per os de dexaméthasone a entraîné une baisse significative de la perception des
sensations douloureuses versus placebo (p < 0,01). D’autres auteurs montrent l’efficacité de la dexaméthasone administrée par voie orale ou injectée en intramusculaire dans les douleurs consécutives aux traitements endodontiques.
L’efficacité des corticoïdes en utilisation topique endoalvéolaire ou en injection sous-muqueuse est apportée dans l’étude de Graziani et al. Ces auteurs ont évalué l’efficacité de la dexaméthasone dans le contrôle d’oedème, trismus et douleurs à j1 et à j7 après l’intervention contre l’efficacité d’un placebo et concluent que les corticoïdes avaient réussi à réduire de façon significative l’œdème, le trismus et la douleur. Des résultats similaires attestant l’efficacité des corticoïdes en cas de chirurgie au niveau de la cavité buccale ont été rapportés dans la littérature par de nombreux auteurs. La plupart des auteurs rapportent une efficacité sur la douleur (en
utilisant l’échelle visuelle analogique), sur le trismus (en mesurant la distance interincisive) et sur l’œdème.
- Quelle dose employer ?
Dans une étude récente Numazaki et Fujii confirment l’efficacité d’un prétraitement corticoïde en prévention de douleurs postchirurgicales. Les auteurs qui ont étudié l’effet de différentes doses de dexaméthasone concluent que le meilleur effet était obtenu avec une dose de 8 mg. La dose de 16 mg n’apportait rien de plus sur le plan thérapeutique. Cette étude était faite chez les patients programmés pour une chirurgie buccale réalisée sous anesthésie générale. L’utilisation de la dexaméthasone a été faite par voie intraveineuse (IV) et s’est avérée efficace dans la réduction des douleurs postchirurgicales (la demande en diclofénac était réduite dans le groupe prétraité par la dexaméthasone).
Dans un intéressant article, Alexander et Throndson ont effectué une revue générale de l’utilisation des corticoïdes lors de chirurgies des dents incluses, des extractions multiples, de remodelage alvéolaire tel que alvéoloplastie, vestibuloplastie, ainsi que dans toutes sortes de chirurgie extensive. Ils préconisent l’emploi d’un corticoïde, la dexaméthasone en l’occurrence, à raison de 2 cp de 4 mg, la veille de l’intervention (ou le matin de l’intervention si la chirurgie est programmée dans l’aprèsmidi) et l’administration de la même dose le lendemain et le surlendemain de la chirurgie. Ces auteurs concluent que l’emploi de corticoïdes permet de réduire la réponse inflammatoire à une agression traumatique d’origine chirurgicale.
- Dans quelles indications ?
Les corticoïdes peuvent être utilisés dans le traitement des douleurs liées à l’inflammation pulpaire, dans les douleurs consécutives aux traitements endodontiques et dans le traitement des péricoronarites. Dans cette dernière indication, ils sont associés aux antibiotiques.
Ils sont également et surtout utilisés dans la prévention de l’oedème et de la douleur lors de la chirurgie buccodentaire.
Il est à noter que :
- l’association corticoïdes-AINS ne permet d’obtenir aucun bénéfice supplémentaire dans la réduction d’oedème alors que le risque de survenue d’atteinte digestive ulcéreuse s’accroît significativement ;
- l’antibiothérapie n’est pas nécessaire si la corticothérapie est instaurée à titre prophylactique pour une courte durée, sauf bien entendu en cas de risque infectieux postopératoire clairement établi ou en cas d’utilisation chez des patients présentant un statut immunitaire altéré (dans ce cas s’abstenir de l’emploi des corticoïdes). En cas d’utilisation des corticoïdes dans le traitement de péricoronarite, le recours aux antibiotiques peut être envisagé ;
- en cure courte (inférieure à 4 à 5 jours), le traitement peut et doit être interrompu brutalement. L’odontologiste doit tenir compte d’éventuelles pathologies présentes chez son patient dans le choix de l’anti-inflammatoire.
L’ensemble de ces résultats montre une efficacité certaine des corticoïdes dans la prévention de l’inflammation et de ses conséquences (douleur, trismus, oedème) en cas de chirurgie programmée et en cas de traitement endodontique. En revanche, il n’y a que peu d’études comparant l’efficacité antiinflammatoire des corticoïdes versus AINS. Cependant, le mécanisme d’action des corticoïdes indique une action en amont de la synthèse de l’acide arachidonique contrecarrant la biosynthèse des deux voies métaboliques, cyclo-oxygénase et lipo-oxygénase, donc sur les phases vasculaires et cellulaires de l’inflammation associée à une action
anticytokines alors que seule la phase vasculaire de l’inflammation est accessible aux AINS. Il est donc possible d’admettre une supériorité d’effet des corticoïdes sur les AINS, ce qui justifie
pleinement l’emploi des corticoïdes en chirurgie odontostomatologique en respectant les contre- indications à leur emploi.
- Conclusion
À la lumière des données décrites dans la littérature et rapportées ci-dessus, il est possible
d’admettre la supériorité des corticoïdes sur les AINS en termes : d’efficacité, de toxicité en cas de cure courte et en l’absence des contre-indications. Le rapport bénéfice/risque est donc en faveur des corticoïdes qui doivent être utilisés (en l’absence des contre-indications) par les odontostomatologistes dans la prévention et le traitement de toute inflammation et douleur d’origine chirurgicale ainsi que dans le traitement des douleurs liées aux traitements endodontiques et dans celui des péricoronarites.
Dans cette dernière indication, ils peuvent être associés à un antibiotique.
Il est à rappeler que l’odontologiste a, pratiquement toujours, à faire face à une inflammation de caractère aigu et non à une inflammation de caractère chronique qui, comme en rhumatologie, nécessite souvent l’emploi d’un AINS.
Cependant, en cas de contre-indications de la corticothérapie, la prescription d’un AINS peut être envisagée. Elle doit tenir compte des mêmes recommandations nécessaires à l’établissement du rapport B/R. Ce dernier semble être en faveur des AINS tels que les dérivés de l’acide phénylacétique du groupe des acides arylcarboxyliques représentés par le diclofénac (Voltarène
®) comparativement aux salicylés et aux propioniques
Anti-inflammatoires en odontostomatologie: avantages et inconvénients des AINS versus corticoïdes
Voici une sélection de livres:
“Orthodontie de l’enfant et de l’adulte” par Marie-José Boileau
Orthodontie interceptive Broché – Grand livre, 24 novembre 2023
ORTHOPEDIE DENTO FACIALE ODONTOLOGIE PEDIATRIQUE
Nouvelles conceptions de l’ancrage en orthodontie
Guide d’odontologie pédiatrique: La clinique par la preuve
Orthodontie linguale (Techniques dentaires)
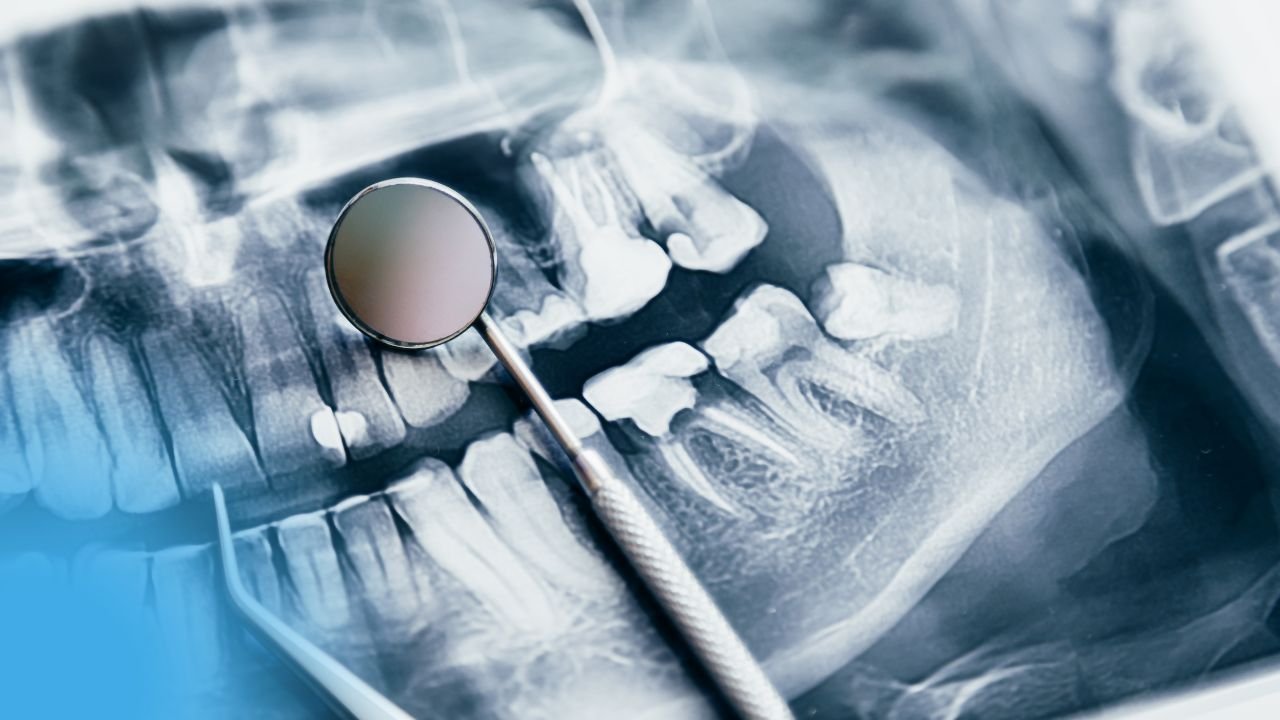
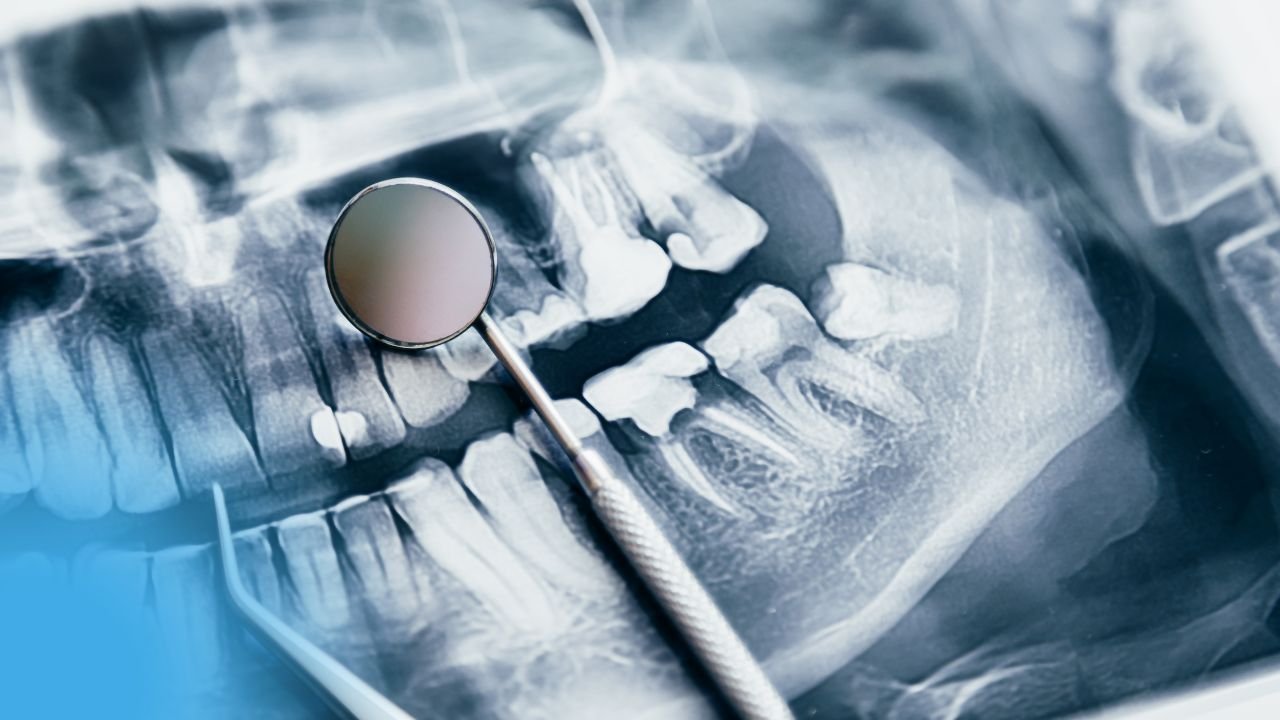


Leave a Reply