Anatomie et physiologie de L’ATM, des muscles masticateurs et de L’occlusion
Anatomie et physiologie de L’ATM, des muscles masticateurs et de L’occlusion
- Définition :
L’ATM est une Diarthrose de variété bi-condylienne mettant en relation le processus condylien mandibulaire (le condyle mandibulaire) et la fosse mandibulaire de l’os temporal (la cavité glénoïde) par l’intermédiaire d’un disque biconcave (le ménisque) fibro-cartilagineux et fermée par une capsule articulaire. ( Fig 1)
L’ATM relie la mandibule au massif facial et réalise l’union d’une partie convexe (le processus condylaire mandibulaire) mobile et d’une partie concave fixe, (la fosse mandibulaire de l’os temporale) se poursuivant en avant par une partie convexe (le tubercule articulaire du temporal), par l’intermédiaire d’un disque biconcave.
Les deux articulations droite et gauche sont seules dans l’organisme à travailler de façon couplée car elles sont caractérisées par une interdépendance fonctionnelle.
(Fig 1)
- Description : Chaque ATM comprend :
- Des surfaces articulaires osseuses.
- Des moyens d’union.
- Des moyens de glissement.
- Les surfaces articulaires osseuses : (Fig. 2)
- La surface articulaire temporale : Constituée de deux parties :
- Le tubercule articulaire (condyle ou éminence temporale)
- La fosse mandibulaire ou cavité glénoïde.
- La surface articulaire mandibulaire : c’est le condyle mandibulaire
- La surface articulaire temporale : Constituée de deux parties :
- Les moyens d’union :
- La capsule articulaire : (Fig3)
C’est un manchon fibreux lâche, d’épaisseur variable, ayant la forme d’un tronc de cône qui se fixe en haut sur le pourtour de la surface articulaire du temporal et en bas sur le col du condyle.
- Les ligaments :
Les ligaments latéraux
- Le ligament latéral externe : c’est un faisceau fibreux, très résistant tendu en éventail à la face externe de l’articulation. il représente à lui seul le principal moyen d’union de l’articulation.
- Le ligament latéral interne : qui est symétrique au premier mais moins puissant.
Les ligaments accessoires :(Fig 4)
- Le ligament sphéno-mandibulaire.(2)
- Le ligament stylo-mandibulaire.(1)
- Le ligament ptérygo-mandibulaire. (3)
(Fig 3) (Fig 4)
- Les moyens de glissement :
- Le disque articulaire : ou ménisque intercondylien
Il se présente sous forme d’une lentille biconcave, souple a grand axe transversal épousant intimement la surface temporale en haut et condylienne en bas. Le disque est de structure fibreuse, collagénique rétablissant la concordance des surfaces articulaire.
- La synoviale :(Fig 5)
C’est un liquide plasmatique secrété par la membrane synoviale tapissant la face interne des deux surfaces articulaires de chaque ATM, il assure la lubrification de l’articulation.
(Fig 5)
- Les muscles masticateurs
Ces muscles sont à l’origine de tous les mouvements et positions de la mandibule auxquels sont liés, d’une façon irrémédiable, les positions et mouvements de la langue et du plancher de la bouche.
Parmi les différents muscles qui interviennent au cours de la mastication, il convient de distinguer:
- Les muscles abaisseurs.
- Les muscles élévateurs.
- Les muscles propulseurs.
II. 1. Les muscles abaisseurs : (Fig.6)
Ils sont représentés essentiellement par les muscles sus-hyoïdiens, qui abaissent lamandibule en prenant comme point d’appui l’os hyoïde.
Les muscles sus-hyoïdiens comprennent : (Fig.7 et 8)
- Les muscles digastriques et stylo-hyoïdiens situés dans un plan superficiel.
- Les muscles génio-hyoïdiens dans un plan profond et n’ayant aucune interférence directe avec la prothèse.
- Les muscles mylo-hyoïdiens, constituant le plancher de la bouche. Ils s’étendent de la ligne oblique interne sur presque toute son étendue, jusqu’à un raphé fibreux médian tendu de la symphyse mentonnière à l’os hyoïde. Les fibres les plus postérieures s’insèrent sur l’os hyoïde.
Fig.7 Fig.8
II. 2. Les muscles élévateurs.
- Le masséter (Fig.9,10,11) c’est un muscle épais de forme quadrangulaire appliqué contre la face externe de la branche montante de la mandibule, constitué de deux faisceaux :
- Le faisceau superficiel, allant du bord inféro-antérieur de l’arcade zygomatique à l’angle inférieur de la mandibule.
- Le faisceau profond, s’étendant du bord inféro-postérieur de l’arcade zygomatique au milieu de la face externe de la branche montante de la mandibule.
Action: la principale fonction du muscle est l’élévation mandibulaire ; il peut également être actif lors de la propulsion.
Fig.9 Fig.10 Fig.11
II.2.2 Le temporal (Fig. 12 et 13) : c’est un muscle large et triangulaire qui occupe toute la fosse temporale, les fibres antérieures sont verticales, les fibres postérieures sont horizontales elles se réunissent pour former un tendon qui va passer entre le crâne et l’arcade zygomatique et engaine l’apophyse coronoïde de la mandibule, et se prolonge jusqu’au trigone rétro-molaire.
Action :
- Par sa portion antérieure il est élévateur de la mandibule
- Par sa portion postérieure il est rétropulseur de la mandibule.
II.2.3 Le ptérygoïdien interne (médial) (Fig.14 et 15). Symétrique du masséter, c’est un muscle épais quadrilatère, il s’étend de la fosse ptérygoïde à l’angle de la face interne du maxillaire inférieur.
Action : Elévateur de la mandibule : contraction bilatérale. Diduction de la mandibule : contraction unilatérale.
Fig. 14 Fig. 15
I.3. Muscles propulseurs : « Le ptérygoïdien externe (latéral) » (Fig. 16).
Il est formé de deux faisceaux qui s’unissent à leur extrémité:
- Le faisceau supérieur est sphénoïdal,
- Le faisceau inférieur est ptérygoïdien.
Le tendon sur lequel ils se jettent s’insère sur une fossette située sur la face antéro-interne du col du condyle et sur le bord antérieur du ménisque de l’articulation temporo-maxillaire.
Action :
La contraction bilatérale du muscle provoque la propulsion mandibulaire ; sa contraction unilatérale provoque la diduction controlatérale de la mandibule.
Fig. 16
- L’occlusion dentaire:
III.1. Définition :
Tout état statique mandibulaire (quel que soit la position de cette dernière) qui correspond à tous les contacts possibles entre les surfaces occlusales des arcades dentaires maxillaires et mandibulaires.
C’est aussi l’acte de fermeture des arcades résultant de l’activité du système neuro- musculaire de l’appareil manducateur qui aboutit à l’engrènement dentaire.
- Physiologie de l’occlusion :
- Notions statiques :
- Agencement intra-arcade : c’est le rapport des dents entre elles.
- Dans le plan horizontal : On déduit 3 courbes qui sont sensiblement parallèles à ce plan :
- Une courbe des cuspides primaires.
- Une courbe des cuspides secondaires.
- Une courbe des sillons de coalescences.
- Dans le plan sagittal :
- La courbe de Spee, à concavité supérieure, passant par le sommet de la canine inférieure et les cuspides vestibulaires des prémolaires et molaires et se termine au bord antérieur de la branche montante de la mandibule.
- Dans le plan frontal : `
- La courbe de Wilson, c’est une ligne imaginaire à concavité supérieure, passant par les pointes cuspidiennes des dents homologues de chaque côté de l’arcade mandibulaire.
- Agencement inter-arcade : C’est le rapport des arcades entre elles. (Les contacts occlusaux en ICM)
- Classification d’Angle : Elle est fondée sur le rapport première molaire Mandibulaire/première molaire maxillaire dans le sens sagittal, et par extension, elle s’applique aussi aux canines. On distingue :
- La classe I : Où la première molaire mandibulaire est mésialée d’une demi-cuspide par rapport à la première molaire maxillaire.
La pointe cuspidiènne de la canine mandibulaire est en rapport avec l’embrasure formée par la face distale de l’incisive latérale et la face mésiale de la canine maxillaire.
- La classe II : Avec mésiocclusion de la première molaire maxillaire par rapport à la première molaire mandibulaire et de la canine maxillaire par rapport à la canine mandibulaire.
- La classe III : Avec distocclusion de la première molaire maxillaire par rapport à la première molaire mandibulaire et de la canine maxillaire par rapport à la canine mandibulaire.
- Les contacts occlusaux :
Antérieurement :
- Dans le plan horizontal :
Le bord libre des incisives et canines mandibulaires viennent s’appuyer sur les faces palatines du groupe incisivo-canin supérieur selon des contacts punctiformes stabilisant ainsi l’occlusion en ICM et durant les mouvements de protrusion et de latéralité.
- Dans le plan sagittal : Over-jet 1-2 mm
- Dans le plan frontal :-Dans la classe I d’angle, les latérales et canines inferieures s’articulent avec 2 dents supérieures ;
Par contre les centrales inférieures ne prennent appui que sur les centrales antagonistes.
Over bite de 1 à 2mm Postérieurement :
En ICM, on distingue 2 groupes de cuspides supports (primaires) :
- Un 1er groupe mandibulaire : ce sont les cuspides vestibulaires des PM et M inférieures ; leur sommet est plus haut que celui des cuspides linguales. Elles sont les cuspides les plus importantes pour assurer la stabilité de l’occlusion en ICM.
La ligne de crêtes de ces cuspides vient se placer au centre des tables occlusales des dents maxillaires.
Les points supports du 1er groupes s’articulent principalement avec les crêtes marginales maxillaires. Seules les deuxièmes cuspides vestibulaires des molaires inferieures rencontrent les fosses centrales supérieures.
- Un 2ème groupe maxillaire : ce sont les cuspides palatines des PM et M supérieures.
La ligne des crêtes des cuspides palatines vient se placer, en ICM, au centre des tables occlusales des dents inférieures.
III.2.2 Notions dynamiques :
C’est l’étude des mouvements mandibulaires fonctionnels développés pendant la mastication, la déglutition, la phonation, ces derniers se répartissent en :
- Mouvements verticaux : qui permettent l’ouverture et la fermeture de la bouche.
- Mouvements horizontaux : représentés par les mouvements de propulsion, rétropulsion et de diduction.
Le premier qui a étudié ces mouvements c’est Posselt, il a utilisé comme point de repère, le point incisif inférieur, un stylet placé à ce niveau permet de tracer la trajectoire des mouvements mandibulaires qui s’inscrivent sur les plans : sagittal, frontal ethorizontal.
- Dans le plan sagittal et frontal : « Diagramme de Posselt »
- Point 1 représente la position de la RC.
- Point 2 représente l’ICM.
- Point 3 correspond au glissement des incisives jusqu’au bout à bout.
- point 4 il y a perte de contact incisif.
- Point 5 c’est la propulsion extrême.
- Trajet d’ouverture en rétrusion : en deux phases :
– 1ère phase : De 1 jusqu’à II (c’est l’arc de cercle « a »), elle correspond à une rotation simple des condyles dans leur cavité glénoïde qui, durant ce mouvement, conservent leur position de RC (position à partir de laquelle les mouvements d’ouverture et de diduction peuvent s’effectuer aisément).
– 2ème phase : Si, on augmente l’ouverture au-delà du point II ; les condyles vont se déplacer en bas et vers l’avant, vers le point III qui représente l’ouverture maximale, selon un mouvement de roto- translation en décrivant un arc de cercle « b ».
- Trajet de fermeture en protrusion : il est représenté par la courbe « c » qui va de l’ouverture maximale III jusqu’à la propulsion extrême (point 5).
- Trajet habituel de fermeture : c’est le trajet « h » en allant de l’ouverture maximale III jusqu’à « 2 » qui correspond à l’ICM en passant par le point « r » qui représente la position de repos.
- Trajet automatique rétro-antérieur en propulsion : de la position « 1 » de RC, le point incisif passe en « 2 » qui représente l’ICM puis en « 3 » qui correspond au glissement en bout à bout des incisives pour arriver en « 4 » ou il y a perte de contact incisif puis finir en « 5 » propulsion maximale.
- Dans le plan horizontal : « Arc gothique » décrit par Gysi, représente l’enregistrement des glissements latéraux.
- Le sommet figure la position 1 ou RC.
- Le point 2 : ICM.
- Le point 4 : perte de contact.
- Le point 5 : propulsion extrême.
- Les côtés du losange représentent les trajectoires en diduction qui est un mouvement asymétrique :
- Le côté vers lequel la mandibule se déplace est appelé coté travaillant, le condyle se déplace latéralement en dehors, c’est le mouvement de BENNET.
- Le côté opposé est appelé coté non travaillant, le condyle se déplace en bas, en avant et en dedans, selon une trajectoire curviligne et forme avec le plan sagittal médian un angle dit de BENNETT.
Anatomie et physiologie de L’ATM, des muscles masticateurs et de L’occlusion
Voici une sélection de livres en français sur les prothèses dentaires:
Prothèse fixée, 2e Ed.: Approche clinique Relié – Illustré, 4 janvier 2024
Prothèse Amovible Partielle : Clinique et Laboratoire
Collège National des Enseignants en Prothèses Odontologiques (CNEPO), Michel Ruquet, Bruno Tavernier
Traitements Prothétiques et Implantaires de l’Édenté Total 2.0
Conception et Réalisation des Châssis en Prothèse Amovible Partielle
Prothèses supra-implantaires: Données et conceptions actuelles
Prothèse complète: Clinique et laboratoire Broché – Illustré, 12 octobre 2017
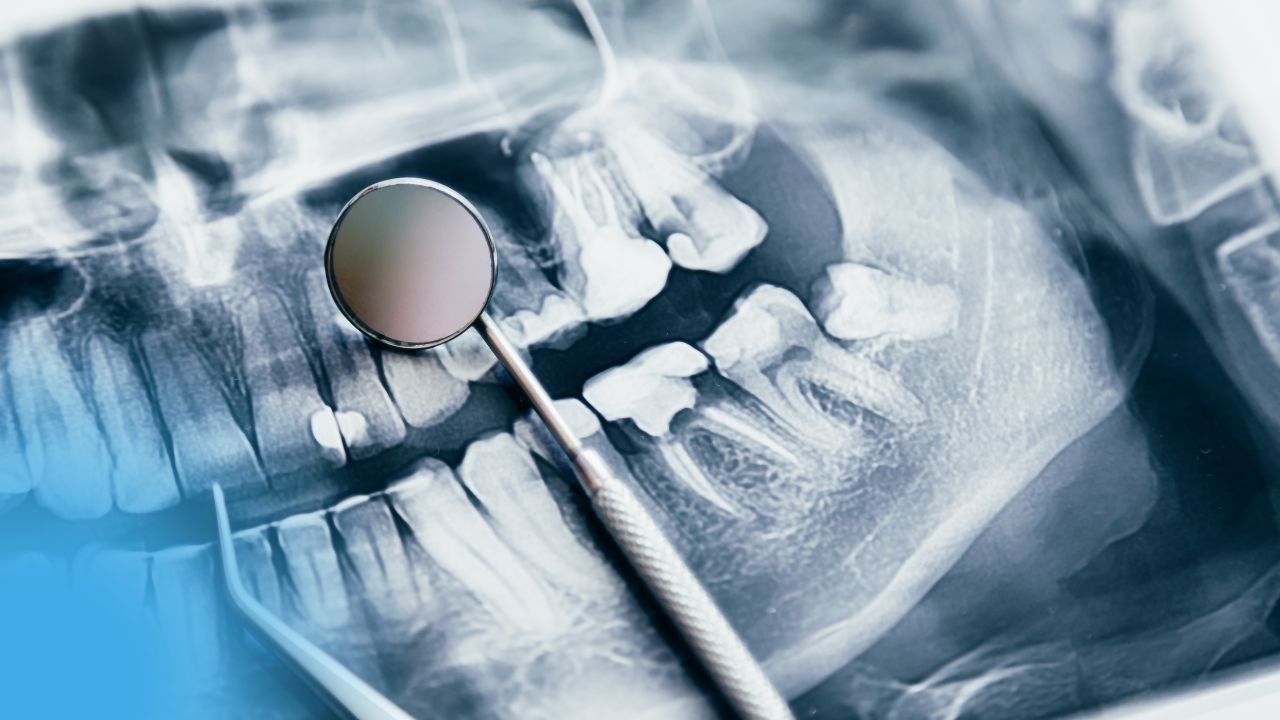



Leave a Reply