Le collage
Le collage
Collage
- L’adhésion, qui est l’ensemble des interactions physico-chimiques permettant une liaison entre deux matériaux de natures différentes,
- Il existe actuellement trois systèmes de collage faisant intervenir plusieurs technologies

Différentes colles
- Résines
- On les retrouve dans les colles et dans les matériaux composites.
- On distingue l’adhésif qui est une résine très fluide qui infiltre les rugosités des surfaces dentaires traitées et ainsi forme un clavetage mécanique,
- et les colles qui sont chargées en particules et créent le lien mécanique entre la couche adhésive et la prothèse.
- Dans les systèmes adhésifs, les résines sont généralement associées à des agents de type “primer” qui modifient la surface à coller.
Types de polymérisation
Polymérisation générale
- L’initiation de la polymérisation peut être obtenue par une source lumineuse dans le cas des colles photopolymérisables, ce qui permet un temps de manipulation important. La polymérisation peut être aussi chimique, par un mélange de type « base-catalyseur », ce qui permet d’obtenir une polymérisation complète sous des obligations opaques. On trouve également des colles dont la polymérisation est mixte « photo-chemo »
Polymérisation chimique, autopolymérisation
- Intérêt dans les cavités très profondes ;
- Polymérisation complète ;
- Temps de mise en œuvre compté ;
- Finition assez longue et délicate

Photopolymérisation
- Temps de mise en œuvre plus long.
- Enlèvement des excès avant polymérisation.
- Finition plus rapide.
- Risque de polymérisation incomplète dans le cas de restaurations épaisses et opaques.

Polymérisation mixte (dual)
- Polymérisation par la lumière pour initier la polymérisation du composite le plus superficiel complétée par un phénomène chimique d’autopolymerisation pour le composite le plus profond.
- Il est à noter que certains adhésifs de dernière génération en un seul flacon (automordançants) comprennent des acides faibles qui vont inhiber la polymérisation chimique des résines de collage chémopolymérisable, l’adhésion ne peut être obtenue.
Avantages et inconvénients
Avantages
- Plus grande résistance à la compression et à la flexion.
- Faible solubilité.
- Meilleure adhésion à l’émail et à la dentine ainsi qu’aux restaurations en composite ou en céramique.
- Polissage aisé.
- Plus grande résistance à l’abrasion.
- Meilleurs effets de translucidité et d’esthétique.
Inconvénients
- Coefficient d’expansion thermique plus élevé.
- Présence d’une couche inhibée en surface due à l’oxygène.
- Incompatibilité avec les substances à base d’eugénol.
- Plus faible tolérance aux erreurs de manipulation
Les résines « 4 META »
- le 4-META (4-méthacryloyloxyéthyl trimellitate anhydride) ;
- le tri-n-butyl borane (TBB).
- L’adhésion aux tissus dentaires, et en particulier à la dentine est efficace, grâce à la création d’une couche hybride de qualité.
- Une particularité des résines 4-META est de conserver une certaine plasticité après polymérisation, et ainsi d’absorber en partie les contraintes mécaniques et donc de limiter les risques de décollement.
Ciments verres ionomères modifiés à la résine
- Les ciments verres ionomères (CVI) sont utilisés depuis les années 1970.
- Ils possèdent une vraie adhésion chimique aux tissus minéralisés de la dent, ainsi qu’avec certains alliages.
- Cette adhésion se fait sans traitement de surface.
- Cependant, la résistance propre du matériau est inférieure à la force d’adhésion obtenue.
- Les CVI sont donc le plus souvent renforcés avec une résine.
- Le comportement mécanique des CVI est très proche de celui de la dentine (rigidité, expansion
Résines « méthyle diphosphate »
- La résine « MDP »,
- non seulement améliore l’adhésion à l’émail et à la dentine,
- mais procure un collage très efficace aux alliages métalliques.
- La prise du matériau est anaérobie et permet donc un temps de travail important.
- Le rendu esthétique est celui d’une résine composite.
Collage aux tissus dentaires
- Les deux tissus constituant la dent, l’émail et la dentine, sont assez différents quant à leur composition chimique et leurs propriétés physiques. L’émail est un tissu dur et cassant, alors que la dentine est souple et plus tendre.
- Cette dualité tissulaire confère à la dent une résistance mécanique très importante,
- cependant elle complique les processus d’adhésion
Spécificité de l’émail
Constitution
- L’émail est le tissu le plus minéralisé du corps humain. 96 % son poids est constitué de matière minérale, et les 4 % du l’eau et un peu de matière organique.
- matière minérale s’organise en long cristaux d’hydroxyapatite.
- Ces cristaux sont regroupés en faisceaux de prismes hexagonaux dont le diamètre de 4-8 µm. Au sein des prismes,
- les cristaux d’hydroxyapatite sont orientés parallèlement au grand axe.
- Cette substance interprismatique permet la cohésion des prismes entre eux.
- Les prismes prennent leur origine à la jonction améliodentinaire et rejoignent la surface de la couronne.
- La matrice organique est constituée de glycoprotéines et de polysaccharides
Mode d’adhésion
- C’est le Dr Michael Buonocore qui le premier mit en évidence qu’un acide pouvait altérer la surface de l’émail dentaire permettre un collage par une résine.
- La dissolution plus importante du cœur des prismes va en effet créer un microrelief à la surface de l’émail.
- Une résine peut ensuite s’infiltrer dans ces anfractuosités créées et assurer une adhésion par clavetage
- Le protocole idéal est l’application d’acide orthophosphorique à 37 %, durant 15 secondes.
- Les modifications de concentration de l’acide ou de sa durée d’application se traduisent par une baisse des valeurs d’adhésion (sous- ou surmordançage).
Spécificité de la dentine
- La dentine est une matrice extracellulaire sécrétée par les odontoblastes qui se calcifie par l’accumulation d’hydroxyapatite.
- Elle est moins minéralisée que l’émail.
- De par son mode de formation, elle est parcourue par de fins tubules
- Ces canalicules sont perpendiculaires à la jonction pulpodentinaire et contiennent de fins prolongements cytoplasmiques des odontoblastes
- La dentine, contrairement à l’émail, est un tissu qui va évoluer au cours de la vie de la dent.
- Sous l’action des sollicitations chimiques et mécaniques, les odontoblastes ont la possibilité de synthétiser de la néodentine.
- petit les canalicules vont s’oblitérer et le volume pulpaire se réduire.
- En fonction de la proximité pulpaire et du vécu de la dentine (agression, âge), la densité en tubuli peut être très variable.
Mode d’adhésion
- la dentine ne permet pas de créer un relief à sa surface par une attaque acide. De plus, la présence d’eau,
- notamment dans les prolongements cellulaires n’est pas favorable à un bon contact entre la résine et la dentine.
- La clef de l’adhésion dentinaire réside dans la possibilité de pénétrer les tubuli dentinaires par l’adhésif.
- Ces prolongements intratubulaires (tags) vont ancrer mécaniquement la résine à la dentine.
- la rétention est aussi obtenue par infiltration par l’adhésif des fibres de collagène de la surface préparée de la dentine.
- Il se crée la couche hybride.
Protocole
- il convient en premier lieu de nettoyer les surfaces à coller.
- Un détartrage ultrasonique et l’utilisation d’une pâte abrasive sans fluorures permettent de nettoyer efficacement les surfaces dentaires.
- les fluorures diminuent les valeurs d’adhésion.
- L’utilisation d’une digue est le meilleur moyen pour obtenir un champ opératoire propre et sec

L’adhésion en deux temps
- La première application est celle de l’agent de mordançage, l’acide orthophosphorique à 37 %
- une attaque acide de l’émail et de la dentine.
- respecter un temps d’application d’environ 15 secondes afin d’éliminer la boue dentinaire
- Le gel de mordançage est rincé abondamment,
- Les surfaces dentaires sont ensuite séchées délicatement.
- Un séchage intensif empêche la formation de la couche hybride et augmente le risque de douleur postopératoire.
- Le produit contenant le primer et l’adhésif est ensuite appliqué. Il permet de réhydrater les protéines de surface afin de garantir la formation de la couche hybride.
- Cet agent adhésif est polymérisé.
L’adhésion en un temps
- l’adhésion est obtenue en 1 temps
- Grâce à la 7ème génération d’adhésifs,
- le mordançage améliodentinaire, le traitement de la dentine et la mise en place de l’adhésif en une seule étape.
- on met en place le produit et on le polymérise. La couche adhésive est créée en une seule étape.
- A chaque fois que l’on est amené à utiliser des produits automordançants sur des préparations où la surface d’émail est importante,
- on a intérêt à réaliser un mordançage préalable de l’émail avec un acide orthophosphorique
Collage de la céramique
- Les céramiques sont par nature des matériaux cassants
- leur collage est un moyen efficace de pallier leur fragilité.
- La couche adhésive permet de dissiper l’énergie emmagasinée dans la céramique au travers des tissus dentaires sous-jacents.
- le collage renforce les éléments céramocéramique.
- On va classer les céramiques en deux catégories
Céramiques mordançables
- Ce sont des céramiques qui contiennent des silicates.
- Cette phase vitreuse peut être mordancée par un acide fort, l’acide fluorhydrique,
- Cet acide est appliqué
- L’acide doit être rincé abondamment.
- Puis dépose à la surface de la céramique un silane.
- Cet agent de couplage permet, d’une part de créer une liaison chimique à la phase vitreuse, et d’autre part de se lier à la résine de collage
- d’obtenir une adhésion forte dans le cas de céramique feldspathique, ou dans les céramiques pressées.
- Ce type de céramique étant suffisamment translucide, on peut utiliser un système adhésif photopolymérisant.

Céramiques renforcées non mordançables
- Dans le cas de céramiques renforcées à l’alumine ou au zircone
- le traitement à l’acide fluorhydrique est inefficace et ne permet pas de créer à la surface de telles céramiques un relief propice au collage.
- Il n’existe pas de protocole idéal.
- Le traitement par sablage de l’intrados de la prothèse avec de l’alumine permet d’améliorer simplement la rétention finale.
- Un dépôt artificiel de silice permet d’utiliser les propriétés des silanes.
- Les valeurs d’adhésion obtenues immédiatement sont très importantes
- Cependant, cette couche de silice déposée mécaniquement à la surface de la céramique semble vieillir prématurément sous les effets des agressions thermiques et mécaniques :
- les valeurs d’adhésion à moyen terme sont faibles.
- Ces céramiques étant plus ou moins opaques,
- il est important d’utiliser un système adhésif en partie, ou totalement chémopolymérisant, pas seulement photopolymérisant.

Collage du métal
- d’abord sous forme de macrorétention
- puis microrétention par sablage à l’alumine.
- Grâce aux colles de type 4-META les valeurs d’adhésion obtenues sur les alliages sont du même ordre de grandeur que l’adhésion aux tissus dentaires.
- Cependant, le collage avec un alliage noble est moins efficace qu’avec un alliage non précieux.
- des traitements de surface ont été proposés déposer à la surface du métal, de la silice.
- couplée à la résine de collage par l’application.
- Si les valeurs d’adhésion obtenues sont alors très importantes,
- la fatigue mécanique et thermique semble dégrader à moyen terme le collage perd de son efficacité.
Le collage
Voici une sélection de livres:
Parodontologie Relié – 1 novembre 2005
Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011
Parodontologie Broché – 19 septembre 1996
MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE
Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient
Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé
Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1
Endodontie, prothese et parodontologie
La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020
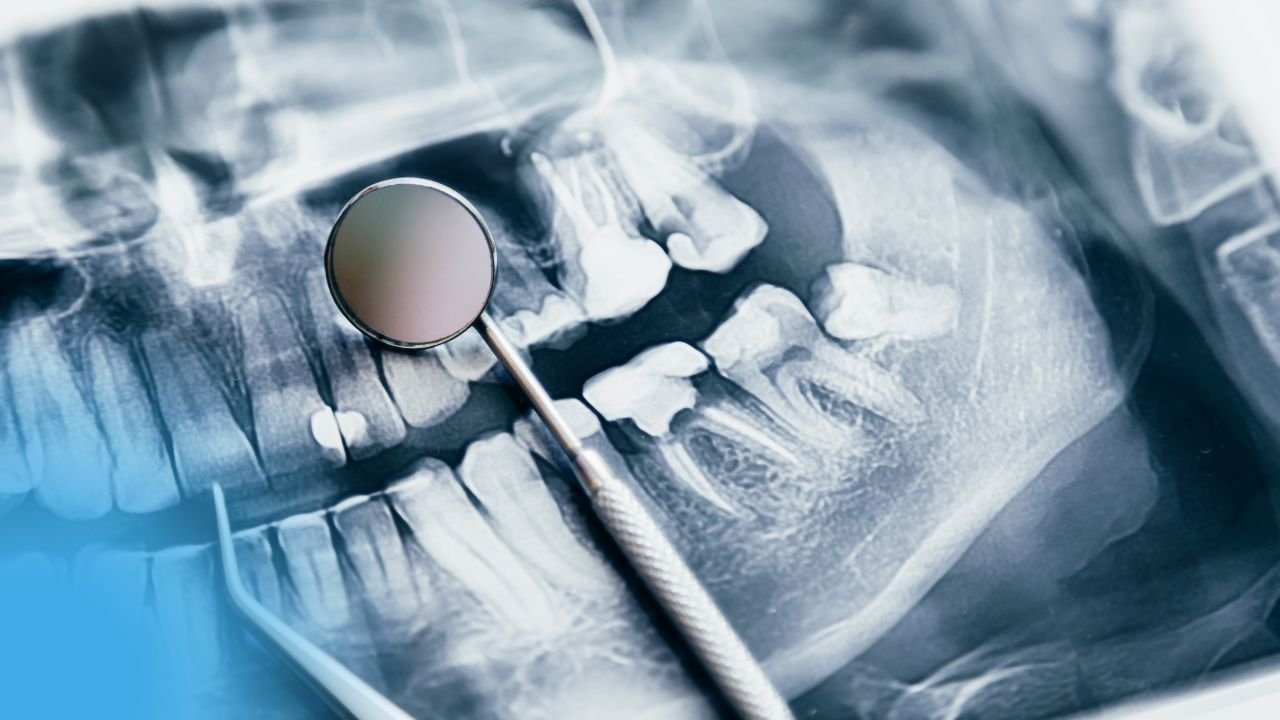



Leave a Reply