Occlusion Généralités – Terminologie
Occlusion Généralités – Terminologie
Définitions
L’occlusion : définie comme étant l’établissement d’un contact entre les dents antagonistes, naturelles ou artificielles, lors de la fermeture des arcades dentaires.
Occlusion en ICM intercuspidation maximale : C’est une position de référence dentaire qui détermine la position de la mandibule par rapport au maxillaire lorsque les arcades dentaires établissent entre elles le maximum de contacts occlusaux.
Occlusion en RC relation centrée : Actuellement, la définition de la relation centrée est proposée par le Collège national d’occlusodontologie, comme étant la situation condylienne de référence la plus haute, réalisant une coaptation bilatérale et transversalement stabilisée, suggérée et obtenue par contrôle non forcé, réitérative dans un temps donné et pour une posture corporelle donnée et enregistrable à partir d’un mouvement de rotation mandibulaire sans contact dentaire. »
occlusion de convenance : C’est une occlusion d’adaptation à une situation donnée, elle évolue dans le temps en répondant au vieillissement physiologique et aux altérations pathologiques de l’appareil manducateur. Elle peut être équilibrée ou déséquilibrée
Physiologie de l’occlusion
Notions statiques
La position physiologique de repos : C’est la position de la mandibule déterminée par un équilibre neuromusculaire apparent, en absence de tout contact dentaire, lorsque la tête est droite.
La dimension verticale de repos DVR :C’est la mesure chiffrée de la situation
précédente entre le point sous nasal et le gnathion.
La dimension verticale d’occlusion DVO :C’est la distance entre les deux points précédemment cités lorsque les deux arcades dentaires sont en intercuspidation maximale. Elle correspond à la hauteur de l’étage inférieur de la face lorsque les dents sont en occlusion d’intercuspidie.
L’espace libre de repos ou d’inocclusion : C’est la distance qui sépare les surfaces occlusales lorsque la mandibule se situe en position physiologique de repos. C’est la différence entre la DVR et la DVO.
La table occlusale : C’est la surface occlusale des dents pluri-cuspidées formée par les versants internes des cuspides vestibulaires et linguales (ou palatines).
Les crêtes marginales : c’est les poutres de résistance de la dent, elles représentent les limites mésiales et distales des tables occlusales. Elles forment le rebord d’une fosse triangulaire qui constitue avec la fosse correspondante de la dent adjacente la surface d’appui de la cuspide antagoniste.
Les fosses centrales : située au centre de la table occlusale des molaires, est destinée à recevoir la cuspide antagoniste qui s’appuie sur la partie inférieure de ses versants. Le fond de la fosse centrale n’a pas de contact occlusal.
Les cuspides supports ou cuspides d’appui : Ce sont les cuspides qui s’articulent avec les crêtes marginales et les fosses centrales des tables occlusales (vestibulaires inferieures et palatines supérieures). Elles maintiennent la DVO et participent à l’écrasement du bol alimentaire.
Les cuspides secondaires ou cuspides guides : Ce sont les cuspides vestibulaires supérieures et linguales inferieures ; elles sont hors occlusion en ICM.
Les cuspides primaires et secondaires :
Rôle des cuspides d’appui primaires :
-Stabilisation et calage des arcades dentaires au cours de la déglutition.
-Participent à l’écrasement du bol alimentaire au cours de la mastication
– Maintenir la dimension verticale et la relation centrée
Rôle des cuspides de guidages secondaires :
- Protection des lèvres et des joues (arcade maxillaire) et de la langue
(arcade mandibulaire) par l’intermédiaire de leur versant périphérique.
- Maintien du bol alimentaire sur l’aire occlusale au cours de la mastication par l’intermédiaire du versant central
- Dilacérer et couper.
La courbe de Spee : c’est une courbe à concavité supérieure, passant par le sommet de la canine inférieure et les cuspides vestibulaires des prémolaires et molaires et se termine au bord antérieur de la branche montante de la mandibule.
La courbe de Wilson : Elle passe par le sommet des cuspides des molaires de
chaque côté de l’arcade, l’inclinaison vestibulaire des molaires supérieures et
l’inclinaison linguale des molaires inférieures sont à l’origine de cette concavité.
Classification d’Angle : Elle est fondée sur le rapport première molaire Mandibulaire/première molaire maxillaire dans le sens sagittal, et par extension, elle s’applique aussi aux canines. On distingue :
-la classe I : ou la première molaire mandibulaire est mésialée d’une demi- cuspide par rapport à la première molaire maxillaire.
La pointe cuspidiènne de la canine mandibulaire est en rapport avec
l’embrasure formée par la face distale de l’incisive latérale et la face mésiale
de la canine maxillaire.
-la classe II : avec mésiocclusion de la première molaire maxillaire par rapport à la première molaire mandibulaire et de la canine maxillaire par rapport à la canine mandibulaire.
-la classe III : avec distocclusion de la première molaire maxillaire par rapport à la première molaire mandibulaire et de la canine maxillaire par rapport à la canine mandibulaire.
Notions dynamiques
C’est l’étude des mouvements mandibulaires fonctionnels développés pendant
la mastication, la déglutition, la phonation, ces derniers se répartissent en :
Mouvements verticaux : qui permettent l’ouverture et la fermeture de la
bouche.
Mouvements horizontaux : représentés par les mouvements de propulsion, rétropulsion et de diduction.
Le premier qui a étudié ces mouvements c’est Posselt, il a utilisé comme point de repère, le point incisif inférieur, un stylet placé à ce niveau permet de tracer la trajectoire des mouvements mandibulaires qui s’inscrivent sur les plans : sagittal, frontal et horizontal.
Dans le plan sagittal et frontal :
« Diagramme de Posselt »
- Point 1 représente la position de la RC.
- Point 2 représente l’ICM.
- Point 3 correspond au glissement des incisives jusqu’au bout à bout.
- point 4 il y a perte de contact incisif.
- Point 5 c’est la propulsion extrême.
- Trajet d’ouverture en rétrusion : en deux phases :
- 1ère phase : De 1 jusqu’à II (c’est l’arc de cercle « a »), elle correspond à une rotation simple des condyles dans leur cavité glénoïde qui, durant ce mouvement, conservent leur position de RC (position à partir de laquelle les mouvements d’ouverture et de diduction peuvent s’effectuer aisément).
- 2ème phase : Si, on augmente l’ouverture au-delà du point II ; les
condyles vont se déplacer en bas et vers l’avant, vers le point III qui représente l’ouverture maximale, selon un mouvement de roto-translation en décrivant un arc de cercle « b ».
- Trajet de fermeture en protrusion : il est représenté par la courbe « c » qui
va de l’ouverture maximale III jusqu’à la propulsion extrême (point 5).
- Trajet habituel de fermeture : c’est le trajet « h » en allant de l’ouverture maximale III jusqu’à « 2 » qui correspond à l’ICM en passant par le point « r » qui représente la position de repos.
- Trajet automatique rétro-antérieur en propulsion : de la position « 1 » de RC, le point incisif passe en « 2 » qui représente l’ICM puis en « 3 » qui correspond au glissement en bout à bout des incisives pour arriver en « 4 » ou il y a perte de contact incisif puis finir en « 5 » propulsion maximale.
Dans le plan horizontal :
« Arc gothique » décrit par Gysi, représente l’enregistrement des glissements
latéraux.
*- Le sommet figure la position 1 ou RC.
- Le point IM : ICM.
- Le point P : propulsion.
- Les côtés du losange représentent les trajectoires en diduction
Facteurs intervenants sur l’occlusion
L’occlusion est sous la dépendance de deux facteurs :
- Facteurs anatomiques.
- Facteur neuro-musculaires.
- Facteurs anatomiques :
- Déterminants antérieurs : « dentaires » ; sont représentés par le guidage antérieur (la pente incisive ou trajectoire incisive) qui se définit par : (trajectoire incisive) est le glissement des faces vestibulaires des incisives inférieures contre les faces palatines des incisives supérieures avec absence de contact entre les dents postérieures.
Ce guide antérieur permet de limiter les mouvements mandibulaires entre la position d’ICM et le bout à bout incisif protégeant ainsi les dents postérieures lorsque la mandibule effectue une propulsion.
- Déterminants postérieurs : « articulaires », sont représentés par les ATM qui sont des facteurs fixes non modifiables et déterminent les mouvements mandibulaires, peuvent être étudiés et reproduits (la pente condylienne et l’angle de Bennett).
- Facteurs neuro-musculaires :
Représenté par le système nerveux et musculaire. Ils assurent la coordination et le fonctionnement harmonieux de l’ensemble des constituants de l’appareil manducateur. Ils sont représentés par :
Les mécanismes neuro-moteurs : qui dirigent les mouvements mandibulaires.
Les mécanismes sensitivo-sensoriels : pour les sensations ou les sensibilités inconscientes. Les récepteurs de ces mécanismes se répartissent en :
- Extérocepteurs : donnent la perception superficielle, situés dans les revêtements cutanéo-muqueux.
- Intérocepteurs : donnent la perception profonde, représentés essentiellement par les propriocepteurs qui se situent à 3 niveaux :
- Les muscles : ils contrôlent l’élongation et la contraction musculaire.
- Les ATM : ils transmettent les informations concernant :
- La position de la mandibule.
- La vitesse et la direction des mouvements mandibulaires.
- Les sensations douloureuses
- Le desmodonte : ils transmettent la sensibilité et sont capables de percevoir des variations d’intensité, de direction et de vitesse des forces appliquées, ainsi ils répondent aux stimulations douloureuses.
Définitions
- Contact prématuré : Contact dentaire qui survient avant la position
d’intercuspidation maximale modifiant le trajet habituel de la mandibule
- Interférences : Sont des obstacles aux mouvements fonctionnels de la mandibule.
- Para fonctions : Activités qui s’exercent arbitrairement et qui s’imposent en dehors de toute fonction normale, mais en se servant des éléments même de la fonction.
- Dysfonction : Altération de la cinématique mandibulaire, accompagnée ou non de symptômes douloureux et du bruit articulaire.
- Bruxisme : Contractures inconscientes nocturnes ou diurnes, des muscles
élévateurs de la mandibule sous l’influences de certains états nerveux.
- Traumatisme occlusal : Lésion dégénérative qui se produit quand les forces
occlusales dépassent la capacité d’adaptation des tissus parodontaux.
- SADAM-ADAM- DAM : Ensemble des signes musculaires et articulaires de l’appareil manducateur qui traduit un défaut d’adaptation de l’appareil manducateur à une dysfonction.
Bibliographie
Occlusion Généralités – Terminologie
Voici une sélection de livres en français sur les prothèses dentaires:
Prothèse fixée, 2e Ed.: Approche clinique Relié – Illustré, 4 janvier 2024
Prothèse Amovible Partielle : Clinique et Laboratoire
Collège National des Enseignants en Prothèses Odontologiques (CNEPO), Michel Ruquet, Bruno Tavernier
Traitements Prothétiques et Implantaires de l’Édenté Total 2.0
Conception et Réalisation des Châssis en Prothèse Amovible Partielle
Prothèses supra-implantaires: Données et conceptions actuelles
Prothèse complète: Clinique et laboratoire Broché – Illustré, 12 octobre 2017

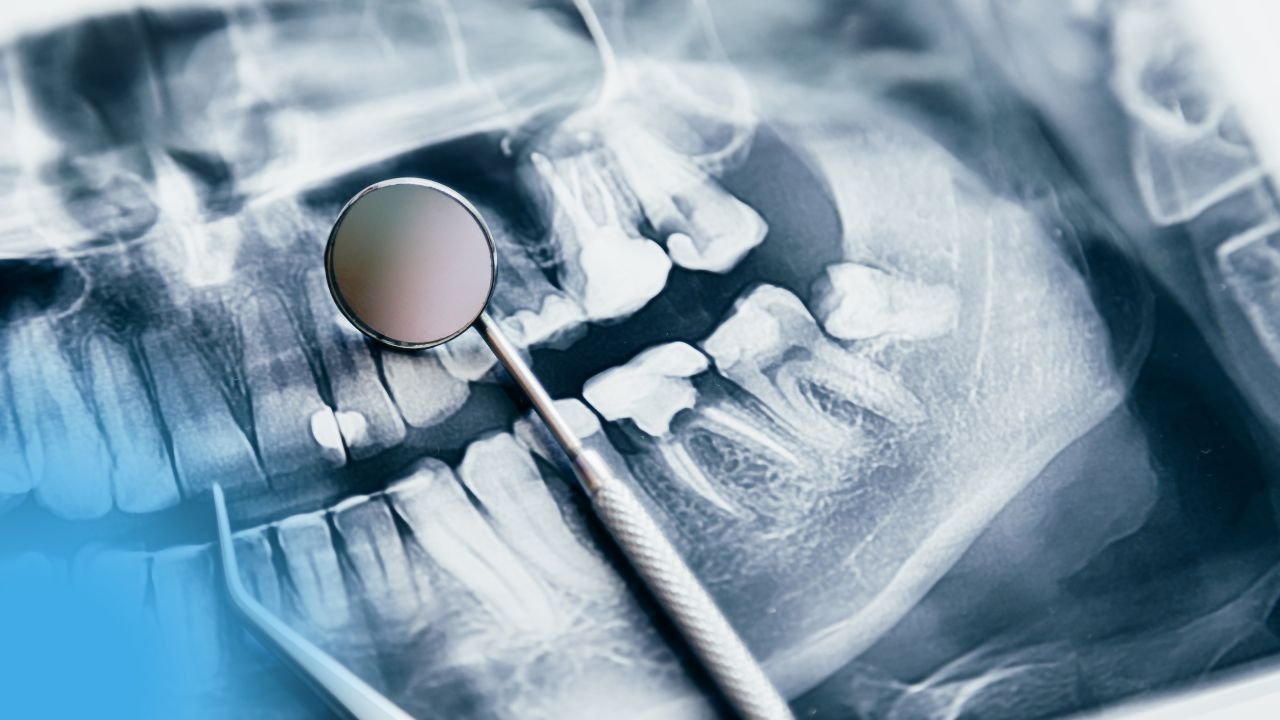


Leave a Reply