Mise en forme et nettoyage du système canalaire
Mise en forme et nettoyage du système canalaire
Introduction
Le traitement endodontique consiste en une première étape de préparation canalaire chimio- mécanique, qui vise à éliminer le contenu canalaire et à en assurer la désinfection, suivie d’une seconde étape d’obturation de l’ensemble du volume canalaire étanche à ses deux extrémités, apicale et coronaire.
Ce traitement permet la cicatrisation des tissus péri-radiculaires affectés.
- Objectifs cliniques du traitement endodontique:
- Prévenir ou éliminer l’infection, par l’éradication ou une réduction considérable de la charge
bactérienne et de leurs toxines du système canalaire, d’une part, et de tous les débris pulpaires, la prédentine et dentine infectées, susceptibles de servir de support et de nutriments à la prolifération bactérienne, d’autre part.
- Obtenir une mise en forme canalaire et apicale suffisante pour permettre aux solutions
d’irrigation de réaliser un nettoyage tridimensionnel de toutes les zones de l’espace canalaire, notamment la zone apicale, et d’y être renouvelées, afin d’être efficaces dans leur action antiseptique et solvante.
- La réalisation d’une obturation tridimensionnelle étanche, qui doit sceller toutes les portes de communication entre le réseau endodontique et le parodonte.
- Choix de la limite apicale et de la longueur de travail:
- Le succès du traitement endodontique impose au praticien de déterminer une limite apicale, jusqu’à laquelle il va préparer puis obturer le canal.
- C’est la distance séparant la limite apicale d’un repère coronaire fixe est appelée longueur de travail.
- Cette limite est idéalement choisie au niveau de la constriction, correspondant à la position la plus étroite de l’extrémité canalaire.
- Rappels anatomiques : région apicale
- Grove a défini la constriction apicale comme « l’endroit où la pulpe se termine et où le parodonte commence ».
- Selon Kuttler (1955) Plusieurs structures anatomiques sont identifiables dans la zone apicale de la racine :
→ La constriction apicale, point le plus étroit apicalement, qui définit deux structures triangulaires opposées à ce point qui en constitue leur sommet :
- Le cône dentinaire : dont la base est coronaire et le sommet est la jonction cémento- dentinaire (JCD)
- Le cône cémentaire : dont le sommet est la (JCD) et la base est le foramen
→ La jonction cémento-dentinaire (JCD): identifiable histologiquement seulement, qui est de hauteur très variable d’une dent à l’autre, voire même sur les parois d’une même racine, ou est parfois détruite.
→ Le foramen apical, qui constitue la sortie principale du canal vers le parodonte.
→ Le dôme apical représente le vertex de la dent.
→ Apex radiologique est l’image projetée sur un support radiologique (argentique ou numérique) de la partie la plus apicale de la dent.
- Choix de la limite apicale de la préparation canalaire:
- Selon l’approche standardisée:
→ Dans le cas de pulpe vivante, la limite conseillée est située entre 1 et 2 mm de l’apex radiographique, en espérant maintenir un moignon pulpaire apical vital.
→ Dans le cas de pulpe nécrosée et infectée, la limite conseillée est la plus proche possible de l’apex radiographique, dans la limite du dernier millimètre apical, afin de tenter d’éliminer la totalité des tissus nécrosés et des bactéries.
- Selon l’approche « schildérienne »:
→ Fondée sur la conicité apicale, la limite de la mise en forme doit se rapprocher le plus possible de la constriction apicale, voire se confondre avec elle, et ce, quelle que soit la situation clinique préopératoire.
- La mise en forme canalaire: Après avoir relocalisé les orifices canalaires, chaque partie accessible du canal est mise en forme en 3 étapes:
→ L’exploration qui correspond à la négociation initiale.
→ Le pré-élargissement : qui a pour but de sécuriser la trajectoire canalaire avant le passage des instruments de mise en forme.
→ La mise en forme proprement dite est actuellement réalisée à l’aide des instruments en Nickel-Titane, rotatifs ou manuels.
1ére étape : Réaliser une radiographie rétro-alvéolaire préopératoire qui donne une idée sure:
→ L’anatomie de la dent;
→ Sa longueur;
→ La perméabilité visible ou non des canaux.
2éme étape : Négociation/phase initiale ou cathétérisme
« C’est l’exploration initiale du canal (première entrée dans le canal) »
Est réalisée avec des limes en acier manuelles ou en NiTi (MMC 08 ou 10) de faible diamètre (généralement une lime KO8 ou K10).
But: s’assurer de la présence d’un « passage » dans le canal sans jamais forcer.
L’instrument de cathétérisme pénètre jusqu’au niveau où le canal peut l’accepter sans chercher à atteindre d’emblée la longueur de travail. « Prendre ce que le canal nous donne passivement »
RQ : Il est important d’entreprendre la négociation canalaire avec une cavité d’accès remplie de solution d’irrigation; permettant ainsi de lubrifier l’instrument et de faire circuler cette solution avec le mouvement de pénétration instrumental.
Technique opératoire : Dynamique instrumentale: reptation (lime K)
Après estimation de la longueur de travail sur une radiographie préopératoire bien angulée Une lime est pré-courbée sur ses derniers millimètres et insérée passivement dans le canal avec un mouvement de reptation, c’est-à-dire un mouvement de rotation alternativement en sens horaire et anti-horaire jusqu’à ce qu’il se trouve gainé (percevoir la première légère résistance à la progression).
RQ: L’instrument n’est jamais forcé en direction apicale.
Une fois qu’il se trouve à son point de pénétration maximum, il est libéré sur place par un petit mouvement de translation alternatif de retrait-poussée puis retiré avec un mouvement de rotation horaire afin d’entraîner les débris en direction coronaire.
→ Le mouvement de « reptation » est répété jusqu’au moment où la lime flotte dans le canal.
→ Après retrait de la lime, le canal est irrigué abondamment afin d’éliminer les débris en suspension et la longueur de pénétration des limes est alors mesurée.
3 éme étape : Mesure de la longueur de travail :
C’Est la distance qui sépare la limite apicale de préparation choisie d’un repère coronaire fixe. Différentes techniques sont ou ont été utilisées pour la déterminer:
- Utilisation du sens tactile
→ Introduire une lime de faible diamètre dans le canal jusqu’au blocage dans la progression.
→ Plusieurs études ont démontré que cette technique était empirique et que les résultats n’étaient pas reproductibles.
- Détermination radiographique :
- La radiographie rétro-alvéolaire.
- Les capteurs numériques. (RVG)
L’utilisation de différentes incidences permet au praticien de rassembler un maximum d’informations à partir de ses radiographies.
- Détermination électronique: C’est l’utilisation des localisateurs électroniques d’apex ou de foramen:
- Après la mise en place de l’électrode labiale et la mise sous tension du localisateur, la
deuxième électrode est mise au contact de l’instrument (lime K10) sous le manche, que l’on va faire progresser dans le canal jusqu’à ce que l’appareil indique par un signal sonore et visuel la constriction
- La mesure doit être réitérée plusieurs fois pour s’assurer de sa reproductibilité.
- Cette mesure peut être confirmée par une radiographie lime en place.
4 éme étape : Le pré-élargissement:
Une fois la lime K10 libre dans le canal:
→ Soit une lime K 15 manuelle est utilisée de la même manière;
→ Soit un instrument rotatif Nickel-Titane de pré-élargissement est choisi pour sécuriser la trajectoire canalaire avant la mise en forme canalaire.
- La technique manuelle:
→ Si la lime K 10 est complètement libre dans le canal et ne présente aucune friction, la lime K 15 est utilisée de la même manière : légère poussée jusqu’au blocage, puis mouvement de rotation horaire-antihoraire/traction. Elle sera ensuite retirée et le canal sera abondamment irrigué afin d’éliminer les débris en suspension.
→ Les MMC (Micro Mega Cathétérisme), MME (Micro Mega Elargisseur), existant dans les diamètres 6, 8, 10, 15/100 mm, peuvent être utilisés.
- Le principe de la technique est : l’effet de la première lime MMC qui atteint l’apex est
” amplifié par le passage d’une lime MME de même diamètre “. L’élargissement ainsi obtenu facilite le passage de la lime MMC de diamètre supérieur et ainsi de suite selon la séquence instrumentale suivante :
→ La lime MMC s’utilise avec un mouvement hélicoïdal dans les sens horaire/antihoraire de faible amplitude, en pénétration apicale sans jamais dépasser un huitième de tour, ni forcer en direction apicale.
→ La lime MME sera utilisée avec un mouvement de retrait (comme la lime H) avec appui pariétal circonférenciel.
→ L’élimination des débris organiques et dentinaires est assurée par ce mouvement de la lime MME sous irrigation abondante d’hypochlorite de sodium.
RQ :
→ Pour les canaux larges et rectilignes, on peut commencer au 15/100.
→ Pour les canaux difficiles, fins et courbes, il faut commencer au 8/100, voire au 6/100.
→ Il est indispensable d’utiliser un gel chélatant, qui facilitera grandement les manœuvres de cathétérisme.
- La technique mécanisée: (Le glide path endodontique)
C’est un tunnel radiculaire lisse allant de l’orifice canalaire jusqu’au terminus physiologique (la constriction foraminale).
RQ: Il est unanimement admis que le passage d’une lime K 10 totalement libre dans le canal radiculaire reste une étape incontournable pour sécuriser le canal avant la réalisation d’un glide path mécanisé.
Les limes de pré-élargissement qui peuvent être utilisé sont :
- Les PathFiles®,
- Les Pro Glider® (Dentsply Maillefer),
- Les WaveOne Gold Glider (Dentsply Maillefer)
→ Elles peuvent être utilisées en combinaison avec n’importe quel système de mise en forme canalaire en Nickel-Titane.
→ Ils facilitent la préparation des canaux difficiles, étroits et calcifiés, car ils permettent de préparer l’accès des instruments rotatifs en évitant le passage des limes manuelles n° 15 et 20.
Technique opératoire:
→ Sont utilisées en rotation continue à une vitesse lente (400 trs/min) sans pression en direction apicale.
→ L’instrument suit la trajectoire du canal sur quelques millimètres puis on le retirant dans un mouvement de peinture sur les parois canalaires.
→ En cas de résistance trop importante, la lime est retirée du canal, nettoyée à l’aide d’une compresse imbibée d’hypochlorite de sodium.
→ Le canal est irrigué et le mouvement de descente apicale est répété jusqu’à la limite de pénétration de la lime d’exploration initiale.
→ Un gel chélatant lubrifiant peut être utilisé lors de cette étape.
5 éme étape : la mise en forme canalaire proprement dite
- Les concepts de mise en forme
1 – Approche « standardisée » (l’école scandinave) : décrite dans les années 1960 par John Ingle,
Objectif:
→ Éliminer une épaisseur importante de dentine au niveau du tiers apical et de créer une boîte apicale cylindrique (cône d’arrêt ou stop apical) permettant:
- D’éliminer les débris et les bactéries dans la région apicale.
- De bloquer les matériaux au moment de l’obturation.
Elle reposait initialement sur l’utilisation successive de broches (un quart de tour et retrait) de diamètre croissant selon la longueur de travail pour élargir progressivement les derniers millimètres du canal, suivie de l’utilisation de limes d’Hedströem en limage circonférentiel (limes H ou racleurs) et de forêts de Gates pour mettre en forme le reste du canal.
RQ : Pour les dents infectées:
→ Le diamètre devrait encore être plus large
→ Le traitement endodontique doit se réaliser en une ou plusieurs séances intermédiaires avec placement de Ca(OH)2 dans les canaux afin de parfaire la désinfection canalaire
2. Approche fondée sur la conicité : proposées par Schilder (1974)
Objectif :
→ L’obtenions d’une conicité continue à partir du terminus apical jusqu’à l’orifice caméral ;
→ Le respect de la trajectoire originelle du canal, notamment dans les deux tiers apicaux ;
→ Une mise en forme suffisante permettant d’obtenir une conicité apicale adéquate, garante de la pénétration et du renouvellement des solutions d’irrigation ;
→ Le maintien du foramen apical le plus étroit possible et le respect de sa position spatiale originelle sans déchirure ni déplacement.
En fin de préparation, le canal doit présenter un évasement régulier depuis l’apex jusqu’à l’orifice coronaire, dans tous les plans de l’espace, en se calquant sur son anatomie initiale.
Élargissement ou conicité ?
La seule étude publiée à ce jour et comparant les deux concepts a montré un taux de succès :
→ Identique entre les deux concepts dans les traitements initiaux sur les dents sans lésion inflammatoire périradiculaire d’origine endodontique (LIPOE) préopératoire ;
→ De 10 % supérieur avec la technique sérielle et obturation à la gutta chaude dans les dents avec LIPOE préopératoire.
- Techniques de mise en forme canalaire proprement dite :
- Technique manuelle: appelée aussi la technique ” step back “, la ” serial préparation ” de Weine ou méthode de l’alternance.
Principe
Il s’agit de réaliser la préparation du canal, depuis le cathétérisme jusqu’à la mise en forme définitive, à l’aide d’instruments manuels de diamètre croissant, sans jamais sauter de numéro, sous irrigation abondante.
Le passage à l’instrument de diamètre supérieur ne se fera que si l’instrument précédent est libre dans le canal, à la longueur de travail, jusqu’au 25/100 minimum, avec au besoin retour à un instrument de diamètre inférieur (step back) si l’instrument considéré n’était pas libre dans le canal et à la bonne longueur.
Instrumentation: Les instruments de base sont la broche, la lime K et la lime H.
Séquence instrumentale : après cathétérisme et détermination de la LT, sous irrigation de 1 à 2 ml d’hypochlorite de sodium à 2,5 % entre chaque passage d’instrument, la séquence est la suivante :
- La lime K n° 25 constituant la lime apicale maîtresse (LAM) ou lime apicale de référence (LAR) de Weine, c’est le minimum de diamètre à atteindre à la LT.
- Les limes successives de diamètre croissant sont raccourcies de 0,5 à 1 mm par rapport à la lime précédente jusqu’à la lime finale de préparation.
Les étapes importantes de la technique sont :
→ Arriver à LT avec la LAM (en fonction du diamètre du canal) ;
→ Réaliser un cône d’arrêt à la limite apicale choisie.
→ La lime K s’utilise en un quart de tour dans les sens horaire et antihoraire alternativement, avec une légère pression apicale et retrait.
→ La lime H s’utilise uniquement en traction ou retrait avec appui pariétal circonférenciel.
→ Cette technique permet de préparer la plupart des canaux radiculaires, même ceux ayant une courbure modérée, et ce avec des résultats constants.
- Technique de mise en forme mécanisée (crown down):
Le principe du « crown-down » est l’élimination des contraintes coronaires, en commençant la préparation par la zone coronaire du canal en utilisant des instruments de gros diamètre, afin de pouvoir aborder les derniers millimètres apicaux en utilisant les instruments de plus en plus fins.
Règles essentielles pour tous les systèmes NiTi mécanisés : Les instruments Nickel-Titane doivent être utilisés avec moteur ou contre angle.
- L’accès coronaire doit être correctement aménagé afin d’éviter les contraintes coronaires sur l’instrument.
- Le canal doit toujours être exploré avec des limes manuelles en acier.
- Les instruments ne doivent jamais être forcés apicalement.
- Les instruments ne doivent pas être maintenus en rotation à la même longueur dans le canal, sans mouvement vertical de va-et-vient.
- Les instruments doivent être vérifiés après chaque passage.
- Les contre-indications de la rotation continue (double courbure, crochets apicaux).
- Mise en forme des deux tiers coronaires: permet
- De libérer les instruments coronairement pour leur assurer un accès direct au tiers apical;
- La pénétration d’un plus grand volume de solution d’irrigation dans le corps du canal;
- Réduit le refoulement apical des débris;
- Offre une meilleure sensibilité tactile pour le travail des instruments pré courbés qui pourront explorer la zone apicale sans friction coronaire.
- Accroit la précision des localisateurs d’apex électroniques, dont la mesure est plus fiable puisque la lime est en contact avec les parois dentinaires au niveau apical
De nombreux instruments sont à la disposition du praticien pour la préparation des deux tiers coronaires du canal:
- Soit à l’aide de forêts de Gates utilisés en séquence ascendante pour élargir la partie coronaire du canal;
- Soit en utilisant les instruments NiTi rotatifs.
Quasiment tous les systèmes des instruments de mise en forme coronaire ont deux caractéristiques communes :
- Ils sont de plus forte conicité;
- Plus courts que les autres instruments de la série qui sont destinés à travailler plus apicalement.
- Tous ces instruments doivent être utilisés sans aucune poussée apicale, ainsi ils doivent être guidés par le canal à la descente et par la main du praticien à la remontée.
Dans la phase de retrait, l’instrument est appuyé sur la paroi du canal où de la dentine doit être éliminée :
- Sur les racines rondes, ce mouvement de brossage des parois se fait de manière circonférentielle ;
- Sur les racines plates l’action des instruments est dirigée sélectivement du côté opposé à la furcation dite « de sécurité » afin de relocaliser l’entrée canalaire tout en évitant la fragilisation de la paroi interne des racines.
Technique opératoire:
- Le foret de Gates-Glidden:
- Il est utilisé avec des mouvements verticaux en balayant toutes les parois du canal en retrait de son point de pénétration maximum.
- La séquence doit toujours être adaptée au canal traité: insérer le foret n° 2, suivie du n° 3 et peut-être le n° 4.
- Si le canal est étroit, l’utilisation du n° 1 est possible. 2.Élargissement par les instruments en NiTi rotatifs:
- Les instruments de forte conicité sont destinés à ouvrir une voie aux instruments de plus faible conicité jusqu’au niveau où le canal a été pré-élargi.
- Ils doivent être guidés par le canal à la descente, sans pression excessive, et par la main du praticien à la remontée: sont utilisés avec une légère pression, par des mouvements de va- et-vient verticaux, et chaque mouvement de brossage fait avancer l’instrument plus apicalement dans le canal.
- Au retrait l’instrument est nettoyé et le canal irrigué à l’hypochlorite, la lime de perméabilité est passée entre chaque instrument afin d’assurer la vacuité du canal.
- Dès que l’instrument ne peut plus avancer apicalement, l’instrument suivant de la séquence est utilisé selon les mêmes principes.
- La progression s’arrête dès que l’un des instruments parvient à la profondeur du canal pré- élargi.
- Mise en forme du tiers apical:
a/Phase d’exploration du tiers apical: Une lime K 10 manuelle en acier (lime dite« de perméabilité») est précourbée et utilisée pour explorer la zone apicale. Cette étape est importante car elle permet de :
- Rassembler des renseignements sur l’anatomie de la zone apicale;
- Déterminer de manière précise et définitive la longueur de travail à l’aide d’un localisateur d’apex électronique et d’une radiographie si nécessaire ;
- Confirmer la perméabilité du foramen apical.
La partie coronaire du canal est remplie d’hypochlorite de sodium et/ou de gel chélatant, la lime K 10 manuelle reliée au localisateur d’apex est insérée passivement dans le canal.
Une fois que la LT est établie et confirmée, et que la lime K 10 est libérée apicalement, elle est doucement poussée à la LT, puis à la LT + 0,5 ou 1 mm afin de confirmer la perméabilité apicale.
Cette manœuvre sera répétée tout au long de la mise en forme apicale afin de s’assurer qu’aucun bouchon ne vient obstruer le foramen.
La LT, qui correspond donc à la limite apicale de préparation, sera différente en fonction du concept de mise en forme choisi :
→ Elle sera, au foramen, de moins 1,5 à 2 mm pour une préparation avec stop apical ;
→ Elle sera à la constriction apicale (foramen électronique moins 0,5 mm) pour une préparation avec conicité apicale.
À partir de ce stade, un pré-élargissement supplémentaire de la zone apicale doit être réalisé et peut être obtenu :
- Soit par l’utilisation d’une lime K 15 manuelle précourbée et amenée à la longueur de travail par des mouvements de rotation horaire/antihoraire ;
- Soit par l’utilisation très avantageuse d’instruments rotatifs NiTi de pré-élargissement.
A ce moment-là la mise en forme peut être réalisée de manière extrêmement fiable avec les instruments du système choisi par le praticien et en respectant les instructions du fabricant.
b. Phase de mise en forme et de finition du tiers apical
De manière générale, certains systèmes disposent d’une gamme d’instruments suffisamment étendue pour permettre la préparation selon les deux concepts.
La décision finale reviendra toujours au praticien qui, se fondant sur son sens clinique, jugera de l’utilisation d’un instrument ou d’un autre.
→ Pour une préparation en technique de stop apical (concept d’élargissement), les instruments d’un diamètre de plus en plus important et de plus faible conicité seront amenés successivement à la limite apicale choisie pour la préparation.
Une fois la séquence de base achevée (généralement au diamètre 25) les instruments de diamètre et de conicité supérieure (30 ,35 et 40 ou 45 en 2% ou 4%) peuvent être utilisés.
→ Pour une préparation en conicité apicale, les instruments suivants de la séquence utilisée sont amenés à la longueur de travail. Dans la plupart des systèmes existants, il s’agit d’un instrument 25.06.
- Nouveaux concepts de mise en forme canalaire mono-instrumentale en mouvement réciproque:
→ Bien que chaque système comporte plusieurs instruments, le principe est de n’en utiliser qu’un seul.
→ L’instrument doit avoir un diamètre apical et une conicité supérieure à ceux du canal concerné.
→ Il s’agit d’un mouvement alternatif d’amplitude différente dans un sens et dans l’autre. On pourrait parler de « mouvement alternatif asymétrique », « réciprocité » ou « mouvement réciproque » .
→ En effet, Le mouvement de réciprocité consiste à animer les limes de conicité élevée d’un mouvement horaire/antihoraire d’amplitude variable.
→ L’intérêt principal du mouvement réciproque est la réduction de la fatigue cyclique des instruments par rapport au mouvement de rotation continue.
→ Le concept est représenté par deux instruments différents utilisant le mouvement de réciprocité : WaveOne® (Dentsply-Maillefer) et Reciproc® (Dentsply-VDW)
La mise en forme canalaire avec ces instruments suit la même stratégie que celle évoquée précédemment :
- Exploration (lime K manuelle);
- Pré-élargissement (lime K manuelle ou avec PathFile®);
- Puis mise en forme des deux tiers coronaires d’abord;
- Ensuite, exploration, pré-élargissement et mise en forme du tiers apical.
Conclusion
La procédure du traitement canalaire initial est très bien codifiée et permet de réaliser des traitements endodontiques de qualité si les règles de base sont respectées.
La pose de la digue et l’utilisation des moyens de grossissement sont des prérequis.
La compréhension des objectifs, la connaissance de l’anatomie, le respect du protocole opératoire et, surtout, la connaissance des limites et des contre-indications permettent de traiter la majorité des cas avec succès.
Mise en forme et nettoyage du système canalaire
Voici une sélection de livres:
Parodontologie Relié – 1 novembre 2005
Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011
Parodontologie Broché – 19 septembre 1996
MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE
Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient
Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé
Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1
Endodontie, prothese et parodontologie
La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020
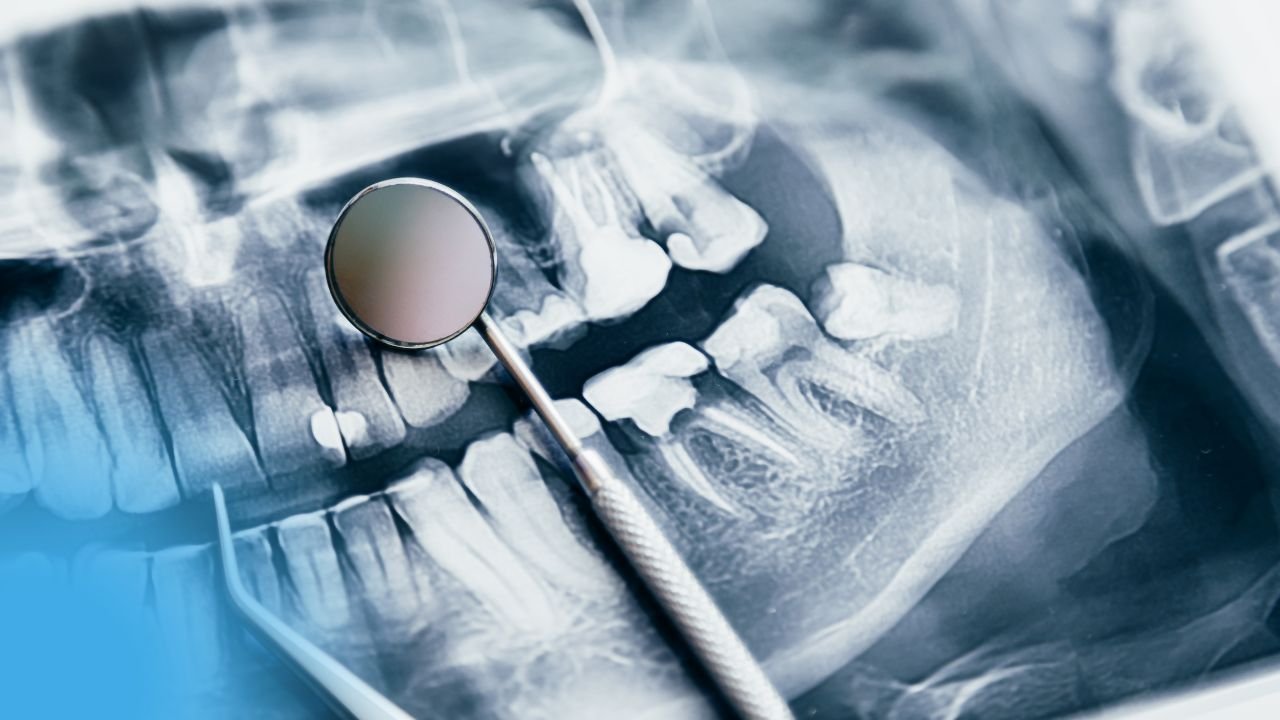



Leave a Reply