LES LESIONS INFLAMMATOIRES PERIAPICALES D’ORIGINE ENDODONTIQUE Dynamique inflammatoire, Diagnostic et Formes Cliniques des LIPOE
LES LESIONS INFLAMMATOIRES PERIAPICALES D’ORIGINE ENDODONTIQUE Dynamique inflammatoire, Diagnostic et Formes Cliniques des LIPOE
PATHOGENESE DES PATHOLOGIES PERIAPICALES ET STRUCTURE DES LESIONS :
- La réponse initiale aigue et exacerbation primaire
- La transformation chronique et exacerbation secondaire
- Transformation en kyste
DIAGNOSTIC CLINIQUE DES PARODONTITES APICALES
1) Les moyens du diagnostic : Evaluation de la symptomatologie
2) Les moyens du diagnostic : Evaluation des signes subjectifs
3) Les moyens du diagnostic : Evaluation des signes objectifs
4) Les moyens du diagnostic : Les tests cliniques de diagnostic
+ Les tests de sensibilité pulpaire :
+ Test de percussion :
+ Tests de palpation intra-orale
5) Les moyens du diagnostic : Les tests complémentaires : Le test du cône de gutta-percha :
6) Les moyens du diagnostic : Les tests complémentaires : Le sondage parodontal :
7) Les moyens du diagnostic : Les tests complémentaires : le test de transillumination
8) Les moyens du diagnostic : Les tests complémentaires : l’examen radiographique
LES FORMES CLINIQUES DES PARODONTITES APICALES
A. PARODONTITES APICALES SYMPTOMATIQUES
- Parodontite apicale aigue liée à un traumatisme occlusal :
- Parodontite apicale aigue primaire
- Parodontite apicale aigue primaire abcédée
- Parodontite apicale aigue secondaire abcédée (Abcès phœnix)
B. PARODONTITES APICALES ASYMPTOMATIQUES
- Parodontite apicale chronique simple
- Ostéite condensante :
- Granulome apical ou parodontite périapicale proliférative
- Kyste périapical
- Parodontite apicale chronique fistulisée :
Pr Nobila TAHARI : 2023/2024
1. Pathogénèse des pathologies périapicales et structure des lésions :
1. La réponse initiale aigue et exacerbation primaire
Il s’agit d’une réponse de l’hôte intense et de courte durée. Cette réponse initiale aiguë peut être initiée par les bactéries du canal infecté, mais aussi par un traumatisme ou une lésion iatrogénique.
Elle est caractérisée par une hyperémie, une congestion vasculaire, un œdème du desmodonte, une extravasation des neutrophiles et des monocytes et une résorption osseuse limitée. Histologiquement, les modifications tissulaires sont limitées à l’espace desmodontal périapical et à l’os voisin. La dent est sensible et douloureuse à la pression. La lésion n’est pas obligatoirement détectable à la radiographie. Toutefois, la réaction ostéoclastique est très rapidement déclenchée par l’accumulation des médiateurs chimiques.
A ce stade, plusieurs voies sont possibles :
- La guérison spontanée,
- L’amplification de l’inflammation et la formation d’un abcès primaire,
- L’abcédation et la fistulisation
- L’évolution vers la chronicité.
2. La transformation chronique et exacerbation secondaire
La présence continue d’irritants intracanalaires favorise graduellement le passage de l’inflammation initiale vers une lésion encapsulée par un tissu conjonctif collagénique contenant de plus en plus de macrophages et lymphocytes, produisant des anticorps et des cytokines.
Au cours de cette transformation, les cytokines vont orienter le statut de la lésion,
- Tantôt en stimulant les facteurs d’activation des ostéoclastes et en favorisant la résorption osseuse,
- Tantôt en favorisant les facteurs de croissance stimulant la prolifération des fibroblastes et l’angiogénèse, la reconstruction du conjonctif et le ralentissement de la résorption.
Ainsi, le granulome reflète un stade d’équilibre entre les agresseurs confinés dans le canal et une défense autocontrôlée. Il peut rester au repos et sans symptômes pendant plusieurs années et sans modification radiographique décelable.
À tout moment, ce fragile équilibre peut-être rompu, les bactéries s’avancent à la lisière du périapex et déclenchent une exacerbation aiguë, sous forme d’abcès secondaire mieux connu sous les noms d’abcès phoenix ou d’abcès récurrent. La résorption osseuse reprend et on observe un élargissement de la zone radicolaire. Ainsi, la progression de l’inflammation n’est pas linéaire, mais discontinue avec alternance de poussées aiguës de courte durée au sein de la phase chronique s’étalant sur des années Histologiquement, le granulome est un tissu de granulation infiltré et vascularisé, limité par une membrane fibroconjonctive. Cette capsule, bien délimitée, consiste en fibres de collagène denses, fermement attachées à la surface radiculaire, de telle façon que si l’on extrait la dent, la lésion appendue à l’apex est retirée simultanément.
Dans le cas d’exacerbations aiguës secondaires, l’extension des foyers abcédés peut varier d’une petite zone complètement encapsulée au sein du granulome, à l’engloutissement de portions importantes du granulome au sein de la masse abcédée
3. Transformation en kyste
Tous les granulomes n’évoluent pas en kystes. Seulement 20 % des lésions épithélialisées seraient des kystes et, parmi celles-ci, la moitié correspondrait à des kystes en poche s’ouvrant dans le canal et non à des kystes vrais.
Un kyste vrai est défini par 4 éléments histologiques principaux, du centre vers la périphérie :
- Une cavité kystique qui contient des débris nécrotiques et des érythrocytes reliquats d’hémorragies. La présence de cristaux de cholestérol dans certaines cavités kystiques (29 à 43% des kystes) résulte de la précipitation des lipides issus des cellules désintégrées (érythrocytes, lymphocytes …) et des lipides circulants
- Un épithélium continu bordant cette cavité. Il s’agit d’un épithélium squameux stratifié dont l’épaisseur varie de une à plusieurs couches et qui contient des espaces intercellulaires permettant le passage des neutrophiles vers l’intérieur de la cavité kystique ;
- Un tissu périphérique contenant des vaisseaux, infiltré par les macrophages, les lymphocytes et les plasmocytes, plus rarement par des polynucléaires ;
- Une capsule fibreuse collagénique contenant l’ensemble des éléments précédents.
Dans le cas des kystes en poche la formation de la lésion est différente
✓ Une barrière de neutrophiles s’installe à l’apex pour contenir les germes intracanalaires. Avec le temps les neutrophiles s’accumulent et forment un bouchon apical ;
✓ Les cordons épithéliaux prolifèrent en périphérie et réalisent un attachement épithélial aux parois radiculaires, isolant le bouchon apical de neutrophiles ;
✓ Le bouchon continue à croître. Lorsqu’il se désintègre une micro-poche se forme, puis s’élargit formant un diverticule du canal, en forme de sac, confiné à l’intérieur de la lésion
II. DIAGNOSTIC CLINIQUE DES PARODONTITES APICALES
La difficulté du diagnostic ne réside pas dans la prise de décision thérapeutique, mais plutôt dans l’établissement du diagnostic différentiel entre les formes aiguës ou chroniques, primaires ou secondaires, supportées ou non. Cette difficulté est accrue par l’absence de signes pathognomoniques.
MOTIF DE LA CONSULTATION
Enregistrer les symptômes et problèmes du patient
ANAMNESE MEDICALE ET DENTAIRE
Enregistrer les données utiles passées et présentes
ENTRETIEN AVEC LE PATIENT
Caractériser la douleur
HYPOTHESE DIAGNOSTIQUE
Probabilité d’une maladie pulpoparodontale
OBSERVATION CLINIQUE
Examen extra et intra-oral, tests cliniques, examen radiographique – Rechercher les signes et symptômes correspondant aux critères de diagnostic spécifiques à la maladie
FORMULATION DIAGNOSTIQUE
- Etiologique : Indiquer la cause de l’infection endocanalaire
- Positif : Identifier les trois critères clés caractérisant la PA
- Différentiel : Identifier les signes et symptômes caractérisant la forme clinique de la PA
1) Les moyens du diagnostic : Evaluation de la symptomatologie
| Critères | Questions à poser au patient | Signification probable |
|---|---|---|
| Localisation | Le patient peut-il identifier la dent causale ? | Si oui : atteinte périapicale très probable |
| Intensité | Le patient est-il perturbé dans sa vie quotidienne du fait de la douleur ? | Si oui : Pulpite irréversible, ou Parodontite Apicale Aigue |
| Durée | La douleur se propage-t-elle après le stimulus, et tend-elle à être permanente ? | Si oui, Pulpite irréversible ou Parodontite Apicale Aigue |
| Stimuli | Quels sont les causes et les facteurs de déclenchement ? | Si pression impliquée, Atteinte Périapicale très probable |
| Soulagement | La douleur peut-elle être soulagée ? | Si oui, Atteinte Périapicale peu probable |
| Spontanéité | La douleur intervient-elle sans raison apparente ? | Si oui : Pulpite irréversible, ou Parodontite Apicale Aigue |
| Antécédents | Le patient a-t-il subi des crises douloureuses dans le passé ? | Si antécédents douloureux, Atteinte Périapicale très probable |
| Signes généraux | Existe-t-il des signes associés : fièvre, tuméfaction, adénopathie, fistule cutanée ? | Si oui, Atteinte Périapicale certaine |
2) Les moyens du diagnostic : Evaluation des signes subjectifs
L’examen exobuccal recherchera par visualisation et palpation, les signes d’une infection dentaire :
❖ Une asymétrie faciale,
❖ Une tuméfaction,
❖ Une fistule cutanée,
❖ Des ganglions volumineux et douloureux,
❖ Une limitation d’ouverture buccale,
❖ Une gêne à la déglutition
3) Les moyens du diagnostic : Evaluation des signes objectifs
L’examen endobuccal permettra de reconnaître les signes cliniques objectifs de la pathologie
Les signes dentaires : caries profondes, félures et fractures, abrasions et érosions, restaurations
étendues et défectueuses, dyschronies dentaires et autres anomalies ;
Les signes muqueux : aspect inflammatoire (rougeur, œdème) des tissus mous, ulcérations, ostium
fistulaire
Les signes fonctionnels : interférences occlusales, mobilités anormales
4) Les moyens du diagnostic : Les tests cliniques de diagnostic
➜ Les tests de sensibilité pulpaire : Comprennent les tests thermiques et électriques. Une réponse négative à ces tests indique que la pulpe est nécrosée et constitue un second critère clé indispensable au diagnostic de PA.
➜ Test de percussion : On percute légèrement et axialement la dent avec le manche du miroir ; une réponse douloureuse permet de détecter une inflammation péridentaire. En cas de doute, la réponse est analysée par rapport à une dent controlatérale saine
➜ Tests de palpation intra-orale : Dans le cas des P.A., la palpation permet de diagnostiquer la disparition de la corticale osseuse vestibulaire
5) Les moyens du diagnostic : Les tests complémentaires : Le test du cône de gutta-percha La présence d’un orifice fistuleux signe l’existence d’un foyer infectieux profond dont on ignore la localisation et l’origine. L’introduction d’un cône de gutta-percha (cône accessoire fin) dans l’ostium permet de suivre le trajet fistuleux jusqu’à sa source.
6) Les moyens du diagnostic : Les tests complémentaires : Le sondage parodontal Le sondage sulculaire d’une dent sur les faces proximales, vestibulaire et linguale à l’aide d’une sonde parodontale graduée est utile quand on cherche à différencier une atteinte d’origine parodontale ou endodontique, dans les formes hybrides de lésions endoparodontales. Une sonde qui « plonge » en un point précis le long de la racine indique la présence d’une fistule d’origine apicale émergeant au niveau du sulcus, dans la poche parodontale.
7) Les moyens du diagnostic : Les tests complémentaires : le test de transillumination La recherche d’une fêlure, pouvant expliquer la présence d’une lésion apicale sur une dent apparemment intacte, peut être faite avec le test de transillumination. En cas de fracture verticale, la lumière est arrêtée par un hiatus entre les fragments : une face est éclairée, la face opposée reste sombre.
8) Les moyens du diagnostic : Les tests complémentaires : l’examen radiographique La présence d’une image osseuse radioclaire périapicale détectée au moyen d’un cliché rétroalvéolaire, constitue le troisième critère clé du diagnostic d’une PA. L’analyse des clichés radiologiques rétroalvéolaires est une étape incontournable pour le diagnostic en endodontie. Les limites de ces clichés sont liées à la détection des lésions périapicales débutantes, leur interprétation et la distinction entre les différents stades pathologiques permettant de mettre en évidence les processus de destruction ou de guérison.
III. LES FORMES CLINIQUES DES PARODONTITES APICALES
A. PARODONTITES APICALES SYMPTOMATIQUES L’inflammation apicale démarre par une phase aiguë, ou qu’un accident aigu se superpose sur une lésion chronique préexistante. Les principaux signes des PAA sont :
- [ ] La douleur d’origine périapicale (de l’inconfort à la douleur intolérable),
- [ ] Une réponse négative aux tests de vitalité pulpaire (sauf pour les réactions initiales du périapex),
- [ ] Des modifications radiographiques (de l’élargissement desmodontal à l’image radicolaire étendue),
- [ ] Une percussion franchement douloureuse,
- [ ] Une palpation positive, avec ou non une tuméfaction (inconstante)
- Parodontite apicale aigue liée à un traumatisme occlusal :
C’est une inflammation transitoire et d’origine non bactérienne. Il s’agit d’une dent porteuse d’une restauration récente avec une interférence occlusale. La dent est sensible au contact lors de la mastication, les tests de sensibilité sont normaux - Parodontite apicale aigue primaire
A un stade débutant, elle correspond au passage initial de l’inflammation pulpaire dans le périapex.
La douleur est spontanée, provoquée par le simple contact de la dent, et toujours reconnue à la percussion. La pulpe est vitale, la réponse aux tests de sensibilité est positive,
A un stade avancé, l’inflammation s’installe dans le périapex et correspond à une inflammation exsudative sévère, en rapport avec la pénétration des germes dans la cavité pulpaire. La pulpe est nécrosée, les tests de sensibilité pulpaire sont négatifs. La douleur est spontanée et exacerbée par la percussion ou la pression. La palpation, en regard de l’apex, est positive. - Parodontite apicale aigue primaire abcédée
Ou Abcès Apical Aigu, elle correspond à une suppuration localisée du périapex.
La réponse aux tests de sensibilité pulpaire est négative. La douleur est spontanée et permanente.
C’est le stade le plus douloureux. Le contact de la dent est intolérable et la percussion doit être évitée.
Des signes parodontaux sont généralement présents. La palpation en regard de l’apex est douloureuse, faisant suspecter la présence de pus. Une tuméfaction sous-périostée ou sous muqueuse est possible.
Un abcès périapical aigu primaire n’est pas nécessairement visible radiographiquement - Parodontite apicale aigue secondaire abcédée (Abcès phœnix)
Elle correspond à l’Abcès Périapical récurrent ou Abcès Phœnix. C’est une exacerbation d’une lésion chronique (granulomateuse). Les symptômes sont sensiblement voisins de ceux de l’abcès primaire.
Les critères diagnostiques sont identiques à ceux du stade précédent avec une caractéristique : une image radicolaire est toujours décelable du fait de la destruction osseuse préexistante.
B. PARODONTITES APICALES ASYMPTOMATIQUES
1) Parodontite apicale chronique simple
Cette première réponse chronique est une irritation de faible intensité mais elle augmente suite à un passage des toxines pulpaires dans le périapex ; ici il y’aura des modifications du desmodonte qui se transforme en tissu de granulation ainsi une attraction des polynucléaires qui sont entourées par des lymphocytes au niveau du foramen apical.
2) Ostéite condensante :
L’ostéite condensante est une réaction périapicale d’origine inflammatoire, en réponse à une lésion d’origine endodontique. L’inflammation chronique de la pulpe radiculaire entraîne l’hyperactivité du tissu osseux ; cela se traduit par une augmentation de la densité osseuse trabéculaire.
Diférentes appellations : Ostélie condensante, Ostélie sclérosante focale, Ostéosclérose réactionnelle/post-inflammatoire
On retrouve 85% de ces lésions ostéoscléreuses dans le maxillaire inférieur. La région des premières molaires est impliquée. Les dents concernées peuvent être encore vivantes : soit au stade de pulpite chronique, soit en voie de nécrose. L’ostélie condensante est dans la plupart des cas asymptomatique ; Les douleurs à la percussion et/ou à la palpation sont rares.
Radiographiquement ; On observe une masse radiologique, circonscrite à l’apex d’une dent, et donc en étroite relation avec l’endodonte. Elle est dense, uniforme et bien limitée. On retrouve le plus souvent un élargissement ligamentaire avec perte de la lamina dura.
3) Granulome apical ou parodontite périapicale proliférative
Définition : une pathologie d’origine infectieuse. Une petite tumeur bénigne qui se développe au niveau de la pointe de la racine de la dent., Son origine provient d’une destruction osseuse
La forme la plus avancée de la parodontite apicale chronique. Elle est caractérisée par la formation d’un tissu granulomateux périapical, en réponse à une irritation pulpaire continue et par la présence d’une capsule périphérique de fibres collagènes
Les signes subjectifs : Parfois au niveau de la dent causale il y a des poussées douloureuses d’intensité variable prennent l’allure d’une névralgie, ces poussées inflammatoires rendent les signes subjectifs plus nets comme sensation de pesanteur, douleur à la percussion axiale, apex plus sensible.
Les signes objectifs : Le test de sensibilité pulpaire est négatif ainsi le test de percussion et la palpation sauf si elle perdre le corticale osseux qu’elle devient sensible. La palpation en regard de la région apicale indique en grande partie les stades de l’évolution de la lésion
4) Kyste périapical
C’est une réponse inflammatoire du péripex, qui se développe à partir de lésions chroniques avec préexistence de tissu granulomateux. Il est caractérisé par une cavité pathologique faite aux dépens du tissu osseux, délimitée par un épithélium et remplie de liquide. Il est entouré d’un tissu granulomateux et d’une capsule fibreuse périphérique. Un kyste est une cavité pathologique fermée ne Communiquant pas avec l’extérieur et contenant le plus souvent une substance liquide ou semi liquide. La parodontite apicale chronique kystique (PACK) est une transformation d’un granulome en kyste inflammatoire, Le liquide kystique de la poche contient des cristaux de cholestérine.
Il existe deux types de kystes périapicaux :
5) Parodontite apicale chronique fistulisée :
C’est une réaction inflammatoire, de faible intensité et de longue durée, du tissu conjonctif périapical, en réponse à une irritation pulpaire. Elle est caractérisée par une formation active de pus, drainé à travers une fistule. La parodontite apicale chronique fistulisée peut se développer à partir d’une parodontite apicale chronique ou d’un abcès périapical aigu qui a trouvé sa voie d’évacuation à travers la muqueuse buccale.
Clinique
Elle est asymptomatique, son apparition est souvent ignorée par le patient. L’aspect de l’orifice fistulaire est très varié :
- Au niveau gingival : petite saillie rouge foncé, simple fente, papille ou pédicule allongé, flexible.
- Au niveau cutané : orifice avec un aspect irrégulier, entouré d’une zone œdémateuse et congestionnée.
Radlographie
L’introduction d’un cône de gutta-percha dans l’ostium permet de suivre le trajet fistuleux jusqu’à sa source. Une radiographie prise ainsi permettra de localiser cette source : la dent causale et la racine concernée ou une poche parodontale.
Répartition des principaux signes et symptômes des Parodontites Apicales
| Signes, symptômes | Parodontites apicales aiguës | Parodontites apicales chroniques |
|---|---|---|
| PAA primaire | Abcès péripital | |
| Douleur spontanée | ++ | ++ |
| Vitalité Pulpaire | – | – |
| Douleur à la Percussion | + | ++ |
| Douleur à la Palpation | – | ++ |
| Cédème des tissus mous | – | +/- |
| Ostium fistulaire | – | – |
| Image apicale Rx | +/- | +/- |
LES LESIONS INFLAMMATOIRES PERIAPICALES D’ORIGINE ENDODONTIQUE Dynamique inflammatoire, Diagnostic et Formes Cliniques des LIPOE
Voici une sélection de livres:
- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011
- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996
- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE
- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient
- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé
- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1
- Endodontie, prothese et parodontologie
- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020
- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005


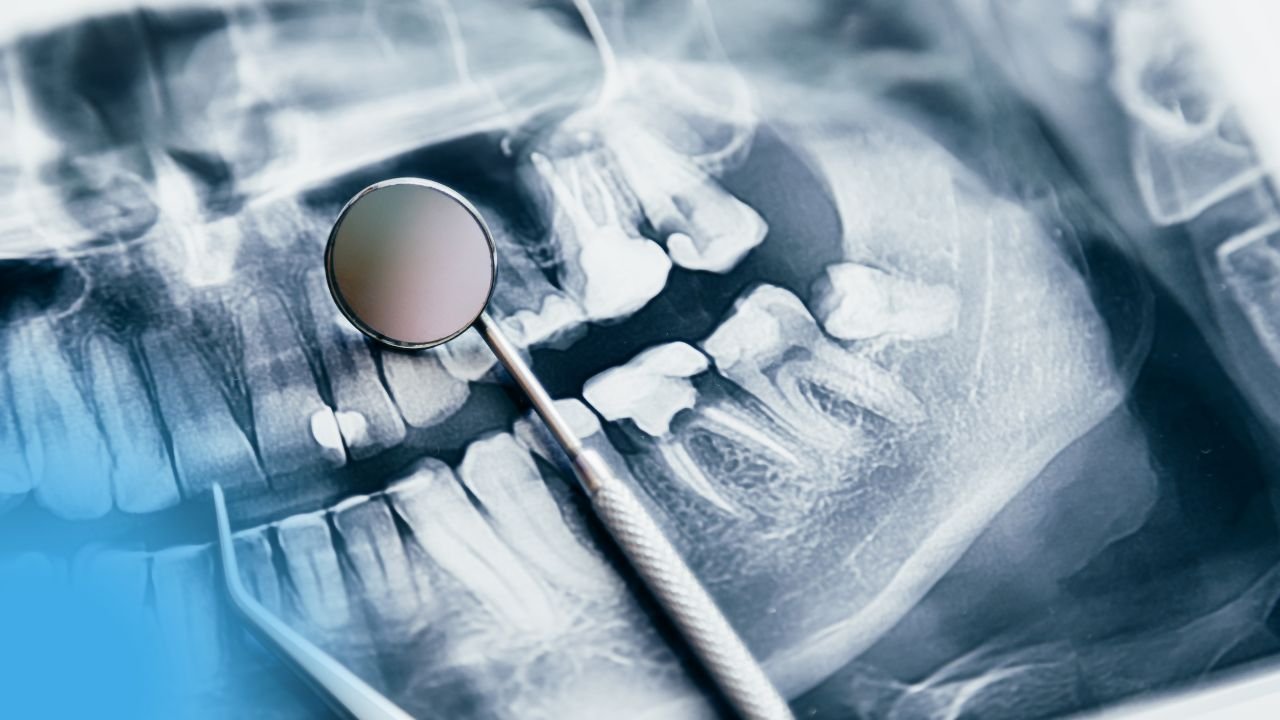

Leave a Reply