La première molaire permanente chez l’enfant
La première molaire permanente chez l’enfant
L’immaturité d’une dent permanente sur l’arcade, est définie comme étant un état dentaire physiologique avant la fin de l’édification radiculaire, la fermeture apicale, c’est-à-dire la mise en place de la jonction cémento-dentinaire, et la mise en occlusion fonctionnelle de la dent.
Les dents permanentes immatures sont présentes à partir de la denture mixte (6 ans) jusqu’au début de la phase de denture adulte jeune (15ans).
Une dent permanente immature présente certaines particularités histologiques, anatomiques et physiologiques.
I/ Morphogénèse des germes dentaires :
L’être humain est caractérisé par une dentition hétérodonte-diphyodonte, Ie développement de la dentition temporaire débute morphologiquement vers la 6 éme ou 7 éme semaine de la gestation puis rapidement, il y a coexistence partielle d’ébauches dentaires déciduales (temporaires et définitives).
Le développement des molaires permanentes diffère de celui des autres dents permanentes par deux spécificités :
- Ces dents n’apparaissent pas au niveau de la lame dentaire, mais de son prolongement distal ou en distal de la deuxième molaire temporaire au 3e-4e mois, et apparaissent au fur et à mesure que la branche montante recule et que la cavité buccale s’agrandit.
- Les bourgeons sont dits monophysaires car elles n’ont pas de dents remplaçantes même si une lame dentaire remplaçante, transitoire, apparaît au-dessus de cette dernière sans donner de bourgeon, et dégénère.
| Première molairemaxillaire | Première molairemandibulaire | |
| Début de calcificationcoronaire | Naissance | Naissance |
| Fin de calcificationcoronaire | 3 à 4 ans | 2,5 à 3 ans |
| Eruption | 6 ans | 6 à 7 ans |
| Fin de la calcificationapicale | 9 à 10 ans | 9 à 10 ans |
Formation des premières molaires permanentes et temps d’éruption
L’odontogenèse est classiquement décrite par la succession de divers stades : lame, bourgeon, capuchon et cloche dentaires, différentiation terminale des odontoblastes et améloblastes, formation des racines (rhizagenèse) et différentiation fonctionnelle des cémentoblastes, éruption dentaire.
La dent permanente se développe sur plusieurs années, depuis sa position intra-osseuse jusqu’à sa position fonctionnelle dans la cavité buccale et ceci en passant par plusieurs situations anatomiques, qui peuvent être schématiquement résumées en quatre stades comme évoqué par Lautrou en 2006.
II/caractéristiques anatomiques
- La première molaire maxillaire : possède :
- 3 racines : une racine palatine, une racine mésio-vestibulaire et une racine disto-vestibulaire. Chacune des racines contient un à plusieurs canaux notamment la racine mésio vestibulaire qui comporte souvent 2 canaux.
- Les racines peuvent parfois être fusionnées.
- Une couronne dont la forme globale est un parallélogramme, elle est la seule dont la face palatine est plus large que la face vestibulaire, Cette face palatine présente une particularité : le tubercule de Carabelli.
La couronne comporte :
- 4 cuspides : 2 cuspides vestibulaires et une cuspide palatine disposées en triangle, et une quatrième cuspide, située en disto-lingual.
- Un pont d’email reliant la cuspide mésio-palatine et la cuspide disto-vistibulaire.
Anatomie occlusale de la première molaire maxillaire
- La première molaire mandibulaire : possède :
- Une racine mésiale, qui comporte 2 canaux.
- Une racine distale la plus forte, pouvant comporter 1 ou 2 canaux.
- La couronne présente une table occlusale beaucoup plus large que la molaire supérieure, elle comporte :
- 5 cuspides : 3 cuspides vestibulaires et 2 linguales et parfois une cuspide mésio linguale supplémentaire.
- Cette surface est constituée de nombreuses dépressions : les sillons, les puits et les fissures.
- La forme globale de la couronne est un pentagone ou un trapèze.
Le diamètre mésio-distal est plus important que le vestibulo-lingual, et ce diamètre est le plus grand parmi toutes les autres dents de l’arcade.
- Caractéristiques anatomiques occlusales de la première molaire permanente immature :
La Première Molaire Permanente immature (PMPI) possède une surface occlusale complexe, non encore usée par la mastication et l’attrition physiologique. Cette surface est constituée de nombreuses dépressions : les sillons, puits et fissures qui sont des zones d’adaptation anatomo-histologique de la surface de l’émail.
Les sillons et puits sont issus, lors de leur minéralisation, d’une zone de jonction et non d’une zone de synthèse. Cette réunion est réalisée par coalescence des prismes d’émail. Ils sont profonds, étroits et anfractueux.
Les sillons anfractueux sont définis par la Haute Autorité de Santé (HAS, 2005) comme des « sillons apparaissant profonds et étroits à l’examen clinique simple ». En cas de sillons anfractueux, les versants cuspidiens possèdent souvent des lobes très marqués par des sillons secondaires. »
Les défauts de coalescence sont fréquents et entraînent l’exposition de la dentine. Cette zone étroite, nommée fissure est plus perméable. Elle favorise l’accumulation de débris alimentaires, de bactéries et n’autorise pas l’accès au brossage, ni à la chasse salivaire.
Fortier et Demars (1987) ont établi une classification en 3 types des puits et fissures. Ces Différents types de sillons existent et cohabitent souvent sur une même face occlusale, leur profondeur et l’angle des parois conditionnent la susceptibilité carieuse.
Selon l’HAS, les principales zones de congruence de la surface de l’émail sont :
- Les sillons principaux ou intercuspidiens: situés à l’intersection des cuspides qu’ils séparent ;
- Les sillons secondaires ou accessoires : sillons descendant les versants cuspidiens qu’ils séparent ;
- Les fossettes marginales : situées aux extrémités des sillons principaux ;
- Les fossettes secondaires : situées sur le trajet des sillons principaux (à leur intersection).
III/ physiologie de la première molaire permanente immature
- Immaturité de l’email
Lorsque la dent fait son éruption dans la cavité buccale, l’émail est immature et poreux, et va bénéficier pendant 2 à 3 ans qui suivent, de sa maturation post-éruptive.
Au cours de cette période suivant l’éruption, de nombreuses protéines amélaires vont disparaître au profit de la charge minérale.
La maturation post-éruptive comprend l’incorporation de calcium, de phosphate et de fluor, via des cycles de déminéralisation-reminéralisation. En permanence se jouent des échanges d’ions phosphates, calcium et fluor à l’interface émail/biofilm. Ceci varie en fonction des concentrations locales de ces différents ions et du pH environnant.
L’email immature est constitué de 37% de phase minérale, 44% de phase aqueuse et de 19% de matrice organique.
La porosité de l’émail s’explique par la structure microscopique et les mécanismes de formation de l’émail lors de l’amélogénèse :
- Au niveau de sa structure microscopique, la phase minérale de l’émail se compose d’hydroxyapatites empilées et regroupées, formant les prismes de l’email.
Ces cristallites sont imbriquées les unes sur les autres, laissant un espace très infime à la matrice organique à l’interface entre prismes et substance interprismatique. Cette disposition induit des espaces inter-cristallins, autorisant la diffusion et les échanges aqueux et d’ions.
- De par son mode de construction, l’émail présente une surface primaire rugueuse. En effet, lors de son édification, les améloblastes forment des lignes de croissance appelées « les stries de Retzius », conférant à l’émail une structure en « pelure d’oignon ». A la surface amélaire, les extrémités de ces stries dépriment la surface et forment de fins sillons ou périkymaties, un important réseau poreux qui disparaît au fil du temps par érosion ou abrasion.
- Immaturité de la dentine
Lors de la dentinogénèse, les odontoblastes secrètent en premier lieu la dentine primaire, du développement dentaire jusqu’à la rhizagénèse. A la fin de l’édification radiculaire, de la dentine sera sécrétée tout au long de la vie de la dent sur l’arcade, on parle alors de dentine secondaire. Enfin, en cas d’agression physique, chimique ou bactérienne, de la dentine tertiaire sera produite (dentine réactionnelle ou de réparation).
Lors de son éruption, la PMPI ne bénéficie pas de la présence de dentine secondaire pendant une période d’environ 3 ans. Cela a pour conséquence une chambre et un volume pulpaire importants, et des cornes pulpaires non rétractées, proche de la surface amélaire.
De plus, cette dentine est également dite immature car la sécrétion de dentine péricanaliculaire n’a pas encore eu lieu. L’oblitération progressive des tubuli par cette dentine péricanaliculaire et sa bordure hyperminéralisée n’est alors pas encore réalisée et les canalicules sont en grande majorité ouverts (environ 80% au niveau du plafond pulpaire). La dentine de la DPI est donc elle aussi poreuse et perméable.
- Immaturité pulpo-radiculaire :
Les racines de la PMPI apparaissent mince et plus ou moins courte selon leurs stades d’évolution. Les parois dentinaires sont fines et fragiles.
La cavité pulpaire (chambre pulpaire et canaux radiculaires) est importante dans son ensemble et abrite une masse pulpaire volumineuse (difficile à extirper).
Le canal très large évasé dans le sens où l’extrémité apicale et plus large que l’extrémité cervicale (à l’inverse d’une dent mature), on dit que le canal est en tromblon.
Enfin, elle présente un apex largement ouvert béant qu’on appelle “entonnoir apical”.
- Les cellules et les fibres :
La pulpe immature est un tissu conjonctif lâche riche en cellules et pauvre en fibres :
- Odontoblastes : alignées sur la prédentine constituent le lien entre pulpe et dentine. Dans la dent juste éruptive le cytoplasme de l’odontoblaste occupe la totalité de la longueur du tubule.
- Cellules mésenchymateuses indifférentier, capables de se différentier en néodontoblastes responsables de l’apposition de Dentine Réparatrice, lors d’une agression.
- Pauvre en fibres (collagène).
- Cellules de défense (lymphocytes, macrophages…), assurant un potentiel de défense pulpaire très important.
- les nerfs et les vaisseaux : l’association des fibres nerveuses et des vaisseaux est étroite, mais des exceptions existent en particulier dans la dent immature. En effet la majorité du volume pulpaire est occupée par du tissu conjonctifs et les vaisseaux et nerfs sont essentiellement séparés.
- Les premières fibres nerveuses qui proviennent principalement du nerf trijumeau, pénètrent dans la pulpe au début de la formation de la dentine et de I ‘email. Le réseau nerveux pulpaire reste immature durant toute la formation de la dent et se stabilise au moment où s’établissent les contacts dentaires inter-arcades. Ce réseau est constitué essentiellement de fibres sensitives.
Les fibres nerveuses sensitives (les fibres C), qui représentent environ la moitié des fibres nerveuses a l’apex, perdent peu à peu leur gaine de myéline, se regroupent au centre de Ia pulpe radiculaire pour former de volumineux faisceaux qui cheminent au voisinage des vaisseaux sanguins. Ces faisceaux se divisent dans la chambre pulpaire en nerfs cuspidiens, qui se ramifient progressivement à l’approche de la périphérie pulpaire, pour se terminer dans la couche acellulaire de Weil, sous la forme d’un réseau dense appelé plexus nerveux sous-odontoblastique ou plexus de Raschkow, qui est constitué uniquement de terminaisons nerveuses amyéliniques, sa maturité est établie peu après l’achèvement de l’éruption dentaire. Par conséquent, les réponses aux tests de sensibilité pulpaire sont inconstantes quand ceux-ci sont appliqués sur des dents partiellement développées.
- La pulpe dentaire jeune est très richement vascularisée avec un paquet vasculo-nerveux encore immature est volumineux. Le flux sanguin capillaire dans la région coronaire est environ deux fois plus important que dans la racine. L’irrigation sanguine est principalement régulée par les sphincters pré-capillaires et l’innervation sympathique. Comme dans d’autres tissus, le volume de la micro-vascularisation est beaucoup plus important que celui du sang qui y circule.
- Physiologie de la région apicale
La dent immature se caractérise essentiellement par une région apicale non encore formée, cette zone très vascularisée à intense activité cellulaire participe directement à l’éruption du tiers apical.
Dès que la couronne est complètement formée, débute la formation de la racine par prolifération épithéliale dans les tissus conjonctifs sous-jacents, prolifération qui constitue la gaine de Hertwig, les cellules de l’épithélium adamantin interne gardent un pouvoir inducteur envers le tissu conjonctif de voisinage qui continue à se différencier en odontoblastes pour élaborer la dentine radiculaire.
Les odontoblastes vont ainsi former de la dentine primaire jusqu’à l’obtention de la longueur radiculaire normale.
La gaine de Hertwig participe ainsi à la formation de l’artifice apicale par accroissement horizontal centripète et à l’élongation de la racine, pour évoluer en direction verticale.
Dès que la racine a atteint sa longueur normale définitive, la gaine de Hertwig se désintègre, mettant ainsi la dentine a nue en contact direct avec le tissu conjonctif environnant, par induction sur celui-ci va entraîner la formation de cémentoblastes, ceux-ci élaborent le cément primaire puis le cément secondaire ou ostéocément qui recouvre l’ensemble de la racine et contribue ainsi à la formation de l’apex.
Même lorsque la racine a atteint sa longueur définitive, cet apex reste béant pour une période de 3 à 4 ans durant laquelle l’entonnoir apical sera comblé par du tissu conjonctif qu’il sera primordial de respecter.
Ce n’est qu’en terme de cette période que la maturation apicale sera atteinte avec la mise en place de la jonction cémento-dentinaire.
Conjointement à la maturation dentaire bien sûr, les structures entourant l’apex vont s’organiser:
Mise en place de la lamina-dura et de l’alvéole dentaire, formation des fibres ligamentaires, à partir du sac dentaire.
- la maturation du parodonte :
- Au moment de l’éruption il y a fusion de l’épithélium adamantin et celui de la gencive kératinisée.
L’épithélium adamantin se transforme progressivement en épithélium de jonction, qui permet le maintien du tissu kératinisé sur l’email.
Au cours de la migration occlusale de la dent, progressivement, au bout d’une dizaine d’année la sertissure marginale de la gencive atteint la jonction amélo-dentinaire.
- Après l’éruption les fibres cémento-gingivales changent d’orientation se répondant dans le chorion gingival et le rebord osseux. La maturation n’est effective que lors de la mise en fonction de la dent.
- Le cément : se forme à partir d’interaction entre l’épithélium de la gaine de Hertwig et la couche odontoblastique via la membrane basale. La formation et la maturation du cément suit deux étapes de développement :
- L’étape pré-fonctionnelle pendant laquelle se produit pour chaque racine une distribution primaire pour chaque type de cément. Cette phase peut durer jusqu’à 5ans après le développement radiculaire.
- La phase fonctionnelle de formation de cément ne se produit qu’à la fin de l’élongation radiculaire et alors que l’orientation fonctionnelle des fibres ligamentaires s’est déjà organisée.
- Os alvéolaire : L’os alvéolaire naît, vit et disparait avec la dent. Il est constamment renouvelé en raison de la migration physiologique (ou déplacement spontané). Ce déplacement dentaire spontané se produit dans une direction mésial et vertical par des phénomènes d’apposition et de destruction, grâce aux cellules osseuses (ostéoblaste/ostéoclastes).
IV/ Les différents stades de développement des PMP
Les stades du développement des dents permanentes ont été établis par Nolla en 1960 en fonction des aspects radiologiques de minéralisation, s’étendant de la formation de la crypte dentaire à la fin de l’édification radiculaire.
La dent fait son éruption au stade 8 de Nolla. L’édification radiculaire sera complète environ 3-4 ans après l’éruption de la dent au stade 9 de Nolla. S’ensuit la fermeture des orifices apicaux et la formation du cément secondaire qui couvre la partie apicale de la racine au stade 10 de Nolla.
V/Rôles de la première molaire permanente
- Mastication : dilacération- trituration
- Clé de voûte de l’occlusion
- La détermination de la dimension verticale
- Elle assure l’organisation de la denture permanente et la croissance du jeune enfant.
Conclusion :
La première molaire permanente immature constitue la pierre angulaire de l’appareil manducateur, elle est une véritable clé de voûte de l’arcade dentaire, tant au niveau maxillaire que mandibulaire. Cependant, à cause de sa précocité d’émergence, sa situation postérieure sur l’arcade, l’immaturité de l’émail et de la dentine, sa morphologie occlusale complexe, des habitudes alimentaires néfastes et une hygiène bucco-dentaire encore en apprentissage à cet âge, en font d’elle « un carrefour de tous les dangers » d’où son atteinte très précoce par la maladie carieuse.
La première molaire permanente chez l’enfant
Voici une sélection de livres:
- Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché
- Concepts cliniques en odontologie conservatrice
- L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement
- Guide clinique d’odontologie
- Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve
- La photographie en odontologie: Des bases fondamentales à la clinique : objectifs, matériel et conseils pratique
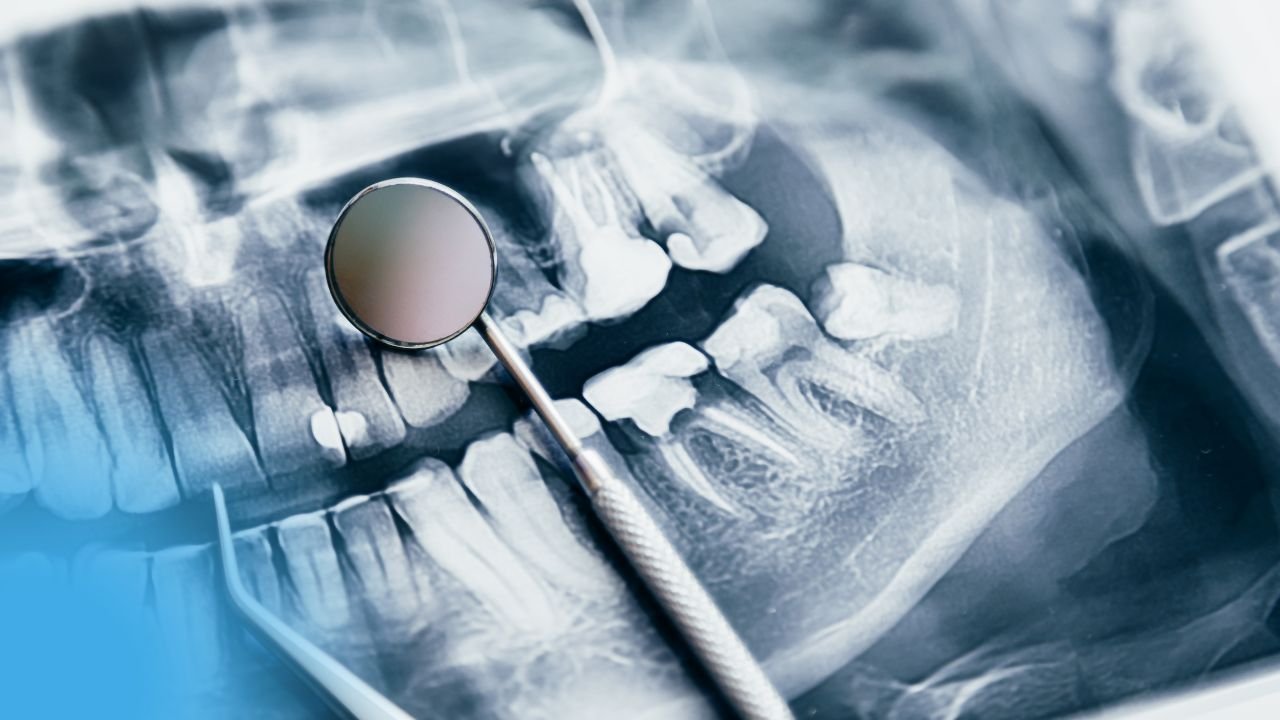



Leave a Reply