Insuffisance rénale chronique et sa prise en charge en odontostomatologie
Insuffisance rénale chronique et sa prise en charge en odontostomatologie
Insuffisance rénale chronique et sa prise en charge en odontostomatologie
Introduction
L’insuffisance rénale chronique (IRC) représente un défi médical majeur, touchant des millions de personnes à travers le monde. En Algérie, environ 4 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, avec près de 6 millions d’individus présentant un risque d’atteinte rénale et 1,5 million souffrant d’une maladie rénale chronique. Cette pathologie affecte particulièrement les patients hypertendus (20 %), dyslipidémiques (30 %), diabétiques (40 %), les personnes âgées de plus de 60 ans (25 %) et ceux traités pour un cancer (60 %). Ces chiffres soulignent l’ampleur du problème et la nécessité d’une prise en charge adaptée, notamment en odontostomatologie.
Les patients atteints d’IRC présentent des particularités physiologiques et thérapeutiques qui exigent une approche spécifique lors des soins dentaires. Une collaboration étroite entre l’odontologiste et le néphrologue est essentielle pour garantir une prise en charge optimale, minimiser les risques de complications et assurer des soins bucco-dentaires sécurisés. Ce document explore les aspects anatomo-physiologiques du rein, les caractéristiques de l’IRC, ses manifestations buccales et les protocoles de prise en charge odontologique adaptés.
Généralités sur le rein et l’insuffisance rénale chronique
Rappels anatomo-physiologiques du rein
Anatomie du rein
Les reins sont des organes vitaux en forme de haricot, situés de part et d’autre de la colonne vertébrale, au niveau des lombaires. Chaque rein mesure environ 12 cm de long, 6 cm de large et 3 cm d’épaisseur, avec un poids moyen de 150 g. Leur rôle principal est de filtrer le sang pour éliminer les déchets métaboliques (urée, acide urique, créatinine), les toxines et l’excès d’eau et de sels minéraux, produisant ainsi l’urine.
L’unité fonctionnelle du rein est le néphron, dont chaque rein contient environ un million. Le néphron est composé de deux parties principales :
- Le glomérule : une structure capillaire où le plasma sanguin est filtré pour former le filtrat glomérulaire.
- Le tubule rénal : responsable de la réabsorption sélective et de la sécrétion, transformant le filtrat en urine définitive.
Physiologie rénale
Les reins remplissent plusieurs fonctions essentielles :
- Élimination des déchets et régulation hydrique : Les glomérules filtrent environ 180 litres de plasma par jour, dont la majorité est réabsorbée, produisant 1,5 à 2 litres d’urine quotidienne. Ce processus régule l’équilibre hydrique et électrolytique de l’organisme.
- Régulation de la pression artérielle : Les reins produisent la rénine, une enzyme qui active le système rénine-angiotensine-aldostérone, régulant la vasoconstriction, la vasodilatation et la rétention de sodium et d’eau.
- Production de globules rouges : L’érythropoïétine, synthétisée par les cellules rénales, stimule la production de globules rouges dans la moelle osseuse.
- Maintien de la santé osseuse : Le rein active la vitamine D en calcitriol, une hormone qui régule les niveaux de calcium et de phosphate, essentiels à la solidité des os.
Explorations biologiques et fonctionnelles du rein
Pour évaluer la fonction rénale, plusieurs examens biologiques sont utilisés :
- Urée : Produite par le foie à partir des protéines alimentaires, son taux sanguin (urémie) augmente en cas d’insuffisance rénale. Sa mesure est souvent associée à celle de la créatinine.
- Créatinine : Un déchet musculaire dont l’élévation dans le sang indique une altération de la filtration glomérulaire.
- Clairance de la créatinine (ou débit de filtration glomérulaire, DFG) : Cet indicateur évalue la capacité des reins à filtrer le sang. Une valeur supérieure à 60 ml/min est considérée comme normale, tandis qu’une diminution reflète une insuffisance rénale.
- Ionogramme sanguin : Analyse les taux de sodium, potassium, chlore et bicarbonate pour détecter des déséquilibres électrolytiques.
- Protéinurie : La présence de protéines dans les urines (albuminurie, hématurie, leucocyturie) indique une atteinte glomérulaire.
Insuffisance rénale chronique : Définition et classification
Définition de l’IRC
L’insuffisance rénale chronique est une altération progressive et irréversible de la fonction rénale, caractérisée par une diminution du débit de filtration glomérulaire (DFG) et une incapacité des reins à assurer leurs fonctions d’excrétion et endocrines. Les principales causes incluent :
- Hypertension artérielle : Endommage les vaisseaux rénaux, réduisant la filtration.
- Diabète : Provoque une néphropathie diabétique par lésions glomérulaires.
- Autres causes : Glomérulonéphrites, maladies polykystiques, infections urinaires chroniques et néphropathies obstructives.
Classification de l’IRC
L’IRC est classée en cinq stades selon le DFG, mesuré par la clairance de la créatinine :
- Stade 1 : DFG ≥ 90 ml/min, fonction rénale normale mais présence de marqueurs d’atteinte rénale (protéinurie, anomalies morphologiques).
- Stade 2 : DFG 60–89 ml/min, légère diminution de la fonction rénale.
- Stade 3 : DFG 30–59 ml/min, insuffisance rénale modérée.
- Stade 4 : DFG 15–29 ml/min, insuffisance rénale sévère.
- Stade 5 : DFG < 15 ml/min, insuffisance rénale terminale nécessitant une dialyse ou une transplantation.
Les marqueurs d’atteinte rénale incluent :
- Anomalies morphologiques détectées par échographie ou tomodensitométrie.
- Anomalies histologiques confirmées par biopsie rénale.
- Anomalies biologiques comme la protéinurie, l’albuminurie, l’hématurie ou la leucocyturie.
Population à risque
Les groupes à risque incluent :
- Les patients hypertendus ou diabétiques.
- Les personnes âgées de plus de 60 ans.
- Les patients atteints de maladies cardiovasculaires, dyslipidémies ou cancers.
- Les individus ayant des antécédents familiaux de maladies rénales.
Complications de l’IRC
L’IRC reste asymptomatique jusqu’aux stades avancés, mais ses complications affectent de multiples systèmes :
- Cardiovasculaires : Hypertension artérielle, cardiopathie urémique, péricardite urémique.
- Hématologiques : Anémie (due à une diminution de l’érythropoïétine), anomalies leucocytaires, troubles de l’hémostase (atteinte plaquettaire, fragilité capillaire).
- Neurologiques : Polynévrites urémiques, troubles cognitifs.
- Digestives et nutritionnelles : Anorexie, nausées, vomissements matinaux, parotidite urémique.
- Osseuses : Décalcification diffuse, rachitisme rénal ou nanisme chez l’enfant.
- Cutanées : Prurit, sécheresse cutanée, pigmentation.
Traitement de l’IRC
Traitement conservateur
Le traitement conservateur vise à ralentir la progression de l’IRC par :
- Mesures diététiques : Régime pauvre en sel, protéines et potassium pour réduire la charge rénale.
- Médicaments : Anti-hypertenseurs (inhibiteurs de l’enzyme de conversion, antagonistes des récepteurs de l’angiotensine), correcteurs de l’anémie (érythropoïétine), suppléments de vitamine D.
Traitement de suppléance
Lorsque l’IRC atteint un stade terminal, deux options principales sont envisagées :
- Hémodialyse : Méthode d’épuration extracorporelle du sang via un dialyseur. Une séance dure 3 à 5 heures, réalisée 3 fois par semaine. Les patients sont sous anticoagulants (héparine) pendant la dialyse, augmentant le risque hémorragique.
- Dialyse péritonéale : Utilise la membrane péritonéale comme filtre naturel. Le dialysat est introduit dans la cavité abdominale via un cathéter. Cette méthode est réalisable à domicile et ne nécessite pas d’anticoagulants, mais elle expose à des risques d’infections péritonéales ou du site du cathéter.
Transplantation rénale
La transplantation rénale est le traitement de choix pour les patients en stade terminal. Elle implique la greffe d’un rein provenant d’un donneur en mort cérébrale ou d’un donneur vivant. Les patients greffés nécessitent une immunosuppression à vie (cyclosporine, tacrolimus, corticostéroïdes), augmentant les risques infectieux et oncologiques (cancers cutanés, lymphomes).
Manifestations buccales associées à l’IRC
L’IRC entraîne des manifestations buccales spécifiques, particulièrement chez les patients dialysés ou greffés, dues à la maladie elle-même ou aux traitements.
Chez l’enfant
- Hypoplasie de l’émail : Altération de la formation de l’émail dentaire, entraînant des dents fragiles ou décolorées.
- Retard d’éruption dentaire : Conséquence des perturbations métaboliques affectant la croissance.
Chez l’adulte
- Pâleur des muqueuses : Résultat de l’anémie associée à l’IRC.
- Xérostomie : Diminution de la sécrétion salivaire, favorisant les infections (candidose, parotidite).
- Dysgueusie : Altération du goût due à l’accumulation de toxines urémiques.
- Halitose : Haleine ammoniaquée liée à l’urémie.
- Stomatite urémique : Ulcérations buccales, principalement sur la langue et le plancher buccal.
- Hémorragies : Pétéchies, ecchymoses, hémorragies gingivales dues à des troubles de l’hémostase.
- Parodontopathies : Gingivite ulcéro-nécrotique, parodontite aggravée par l’immunosuppression.
- Lésions osseuses : Perte de la lamina dura, déminéralisation, élargissement des espaces trabéculaires, calcifications métastatiques visibles à la radiographie.
- Effets des traitements : Les immunosuppresseurs (cyclosporine, tacrolimus) provoquent une hyperplasie gingivale, des candidoses, des infections herpétiques, des leucoplasies chevelues ou des sarcomes de Kaposi.
Prise en charge odontostomatologique des patients atteints d’IRC
La prise en charge odontologique des patients atteints d’IRC nécessite une approche rigoureuse pour gérer les risques associés à leur condition.
Problèmes potentiels en odontostomatologie
- Anémie : Réduit la capacité de transport d’oxygène, augmentant la fatigue et les risques lors des interventions.
- Hypertension et comorbidités : Les troubles cardiovasculaires et le diabète compliquent les soins.
- Risque infectieux :
- Les foyers infectieux bucco-dentaires (caries, abcès) peuvent provoquer des infections systémiques, notamment chez les greffés.
- Les troubles leucocytaires et l’immunosuppression augmentent la susceptibilité aux infections.
- Les patients hémodialysés présentent un risque de transmission virale (hépatite B, C, VIH).
- Risque hémorragique :
- Troubles de l’adhésion plaquettaire.
- Héparinothérapie en hémodialyse.
- Thrombocytopénie liée à une diminution de la production de plaquettes.
- Intolérance aux médicaments néphrotoxiques : Les reins altérés ne métabolisent pas correctement certains médicaments, nécessitant des ajustements posologiques.
Médicaments en odontostomatologie
Le tableau suivant résume les ajustements posologiques pour les médicaments couramment utilisés en soins dentaires, selon la clairance de la créatinine (CC) :
| Médicament | Posologie normale (CC 10–80 ml/min) | CC < 10 ml/min | Remarques |
|---|---|---|---|
| Antibiotiques | |||
| Amoxicilline | 500–1000 mg/8h | 500–1000 mg/24h | Ajuster l’intervalle selon la fonction rénale. |
| Amoxicilline/Clavulanique | 500–875 mg/8h | 500–875 mg/12–24h | Pas d’ajustement si cure courte. |
| Clindamycine | 300 mg/8h | Pas d’ajustement | Élimination non rénale. |
| Doxycycline | 100 mg/24h | Pas d’ajustement | Élimination non rénale. |
| Érythromycine | 200–500 mg/6h | Pas d’ajustement | Élimination non rénale. |
| Métronidazole | 250–500 mg/8h | 250–500 mg/8–12h | Ajustement léger si nécessaire. |
| Azithromycine | 500 mg/24h (3 jours) | Pas d’ajustement | Élimination non rénale. |
| Antifongiques | |||
| Amphothéricine B | 0,3–1 mg/24h | Pas d’ajustement | Surveillance des effets secondaires. |
| Fluconazole | 200 mg/24h | 100–200 mg/24h | Réduire la dose selon la fonction rénale. |
| Antalgiques | |||
| Paracétamol | 500–1000 mg/4–6h | Pas d’ajustement (cure courte) | Éviter les cures prolongées. |
| Aspirine | Contre-indiquée | Contre-indiquée | Risque de saignement et toxicité rénale. |
Conduite à tenir
Patients sous traitement conservateur
- Collaboration médicale : Contacter le néphrologue pour évaluer le stade de l’IRC et les complications associées.
- Bilan d’hémostase : Réaliser une numération formule sanguine (NFS) pour évaluer les risques hémorragiques.
- Anesthésie locale : Éviter le surdosage des anesthésiques à élimination rénale. L’adrénaline est autorisée sauf en cas d’hypertension non contrôlée.
- Hémostase post-extraction : Utiliser des techniques locales (compression, agents hémostatiques, sutures).
- Antibiothérapie : Non systématique, mais si nécessaire, prescrire des antibiotiques non néphrotoxiques (spiramycine, érythromycine).
Patients sous hémodialyse
- Consultation préalable : Contacter le néphrologue et vérifier le bilan sérologique (VIH, hépatite B, C).
- Gestion de l’hémostase : Réaliser une NFS et programmer les extractions le lendemain d’une séance d’hémodialyse pour minimiser l’effet de l’héparine (éliminée en 8 heures).
- Prévention infectieuse : Prescrire une antibioprophylaxie non néphrotoxique avant les interventions.
- Précautions : Éviter d’utiliser le bras porteur de la fistule artério-veineuse (FAV) pour mesurer la tension artérielle ou poser des garrots.
- Médicaments : Proscrire les AINS et l’aspirine, privilégier le paracétamol.
Patients candidats à une transplantation rénale
- Examen bucco-dentaire : Réaliser un bilan clinique et radiologique complet pour identifier et éliminer tout foyer infectieux (caries, abcès, parodontopathies), car ces infections peuvent provoquer un rejet de greffe.
- Protocole d’avulsion : Suivre les mêmes précautions que pour les patients dialysés, avec une attention particulière à l’hémostase et à la prophylaxie infectieuse.
- Suivi post-greffe : Surveiller les effets des immunosuppresseurs (hyperplasie gingivale, candidoses, infections virales).
Conclusion
La prise en charge odontostomatologique des patients atteints d’insuffisance rénale chronique nécessite une compréhension approfondie de la pathologie et de ses implications systémiques. Les manifestations buccales, les risques hémorragiques et infectieux, ainsi que les contraintes médicamenteuses imposent une approche multidisciplinaire. En collaborant étroitement avec le néphrologue, l’odontologiste peut proposer des soins adaptés, minimisant les complications et améliorant la qualité de vie des patients. Une vigilance accrue et des protocoles rigoureux sont indispensables pour garantir des interventions sécurisées et efficaces.
Insuffisance rénale chronique et sa prise en charge en odontostomatologie
Voici une sélection de livres:
- Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché
- Concepts cliniques en odontologie conservatrice
- L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement
- Guide clinique d’odontologie
- Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve
- La photographie en odontologie: Des bases fondamentales à la clinique : objectifs, matériel et conseils pratique

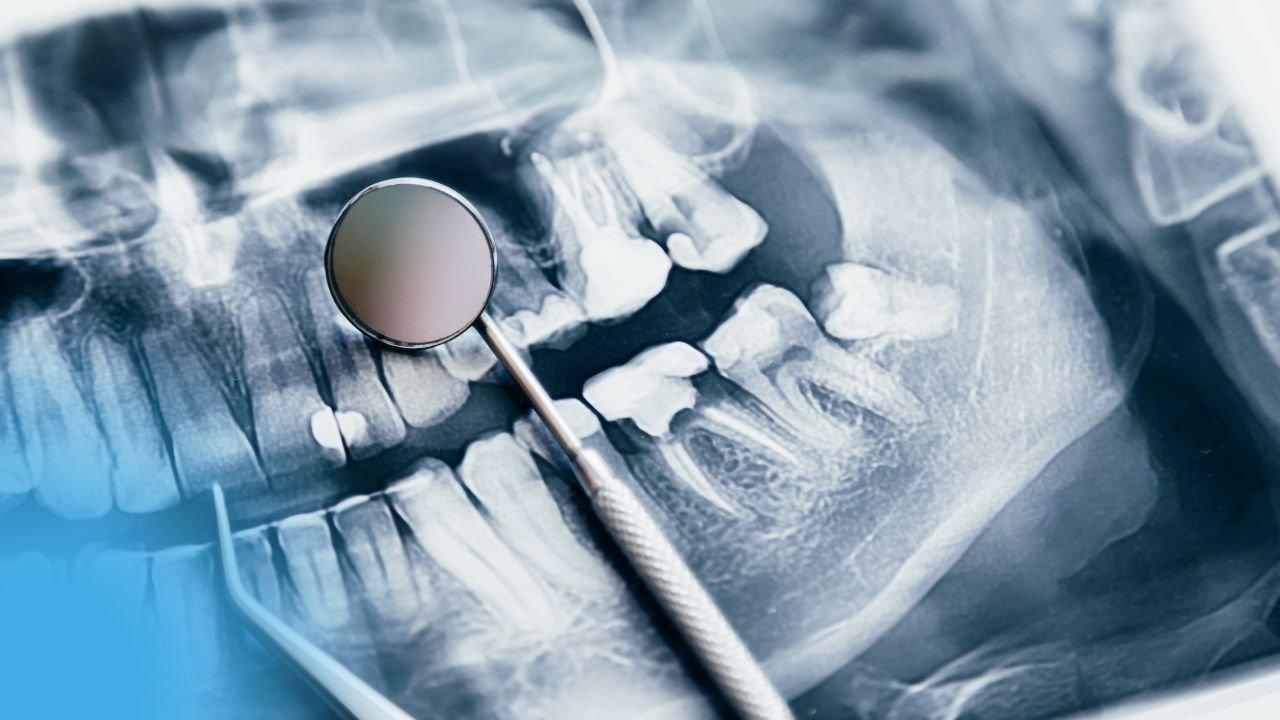


Leave a Reply