Thérapeutiques des défauts du complexe mucogingival
Thérapeutiques des défauts du complexe mucogingival
La thérapeutique des défauts mucogingivaux repose sur les techniques de chirurgie muco gingivale.
- Examen du complexe muco-gingival :
 Dimension de la gencive :
Dimension de la gencive :
 Hauteur de la gencive libre, genvice attachée et de tissu kératinisé :
Hauteur de la gencive libre, genvice attachée et de tissu kératinisé :
A l’aide d’une sonde parodontale graduée, les distances suivantes sont mesurées :
- Sommet du rebord gingival-fond du sulcus (ou poche) = hauteur de gencive libre = profondeur de sulcus ou de poche
- Sommet du rebord gingival-ligne mucogingivale = hauteur de gencive kératinisée
- Sommet rebord gingival-jonction émail-cément = hauteur de récession tissulaire marginale.
La hauteur de gencive attachée est égale à la soustraction de la valeur de la profondeur de sulcus (ou de poche) à la hauteur de tissu kératinisé.
 Epaisseur de la gencive :
Epaisseur de la gencive :
Pour Wilson et Maynard, un test de l’évaluation de l’épaisseur peut consister à placer une sonde parodontale colorée dans le sulcus ; sa visibilité à travers les tissus fait considérer la gencive comme fine. C’est la technique la plus simple et la plus aisément mise en œuvre en pratique clinique courante.
 Evaluation de l’espace biologique :
Evaluation de l’espace biologique :
A la périphérie des préparations des coiffes, le sondage sous anésthésie locale doit révéler une distance égale ou supérieure à 2 mm entre la limite cervicale et le sommet de la crete osseuse. Un espace de 2 mm signifie que l’espace biologique a été respecté mais que la limite cervicale est située au fond du sulcus. Pour s’assurer que la limite cervicale intrasulculaire reste à la portée des moyens de contrôle de la plaque bactérienne, il est préférable de ménager une plus grande distance.
 Freins vestibulaires :
Freins vestibulaires :
Cet examen est réalisé par une traction vigoureuse de la lèvre. Les signes majeurs sont la mobilité et l’ouverture du sillon gingivo-dentaire au cours de la traction de la lèvre.
La localisation du frein labial supérieur correspond aux quatre situations anatomiques de la classification de Placek et al.
- Attache muqueuse : l’insertion du frein labial supérieur appartient à la muqueuse alvéolaire et se situe à la limite de la ligne muco-gingivale.
- Attache gingivale : les insertions basses du frein labial sont noyées dans la gencive attachée.
- Attache papillaire : le frein supérieur est inséré dans la gencive papillaire. La mobilisation de la lèvre (test de traction) entraine, dans ce cas, un déplacement de la gencive marginale des incisives centrales.
- Attache inter dentaire : le frein labial supérieur rejoint le sommet du septum gingival et se confond avec la papille bunoïde. Cette situation anatomique est généralement en relation avec la persistance du diastème inter incisif.
 Le frein lingual :
Le frein lingual :
Il faut demander au patient de :
- Propulser la langue en la dirigeant vers le menton ;
- Placer la pointe de la langue au sommet du palais.
Si ces deux mouvement sont impossibles à réaliser ou d’amplitude très réduite, il est probable que le frein lingual est trop court et trop tendu.
Il faudra ensuite évaluer sa zone d’insertion au niveau de la gencive linguale rétro-incisive mandibulaire. L’insertion peut être muqueuse, au niveau de la ligne muco gingivale, au niveau de la gencive attachée ou de la gencive libre réalisant une traction du sulcus.
- La chirurgie muco-gingivale :
La chirurgie muco-gingivale est une chirurgie plastique qui a pour objectif de corriger la morphologie, la position et/ou la qualité du tissu gingival qui borde la dent, l’une de ses indications est la récession gingivale.
- Différentes techniques de chirurgie muco-gingivale :
- la frénectomie/ frenotomie :
La frénectomie correspond à l’élimination complète d’un frein et se différencie de l’élimination partielle appelé frénotomie.
 Objectif :
Objectif :
- Eliminer les tractions musculaires transmises par l’intermédiaire des fibres du frein sur la gencive marginale.
 Indications :
Indications :
- Frein hypertrophique associé à un diastème.
- Frein vestibulaire limitant les manœuvres d’hygiène, tractant la gencive marginale ou favorisant l’apparition de récessions. Dans ce cas-là, on observe souvent une très faible hauteur de gencive attachée.
- Chirurgie mucogingivale dans une région présentant un frein.
- Frein lingual court limitant l’amplitude des mouvements de la langue, gênant la phonation, la déglutition ou le développement maxillaire ou mandibulaire.
Techniques :
Pour les freins secondaires vestibulaires, une simple frénotomie est souvent suffisante. Le frein est incisé à sa pointe, disséqué en épaisseur partielle puis re-suturé apicalement. Si cela ne suffit pas, la technique décrite pour les freins médians peut être appliquée. Dans le cas de frein lingual court, limitant la mobilité de la langue, la frénotomie est l’intervention de choix.
 Frenectomie vestibulaire :
Frenectomie vestibulaire :
- Anesthésie par infiltrations para-apicales vestibulaires puis faire des rappels papillaires et palatin.
- Tracter la lèvre de façon à bien visualiser l’ensemble du frein.
- Inciser à 1mm de part et d’autre du frein, parallèlement à celui-ci dans toute la hauteur de gencive attachée. La lame doit être au contact de l’os.
- Dans le cas de diastème interincisif, prolonger les incisions en palatin de façon à englober la papille rétro-incisive de la même manière que pour le lambeau esthétique d’accès.
- Réséquer le frein ainsi délimité à l’aide d’une pince gouge. Puis éliminer l’intégralité des fibres sous-jacentes insérées dans l’os et la suture intermaxillaire.
- En orientant la lame en direction apicale, inciser le frein horizontalement au niveau de la ligne de jonction mucogingivale. Disséquer celui-ci en épaisseur partielle en direction apicale.
- Suturer la plaie de la muqueuse libre par une série de points en O. laisser la plaie de la gencive attachée cruentée ou réaliser un point en X de protection.
 Frénotomie linguale :
Frénotomie linguale :
- La principale difficulté de cette technique est le respect des structures nobles telles que les artères, les nerfs et les canaux des glandes salivaires présentes au niveau du plancher lingual.
- Anesthésie par des infiltrations de part et d’autre du frein et à la base de la langue.
- Maintenir fermement la langue en traction en la réclinant et visualiser les ostiums des canaux de wharton afin de ne pas les léser.
- Insérer le bistouri en très faible profondeur et inciser par des mouvements horizontaux à partir de la pointe de la langue en direction de la base de celle-ci jusqu’à ce qu’elle retrouve une mobilité physiologique. Une plaie en forme de losange apparait.
- Rapprocher les berges de la plaie en losange et les suturer par des points en O.
- Faire tirer la langue au patient pour vérifier la bonne libération du frein.
- Vestibuloplastie :
Définition :
Procédé chirurgical d’extension vestibulaire.
 Indication :
Indication :
Vestibule court
 Buts :
Buts :
- Augmenter la profondeur vestibulaire afin de procurer un espace adéquat pour augmenter la zone de la gencive attachée.
- Transformer une muqueuse alvéolaire mobile en une muqueuse fermement attachée au périoste sous-jacent.
 Techniques :
Techniques :
Le protocole chirurgical se déroule en quatre étapes :
- Asepsie : Désinfection du champ opératoire
- Anesthésie locale avec vaso-constricteur
- Incision – Une incision horizontale le long de la ligne muco-gingivale, la lame doit aller jusqu’au contact osseux
- Une compresse de gaze est placée à la lèvre de l’incision et avec une pression exercée contre le mur alvéolaire, on décolle un lambeau d’épaisseur partielle que l’on descend progressivement vers le fond du vestibule.
- Le périoste est mis à nu.
- Les fines insertions musculaires sont tranchées avec une lame de bistouri. – Rinçage avec le sérum physiologique.
- Fenestration
- Une curette partant d’une extrémité, enlève le périoste de la largeur de la tête de cette curette (environ 2mm)
- Bonne hémostase.
- Pansement chirurgical.
4 3- les lambeaux déplacés :
Lambeau déplacé coronairement :
- Objectifs
- Recouvrir une récession.
- Recouvrir une membrane suite à une greffe osseuse de comblement ou une régénération tissulaire guidée.
- Indications
- Récessions simples ou multiples de classe 1 de Miller.
- Présence d’un volume de tissu kératinisé suffisant situé en position apicale à la récession.
- Épaisseur de tissu kératinisé d’au moins 0,8 mm.
- Technique
- Réaliser préalablement les mesures à la sonde parodontale pour évaluer l’importance du déplacement recherché.
- Anesthésier.
- Tracer à la lame 15 les futures papilles, espacées du sommet de la papille initiale de la même hauteur que la récession à recouvrir.
- Tracer les incisions de décharge de façon parallèle en cherchant le contact osseux.
- Une fois la ligne de jonction mucogingivale dépassée, réaliser des incisions obliques dans la muqueuse alvéolaire afin d’augmenter la laxité du lambeau lors de son déplacement.
- Avec un décolleur fin, débuter l’élévation en épaisseur totale à partir de l’une des nouvelles papilles redessinées.
- Poursuivre ce décollement mucopériosté jusqu’à la ligne de jonction mucogingivale.
- Une fois cette ligne atteinte, inciser le périoste en apical et poursuivre la dissection en épaisseur partielle dans la muqueuse alvéolaire.
- Libérer toutes les fibres de traction apicale à l’aide de la lame 15.
- Contrôler le repositionnement passif du lambeau dans la position recherchée.
- Surfacer délicatement le cément exposé.
- Désépithélialiser les papilles initiales à l’aide d’une lame 15.
- Débuter les sutures par des points en O suspendus au-dessus des points de contact de la dent.
- Suturer les décharges parallèles par des points en O.
 Lambeau déplacé latéralement :
Lambeau déplacé latéralement :
- Objectifs
- Recouvrir une récession.
- Apporter du tissu kératinisé en regard d’une dent naturelle ou d’un implant.
- Indications
- Récessions simples classe 1 ou 2 de Miller.
- Présence d’un volume suffisant de tissu kératinisé du site donneur adjacent, soit une hauteur d’au moins 3 mm et une épaisseur d’au moins 1,2 mm.
- Technique
- Évaluer préalablement le schéma de glissement à la sonde parodontale.
- Anesthésier.
- Surfacer doucement la racine.
- Réaliser les incisions à la lame 15 au niveau de la récession
- Incision intrasulculaire qui se poursuit en biseau interne de façon angulée au-delà de la ligne de jonction mucogingivale et délimite ainsi la berge proximale du lambeau.
- Incision à biseau externe débutant à la base de la papille controlatérale et rejoignant la pointe apicale de la dernière incision pour créer une zone cruentée de 2 à 3 mm de large. Le triangle ainsi formé à la base de la récession est désépithélialisé.
- Réaliser les incisions du lambeau :
- Incision horizontale festonnée dans la gencive partant de la base de la papille de la dent présentant la récession et ménageant au moins 2 mm de gencive attachée autour des dents adjacentes. Cette incision délimite un lambeau une fois et demie plus large que la récession à recouvrir ;
- Incision de décharge qui est réalisée jusqu’à la ligne de jonction mucogingivale et qui se poursuit par une incision oblique dans la muqueuse alvéolaire convergente à la récession.
- Élever le lambeau en commençant par un décollement en épaisseur totale débutant en proximal de la récession et s’étendant sur la moitié du lambeau.
- Inciser le périoste du lambeau et disséquer en épaisseur partielle en distal et en apical du défaut. Toutes les fibres retenant le lambeau sont ainsi libérées.
- Toutes les tensions résiduelles étant supprimées, le lambeau est alors déplacé de façon passive sur la zone à recouvrir.
- Suturer le lambeau en débutant par l’angle mésial, puis les papilles. La décharge mésiale est ensuite suturée et enfin des points périostés sont réalisés au niveau de la décharge distale.
4-4- Greffe gingivale libre : Objectifs :
- Augmenter le volume de tissu kératinisé.
- Stopper la progression de récessions dues à l’action de brides et de freins traumatiques et recouvrir celles-ci.
- Approfondir un vestibule.
- Favoriser l’intégration parodontale prothétique et implantaire en créant une zone de gencive attachée kératinisée capable de résister aux traumatismes de la mastication et du brossage.
- Permettre de créer des sites de cicatrisation de première intention lors de manœuvres de chirurgie des tissus mous. Le greffon est alors utilisé comme pansement biologique.
- Éliminer des tatouages gingivaux.
 Indications :
Indications :
- Présence d’une ou plusieurs récessions de classe 1 ou 2 de Miller induites par des brides et freins traumatiques.
- Présence d’une faible hauteur de gencive attachée dans un site nécessitant une thérapeutique implantaire ou prothétique.
- Site ne présentant pas ou peu d’implication esthétique.
- Présence d’un site de prélèvement présentant un volume de tissu kératinisé suffisant.
 Technique :
Technique :
Préparation du site receveur :
- Mobiliser manuellement la joue ou la lèvre ce qui permet de faciliter la visualisation de la LJMG et la dissection.
- Anesthésier le site par des infiltrations para-apicales. Le gonflement alors observé dans la muqueuse libre favorise la visualisation de la LJMG.
- Inciser avec une lame 15 en intrasulculaire les dents à traiter ou parallèlement à la LJMG.
- Poursuivre l’incision horizontalement, coronairement à la ligne de jonction mucogingivale en inclinant la lame de bistouri de façon à biseauter les berges du lit receveur.
- Réaliser deux incisions de décharges se prolongeant apicalement dans la muqueuse.
- Débuter la dissection en épaisseur partielle par un des angles coronaires du lambeau avec une lame 15.
- Poursuivre la dissection en apical en prenant bien soin d’éliminer toutes les tensions fibreuses et musculaires.
- Manipuler manuellement les tissus mous bordant le site de façon à s’assurer qu’aucune mobilité n’apparaît au niveau du lit conjonctif préparé.
- Suturer le bandeau de gencive attachée du lambeau, apicalement au lit receveur par des points en O périostés. Ils sont réalisés avec du fil résorbable afin d’éviter le traumatisme de la dépose.
- Mesurer précisément les dimensions du site à l’aide d’une sonde parodontale et réaliser un patron avec le carton d’emballage du fil de suture à la dimension exacte du lit receveur.
- Mettre en place une compresse imbibée de sérum physiologique sur le lit receveur pendant la phase de prélèvement. Cela permet de limiter la formation du caillot.
- Débuter les incisions par le passage de la lame de façon horizontale à plus de 2 mmde la gencive libre en suivant les contours du patron. Cette incision délimite la base du greffon.
- Finir de délimiter le greffon en suivant les bords du patron. L’incision se fait en profondeur, perpendiculairement à l’os, sans pour autant chercher le contact osseux.
- Introduire la lame parallèlement à la surface osseuse et disséquer le greffon en épaisseur partielle en débutant par l’angle mésiocoronaire. S’assurer d’obtenir une épaisseur d’au moins 1,5 mm.
- Maintenir le greffon avec une pince à disséquer afin de le recourber et de permettre de contrôler la dissection à la lame 15.
- Une fois le greffon détaché, placer celui-ci sur une compresse imbibée de sérum physiologique afin de l’examiner et de le retoucher si nécessaire.
- Immédiatement après le prélèvement, réaliser la première phase de l’hémostase en comprimant le site avec une compresse imbibée de sérum physiologique. Une fois le saignement diminué, mettre en place une compresse collagénique puis insérer la plaque palatine pour comprimer cette dernière.
 Mise en place du greffon :
Mise en place du greffon :
- Vérifier l’adaptation parfaite du greffon en s’assurant de bien placer la face conjonctive du greffon contre le lit conjonctif du site receveur.
- Au niveau d’un des angles coronaires, réaliser un premier passage du fil de suture.
- Réaliser le premier point de positionnement en O, au niveau de l’angle dans lequel le fil a été initialement passé. Ce point est effectué dans une papille.
- Suturer le greffon par des points papillaires afin de le stabiliser dans la position voulue.
- Réaliser des points verticaux périostés à leur base et suspendus autour des dents à traiter. Le périoste étant solidarisé à l’os sous-jacent, il permet la fixité des points. Ces points verticaux peuvent être unitaires ou continus et ont pour but de plaquer le greffon contre le lit receveur.
- Réaliser enfin un point de suture matelassé vertical croisé plaquant le greffon sur toute sa largeur.
- Vérifier l’immobilité du greffon en manipulant les tissus mous environnants.
- Réaliser une compression du site pendant au moins 5 minutes pour limiter la formation du caillot et favoriser la revascularisation.
4-4- Greffe de conjonctif :
Objectifs
- Recouvrir une ou plusieurs récessions radiculaires.
- Épaissir un tissu gingival en regard d’un pilier prothétique naturel.
 Indications
Indications
Récessions de classe 1 de Miller.
 Technique
Technique
- Préparation du site receveur : se fait comme précédemment décrit pour la greffe épithélio-conjonctive
- Prélèvement : se fait comme pour la greffe epithélioconjonctive sauf qu’il faut désépithélialiser le greffon pour ne laisser que le conjonctif qui sera par la suite suturé sur le site receveur.
- Mise en place du greffon :
- Placer le greffon sur le site de façon à ce que la partie la plus épaisse recouvre l’intégralité des récessions. Vérifier sa parfaite adaptation.
- Suturer le greffon par ses berges mésiales et distales au périoste sous-jacent de façon à l’immobiliser sur le site receveur. Un fil résorbable est alors utilisé car il ne pourra pas être déposé.
- Vérifier le repositionnement passif du lambeau de façon à recouvrir parfaitement l’apport de tissu conjonctif.
- Réaliser des points de suture suspendus aux points de contact au niveau de chaque papille.
- Suturer les décharges par des points en O.
- Conclusion :
La technique de chirurgie mucogingival doit être minutieusement choisit selon l’indication et la dextérité du praticien.
- Références bibliographiques :
- Bouchard philippe, parodontologie et dentisterie implantaire, volume 1, lavoisier, 2015.
- Bercy, Tenenbaum, parodontologie du diagnostic à la pratique, de boek, 2000.
- Vigouroux F : Guide pratique de chirurgie parodontale. Edition Elsevier, Masson, 2011.
- Wolf HF, Rateitschak EM, Rateitschak KH. Parodontologie. 3ème édition. Paris : Masson ; 2005.
Thérapeutiques des défauts du complexe mucogingival
Voici une sélection de livres:
- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011
- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996
- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE
- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient
- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé
- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1
- Endodontie, prothese et parodontologie
- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020
- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

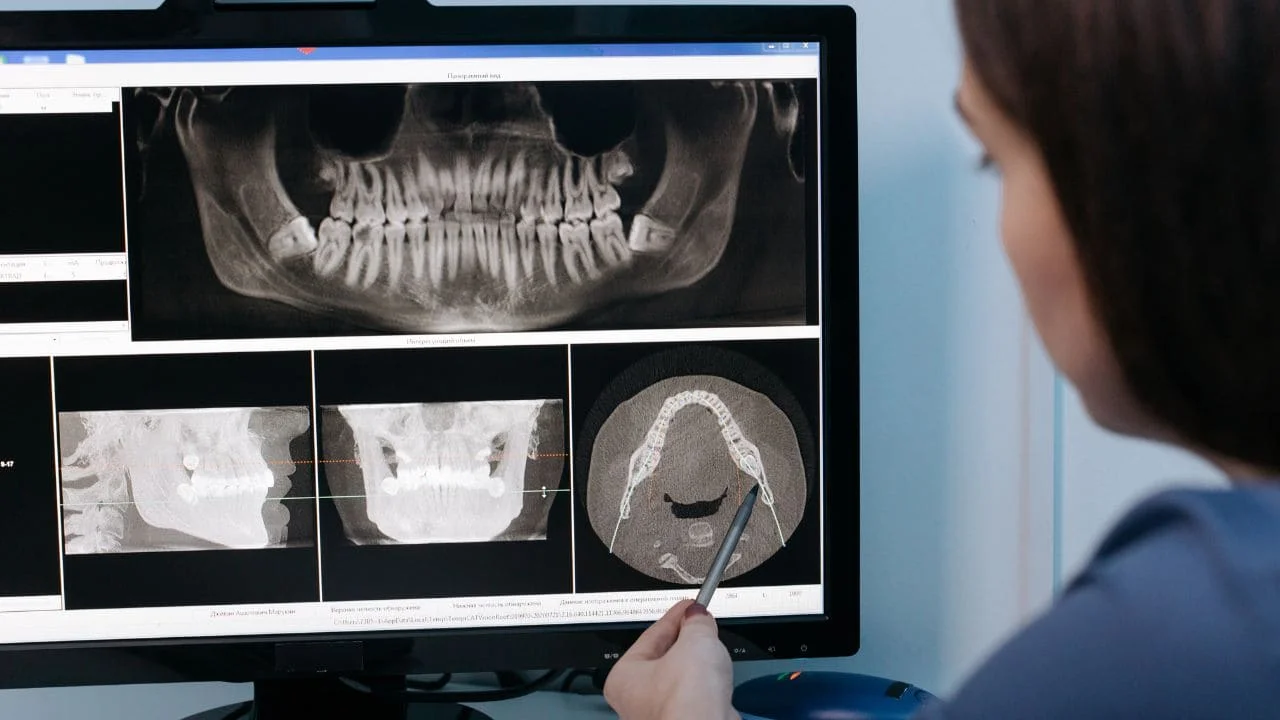


Leave a Reply