Le diagnostic en parodontologie
Le diagnostic en parodontologie
Introduction
Après la fin de l’examen clinique, le praticien est prêt à identifier la maladie à l’origine du motif qui a poussé le patient à le consulter, c’est ce qu’on appelle poser un diagnostic. L’étape suivante consiste à évaluer les chances de réussite du traitement en établissant un pronostic précis et en proposant un plan de traitement complet.
Poser le diagnostic est donc le résultat de l’exploitation des données de l’examen clinique. Ces données peuvent servir aussi bien dans la détermination de l’étiologie que pour évaluer la sévérité et le type de la maladie selon les classifications des maladies parodontales.
Définitions
Le diagnostic
Le terme « diagnostic » vient du mot grec « diagnôsis », qui signifie à la fois discernement et décision. C’est la partie de l’acte médical qui vise à déterminer la nature de la maladie observée. Il est basé sur une classification ayant obtenu l’unanimité chez les acteurs en parodontologie, comme celle d’Armitage ou la nouvelle classification proposée par le World Workshop de Chicago de 2017.
Le diagnostic étiologique
Le diagnostic étiologique vise à rechercher les diverses causes de la maladie parodontale. Il détermine la nature et le rôle des différentes étiologies possibles, en les classant en facteurs étiologiques locaux, généraux ou constitutionnels.
Le diagnostic différentiel
Le diagnostic différentiel consiste à éliminer les entités cliniques dont les signes et symptômes se rapprochent de ceux du diagnostic positif. On élimine les maladies similaires en recherchant les différences d’ordre clinique, radiologique ou même bactériologique.
Le diagnostic positif
Le diagnostic positif est la détermination d’une maladie après le recueil de tous ses symptômes et signes. Il résulte de la déduction issue de l’examen clinique et de l’étude des différents examens complémentaires. Le bilan d’observation rédigé à la fin de l’examen clinique est confronté aux descriptions proposées par la classification des maladies parodontales.
La démarche diagnostique et l’examen clinique
L’anamnèse
Les variations hormonales
Les défenses des tissus parodontaux des femmes sont exacerbées par les variations hormonales au cours de leur vie. De plus, les femmes respectent généralement mieux les rendez-vous par rapport aux hommes.
La profession
Certaines professions ont des répercussions sur l’état du parodonte.
Les antécédents généraux
L’anamnèse permet de :
- Détecter des affections générales qui pourraient modifier la réaction du parodonte aux facteurs locaux.
- Identifier les problèmes généraux nécessitant une modification du traitement.
- Rechercher des conditions générales présentant une contre-indication immédiate ou médiate à tout acte chirurgical.
- Déterminer la présence de maladies générales responsables des parodontolyses.
- Détecter les maladies contagieuses susceptibles de mettre en danger la santé du praticien et de son personnel.
Le motif de consultation et l’histoire de la maladie
La douleur, les saignements, les gonflements et la mauvaise haleine permettent au praticien de retracer l’histoire de la maladie. Cette enquête doit localiser le début de la maladie et déterminer son évolution, qu’elle soit lente ou progressive.
L’examen exobuccal
La coloration des téguments
La coloration des téguments renseigne sur une éventuelle anémie, fatigue, problème dermatologique ou même des cicatrices.
La respiration
L’absence ou la présence de stomion informe sur le type de respiration.
Les muscles masticateurs et les ATM
L’examen des muscles masticateurs, de leurs insertions et des articulations temporo-mandibulaires (ATM) oriente le diagnostic vers l’implication ou non des anomalies de l’appareil manducateur dans la pathogénie des parodontites.
Les adénopathies
La recherche d’adénopathies oriente le diagnostic vers des pathologies infectieuses ou tumorales.
L’examen endobuccal
L’hygiène buccale
Il est essentiel de rechercher la corrélation entre les facteurs locaux et la sévérité de l’inflammation existante.
L’écoulement salivaire
- Hyposialie (diminution de la sécrétion salivaire) : Il faut rechercher la cause (maladies chroniques, lésions des glandes salivaires), qui peut entraîner une sécheresse buccale, favorisant l’accumulation de la plaque bactérienne, l’apparition d’érythèmes et de fissurations.
- Ptyalisme (augmentation de la sécrétion salivaire) : Peut être provoqué par l’utilisation de certains médicaments (bromures, iodures) ou être le signe de certaines stomatites ou d’une gingivite ulcéro-nécrotique aiguë (G.U.N.A.).
L’état des muqueuses
Toute modification de la muqueuse buccale doit être notée, à la recherche d’un foyer inflammatoire, infectieux ou tumoral.
L’insertion des freins et des brides
Une insertion pathologique des freins et des brides constitue un facteur étiologique important dans la rétention de la plaque bactérienne, l’apparition de récessions parodontales ou leur persistance.
L’examen parodontal
L’examen gingival
L’examen gingival guide le diagnostic en précisant la corrélation entre la sévérité de l’inflammation et les facteurs étiologiques, tels que la quantité de plaque, les facteurs de rétention et les conditions anatomiques de la gencive.
Le sondage du sillon gingivo-dentaire
Le sondage permet d’évaluer :
- La profondeur de la poche.
- La perte d’attache.
- La sévérité du saignement au sondage.
Ces informations donnent une idée de la gravité des lésions provoquées par la maladie parodontale et permettent de déterminer s’il s’agit d’une parodontite ou d’une gingivite. Le sondage peut également diagnostiquer une éventuelle atteinte de furcation.
L’examen dentaire
Les fêlures et les abrasions peuvent être le signe d’un traumatisme occlusal (par exemple, lors d’un bruxisme ou d’autres parafonctions). La mobilité pathologique d’une dent peut orienter vers différents diagnostics, tels que :
- Une parodontite plus ou moins avancée.
- Un trauma occlusal primaire ou secondaire.
- Différents types d’abcès, de kystes ou de tumeurs.
- Des lésions endo-parodontales.
L’examen occlusal et l’examen des fonctions
L’existence de surcharges occlusales oriente le diagnostic vers la pathogénie fonctionnelle des parodontites. En cas de respiration buccale, une incidence particulière est notée : la zone antérieure présente un œdème et une hyperplasie, tandis que les secteurs postérieurs sont moins, voire pas du tout, touchés par la gingivite.
Le radiodiagnostic des parodontopathies
Le radiodiagnostic permet de confirmer et de renforcer les résultats de l’examen clinique, qui est chronologiquement prioritaire, ainsi que ceux de l’examen radiographique. Selon Prichard, la radiographie sert de moniteur à l’examen clinique : elle peut le confirmer ou suggérer de refaire un examen dans certaines zones.
D’autres diagnostics peuvent être établis à la suite d’examens complémentaires, tels que le diagnostic microbiologique, immunitaire ou moléculaire, réalisés en cas de nécessité.
Le diagnostic étiologique
Une partie essentielle de l’examen consiste à déterminer les facteurs étiologiques des parodontopathies. Cela ne sert pas seulement à parvenir à un diagnostic positif et à un pronostic, mais aussi à identifier les problèmes à éliminer pour traiter la maladie. Les principales causes des maladies parodontales ont été décrites en 1936 par Weski sous forme de triade.
Ce diagnostic permet au praticien d’organiser efficacement la thérapeutique étiologique de la maladie parodontale.
Le diagnostic positif
Selon Charon, le diagnostic positif sera plus précis et plus facile à élaborer si l’on répond à quatre questions :
Quel est l’état d’activité ?
Les signes indiquant l’état d’avancement d’une maladie parodontale incluent :
- La suppuration : Peut indiquer un état aigu (abcès) ou chronique (parodontite chronique).
- L’halitose : Signe fréquent d’activité de la maladie.
- Le saignement : Indicateur de l’inflammation active.
- La lyse osseuse et l’état de la lamina dura ou de l’os compact de la crête alvéolaire : Rams et coll. (1994) ont montré que la présence de la lamina dura est souvent associée à des lésions parodontales au repos, tandis que son absence peut être interprétée comme un signe d’activité.
- La mobilité/migration : En présence de signes cliniques, radiologiques et microbiologiques de pertes d’attache d’origine infectieuse, une aggravation soudaine de la mobilité ou l’apparition de migration peut représenter un signe d’activité infectieuse.
Quel est le stade d’avancement ?
Le stade d’avancement est défini par la profondeur de la perte d’attache, permettant de déterminer si la maladie est à son début ou avancée.
Quelle est la nature de la flore ?
La réponse à cette question permet de distinguer une maladie causée par une plaque spécifique ou polymorphe, en confrontant les résultats avec l’histoire de la maladie.
De quel type de maladie s’agit-il ?
Pour répondre à cette question, le praticien doit se baser sur une classification reconnue par la communauté scientifique, en particulier celles d’Armitage (1999) et du World Workshop de Chicago de 2017.
Le diagnostic différentiel
Le diagnostic différentiel a pour objectif de confirmer le diagnostic positif en éliminant les entités cliniques dont les signes et symptômes sont similaires, au point de pouvoir induire le praticien en erreur. Il repose sur la recherche des différences d’ordre clinique, radiologique ou bactériologique entre les maladies pouvant affecter le parodonte.
Exemples
- Une gingivite ulcéro-nécrotique aiguë (G.U.N.A.) chez des patients leucémiques sera éliminée par un interrogatoire et un bilan sanguin.
- Une gingivite hypertrophique sera différenciée selon son étiologie (locale, hormonale, respiratoire).
- Une parodontite agressive généralisée sera distinguée d’une parodontite agressive localisée en fonction de l’étendue de la maladie.
Conclusion
Les nombreuses formes cliniques des maladies parodontales partagent des signes cliniques variés et nombreux, ce qui constitue une raison supplémentaire de respecter scrupuleusement les étapes de l’examen clinique, renforcé si nécessaire par des examens complémentaires. Le praticien dispose ainsi des informations nécessaires pour poser un diagnostic précis et proposer un plan de traitement bien fondé.
Voici une sélection de livres:
- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011
- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996
- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE
- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient
- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé
- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1
- Endodontie, prothese et parodontologie
- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020
- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005


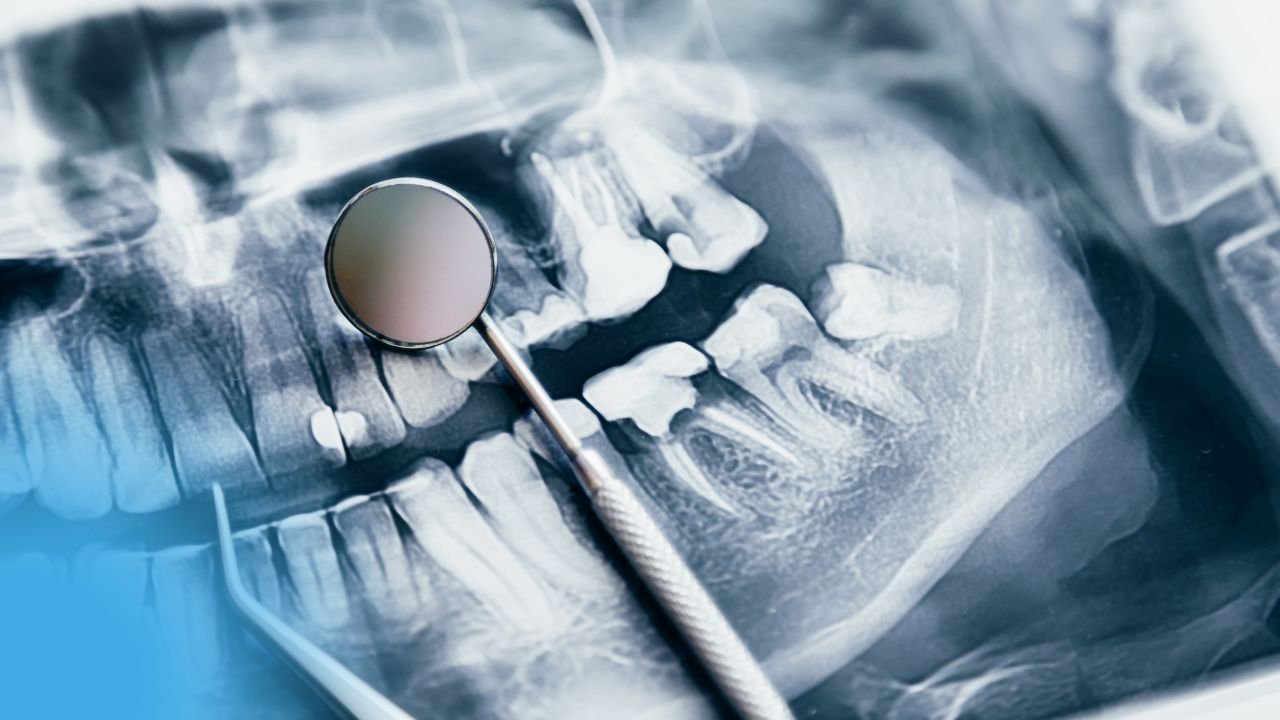

Leave a Reply