Aphte et aphtose
Aphte et aphtose
Aphte et Aphtose
Introduction
Les aphtes, décrits dès l’Antiquité par Hippocrate en 400 avant J.-C., sont des lésions ulcéreuses affectant principalement les muqueuses orale et pharyngienne, bien qu’ils puissent également apparaître dans la région génitale. Ces ulcérations superficielles se forment d’emblée par une nécrose tissulaire et peuvent, dans certains cas, laisser une cicatrice après guérison. Les aphtes se localisent exclusivement sur les épithéliums non kératinisés, c’est-à-dire les zones de muqueuse buccale non adhérentes aux plans sous-jacents, comme l’intérieur des joues, les lèvres, la langue ou le plancher buccal.
Lorsqu’un patient présente plusieurs épisodes d’aphtes, avec des poussées récurrentes plusieurs fois par an, on parle d’aphtose. Cette affection peut être isolée, c’est-à-dire sans cause systémique évidente, ou associée à des maladies systémiques touchant d’autres parties de l’organisme, comme la maladie de Behçet, les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin ou d’autres pathologies auto-immunes. L’aphtose est donc une entité clinique qui nécessite une approche diagnostique rigoureuse pour en déterminer l’origine et adapter le traitement.
L’objectif de ce document est de fournir une analyse détaillée des aphtes et de l’aphtose, en abordant leur définition, leur épidémiologie, leurs causes, leur physiopathogénie, leurs manifestations cliniques, ainsi que les options thérapeutiques disponibles. Ce contenu, enrichi et structuré, vise à offrir une vision complète et accessible pour les professionnels de santé et les patients concernés.
Définition
Qu’est-ce qu’un aphte ?
Un aphte est une ulcération superficielle de forme ronde ou ovalaire, caractérisée par un fond fibrineux de couleur « beurre frais » (jaunâtre ou blanc-grisâtre) entouré d’un halo rouge carmin. Les bords de l’aphte sont souvent œdémateux, mais il n’y a pas d’induration à la base, ce qui le distingue des lésions malignes ou d’autres types d’ulcérations. Les aphtes sont généralement douloureux, entraînant un inconfort lors de la mastication, de la parole ou même au repos.
Qu’est-ce que l’aphtose ?
L’aphtose buccale désigne une affection récidivante caractérisée par l’apparition répétée d’aphtes sur la muqueuse buccale. Elle évolue par poussées, avec des intervalles libres ou parfois quasi continus dans les formes sévères. Contrairement à l’aphte isolé, qui est un symptôme ponctuel, l’aphtose est considérée comme une maladie chronique lorsqu’elle se répète fréquemment. Elle ne laisse généralement pas de cicatrices dans ses formes mineures, mais peut entraîner des séquelles dans les formes plus graves ou associées à des pathologies systémiques.
Remarque : Il est essentiel de distinguer l’aphte, qui est un symptôme, de l’aphtose, qui est une pathologie à part entière. Cette distinction guide le diagnostic et la prise en charge.
Épidémiologie
L’aphtose buccale est une affection courante, avec une prévalence variant de 10 à 65 % selon les populations étudiées. Cette large fourchette s’explique par des différences dans les critères diagnostiques, les populations étudiées et les facteurs environnementaux.
- Âge de début : L’aphtose apparaît généralement chez les jeunes de 10 à 20 ans, bien qu’elle puisse persister à l’âge adulte. La fréquence et la sévérité des poussées tendent à diminuer avec l’âge.
- Histoire familiale : Une prédisposition génétique est souvent observée, avec une forte incidence dans les familles où plusieurs membres sont affectés.
- Sexe : Les femmes semblent légèrement plus touchées que les hommes, probablement en raison de facteurs hormonaux.
- Statut socioéconomique : L’aphtose est plus fréquente dans les classes socioéconomiques favorisées, peut-être en lien avec des facteurs comme le stress ou l’alimentation.
- Chez l’enfant : Les aphtes représentent les lésions orales les plus fréquentes, avec une prédominance chez les filles.
Ces données épidémiologiques soulignent l’importance de considérer l’aphtose comme une affection courante, mais dont l’impact sur la qualité de vie peut varier considérablement d’un individu à l’autre.
Étiologies
L’origine des aphtes et de l’aphtose est multifactorielle, impliquant des facteurs physiologiques, environnementaux, immuno-allergiques et systémiques. Bien que la cause exacte reste souvent idiopathique, plusieurs facteurs déclenchants ont été identifiés.
Facteurs physiologiques
Facteurs génétiques
Des études ont montré que des polymorphismes génétiques, notamment ceux affectant les gènes codant pour des cytokines pro-inflammatoires (IL-2, IL-6, IL-10, TNFα), sont associés à une susceptibilité accrue aux aphtes. Ces variantes génétiques peuvent amplifier la réponse inflammatoire locale, favorisant la formation des ulcérations.
Facteurs hormonaux
Chez les femmes, des fluctuations hormonales liées au cycle menstruel, à la grossesse ou à la ménopause peuvent influencer l’apparition des aphtes. Par exemple :
- Les poussées d’aphtes sont fréquentes en période prémenstruelle.
- Ces lésions disparaissent souvent pendant la grossesse, mais peuvent réapparaître après l’accouchement.
- Ces observations suggèrent un rôle des œstrogènes et de la progestérone dans la modulation de l’inflammation muqueuse.
Facteurs psychologiques
Le stress est un facteur déclenchant bien documenté. Les périodes de stress intense, comme les examens pour les étudiants, sont associées à une augmentation de la fréquence des aphtes. Cette corrélation pourrait être liée à une altération de la réponse immunitaire sous l’effet du stress chronique.
Facteurs environnementaux
Alimentation
Certains aliments sont reconnus pour déclencher ou aggraver les aphtes, notamment :
- Lait de vache et produits laitiers (fromage).
- Chocolat, fruits à coque (noix, amandes), fruits secs et fruits acides (agrumes, tomates).
- Moutarde, épices, chou, miel, café.
Ces aliments peuvent provoquer une irritation locale ou une réaction immuno-allergique favorisant l’apparition des lésions.
Médicaments
Certains médicaments sont associés à des lésions aphtoïdes, notamment :
- Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).
- Sels d’or, utilisés dans le traitement des rhumatismes.
- Nicorandil, un vasodilatateur pour les pathologies cardiaques.
- Captopril, un antihypertenseur.
- Antiépileptiques (carbamazépine, hydantoïne, barbituriques).
- Méthotrexate, utilisé dans le traitement de cancers ou de maladies auto-immunes.
- Alendronate, pour l’ostéoporose.
- Hypochlorite de sodium (antiseptique) et laurylsulfate de sodium (présent dans certains dentifrices).
Hygiène buccodentaire
Une mauvaise hygiène buccodentaire est fortement corrélée à la sévérité et à la récurrence des aphtes. L’accumulation de plaque dentaire et de bactéries peut aggraver l’inflammation locale.
Carences alimentaires
Les déficiences en fer, acide folique et vitamine B12 sont associées à une augmentation du risque d’aphtes. Ces carences altèrent la régénération des muqueuses et affaiblissent la réponse immunitaire.
Facteurs immuno-allergiques
Certains patients développent des hypersensibilités alimentaires, notamment au lait de vache, associées à des niveaux élevés d’immunoglobulines (IgA, IgE, IgG). Ces réactions peuvent s’accompagner de symptômes digestifs, suggérant une composante allergique dans l’aphtose.
Facteurs systémiques associés
L’aphtose peut être un symptôme de maladies systémiques, notamment :
- Hémopathies (leucémies, lymphomes).
- Maladie de Behçet, caractérisée par une aphtose buccale et génitale récidivante.
- Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (Crohn, rectocolite hémorragique).
- Maladie cœliaque, liée à une intolérance au gluten.
- Infection par le VIH, où les aphtes sont souvent plus sévères.
- Périadénite de Sutton, une forme d’aphtose buccale majeure.
- Syndrome MAGIC, associant aphtose et manifestations systémiques.
- Syndrome PFAPA (fièvre périodique, aphtes, pharyngite, adénite).
- Syndrome de Sweet, une dermatose neutrophilique.
- Lupus érythémateux systémique.
- Syndrome de Reiter, une arthrite réactive.
Physiopathogénie
La physiopathogénie des aphtes reste partiellement incomprise, et ils sont souvent qualifiés d’idiopathiques. Cependant, plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer leur survenue.
Anomalies inflammatoires
L’ulcération aphteuse semble résulter d’une réaction inflammatoire exagérée impliquant :
- Les lymphocytes T CD4+ et CD8+, qui exercent une action cytotoxique sur l’épithélium muqueux.
- Les monocytes-macrophages, qui amplifient la nécrose tissulaire par la libération de cytokines pro-inflammatoires (TNFα, IL-1, IL-6).
Théorie microbienne
Bien que l’aphte ne soit pas une infection aiguë, certains micro-organismes sont associés à sa survenue, notamment :
- Streptocoques et leurs toxines.
- Helicobacter pylori, impliqué dans les ulcères gastriques.
- Virus tels que HSV (herpès simplex), CMV (cytomégalovirus) et VIH.
Ces agents pourraient agir comme des déclencheurs en modifiant l’équilibre immunitaire local.
Étude clinique
Les aphtes se manifestent sous différentes formes cliniques, classées selon leur localisation, leur fréquence et leur association avec des pathologies systémiques. On distingue trois grandes catégories :
- L’aphte buccal banal (« vulgaire »).
- L’aphtose buccale récidivante (ABR).
- Les aphtoses associées à des maladies systémiques.
L’aphte buccal banal
Localisation
Les aphtes se développent sur les muqueuses non kératinisées, telles que :
- L’intérieur des joues.
- Les lèvres.
- La langue.
- Le plancher buccal.
Les muqueuses masticatoires (palais dur, rebords alvéolaires) sont généralement épargnées.
Formation
Selon Stanley, l’évolution d’un aphte passe par quatre phases :
- Phase prodromique (< 24 h) : Sensation de picotement ou de brûlure sans lésion visible.
- Phase pré-ulcérative (18 h à 72 h) : Apparition de lésions érythémateuses, maculaires ou papuleuses, parfois vésiculeuses, avec une douleur croissante.
- Phase ulcérative (72 h à 16 jours) : Formation d’une ulcération punctiforme ou lenticulaire, non hémorragique.
- Phase de ré-épithélialisation (4 à 35 jours) : Guérison sans cicatrice dans la plupart des cas.
Description
- Aspect : Ulcération de 2 à 10 mm, bord net avec un halo rouge vif, fond nécrotique jaunâtre ou grisâtre.
- Symptômes : Douleur locale, gêne à la parole et à l’alimentation.
- Durée : 1 à 2 semaines, sans adénopathie satellite ni cicatrice dans les formes banales.
Les aphtoses buccales récidivantes
Les aphtoses récidivantes sont classées selon deux critères :
- Morphologie : Mineure, miliaire, majeure.
- Sévérité : Simple, complexe.
Forme mineure d’ABR
- Prévalence : Forme la plus fréquente, surtout chez les enfants et jeunes adultes (10-40 ans).
- Caractéristiques : Aphtes de < 1 cm, isolés ou multiples (2 à 5), guérissant en 7 à 15 jours sans cicatrice.
- Récidive : Intervalles de 1 à 4 mois, parfois continus.
Forme majeure d’ABR
- Prévalence : Rare, mais plus sévère.
- Caractéristiques : Aphtes de 1 à 3 cm, uniques ou multiples (2 à 6), avec œdème périphérique. Localisation sur toute la cavité buccale, y compris l’oropharynx.
- Durée : Jusqu’à 6 semaines, souvent avec cicatrice.
- Récidive : Périodicité aléatoire, alternant rémissions et poussées intenses.
Forme herpétiforme (miliaire) d’ABR
- Caractéristiques : Petites ulcérations (1-2 mm), nombreuses (5 à 100), sans liseré érythémateux, pouvant fusionner.
- Confusion : Peut ressembler à une primo-infection herpétique.
- Durée : Guérison en 7 à 30 jours, avec récidives fréquentes.
Forme simple d’ABR
- Caractéristiques : Poussées rares (< 7 par an), ulcérations modérées, limitées à la cavité buccale, guérissant en 1 à 2 semaines.
Forme complexe d’ABR
- Caractéristiques : Poussées fréquentes, ulcérations persistantes, symptomatologie prononcée.
- Associations : Maladies systémiques (Behçet, VIH, Crohn).
Aphtose dans les maladies systémiques : Focus sur la maladie de Behçet
La maladie de Behçet est une vascularite systémique chronique associant aphtose buccale, génitale et autres manifestations systémiques. Le diagnostic repose sur les critères de l’International Criteria for Behçet’s Disease (score ≥ 4 points) :
- Aphtose buccale (2 points) : Présente dans 98 % des cas, sous toutes les formes (mineure, majeure, herpétiforme).
- Aphtose génitale (2 points) : Présente dans 60-65 % des cas, avec cicatrices fréquentes.
- Lésions cutanées (1 point) : Pseudo-folliculites, érythème noueux.
- Atteinte oculaire (2 points) : Uvéite, iritis, choriorétinite (30-70 % des cas, risque de cécité).
- Test de pathergie positif (1 point).
- Autres manifestations : Neurologiques (méningo-encéphalites, paralysies), articulaires, cardiaques, pulmonaires, digestives.
Aphtose bipolaire de Neumann : Aphtose buccale et génitale sans autres signes systémiques, considérée comme une forme fruste de la maladie de Behçet.
Traitement
Le traitement des aphtes et de l’aphtose dépend de la sévérité, de la fréquence et de la présence de pathologies associées. On distingue :
- Traitement symptomatique : Soulager la douleur et accélérer la guérison.
- Traitement préventif : Réduire les récidives et limiter les facteurs déclenchants.
Traitement préventif
Mesures diététiques
- Éviter : Aliments durs, acides (agrumes, tomates), salés, épicés (poivre, piment).
- Supplémentation : Vitamines (A, B, C, D, E, K) et minéraux (zinc, magnésium) pour corriger les carences.
Soins buccodentaires
- Élimination des facteurs irritants (caries, prothèses mal adaptées).
- Utilisation de brosses à dents à poils souples et de dentifrices fluorés sans laurylsulfate de sodium.
Conseils d’hygiène
- Maintenir une hygiène buccodentaire rigoureuse pour réduire l’inflammation locale.
Traitement curatif
Traitements locaux
- Anesthésiques locaux : Lidocaïne (ex. : Xylocaïne® visqueuse 2 %) en gel ou bain de bouche pour soulager la douleur temporairement.
- Antiseptiques : Chlorhexidine en bain de bouche (2 fois/jour) pour prévenir les surinfections.
- Anti-inflammatoires : Acide acétylsalicylique (aspirine effervescente) ou corticoïdes locaux (prednisolone, hydrocortisone).
- Amlexanox 5 % (Aphtasol®) : Anti-inflammatoire et antiallergique, appliqué 4 fois/jour.
- Antibiotiques locaux : Tétracyclines en bain de bouche pour les formes herpétiformes ou majeures.
- Acide hyaluronique : Hyalugel® (gel ou spray) pour accélérer la cicatrisation.
- Traitements physiques : Nitrate d’argent, acide trichloracétique, laser CO2 pour cautériser l’aphte et réduire la douleur.
Traitements systémiques
Utilisés pour les aphtoses sévères ou associées à des maladies systémiques :
- Colchicine : Anti-inflammatoire pour la maladie de Behçet (prévention des poussées).
- Thalidomide : Efficace dans les aphtes sévères (VIH, immunocompétents), mais effets secondaires limitants (neuropathie, tératogénicité).
- Pentoxifylline (400 mg 3 fois/jour) : Inhibe les cytokines pro-inflammatoires.
- Corticothérapie systémique : Prednisone (25 mg/jour) pour les formes sévères.
- Azathioprine (1-2 mg/kg/jour) : Immunosuppresseur pour aphtoses oro-génitales.
- Cyclosporine (3-6 mg/kg/jour) : Immunosuppresseur pour ABR sévères.
- Vitamine B12 : 1 mg/jour pendant 6 mois pour réduire la fréquence et la douleur.
- Ozone : Antioxydant et antimicrobien pour améliorer la cicatrisation.
- Extraits naturels : Punica granatum, huile de sésame, gingembre, réglisse, aloe vera pour leurs propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes.
Conclusion
Les aphtes buccaux, bien que souvent bénins, peuvent être le signe d’une aphtose récidivante ou d’une pathologie systémique sous-jacente, comme la maladie de Behçet, le VIH ou les maladies inflammatoires chroniques. Une prise en charge adaptée nécessite une évaluation clinique rigoureuse pour identifier les facteurs déclenchants et les éventuelles pathologies associées. Les traitements locaux et systémiques, combinés à des mesures préventives (diététiques, hygiène buccodentaire), permettent de réduire la douleur, la fréquence des poussées et l’impact sur la qualité de vie. Les professionnels de santé, notamment les odontostomatologistes, jouent un rôle clé dans la gestion des formes mineures et l’orientation vers des spécialistes pour les cas complexes.
Voici une sélection de livres:
- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011
- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996
- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE
- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient
- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé
- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1
- Endodontie, prothese et parodontologie
- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020
- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005
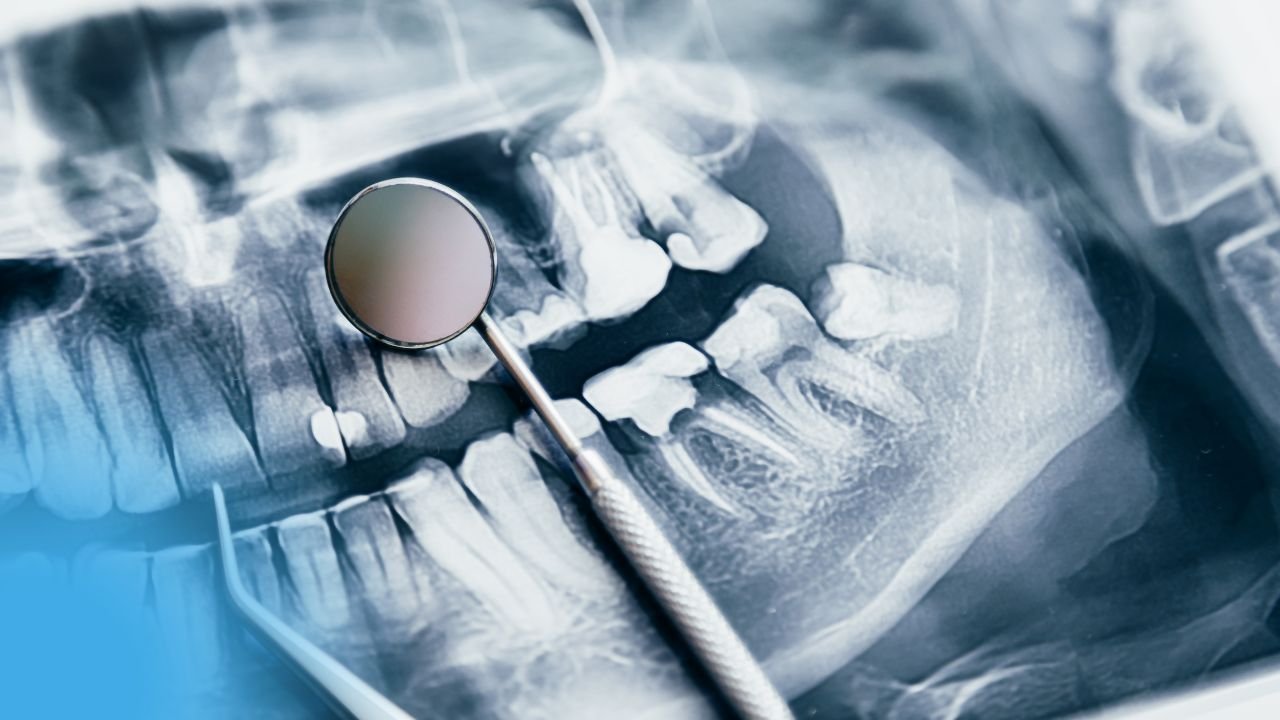


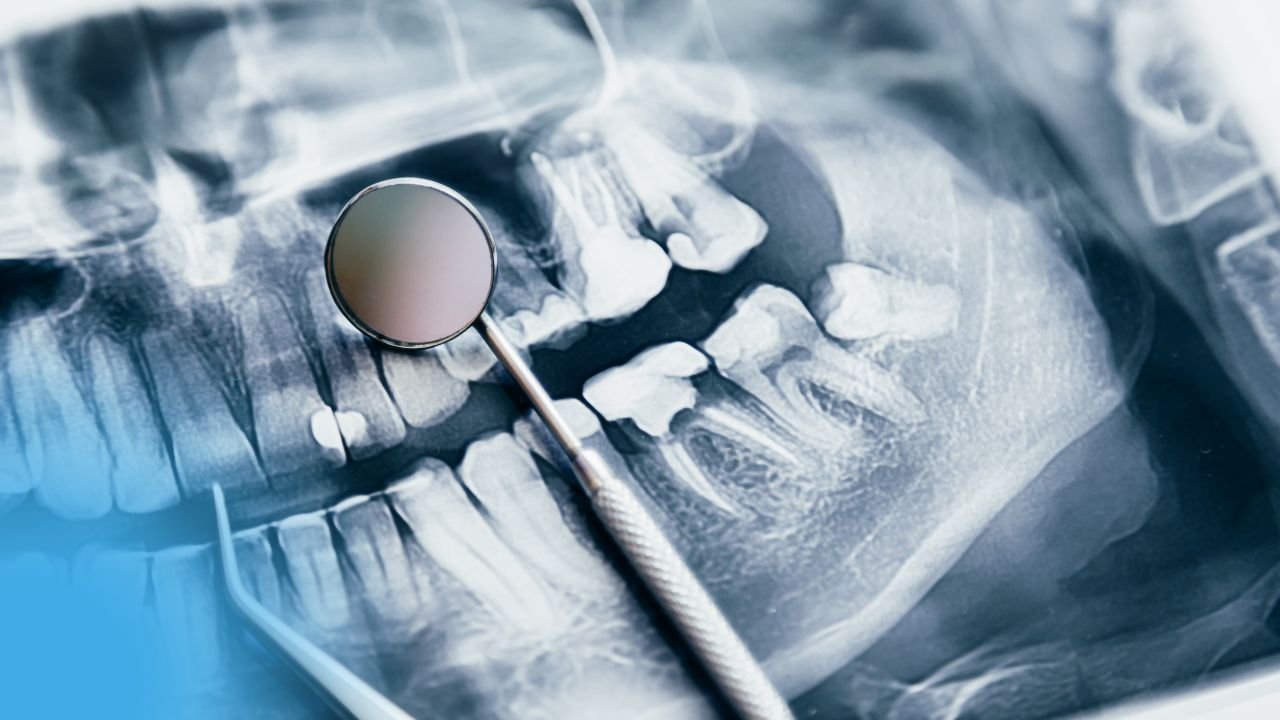
Leave a Reply