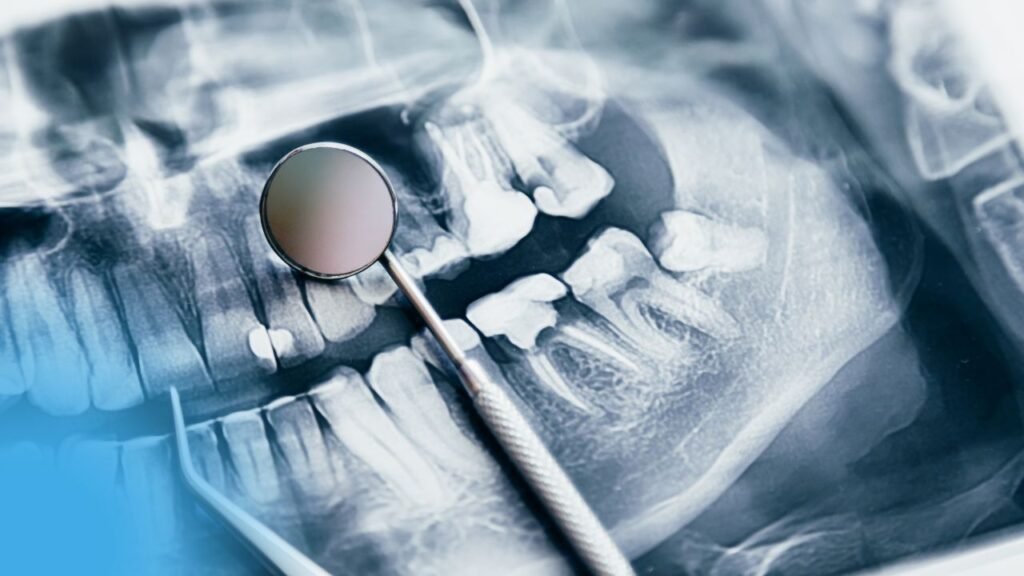Soins et complications postopératoire
Soins et complications postopératoires
Introduction
Les principales complications postopératoires rencontrées après une chirurgie dentaire sont :
- Les tuméfactions et œdèmes
- La douleur
- Le saignement
- L’infection
Ces complications dépendent de l’état du patient (terrain) et des difficultés et incidents chirurgicaux.
Les principales complications post-opératoires
L’œdème
La chirurgie buccale entraîne souvent un œdème, plus ou moins important, en rapport avec l’inflammation. Il se manifeste par une tuméfaction unilatérale, non extensive.
Il apparaît immédiatement après l’intervention sous forme d’une tuméfaction unilatérale, non extensive, avec un maximum d’intensité entre la 48ᵉ et la 72ᵉ heure. Il régresse spontanément vers le 5ᵉ à 7ᵉ jour post-opératoire.
Physiopathologie de l’œdème
L’œdème est dû à une réaction inflammatoire post-chirurgicale avec libération locale de médiateurs de l’inflammation (histamine, prostaglandines), entraînant une vasodilatation et une augmentation de la perméabilité vasculaire. L’exsudation de liquide hors des vaisseaux est responsable d’une tuméfaction qui comprime les nerfs et provoque la douleur.
Caractéristiques cliniques de l’œdème
À l’examen endo-buccal, on retrouve une tuméfaction de la muqueuse qui est dure, tendue, douloureuse, accompagnée d’une rougeur et d’une chaleur au toucher. Il n’existe ni dysphonie, ni dyspnée, ni signes généraux d’infection (fièvre, asthénie, etc.).
Traitement de l’œdème
Cryothérapie : Le froid induit un hypo-métabolisme cellulaire, ralentissant la synthèse des médiateurs chimiques de l’inflammation. Ce traitement local consiste à :
- Appliquer une poche de glace en regard de la zone opérée, isolée de la peau par un tissu, pendant 45 minutes toutes les 2 heures pour éviter les brûlures cutanées.
- Durée du traitement : 1 à 4 jours.
Prévention de l’œdème
L’activité enzymatique responsable de la synthèse des médiateurs de l’inflammation augmente avec la température. Les conseils postopératoires incluent :
- Éviter de porter une écharpe ou un foulard autour du cou.
- Éviter les boissons chaudes.
Emphysème sous-cutané (ESC)
L’emphysème sous-cutané est la présence d’air dans les tissus sous-cutanés de la face et du cou. Bien que rare, il peut entraîner des complications graves, potentiellement mortelles, comme un pneumothorax ou un pneumomédiastin. La propagation de micro-organismes depuis la cavité buccale peut engendrer un risque infectieux.
Caractéristiques cliniques de l’ESC
L’examen clinique révèle une tuméfaction localisée au niveau de la face et du cou, du côté du site opératoire, indolore et non érythémateuse, avec une sensation de crépitation neigeuse à la palpation. Aucun signe d’inflammation locale (érythème, œdème, douleur à la pression, adénopathies) n’est présent. Les examens paracliniques ne sont pas nécessaires, sauf en cas d’extension vers la région thoracique.
Causes de l’ESC
L’ESC est dû à la propagation d’air sous pression dans les tissus sous-cutanés, à partir d’une lésion (alvéole dentaire, muqueuse). Cela peut être provoqué par :
- Le chirurgien (iatrogène) : Survient rapidement, favorisé par l’utilisation de turbines à air, de lasers dentaires ou d’appareils à flux d’air.
- Le patient : Plus rare, survient tardivement, favorisé par la toux, les éternuements, le mouchage ou les vomissements.
Traitement de l’ESC
Dans la plupart des cas, l’emphysème disparaît spontanément en moins de 5 jours, sans mesures particulières. Une antibiothérapie peut être prescrite en cas de signes infectieux. En cas d’extension vers le thorax, une hospitalisation est recommandée pour une surveillance clinique et radiologique, à la recherche de complications graves comme un pneumomédiastin ou un pneumothorax.
La douleur postopératoire
La douleur postopératoire correspond à des neuropathies post-chirurgicales, souvent localisées au territoire du nerf alvéolaire inférieur, après l’avulsion d’une 3ᵉ molaire mandibulaire, la pose d’implants ou une anesthésie locorégionale. Elle doit être évaluée objectivement à l’aide d’une échelle, comme l’Échelle Verbale Simple (EVS). Les douleurs persistantes, tardives et rebelles aux traitements antalgiques, sont rares.
Facteurs favorisant la douleur
- Liés à la chirurgie : Difficultés chirurgicales, durée de l’intervention, expérience du chirurgien.
- Liés au patient : Hygiène buccale, tabagisme, douleur préopératoire, anxiété, dépression.
Traitement de la douleur
L’analgésie est systématique, administrée avant l’apparition de la douleur et pour une durée suffisante.
- Douleurs faibles : Paracétamol, 1 g par prise toutes les 6 heures.
- Douleurs modérées à intenses :
- AINS (propioniques, avec AMM pour cette indication) : Ibuprofène, 400 mg par prise, renouvelable toutes les 6 heures, sans dépasser 1200 mg/jour. Éviter l’aspirine, tenir compte des contre-indications (infection, grossesse).
- Opioïdes :
- Tramadol : 50 à 100 mg par prise, toutes les 4 à 6 heures, sans dépasser 400 mg/24 h.
- Paracétamol/codéine : Aux dosages appropriés (50 à 60 mg de codéine).
- Douleurs persistantes et résistantes : Analgésie multimodale associant AINS (moins de 72 heures, hors contre-indications), paracétamol + codéine ou tramadol par voie orale, en prise systématique pendant une durée suffisante.
La persistance ou la réapparition de douleurs intenses nécessite une consultation postopératoire pour dépister d’éventuelles complications.
Prévention de la douleur
- Information du patient : Fournir des informations claires, détaillées et adaptées sur la douleur prévisible et les moyens de prévention et de traitement.
- Analgésie anticipée : Administrer l’analgésie postopératoire systématiquement avant l’apparition de la douleur.
Le saignement
Le saignement est une complication fréquente, observée pendant quelques heures (4 à 5 h) jusqu’à 24 h après une intervention chirurgicale dentaire (ou extraction). Il résulte de la levée de la vasoconstriction induite par les vasoconstricteurs contenus dans les anesthésiques locaux. Il est généralement maîtrisé par un traitement local, mais en cas de saignement impossible à contrôler, une prise en charge hospitalière est nécessaire.
Facteurs favorisant le saignement
Le risque hémorragique est accru chez les patients présentant des troubles hématologiques ou sous traitement anticoagulant :
- Thrombopénies.
- Thrombopathies.
- Coagulopathies congénitales : Hémophilie de type A et B, maladie de Willebrand.
- Coagulopathies acquises médicamenteuses : Antiagrégants plaquettaires (aspirine, Plavix), anticoagulants (antivitamine K, etc.).
Causes du saignement
- Liées à l’intervention : Hémostase non contrôlée, absence de révision du site opératoire, persistance de tissus inflammatoires.
- Liées au patient : Bains de bouche précoces ou excessifs, succion ou crachats répétés.
Traitement du saignement
Le traitement est local et consiste à assurer l’hémostase par compression au niveau du site opératoire, à l’aide d’une gaze stérile pliée, en serrant les mâchoires avec une pression constante pendant 30 minutes à 1 heure. Si le saignement persiste au-delà de 24 h, une prise en charge hospitalière est nécessaire pour une hémostase médicale et chirurgicale.
Complications du saignement
Un hématome persistant peut survenir en cas d’hémorragie négligée ou de trouble de l’hémostase. Il peut devenir volumineux et diffus, entraînant une compression des voies aéro-digestives supérieures. C’est une urgence vitale nécessitant une stabilisation respiratoire (oxygénation, intubation orotrachéale si nécessaire), un drainage et une hémostase.
Prévention du saignement
- Éviter de cracher et avaler normalement sa salive.
- Éviter les bains de bouche, qui peuvent aggraver le saignement en empêchant la formation du caillot.
- Éviter de passer la langue sur le site de l’extraction.
- Appliquer une pression sur la compresse en mordant dessus pendant au moins 30 minutes.
L’infection
Une infection postopératoire peut survenir, avec une gravité liée au risque de dissémination locorégionale et générale, entraînant des complications graves. Les infections les plus courantes sont les alvéolites (ou ostéites alvéolaires), mais d’autres complications, comme les cellulites cervico-faciales et les ostéites, peuvent survenir.
Facteurs favorisant l’infection
- Nature de l’acte chirurgical (invasif ou non).
- Durée de l’acte (contamination bactérienne).
- État buccal et hygiène bucco-dentaire du patient.
- Tabagisme (retarde la cicatrisation).
- Éthylisme.
- Âge avancé.
L’alvéolite ou ostéite alvéolaire
L’alvéolite est une inflammation de l’alvéole déshabitée après la perte du caillot sanguin, qui joue un rôle protecteur. Elle peut évoluer vers une surinfection. C’est l’infection postopératoire la plus fréquente, avec une bonne évolution si elle est prise en charge précocement. Elle se manifeste sous deux formes : alvéolite sèche et alvéolite suppurée.
Physiopathologie de l’alvéolite
Le caillot sanguin formé après une extraction dentaire protège le site opératoire, favorise une cicatrisation rapide et réduit la douleur. Une alvéolite survient lorsque le caillot est éliminé précocement (en partie ou en totalité). L’alvéole non protégée est envahie par les bactéries de la salive, prolongeant la guérison et entraînant une inflammation ou une infection.
Alvéolite sèche
- Caractéristiques : La plus fréquente, elle se développe 2 à 4 jours après l’intervention. Elle est marquée par une douleur intense, pulsatile, irradiant vers le cou et l’oreille.
- Examen clinique : Alvéole dénudée contenant un résidu de caillot non adhérent au plan osseux, avec des parois blanchâtres et très douloureuses.
Alvéolite suppurée
- Caractéristiques : Se développe généralement 7 jours après l’intervention, due à une surinfection de l’alvéole. La douleur est plus modérée.
- Examen clinique : Tapis blanchâtre au fond de l’alvéole, inflammation de la muqueuse (bourgeonnante, tuméfiée), écoulement de pus, signes généraux d’infection (fièvre, adénopathies mandibulaires).
Causes des alvéolites
| Alvéolites sèches | Alvéolites suppurées |
|---|---|
| Traumatisme per-opératoire | Débris résiduels (séquestres osseux, fragments dentaires, granulomes, tartre, aliments) |
| Perte prématurée du caillot | Extension d’une infection de voisinage |
| Tabac (effet vasoconstricteur) | Mauvaise hygiène buccale |
| Bain de bouche précoce | – |
Traitement des alvéolites
- Alvéolites sèches :
- Antalgiques pour calmer la douleur.
- Guérison spontanée vers le 10ᵉ jour.
- Alvéolites suppurées :
- Antalgiques.
- Antibiotiques par voie générale (Augmentin ± Flagyl).
- Soins locaux : Rinçage avec une solution saline ou antiseptique, curetage soigneux de l’alvéole sous anesthésie sans vasoconstricteurs.
Prévention des alvéolites
- Maintenir une compresse sur l’alvéole, à changer régulièrement pendant 2 à 3 heures, pour favoriser la formation du caillot.
- Arrêter le tabac.
- Maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire, en évitant les bains de bouche et le brossage du site chirurgical dans les 24 premières heures.
- Réaliser une révision alvéolaire après l’extraction.
Les cellulites cervico-faciales
Les cellulites cervico-faciales sont une inflammation infectieuse du tissu cellulo-graisseux et musculaire profond de la face et du cou. Elles peuvent succéder à une alvéolite suppurée non ou mal traitée (vers le 21ᵉ jour post-opératoire) ou à une fracture alvéolaire ou radiculaire. Bien que souvent circonscrites et bénignes, leur gravité réside dans leur potentiel d’évolution extensive (cellulite diffuse), pouvant engager le pronostic vital.
Facteurs favorisant les cellulites
- Infection préexistante latente.
- Traumatisme opératoire ou traitement chirurgical mal conduit.
- Déficit immunitaire, diabète.
- Utilisation d’anti-inflammatoires (stéroïdiens ou non).
- Foyer infectieux local (alvéolite suppurée, fragment d’os alvéolaire fracturé).
- Alcoolisme et tabagisme.
Formes cliniques des cellulites
- Cellulites circonscrites : Surviennent généralement 3 à 5 jours après l’intervention.
- Cellulite séreuse : Purement inflammatoire (œdème, rougeur, chaleur, douleur).
- Cellulite suppurée : Signes locaux (douleur pulsatile, trismus, dysphagie, tuméfaction fluctuante, adénopathies, salivation) et signes généraux modérés (fièvre, asthénie, céphalée). Peut évoluer vers une nécrose tissulaire (cellulite gangréneuse).
- Cellulites diffuses graves : Apparaissent après 11 jours post-opératoires, ou sous une forme fulgurante avec fasciite nécrosante dans les 2 à 8 heures. Signes fréquents : douleur à la déglutition (odynophagie), rougeur cervicale, fièvre, trismus, dysphagie. La dyspnée et la dysphonie sont rares. Une association de signes locaux et généraux (fièvre, confusion, hypotension) indique un sepsis sévère, constituant une urgence thérapeutique.
Examens complémentaires
- Radiologiques : Scanner cervico-facial avec injection de produit de contraste, complété par un scanner thoracique en cas d’extension à la base du cou (recherche de médiastinite).
- Biologiques : FNS, CRP, hémocultures au pic fébrile, prélèvements bactériologiques.
Traitement des cellulites
- Cellulites circonscrites :
- Traitement médical : Antibiotiques (Augmentin ou céphalosporine + imidazolé) pour stopper la propagation.
- Traitement chirurgical : Incision de l’abcès au niveau de la gencive si collecté, drainage de l’infection.
- Cellulites diffuses graves :
- Réanimation respiratoire (oxygénation, intubation orotrachéale, parfois trachéotomie).
- Corticothérapie.
- Antibiothérapie probabiliste (céphalosporine de 3ᵉ génération + imidazolé par voie parentérale), adaptée selon les résultats bactériologiques.
- Traitement chirurgical : Incision, lavage, drainage.
Les ostéites
Les ostéites sont une inflammation du tissu osseux (maxillaire) liée à une extraction dentaire (souvent la 3ᵉ molaire). Elles surviennent généralement sur un foyer d’alvéolite négligé, sur un terrain particulier (os fragile, irradiation, diabète). Elles sont plus fréquentes à la mandibule qu’au maxillaire en raison de la vascularisation terminale de la mandibule. Une ostéite peut suivre une cellulite, et inversement.
Signes cliniques et paracliniques des ostéites
- Signes cliniques :
- Douleur localisée ou irradiée, continue ou paroxystique.
- Érythème et œdème au niveau du site.
- Fistules cutanées, écoulement de pus, parfois dénudation osseuse.
- Trismus en cas d’atteinte osseuse postérieure.
- Signes généraux : Fièvre, adénopathies cervicales.
- Paracliniques :
- TDM faciale avec injection de produit de contraste : Ostéolyse, séquestres osseux.
- Biologie : Hyperleucocytose, CRP positive.
Traitement des ostéites
- Médical : Antibiothérapie adaptée avec bonne diffusion osseuse, antalgiques, oxygénothérapie (hyperbare).
- Chirurgical : Drainage, curetage, exérèse des séquestres.
Infections à distance du site opératoire
Ces complications sont rares, favorisées par une prise en charge tardive ou inadéquate des infections locales. Un foyer infectieux oral peut provoquer :
- Cardiaques : Endocardite bactérienne.
- Ophtalmiques : Uvéite, kératite.
- Emboles septiques : Abcès du cerveau, pulmonaire, osseux, rénal, septicémie.
Les lésions nerveuses
Les lésions nerveuses sont rares, réversibles en cas de compression du nerf, mais irréversibles en cas de section complète. La lésion du nerf alvéolaire inférieur est la plus fréquente, souvent causée par l’avulsion d’une 3ᵉ molaire mandibulaire. Elle entraîne des troubles de la sensibilité labio-mentonnière : anesthésie partielle ou complète, hypoesthésies, paresthésies ou dysesthésies.
Consignes post-opératoires
- Éviter de cracher et les bains de bouche pendant 24 h.
- Appliquer une poche de glace dès la fin de l’intervention.
- Garder la compresse dans la bouche pendant 1 heure après l’intervention.
- Prendre les médicaments prescrits contre la douleur avant son apparition, éviter l’aspirine.
- Assurer une bonne hygiène buccale après chaque repas dès le lendemain (brossage doux).
- Éviter l’activité physique intense pendant 2 à 4 jours.
- Adopter une alimentation semi-liquide et froide/tiède les 2 premiers jours.
- Éviter les boissons chaudes.
- Éviter l’alcool et le tabac pendant 1 à 2 semaines.
Voici une sélection de livres:
- Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché
- Concepts cliniques en odontologie conservatrice
- L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement
- Guide clinique d’odontologie
- Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve
- La photographie en odontologie: Des bases fondamentales à la clinique : objectifs, matériel et conseils pratique
Soins et complications postopératoire

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.