Techniques d’obturation canalaire
Définition de l’obturation canalaire
Selon Weine (1977) : « l’obturation canalaire est la 3ème étape du traitement endodontique après le diagnostic et la préparation canalaire, c’est le scellement de toute la totalité de la cavité endodontique visant à isoler le système canalaire du milieu buccal et du parodonte profond ».
Les conditions techniques du scellement canalaire
1. Asymptomatologie de la dent
La dent ne doit présenter ni douleur, ni sensibilité spontanée et doit répondre négativement à la percussion. Il est recommandé d’attendre la fermeture d’une fistule éventuelle avant de sceller le canal et de ne jamais obturer tant qu’une odeur continue à monter du canal.
2. État du pansement provisoire
Le pansement provisoire doit être intact avant l’obturation. En cas de destruction partielle ou d’infiltrations évidentes par défaut d’adaptation au niveau des bords, le traitement devra être repris avant de sceller le canal.
3. Absence d’exsudation intra-canalaire
Le canal doit être sec au moment de l’obturation canalaire. En cas d’écoulement continu, on obture le canal à l’aide d’un mélange d’hydroxyde de calcium mélangé à de la méthylcellulose à 2 % ou à de l’eau distillée pendant 8 jours.
4. Rinçage du canal
Il est bon de refaire la dernière irrigation du canal préparé avant l’obturation pour assurer une meilleure désinfection. Le sérum physiologique est le produit de choix. On peut également utiliser des carpules anesthésiques, faciles à manipuler, qui contiennent 98 % de sérum physiologique.
5. Assèchement du canal
Après rinçage, l’obturation ne peut s’envisager que si le canal est parfaitement sec.
6. Cultures intra-canalaires négatives
La nécessité de sceller le système canalaire après obtention d’une culture négative.
7. Choix du système d’obturation canalaire
Le choix se fera en fonction d’éléments cliniques qui seront décrits pour chaque technique.
8. Importance du ciment de scellement
Le ciment est nécessaire pour combler les irrégularités les plus fines, obturer les canaux latéraux et accessoires, et assurer le joint d’herméticité entre la masse plastique et les parois canalaires.
Les temps opératoires du scellement canalaire
Champ opératoire
Il sera mis en place dans les conditions habituelles avant d’enlever le pansement temporaire.
Contrôle de la préparation canalaire
Ce contrôle a pour but de vérifier éventuellement la longueur de préparation par une radiographie avec une lime en place supplémentaire ou un contrôle électronique.
Assèchement
Il sera pratiqué jusqu’à ce que les pointes en papier ressortent du canal sèches et non tachées.
Scellement du système canalaire
Il doit obéir à l’ensemble des impératifs de l’obturation. Pour cela, diverses techniques existent, chacune ayant des indications appropriées.
Contrôle post-opératoire
Contrôle immédiat
C’est la classique radiographie de contrôle prise en fin d’intervention. Elle devra être développée rapidement et lue après avoir été séchée, de préférence sur un agrandisseur (loupe).
Contrôles à distance
Ils seront pratiqués systématiquement, dans le cas de lésions péri-apicales, à trois mois, six mois et un an.
Techniques d’obturation canalaire
Techniques classiques
1. Technique simple (pâte seule)
L’obturation sera réalisée avec une pâte à base d’oxyde de zinc et d’eugénol. Pour cela, la poudre et le liquide sont mélangés à l’aide d’une spatule sur une plaque de verre jusqu’à l’obtention d’une pâte de consistance crémeuse. Ensuite, le bourre-pâte monté sur contre-angle est enduit de cette pâte et introduit à l’arrêt dans le canal jusqu’à la longueur de travail. On actionne le contre-angle et on retire petit à petit le bourre-pâte du canal, il n’est arrêté qu’une fois à l’extérieur du canal. On réalise ainsi plusieurs apports de pâte jusqu’à ce que le canal soit complètement obturé.
2. Technique mixte : technique monocône
Choix du cône :
Il doit atteindre la limite apicale de la préparation apicale. Son diamètre correspond à celui du dernier instrument utilisé pour la préparation apicale. La position finale du cône de gutta-percha est contrôlée par une radiographie rétro-alvéolaire.
Mise en place de la pâte d’obturation :
Elle s’effectue de la même façon que pour la technique simple.
Mise en place du cône de gutta-percha :
Le cône de gutta-percha est enrobé de ce ciment, puis il est de nouveau inséré dans le canal jusqu’à la longueur de travail. Une fois l’obturation terminée, on sectionne le cône à l’entrée du canal avec un instrument chauffé au rouge, et avec le fouloir, on exerce une pression axiale pour tasser le cône.
3. Le compactage latéral à froid de la gutta-percha
Choix du cône principal :
Ou le maître cône, le diamètre du cône de gutta-percha non normalisé est choisi en fonction du volume canalaire. À l’aide d’une réglette d’endodontie, on ajuste la pointe du cône au diamètre de la lime apicale maîtresse (qui est le dernier instrument ayant travaillé jusqu’à l’apex).
Choix des cônes accessoires :
Il sera en fonction du spreader utilisé, par exemple médium fin pour spreader B ou fine medium pour spreader C.
Scellement du maître cône :
On badigeonne légèrement les parois canalaires de ciment de scellement avec une broche, actionnée dans le sens anti-horaire. L’extrémité du cône est elle-même enduite de ciment, et le cône est introduit dans le canal jusqu’à la longueur de travail (LT).
Compactage latéral :
Un premier fouloir de gros calibre est positionné le long du maître cône, avec une poussée apicale et latérale. Vérifier l’enfoncement du spreader qui devra pénétrer jusqu’à LT – 2 mm. Puis on le retire en faisant des mouvements alternatifs d’un quart de tour à droite et à gauche de faible amplitude.
Mise en place des cônes accessoires :
Un cône accessoire enduit de ciment est alors introduit dans cet espace, ce cône est tassé en suivant les mêmes opérations que précédemment avec les fouloirs latéraux. L’opération est répétée jusqu’à ce que le spreader ne pénètre plus de 3 à 4 mm dans le canal. Un dernier cône accessoire sera inséré et l’ensemble des extrémités des cônes est sectionné à l’aide d’un instrument chauffé au rouge.
4. Le compactage vertical à chaud de la gutta-percha : technique de Schilder ou technique de compactage vertical en vague multiple
Choix du maître cône :
Il sera effectué de la même façon que pour le compactage latéral de la gutta-percha.
Sélection des fouloirs verticaux :
On sélectionne en général 3 fouloirs de calibre décroissant qui vont être essayés dans le canal préparé. Ils doivent pénétrer dans le canal sans interférer avec les parois, jusqu’à des longueurs « autorisées ».
Scellement du maître cône :
De la même manière que pour la technique citée ci-dessus.
Condensation verticale :
a. Phase descendante
Avec le premier fouloir (le plus gros diamètre), dont l’extrémité a été préalablement trempée dans la poudre d’oxyphosphate de zinc, on effectue une première condensation en direction apicale. L’extrémité du réchauffeur, portée au rouge, pénètre ensuite la gutta-percha sur une profondeur de 2 à 3 mm et est retirée immédiatement. Le même fouloir pénètre à nouveau la masse de gutta ramollie. Il faut le retirer légèrement et effectuer une série de petites poussées verticales de faible amplitude, en cherchant à ramener vers le centre la gutta-percha pour obtenir une surface aussi plane que possible. Ces opérations sont répétées plusieurs fois jusqu’à ce que le premier fouloir atteigne son point de pénétration autorisé. On peut alors utiliser le deuxième, puis le troisième fouloir pour réaliser la condensation de la partie médiane et apicale du canal en effectuant les opérations successives déjà décrites.
b. Phase de remontée
On prend des segments de cônes de gutta-percha de 3 à 5 mm de longueur, et à l’aide d’un réchauffeur porté au rouge, on pique légèrement la masse de gutta déjà compactée dans la région apicale, pour en ramollir la surface. On colle le premier segment de gutta sur l’extrémité tiède du fouloir et on l’insère, à froid, au contact de la gutta déjà en place. Un petit mouvement de rotation permet de détacher le segment de gutta du fouloir. Le réchauffeur, porté au rouge, est alors à nouveau utilisé pour ramollir le segment collé, que l’on compacte immédiatement par une série de poussées verticales jusqu’à l’obtention d’une surface plane. L’opération est répétée pour les segments suivants, en utilisant des fouloirs de calibre croissant jusqu’au remplissage complet du canal.
Techniques récentes
1. Technique de condensation verticale thermomécanique
Étapes :
- D’abord, on choisit un maître cône.
- Le ciment de scellement canalaire est introduit manuellement à l’apex, à l’aide d’une broche que l’on fait tourner dans le sens anti-horaire.
- On enduit la partie apicale du cône de ciment et on le place dans le canal.
- Le compacteur, adapté en diamètre au dernier instrument passé dans le tiers apical (longueur apicale maîtrisée, LAM), est introduit, à l’arrêt, dans le canal à la longueur de travail moins 2 mm.
- Le micromoteur est actionné d’emblée à une vitesse rapide. Le temps de fonctionnement est de 5 à 10 secondes : on voit littéralement le cône s’enfoncer dans le canal.
- En fin, l’obturation est terminée par un compactage vertical manuel avec un fouloir à canaux, et l’excès de gutta-percha est éliminé.
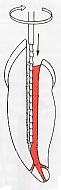
Description des images associées (1 à 4) :
- Insertion du condenseur thermomécanique dans le canal : Montre le compacteur thermomécanique positionné à l’entrée du canal avant son activation.
- Mise en marche du micromoteur : Illustre le moment où le micromoteur est activé pour commencer le compactage.
- Légers mouvements de pompage en direction apicale pendant 10 secondes : Représente les mouvements de va-et-vient du compacteur pour compacter la gutta-percha.
- L’instrument est retiré au moment où l’on sent une répulsion du condenseur : Montre le retrait du compacteur une fois le compactage terminé.
2. Nouvelle technique de Mac Spadden : gutta phases I et II
Matériels et matériaux :
Cette technique est basée sur le compactage de deux types de gutta-percha à l’aide d’un compacteur en nickel-titane : le compacteur NT condensor.
Technique :
- Le compacteur est introduit dans la seringue contenant la gutta phase I préchauffée pour être enrobé d’une fine couche de gutta.
- Le compacteur chargé de gutta phase I est ensuite introduit dans la seringue contenant la gutta phase II, puis chargé d’une fine couche de gutta phase II.
- Le compacteur chargé des deux couches de gutta est introduit immédiatement, à l’arrêt, dans le canal jusqu’à une longueur déterminée.
- Le compacteur est actionné, maintenu en place quelques secondes (2 à 6 secondes en moyenne), puis remonté en direction coronaire.
- La gutta de haute viscosité occupe la région centrale du canal, tandis que la gutta-percha fluide est propulsée dans tous les diverticules et les anfractuosités canalaires. Il ne restera plus qu’à compacter manuellement l’entrée du canal.
3. Le système B : technique de compactage vertical centré en vague unique
Étapes :
- Choix du maître cône.
- Sélectionner et essayer le fouloir correspondant qui arrive, au maximum, à la longueur de travail moins 5 mm (LT – 5 mm).
- Le canal est ensuite séché à l’aide de pointes de papier stériles, et le ciment de scellement est introduit dans le canal à l’aide d’une broche. L’extrémité du cône est également badigeonnée.
- La température du système B est réglée à 200 °C et la puissance sur 10.
- Le cône de gutta-percha est sectionné à chaud au niveau de l’orifice canalaire, puis un fouloir manuel de compactage vertical est utilisé pour compacter à froid sur 1 ou 2 mm le cône de gutta-percha à l’entrée du canal, afin de créer un plateau.
- Le fouloir du système B chauffé est ensuite centré sur la surface de la gutta pour la compacter pendant 3 à 4 secondes, puis l’émission de chaleur est arrêtée.
- La pression verticale sur le fouloir reste maintenue jusqu’à ce que la profondeur repérée par le stop soit atteinte. La pression est maintenue avec le fouloir froid pendant 10 secondes afin de contrebalancer la rétraction de la gutta-percha au cours de son refroidissement.
- L’obturation de l’espace libre laissé par le fouloir peut se faire de plusieurs façons, parmi lesquelles l’injection de gutta-percha chaude à l’aide d’un pistolet à gutta. Cette technique, très rapide, donne d’excellents résultats ; elle est le complément idéal d’une préparation continue.
4. Le système Thermafil
Première étape :
- Choix du Thermafil : Un vérificateur du même diamètre que le dernier instrument de mise en forme est utilisé pour jauger le diamètre apical du canal.
- L’obturateur Thermafil est bloqué par un stop de silicone à la longueur de travail.
Deuxième étape : insertion de l’obturateur
- Élimination de l’excédent de gutta-percha coronaire à l’aide d’une lame de bistouri.
- Une pointe de papier ou une sonde droite sera utilisée pour apporter une légère quantité de ciment et badigeonner les parois du tiers coronaire du canal.
- L’obturateur est ensuite placé dans une cuve qui permet un préchauffage et une plasticité homogène de la gutta-percha.
- Le Thermafil est récupéré et inséré dans le canal par un mouvement lent, ferme et continu jusqu’à la longueur de travail repérée par le stop en silicone.
- Un fouloir manuel de compactage vertical est utilisé afin de compacter la gutta-percha autour du tuteur plastique au niveau coronaire.
Troisième étape : section de l’obturateur
- L’obturateur est sectionné à l’entrée du canal par une fraise « Thermacut » utilisée sur turbine sans eau.
- Pour la préparation d’un logement de tenon, celle-ci est réalisée dans la séance en utilisant une fraise « Post Space Bur », montée sur turbine sans spray, positionnée à l’entrée du canal, au contact du tuteur plastique, actionnée sur place pendant une à deux secondes de manière à ramollir le tuteur.
5. Technique Obtura
Cet appareil permet d’injecter directement dans le canal préparé, à l’aide d’une seringue munie d’un embout métallique, de la gutta-percha préalablement ramollie en phase plastique.
- On utilisera un ciment de scellement à prise lente en tant que lubrifiant pendant l’injection et la compaction de la gutta-percha.
- Pendant l’injection, on doit garder toute la pression sur la gâchette de l’appareil pour permettre à la gutta-percha de couler d’elle-même à l’extrémité de l’aiguille.
- On utilise un compacteur de type pluggers. Le compactage avec cette technique donne la sensation d’une consistance mastic ou de terre glaise sans beaucoup de résistance lorsqu’on pousse le fouloir à travers la masse.
6. Technique GuttaFlow®
Étapes :
- Choix du maître cône.
- Mise en place d’une capsule dans un mélangeur et insertion de celle-ci dans le pistolet.
- Introduire l’embout du pistolet à la longueur de travail moins 3 mm (LT – 3 mm).
- Appuyer sur la gâchette et faire monter l’embout en fur et à mesure que le matériau coule.
- Enduire le cône de gutta-percha avec du GuttaFlow® et l’insérer dans le canal.
7. Le système J.S. Quick-Fill®
Matériels et matériaux :
Utilise un compacteur en nickel-titane (NiTi) préfabriqué enrobé de gutta-percha phase alpha.
Technique :
- Choix de l’instrument.
- Positionnement de l’instrument à l’entrée canalaire.
- Mise en rotation de l’instrument.
- Enfoncement de l’instrument jusqu’à la longueur de travail moins 1 mm (LT – 1 mm).
- Retrait de l’instrument en rotation.
8. Le système Microseal®
Matériels et matériaux :
Utilise un cône de gutta-percha phase alpha, une pâte à base de gutta-percha phase alpha, et un compacteur.
Technique :
- Choix de l’instrument.
- Mise en place du maître cône jusqu’à la longueur de travail.
- Enrober le compacteur avec la pâte de gutta-percha préalablement chauffée.
- Introduire dans le canal le compacteur préalablement enrobé de gutta-percha jusqu’à la longueur de travail en rotation, puis le faire sortir en rotation également.
Voici une sélection de livres:
- Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché
- Concepts cliniques en odontologie conservatrice
- L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement
- Guide clinique d’odontologie
- Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve
- La photographie en odontologie: Des bases fondamentales à la clinique : objectifs, matériel et conseils pratique
Techniques d’obturation canalaire

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.

