PRISE EN CHARGE DES PATIENTS PRESENTANT UNE HEMOPATHIE
PRISE EN CHARGE DES PATIENTS PRESENTANT UNE HEMOPATHIE
Introduction
Le chirurgien-dentiste est un professionnel de la santé dont le champ d’action couvre l’ensemble de la sphère oro-faciale. Celle-ci peut être le siège d’un certain nombre d’affections pouvant avoir des conséquences sur l’état de santé générale. Inversement, des pathologies générales, notamment les hémopathies, peuvent présenter des manifestations au niveau de la cavité buccale. Par conséquent, celle-ci doit être examinée de façon méthodique en toutes circonstances.
Méthodes d’investigations biologiques
L’Hémogramme
L’hémogramme correspond à l’analyse quantitative des éléments figurés du sang (cellules et plaquettes). C’est un examen simple et automatisé (compteurs électroniques) permettant de chiffrer le nombre de globules blancs, de globules rouges et de plaquettes.
Le frottis sanguin permet de donner une estimation qualitative permettant d’établir la formule sanguine et dépister d’éventuelles anomalies morphologiques des cellules. Le frottis est une technique manuelle.
Hémogramme normal de l’adulte
Globules rouges
L’hémoglobine : L’hémoglobine (Hb) sanguine correspond à la quantité d’hémoglobine contenue dans 100 ml de sang. Elle varie en fonction du sexe et les valeurs normales sont :
- Chez l’homme : 13 à 18 g/dl
- Chez la femme : 12 à 16 g/dl
Le nombre de globules rouges : Il s’agit du nombre de globules rouges par mm³. Les valeurs normales sont :
- Chez l’homme : 4,2 à 5,7 millions par microlitre
- Chez la femme : 4,0 à 5,3 millions par microlitre
L’hématocrite : Il s’agit de la répartition (exprimée en %) des globules rouges par rapport au plasma, la quantité de globules blancs et de plaquettes ne rentrant pas en ligne de compte car en quantité très petite. Lorsque l’hématocrite est égal à 40 %, cela signifie que 100 ml de sang contient 40 ml de globules rouges et 60 ml de plasma.
Les valeurs normales sont :
- Chez l’homme : 40 à 52 %
- Chez la femme : 37 à 46 %
Le VGM : Comme l’hématocrite correspond à un volume, si on divise l’hématocrite par le nombre de globules rouges, on obtient le volume moyen des globules rouges. C’est le Volume Globulaire Moyen (VGM). Il est exprimé en µ³. Il s’agit d’une valeur moyenne, la taille des globules rouges pouvant varier (anisocytose).
Le VGM est normalement compris entre 80 et 100 µ³. Sous le seuil de 80, on parle de microcytose et au-dessus de 100 de macrocytose. Le VGM est actuellement mesuré directement par les appareils automatiques lors d’un hémogramme.
La CCMH : La concentration corpusculaire (ou globulaire) moyenne en hémoglobine (CCMH) correspond à la quantité d’hémoglobine contenue dans 100 ml de globules rouges. Ce paramètre est obtenu en faisant le rapport entre hémoglobine/hématocrite. Il est exprimé en gramme/100 ml ou en %. Les valeurs normales varient entre 32 et 36 %.
Lorsque la CCMH est inférieure à 32 %, on parle d’hypochromie. Au-dessus, on parle de normochromie. Le taux maximal de la CCMH est de 38 % (arrêt de la synthèse de l’hémoglobine dans l’érythroblaste à partir de ce taux).
La TCMH : Paramètre moins utile, la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine (TCMH) est calculée par le rapport hémoglobine/nombre de globules rouges contenus dans 100 ml de sang. Elle est normalement comprise entre 27 et 31 pg/GR.
Les réticulocytes : Ces cellules correspondent à des globules rouges très jeunes, visibles seulement avec certains colorants. Le nombre de réticulocytes est le reflet de la production érythroblastique. Il est exprimé en % avec des valeurs normales entre 0,5 et 1,5 % des hématies (soit 25 000 à 75 000/mm³). Ce chiffre permet de connaître le caractère régénératif (réticulocytes élevés) ou arégénératif (réticulocytes bas) d’une anémie.
Globules blancs
Le chiffre total de leucocytes : Le nombre normal des leucocytes varie entre 4 et 10 G/L. En dessous de 4000/mm³, on parle de leucopénie et au-dessus de 10000/mm³ d’hyperleucocytose.
La formule leucocytaire : On retrouve à l’état normal 5 types de leucocytes dans le sang. Leur taux est souvent exprimé en %, mais la valeur absolue est plus importante.
- Polynucléaires neutrophiles : Ils ont un rôle dans l’élimination par phagocytose des particules étrangères, en particulier les bactéries.
Chiffres normaux : 2000 à 7500/mm³ - Polynucléaires éosinophiles : Ils ont un rôle dans l’allergie et la lutte antiparasitaire.
Chiffres normaux : 100 à 500/mm³ - Polynucléaires basophiles : Ils ont un rôle dans l’hypersensibilité immédiate.
Chiffres normaux : 0 à 150/mm³ - Lymphocytes : Ils ont un rôle dans l’immunité cellulaire et humorale (synthèse d’anticorps).
Chiffres normaux : 1500 à 4000/mm³ - Monocytes : Ils ont un rôle dans la phagocytose et l’immunité.
Chiffres normaux : 200 à 1000/mm³
Plaquettes
Les plaquettes sont utiles à l’hémostase primaire (clou plaquettaire). Leur taux habituel varie de 150 000 à 450 000/mm³ (150 à 450 x 10⁹/L ou 150 à 450 G/L). Sous la valeur de 150 G/L, on utilise le terme de thrombopénie ; au-dessus de la valeur de 450 G/L, on parle de thrombocytose (ou d’hyperplaquettose).
Classification
Les hémopathies peuvent être groupées en quatre grands syndromes :
- Le syndrome hémorragique
- Le syndrome anémique
- Le syndrome leucocytaire non prolifératif
- Le syndrome prolifératif
Le syndrome hémorragique
Trouble de l’hémostase primaire
- Troubles liés aux désordres plaquettaires
- Troubles liés à une anomalie vasculaire
Troubles de la coagulation
- L’hémophilie
- Maladie de Willebrand
Troubles de l’hémostase primaire et secondaire
Thrombopénie
La thrombopénie est une diminution du nombre de plaquettes en dessous du seuil de 150 000/mm³ de sang.
Étiologies :
- Origine centrale : Par insuffisance de production médullaire
- Origine périphérique :
- Médicaments (AINS, héparine et pénicillines)
- Maladies infectieuses : VIH, VHB, VHC, EBV, CMV
- Maladies auto-immunes / lupus
Répercussions buccales :
| Taux de plaquettes (/mm³) | Manifestations buccales |
|---|---|
| > 80 000 | Pas de signe d’hémorragies |
| 50 000 – 80 000 | Purpura et gingivorragies occasionnels |
| 30 000 – 50 000 | Purpura, pétéchies, hématomes buccaux et gingivorragies |
| < 30 000 | Hémorragies profuses et incontrôlables localement |
Situations cliniques :
- Pour une thrombopénie à 100 000 plaquettes/mm³ :
Tous les soins sont possibles en respectant les précautions générales. - Pour une thrombopénie entre 50 000 et 100 000 plaquettes/mm³ :
- Pour des actes sans risque hémorragique :
- Soins conservateurs
- Soins prothétiques
- Anesthésie para-apicale, intraligamentaire ou intraseptale
- Détartrage supragingival
Il faut respecter les précautions générales.
- Pour des actes à risque hémorragique modéré :
- Une extraction dentaire en secteur localisé
- Pose d’implant unitaire
- Détartrage sous-gingival et surfaçage
Il faut respecter les précautions générales et le protocole d’hémostase locale.
- Pour des actes à haut risque hémorragique :
- Extraction de plus de 3 dents
- Chirurgie parodontale, mucogingivale, énucléation kystique et chirurgie apicale
- Extraction des dents temporaires
- Extraction des dents à parodonte altéré
- Extraction des dents incluses
- Biopsies et pose d’implants multiples
La prise en charge doit être spécialisée et hospitalière.
- Pour une thrombopénie en dessous de 50 000 plaquettes/mm³ :
Tout acte est contre-indiqué et la prise en charge doit être hospitalière.
Précautions vis-à-vis de l’anesthésie :
Pas de précautions particulières chez les patients présentant un taux de plaquettes supérieur à 50 000 plaquettes/mm³ de sang.
Précautions vis-à-vis des prescriptions :
La prescription des AINS, si nécessaire, doit être discutée avec le médecin traitant.
Hémophilie et maladie de Willebrand
Ce sont des pathologies qui résultent d’un déficit congénital en facteur de l’hémostase. Les gènes codant pour les facteurs VIII et IX sont situés sur le chromosome X, ce qui explique que l’hémophilie touche principalement les hommes.
- Facteur Willebrand et/ou facteur VIII : Pour la maladie de Willebrand
- Facteur VIII : Pour l’hémophilie A
- Facteur IX : Pour l’hémophilie B
Classification :
- Pour la maladie de Willebrand :
- Type 1 : Déficit quantitatif
- Type 2 : Déficit qualitatif
- Type 3 : Déficit sévère
- Pour l’hémophilie :
Elle peut être mineure, modérée ou sévère.
Répercussions buccales :
En fonction de la sévérité du déficit en facteur de coagulation, les répercussions peuvent aller de l’absence de saignement spontané à des hémorragies spontanées.
Précautions générales :
- Contact avec le médecin traitant
- Utiliser un vasoconstricteur
- En cas de saignement muqueux, assurer une compression locale à l’aide de compresses imprégnées d’acide tranexamique et mettre en place une gouttière non traumatisante.
Situations cliniques :
- Pour des actes non invasifs :
Ces soins peuvent être réalisés dans un cabinet, mais en respectant les précautions générales. - Pour les actes invasifs :
Discuter le cas avec l’hématologue et assurer une éventuelle substitution du facteur manquant.
Précautions vis-à-vis de l’anesthésie :
Pas d’anesthésie locorégionale.
Précautions vis-à-vis des AINS :
Ils sont contre-indiqués, mais si nécessaire, un avis de l’hématologue est requis.
Le syndrome anémique
L’anémie est caractérisée par une diminution du nombre de globules rouges, du volume érythrocytaire ou hématocrite et de la quantité d’hémoglobine présente dans le sang circulant. Le diagnostic d’anémie est, par définition, posé lorsque :
- La quantité d’hémoglobine passe en dessous de 12 g chez l’homme et 11 g chez la femme
- L’hématocrite est inférieur à 40 % chez l’homme et 37 % chez la femme
Risques par rapport à l’anémie :
- Saignement
- Infection
- Retard de cicatrisation
Manifestations buccales des anémies :
- Glossite
- Chéilite
- Pétéchies
- Ulcérations
- Paresthésies
Situations cliniques :
- Patient à risque faible :
- Antécédent d’anémie corrigée et hématocrite normal
- Anémie légère ne nécessitant pas de traitement avec hématocrite > 40 % chez l’homme
- Anémie associée à une maladie chronique avec hématocrite > 40 % chez l’homme
- Patient à risque élevé :
- Anémie non diagnostiquée
- Hématocrite < 40 %
- Coagulopathies associées
Précautions à prendre :
- Marge de sécurité de Hb ≥ 10 g/dl
- Antibiothérapie ou antibioprophylaxie en cas de risque infectieux
Les désordres leucocytaires prolifératifs / Neutropénie
Les leucémies
Les leucémies sont des proliférations malignes des tissus hématopoïétiques. Elles sont dues à des anomalies chromosomiques ou à des irradiations et expositions à certains composés chimiques. On distingue :
- Leucémies aiguës : Cancer des cellules souches du sang
- Leucémies chroniques : Cancer des lymphocytes B
Situations biologiques :
- Neutropénie discrète : 1000 à 2000 PNN/mm³
- Neutropénie modérée : 500 à 1000 PNN/mm³
- Neutropénie sévère : < 500 PNN/mm³
Manifestations cliniques :
- Pâleur des muqueuses
- Ulcérations virales et médicamenteuses
- Hyperplasie gingivale
- Gingivorragie
- Infections virales et fongiques
- Adénopathies cervicales
- Xérostomie
- Paresthésies
Situations cliniques et conduite à tenir :
Stratégie globale des soins en cas de leucopénie :
- Soins électifs : Attendre que la numération soit correcte
- Soins urgents : Sous antibiotiques en période de dépression sévère
Prise en charge d’un patient présentant une leucémie :
- Contact avec le médecin traitant
- Bilan d’hémostase (même pour le détartrage)
- Prévenir une infection post-opératoire par une prophylaxie anti-infectieuse
Si PNN < 500/mm³ :
- 2 g d’amoxicilline par voie orale 30 min avant l’acte, puis 500 mg toutes les 6 h durant le reste de la journée de l’intervention, ou
- 1 g de céphalexine 1 h avant, suivi de 250 mg toutes les 6 h pendant 1 semaine
- En cas d’allergie aux bêta-lactamines :
300 mg de clindamycine 1 h avant l’acte, puis 150 mg toutes les 6 h pendant 7 jours
Cas de leucémie avec greffe
- Chez le patient transplanté il y a moins de 3 mois :
- Bilan pré-opératoire
- Examen clinique et bilan radiologique
- Seuls les soins urgents seront réalisés
- Entre 3 mois et 1 an :
- Examen clinique
- Bilan radiologique
- Motivation à l’hygiène bucco-dentaire
- Au-delà de 1 an :
- En absence de rejet de la greffe : Les soins de routine seront faits
- En cas de rejet : Seuls les soins d’urgence seront faits
Voici une sélection de livres:
- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011
- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996
- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE
- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient
- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé
- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1
- Endodontie, prothese et parodontologie
- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020
- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005
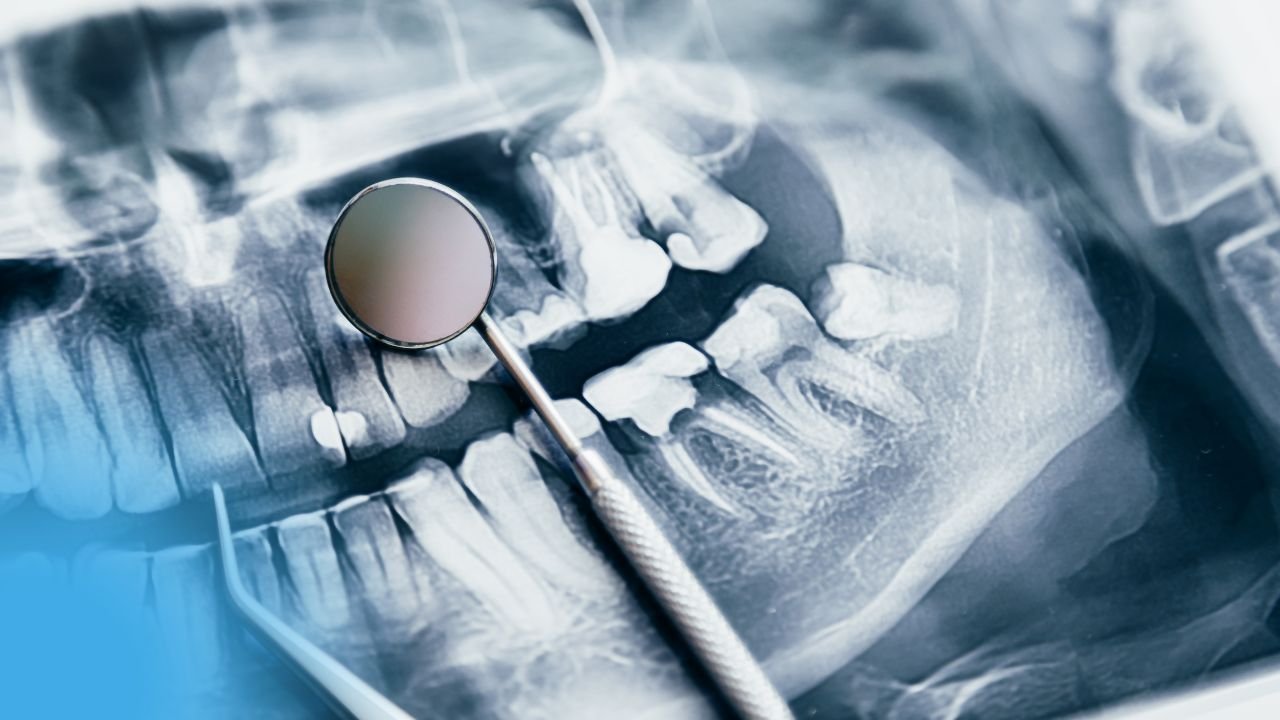

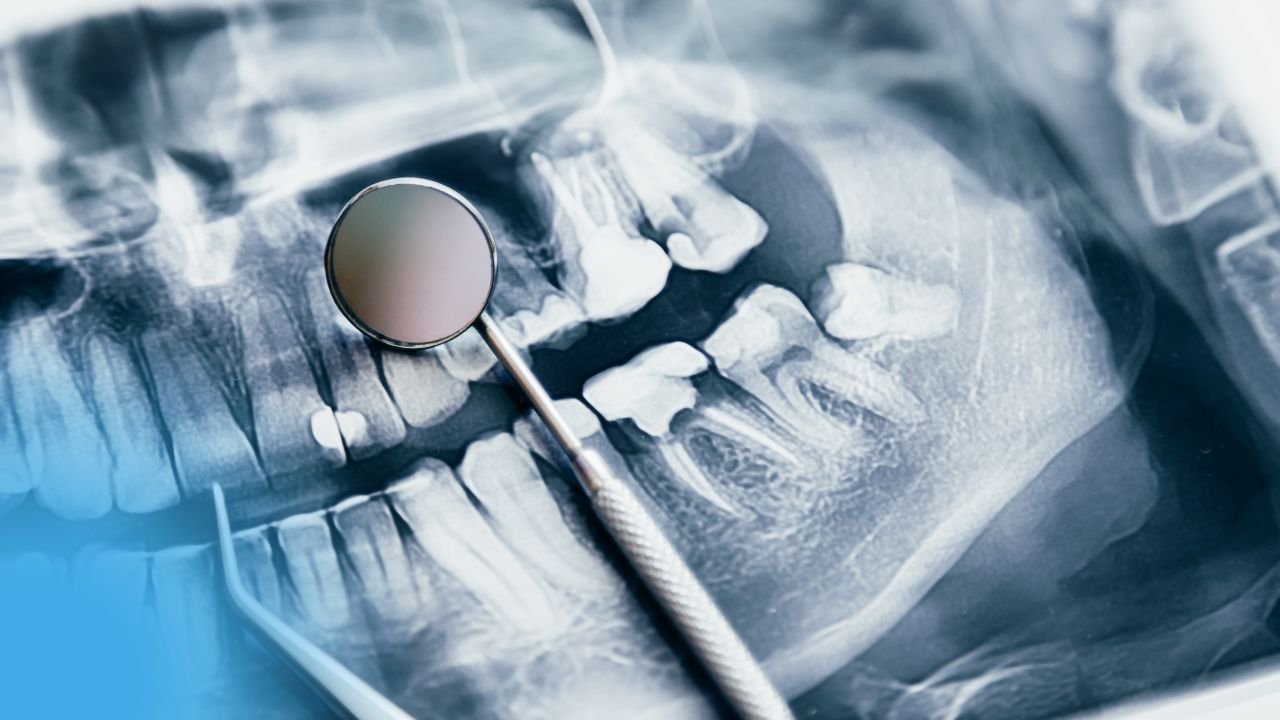

Leave a Reply