La chirurgie parodontale
La chirurgie parodontale.
La Chirurgie Parodontale
Introduction
La plupart des formes des maladies parodontales sont des troubles liés au biofilm bactérien. Le traitement chirurgical ne peut être considéré que comme un complément de la thérapeutique étiologique. Par conséquent, diverses méthodes chirurgicales devraient être jugées sur la base de leur aptitude à contribuer au contrôle de la plaque et à la préservation à long terme du parodonte.
Rappel sur le Parodonte Sain
La Santé Parodontale
Selon Claude Bernard : « Étape stable dans le temps de chacun des quatre tissus parodontaux qui adhérent et/ou s’attachent sur la face entière de la racine dentaire. »
N.B. : Tout état parodontal qui s’écarte de cette définition peut être considéré comme pathologique.
La Maladie Parodontale
Les parodontopathies regroupent toutes les affections atteignant le parodonte superficiel et profond.
Les Gingivopathies
Ce sont des affections atteignant le parodonte superficiel (gencive) sans destruction des structures parodontales profondes (fausse poche).
Les Parodontolyses
Ce sont des affections atteignant le parodonte profond avec destruction irréversible des tissus de soutien de la dent (vraie poche).
Étiologies des Maladies Parodontales
Triade de Weski : facteurs locaux, constitutionnels, généraux.
Généralités sur la Chirurgie Parodontale
Définition de la Chirurgie Parodontale
Par chirurgie parodontale, on entend toute intervention chirurgicale portant sur les tissus mous parodontaux et sur l’os alvéolaire.
Place de la Chirurgie Parodontale dans le Plan de Traitement
La chirurgie parodontale occupe une place précieuse dans le plan de traitement. Après la thérapeutique initiale et l’assainissement de la cavité buccale, suivi d’une phase de réévaluation, on décidera du passage à la thérapeutique chirurgicale dans la phase corrective.
Classification de la Chirurgie Parodontale
Classification de Kramer
- Zone kératinisée : curetage parodontal, gingivectomie, gingivoplastie.
- Zone muqueuse : freinectomie, lambeaux, greffes gingivales.
- Zone osseuse : ostéotomie, ostéoctomie, ostéoplastie, greffes d’os, substitutions.
En Fonction du Type de Chirurgie
- Réparatrice par incision.
- Réductrice par excision.
En Fonction de la Chronologie Thérapeutique
- Immédiate à chaud, ou après traitement étiologique.
En Fonction du Type de Cicatrisation
- Réattache par réparation : épithélium jonctionnel long, adhésion épithéliale ou conjonctive, pas de néocément ni de néoligament, peut-être un nouvel os ; sillon gingivodentaire plus profond que la normale.
- Nouvelle attache par régénération : épithélium jonctionnel court, néocément, néoligament, un nouvel os, sillon gingivodentaire court.
Objectifs de la Chirurgie Parodontale
- Meilleur accès aux surfaces radiculaires dans les poches profondes, surtout en cas de persistance de l’inflammation après traitement parodontal initial.
- Régénération du système parodontal détruit par la maladie parodontale.
- Correction pré-prothétique des sites parodontaux pour l’aménagement d’un environnement compatible avec les actes de dentisterie restauratrice et les reconstitutions prothétiques.
- Correction d’actes iatrogènes.
- Amélioration de l’esthétique.
Indications de la Chirurgie Parodontale
- Création d’un meilleur accès pour le surfaçage radiculaire.
- Zones d’accès difficiles pour l’hygiène bucco-dentaire (atteintes inter-radiculaires, particularités gingivales).
- Préparation parodontale avant restauration prothétique, chirurgie pré-prothétique.
- Correction de certains actes iatrogènes.
- Problèmes mucco-gingivaux (freins hypertrophiques, hypertrophie gingivale).
Contre-Indications de la Chirurgie Parodontale
Contre-Indications Relatives
- Patient non coopérant.
- Atteintes cardiovasculaires à risque moyen ou faible : HTA, angine de poitrine, traitement par anticoagulants (avis favorable du médecin traitant).
- Troubles hématologiques : formes modérées ou compensées d’anémie.
- Troubles hormonaux.
- Diabète sucré : patients déséquilibrés (régime alimentaire irrégulier, traitement d’insuline inadapté).
Contre-Indications Absolues
- Atteintes cardiovasculaires à haut risque (prothèses valvulaires, valvulopathies, cardiopathies congénitales).
- Troubles hématologiques (leucémie aiguë, agranulocytose, lymphogranulomatose).
- Troubles neurologiques (sclérose en plaques, Parkinson).
- Radiothérapie cervico-faciale.
Principes Généraux de la Chirurgie Parodontale
La préparation lors de la thérapeutique initiale doit être complétée par :
- Un bilan sanguin.
- La préparation psychologique du patient.
- La préparation médicale.
- Le respect des règles d’asepsie.
Les principes généraux des différentes techniques chirurgicales consistent à :
- Anesthésie : locale ou locorégionale (avec ou sans vasoconstricteur).
- Incision.
- Décollement : délicatement (risque de déchirure).
- Élimination parfaite des tissus pathologiques.
- Sutures : pas de traction, ni de déchirure des tissus.
- Utilisation de pansement parodontal : protection de la plaie.
- Prescription médicamenteuse.
- Conseils postopératoires.
Différents Types d’Interventions Chirurgicales
Chirurgie de la Poche
Curetage Parodontal
Définition : Débridement et excision au moyen d’une curette du tissu de granulation constituant la partie interne de la paroi gingivale de la poche, ainsi que de l’épithélium de jonction et du tissu conjonctif supra-crestal enflammé. Le curetage est accompagné de surfaçage radiculaire.
Indications (devenues rares) :
- Poches peu profondes (prolongement du surfaçage radiculaire).
- Préparation à une chirurgie plus profonde dans les cas complexes.
- En cas d’abcès parodontal, le curetage accélère la guérison.
Contre-Indications :
- Poches profondes.
- Gencives de consistance fibreuse.
La Gingivectomie
Définition : Technique chirurgicale la plus ancienne, son principal objectif est de supprimer les tissus mous constituant les parois de la poche parodontale. La gingivectomie est destinée au remodelage de la gencive pour lui donner une morphologie esthétique et fonctionnelle. Deux types de gingivectomie selon le type d’incision : GBE (gingivectomie à biseau externe) et GBI (gingivectomie à biseau interne).
Indications :
- Hyperplasie et hypertrophie gingivales (inflammatoire, hormonale, médicamenteuse, respiratoire, congénitale).
- Hyperplasies associées à des poches parodontales supra-osseuses peu profondes.
Contre-Indications :
- Poches infra-osseuses.
- Poches supra-osseuses dépassant la ligne mucco-gingivale.
- Insuffisance de gencive attachée.
- Gencive molle.
- Défauts osseux.
L’E.N.A.P (Excisional New Attachment Procedure)
Définition : Curetage parodontal effectué avec une lame de bistouri (décrite par Yukna en 1976). Intermédiaire entre curetage à l’aveugle et curetage à ciel ouvert.
Indications :
- Poches peu profondes, surtout au secteur antérieur (limite les récessions).
Interventions à Lambeau
Définition : L’intervention à lambeau consiste à soulever un volet tissulaire libéré par des incisions afin d’accéder aux structures radiculaires et osseuses sous-jacentes. Sa base reste solidarisée aux tissus sous-jacents et assure l’apport vasculaire. Il peut intéresser l’épithélium, le chorion et le périoste (lambeau mucco-périosté de pleine épaisseur) ou être disséqué dans l’épaisseur du tissu conjonctif (lambeau muqueux ou d’épaisseur partielle).
Indications :
- Accessibilité suffisante aux surfaces radiculaires pour un débridement correct.
- Élimination des poches supérieures à 5 mm qui ne répondent pas suffisamment au traitement initial.
- Poches infra-osseuses.
- Épaississement accentué du rebord osseux (traitement des lésions osseuses).
- Hémisection dentaire avec traitement des structures adjacentes (traitement des lésions inter-radiculaires).
Contre-Indications :
- Tuméfaction et hyperplasie gingivale.
- Rapport corono-radiculaire clinique très défavorable.
- Dents mobiles avec perte d’attache importante.
- Accès difficile.
Lambeau Repositionné Apicalement
Définition : L’incision est à biseau interne et déplacée apicalement par rapport à sa situation initiale. Les sutures sont réalisées sur la crête osseuse ou légèrement coronairement.
Indications :
- Hauteur de gencive kératinisée égale ou inférieure à 3 mm.
- Poches parodontales peu profondes.
Contre-Indications :
- Poches parodontales dans les secteurs esthétiques.
- Défauts intra-osseux profonds.
- Patients à risque élevé de caries.
- Hyperesthésies sévères.
- Dents avec mobilité et perte d’attache importantes.
- Rapport corono-radiculaire clinique très défavorable.
Lambeau de Neumann (1926)
Définition : Intéresse le bloc incisivo-canin supérieur et vise à ménager un accès aux lésions palatines très fréquentes à ce niveau. Incisions intrasulculaires vestibulaires et inter-dentaires, ainsi que des incisions semi-lunaires palatines, permettent le soulèvement du tissu inter-dentaire gingival.
Lambeau d’Accès Palatin
Définition : Vise à ménager un accès aux lésions palatines.
Chirurgie Mucco-Gingivale
Définition : La chirurgie mucco-gingivale est définie comme étant « l’ensemble des techniques chirurgicales parodontales visant à corriger les défauts de morphologie, position et/ou la quantité du tissu gingival qui borde la dent ».
Freinectomie/Freinotomie
Définition :
- Freinectomie : Ablation totale du frein suivie d’une désinsertion des fibres musculaires.
- Freinotomie : Ablation partielle du frein, dissection du frein de l’apex à la base.
Vestibuloplastie
Définition : Augmentation de la profondeur d’un vestibule peu profond afin de supprimer toute tension au niveau de la gencive marginale et obtenir une hauteur suffisante de gencive attachée, facilitant ainsi une hygiène et un brossage adéquat.
Indications :
- Pratiquée exclusivement dans le secteur incisivo-canin inférieur, s’étendant parfois aux prémolaires.
- Vestibule court associé à une brièveté généralisée du système d’attache sans dénudation radiculaire importante.
Techniques des Lambeaux
Lambeau Déplacé Latéralement
Définition : Technique chirurgicale destinée à recouvrir et/ou stabiliser les dénudations radiculaires. La gencive est déplacée (mouvement de rotation) et suturée sur la zone à traiter.
Indications :
- Préjudice esthétique.
- Hyperesthésie.
- Lésion évolutive.
- Manque de gencive adhérente.
Contre-Indications :
- Présence d’inflammation.
- Hygiène incorrecte.
- Absence de problème esthétique.
- Absence d’hyperesthésie.
Lambeau Bi-Papillaire
Définition : Technique décrite par Nelson en 1987. C’est un double lambeau de translation latérale associé ou non à l’emploi d’un greffon conjonctif.
Lambeau Déplacé Coronairement
Définition : Intervention qui consiste à déplacer en direction coronaire le tissu gingival présent apicalement au site à traiter.
Lambeau Semi-Lunaire
Définition : Technique décrite par Tarnow en 1986. C’est une variante du lambeau déplacé coronairement.
Techniques des Greffes
Greffes Épithélio-Conjonctives
Définition : Transplantation autogène d’un tissu muqueux d’un site donneur à un site receveur. Technique décrite par Björn en 1963, consistant en la mise en place au niveau de la zone à traiter d’un greffon épithélio-conjonctif prélevé au palais.
Greffes Conjonctives Enfouies
Définition : Intervention chirurgicale consistant en un prélèvement de greffon dans l’épaisseur du palais ou à la tubérosité maxillaire, qui sera fixé sous un lambeau. Technique fondée sur la spécificité et l’induction propres au tissu conjonctif. Historiquement, l’utilisation de greffes conjonctives a été proposée afin d’améliorer les résultats esthétiques des interventions par rapport à ceux obtenus avec des greffes épithélio-conjonctives.
Techniques Avancées
Régénération Tissulaire Guidée
Objectifs : La régénération tissulaire guidée a pour but de reconstituer l’ensemble du système d’attache, à la différence des autres techniques qui favorisent une réparation, avec création d’un long épithélium de jonction au contact de la surface radiculaire.
Indications : L’utilisation d’une membrane limite cette technique à des récessions unitaires, en présence de tissus épais pouvant être tractés coronairement. L’objectif est double : régénération du système d’attache et recouvrement de la récession.
Chirurgie Osseuse
Définition
Le terme de chirurgie osseuse se rapporte à des procédés chirurgicaux pratiqués sur l’os dans le but de le remodeler ou de le restaurer. Elle vise à la correction des lésions osseuses provoquées par les parodontolyses ou par une déformation anatomique.
Buts de la Chirurgie Osseuse
- Recherche d’une architecture osseuse idéale aboutissant à une anatomie physiologique des tissus osseux et gingivaux.
- Réduction drastique de la profondeur des poches.
- Meilleur contrôle de l’hygiène orale personnelle.
Différentes Techniques Thérapeutiques
Technique par Soustraction (Chirurgie Osseuse Résectrice)
Les techniques résectrices englobent l’ostéoplastie et l’ostéotomie, qui comprennent un remodelage de l’os alvéolaire avec ablation ou élimination de l’os de soutien. Contrairement à l’ostéoplastie, qui ne nécessite pas l’élimination de l’os et permet une harmonisation des contours en restant économe du tissu osseux.
Techniques de Reconstruction ou de Comblement
- Sans apport : Les techniques régénératrices font appel au débridement et au curetage des lésions. Prichard a démontré que certaines lésions osseuses étaient susceptibles de se régénérer sans apport chirurgical, mais par simple curetage de la lésion.
- Avec apport : Le principe consiste à déposer, après curetage de la lésion, un matériau de comblement susceptible d’augmenter le potentiel de régénération des tissus parodontaux de façon à favoriser une reconstitution osseuse et la formation d’une nouvelle attache.
Association RTG + Greffe Osseuse :
- Empêcher l’effondrement de la membrane dans la lésion.
- Maintien d’un espace cicatriciel conséquent.
- La néoformation osseuse pourrait être améliorée.
Régénération Osseuse Guidée (ROG) :
Lors d’une ROG, les défauts osseux sont recouverts d’une membrane adaptée précisément à la surface osseuse. Les cellules non osseuses sont exclues. Les ostéoblastes provenant du périoste et de l’os sont conduits sur la surface osseuse pour y faciliter la néoformation osseuse.
Les Sutures
Définition : La suture est le moyen par lequel le fil passe d’un point à l’autre, le point étant celui par lequel l’aiguille entre en rapport avec le tissu en le transperçant (Pasqualini et Gallini, 1989).
Objectifs :
- Recouvrir l’os alvéolaire, inter-dentaire ou crestal par les tissus mous.
- Rapprocher les berges muqueuses pour favoriser la cicatrisation et réduire les complications postopératoires.
La Cicatrisation
Selon Bouchard et Etienne (1993) : La guérison d’une plaie est représentée par l’ensemble des phénomènes biologiques qui conduisent à la réparation du tissu concerné, réalisant sa continuité, avec restitution de sa morphologie et de sa fonction.
Conclusion
Les praticiens se doivent de connaître les différentes indications et contre-indications des techniques chirurgicales afin de pouvoir décider de la meilleure démarche à suivre pour chaque cas et éviter les échecs dans les cas défavorables.
Voici une sélection de livres:
- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011
- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996
- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE
- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient
- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé
- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1
- Endodontie, prothese et parodontologie
- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020
- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005



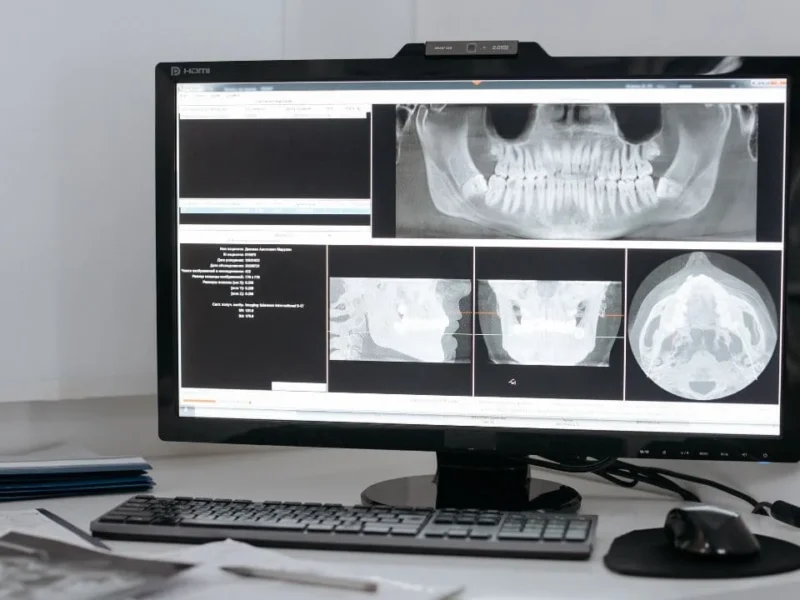
Leave a Reply